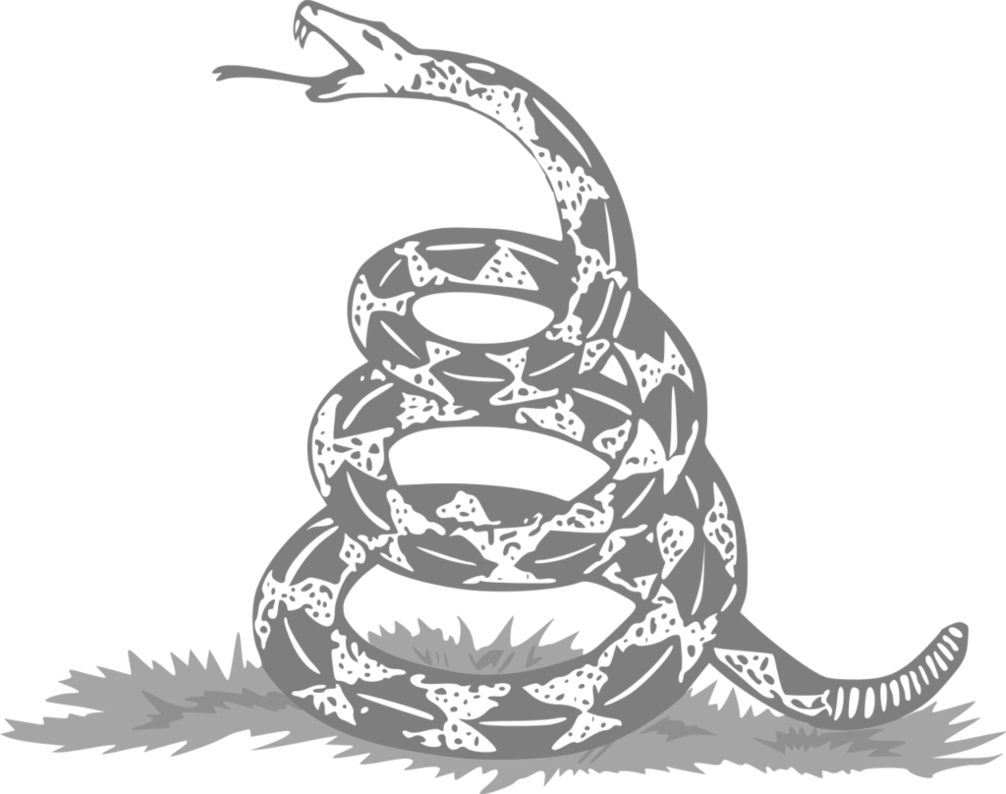The Pretence of Knowledge
Présentation
« The Pretence of Knowledge » est le discours d’acceptation du Prix Nobel d’économie reçu par Friedrich Hayek le 11 décembre 1974.[1]
Commentaire sur le titre
Le mot pretence (pretense en anglais américain) peut correspondre à deux mots proches en anglais, qui correspondent aux deux traductions possibles en français :
La nuance entre les deux sens est particulièrement pertinente pour comprendre les nuances de l’argument anti-constructiviste, notamment entre Hayek et les libéraux contemporains.
C’est à dire : Hayek voulait dire plutôt prétention, mais les libéraux qui l’ont suivi dans la critique du constructivisme ont retenu plutôt prétexte. Cependant, les deux aspects sont pertinents :
- Les constructivistes prétendent avoir la connaissance nécessaire pour planifier la société (arrogance, erreur ou mensonge de prétendre connaître quelque chose qu’ils ne connaissent pas (et ne peuvent pas connaître, dirait Mises !);
- Les constructivistes se servent de la connaissance (qu’ils prétendent avoir) comme prétexte pour prétendre avoir le droit de planifier la société, alors que ce n’est pas la vraie raison (ils le feraient, ou le font déjà, même s’ils ne l’avaient pas) et/ou que ce n’est pas une raison valable (non sequitur : la connaissance en tant que telle ne leur donne aucun droit de prendre les décisions à la place des individus concernés).
Une traduction précise serait alors Le prétexte prétentieux de la connaissance[6].
Voir aussi
- Friedrich Hayek
- Humanisme et constructivisme
- Impossibilité du calcul économique en régime socialiste
- L’utilisation de l’information dans la société par Friedrich Hayek
Traduction
La Falsification de la science par Friedrich Hayek
Conférence à la mémoire d’Alfred Nobel, le 11 Décembre 1974
L’occasion particulière de cette conférence, de même que le principal problème pratique auquel les économistes sont aujourd’hui confrontés, ont rendu le choix de son sujet presque inévitable.
D’un côté, la création encore récente du prix à la Mémoire d’Alfred Nobel en Sciences économiques marque une étape importante dans le processus au cours duquel, de l’avis du grand public, on a attribué à l’économie une partie de la dignité et du prestige des sciences physiques.
De l’autre, on fait aujourd’hui appel aux économistes pour qu’ils disent comment le monde libre pourrait parer la menace d’une inflation qui s’accélère — et que l’on doit, il faut l’admettre, à des politiques que la majorité des économistes avaient recommandées aux hommes de l’état, voire les y avaient instamment poussés.
Nous avons certes en ce moment peu de raison de nous vanter : en tant que profession, c’est la pagaille que nous avons installée.
Il me semble que cette incapacité des économistes à mieux guider les politiques est étroitement liée à leur propension à imiter d’aussi près que possible les procédures des sciences physiques avec leurs éclatants succès — entreprise, qui dans notre domaine, peut conduire à l’erreur pure et simple. C’est là une approche qu’on en est venu à décrire comme la démarche « scientiste » - attitude qui, comme je l’ai qualifiée il y a trente ans,
« est carrément non scientifique, dans le vrai sens du mot, parce qu’elle consiste à met en oeuvre sans réflexion ni démarche critique des modes de pensée à des domaines différents de ceux où s’étaient formés [1]. »
Aujourd’hui, j’entends d’abord expliquer comment il se fait que certaines des erreurs les plus graves de la politique économique récente sont une conséquence directe de cette erreur scientiste.
Depuis trente ans, la théorie qui inspire les politique monétaires et budgétaites, et dont je soutiens qu’elle est en grande partie le produit de cette conception erronée de la procédure scientifique, consiste dans l’affirmation comme quoi il existerait une corrélation positive entre l’emploi total et le volume de la demande globale de biens et de services ; celle-ci conduit à la croyance comme quoi nous pourrions en permanence assurer le plein emploi en maintenant l’ensemble des dépenses en monnaie à un niveau approprié. En outre, parmi les diverses théories avancées pour rendre compte d’un chômage massif, celle-ci est probablement la seule pour laquelle on peut mettre en avant de solides observations quantitatives.
Je ne l’en considère pas moins comme fondamentalement fausse, et l’intervention qui s’en inspire, ainsi que comme nous l’éprouvons désormais, comme tout à fait nuisible. Ce qui m’amène à la question cruciale. Contrairement à la situation qui existe dans les sciences physiques, en économie et autres disciplines qui traitent essentiellement de phénomènes complexes, les aspects des événements à expliquer pour lesquels nous pouvons obtenir des données quantitatives sont nécessairement limités et pourraient bien ne pas compter parmi les plus importants. Alors que, dans les sciences physiques on suppose généralement, sans doute avec juste raison, que tout facteur important qui détermine les événements observés sera lui-même directement observable et mesurable, dans l’étude de phénomènes complexes comme le marché, qui dépendent de l’action de nombreux individus, toutes les circonstances qui détermineront le résultat d’un processus, pour des raisons que je vais expliquer plus loin, ne pourront presque jamais être entièrement connues ni mesurables.
Or, tandis que dans les sciences physiques le chercheur sera capable de mesurer ce qui, sur la base d’une théorie à première vue, il estime important, dans les sciences sociales ce que l’on traite comme important est souvent ce qui se trouve à être accessible à la mesure. On pousse parfois ce parti pris à tel un point que l’on exige que nos théories soient formulées en des termes tels que celles-ci se réfèrent uniquement à des grandeurs mesurables. On peut difficilement nier qu’une telle exigence limite tout à fait arbitrairement les faits qu’il y a lieu d’admettre comme des causes possibles pour les événements qui se produisent dans le monde réel.
Cette opinion, dont on admet souvent très naïvement qu’elle serait voulue par la procédure scientifique, a des conséquences plutôt paradoxales. Nous savons, bien sûr, à propos du marché et autres formations sociales similaires, un très grand nombre de faits que nous ne pouvons pas mesurer et à propos desquels nous n’avons qu’une information très imprécise et générale. Et comme, dans n’importe quelle situation particulière, les effets de ces réalités-là ne peuvent pas être confirmées par des observations quantitatives, ils sont tout simplement méconnus par ceux qui ont juré de n’admettre que ce qu’ils considèrent comme des preuves scientifiques : ceux-ci poursuivent alors joyeusement à partir de la fiction comme quoi les facteurs qu’ils peuvent mesurer seraient les seuls qui sont pertinents.
La corrélation entre la demande globale et l’emploi total, par exemple, peut n’être qu’approximative, mais comme elle est la seule pour laquelle nous ayons des données quantitatives, on l’admet comme le seul lien de causalité qui compterait. D’après cette norme, il pourrait ainsi exister de bien meilleures « preuves scientifiques » pour une théorie fausse, que l’on acceptera parce qu’elle est plus « scientifique », que pour une explication valable, que l’on rejettera parce qu’il n’y a pas assez de données quantitatives pour l’appuyer.
En tant que profession, les économistes ont fait un beau gâchis. Permettez-moi d’illustrer cela par un bref aperçu de ce que je considère comme la principale cause réelle du chômage massif – une explication qui rendra également compte des raisons pour lesquelles un tel chômage ne peut être durablement guéri par les politiques inflationnistes que recommande la théorie aujourd’hui à la mode.
L’explication correcte en question me semble être l’existence de désajustements entre la distribution des demandes entre les différents biens et services et la répartition de la main-d’oeuvre et autres ressources entre les lignes de fabrication de ces produits. Nous possédons une assez bonne connaissance « qualitative » des forces qui permettent de réaliser une correspondance entre les offres et les demandes dans les différents secteurs du système économique, des conditions dans lesquelles elle se réalisera, ainsi que des facteurs susceptibles de prévenir de tels ajustements. Les différentes étapes dans l’explication de ce processus s’appuient sur des faits de l’expérience quotidienne, et il y a peu de gens qui, ayant pris la peine de suivre l’argument en question, contesteront la réalité des hypothèses factuelles, ou la validité logique des conclusions qu’on en tire.
Nous avons en effet de bonnes raisons de croire que le sous-emploi est une indication du fait que la structure des prix et des salaires a été faussée (en général par des ingérences monopolistiques ou étatiques dans la fixation des prix) et que, pour rétablir l’égalité entre les offres et les demandes de travail dans l’ensemble des secteurs, il faudra que les prix relatifs s’ajustent et qu’une partie de la main-d’œuvre passe d’un emploi à l’autre. Cependant, lorsqu’on nous demande des données chiffrées décrivant la structure particulière des prix et des salaires qui devraient exister pour assurer un écoulement régulier et continu des produits et services offerts, nous devons admettre que cette information-là, nous ne l’avons pas . Nous savons, en d’autres termes, à quelles conditions générales ce que nous appelons, de manière un peu trompeuse, un équilibre, va se réaliser, mais nous ne savons jamais quels sont les prix ou les salaires qui existeraient si le marché devait amener un tel équilibre. Tout ce que nous pouvons dire, c’est à quelles conditions nous pouvons attendre du marché qu’il fixe des prix et des salaires pour lesquels les demandes seront égales aux offres. En revanche, nous ne pourrons jamais produire l’information statistique qui montrerait dans quelle mesure le prix et les salaires existants diffèrent de ceux qui permettraient d’assurer des débouchés réguliers aux offres de travail telles qu’elles se présentent maintenant.
Cette description des causes du chômage est une théorie empirique — dans le sens où on pourrait imaginer une observation qui la réfuterait — par exemple si, avec une quantité de monnaie constante, une hausse générale des salaires ne provoquait pas de chômage, mais ce n’est certainement pas le type de théorie dont on pourrait se servir pour obtenir des prédictions numériques spécifiques sur les taux de salaire, ou la répartition des effectifs, auxquels y a lieu de s’attendre. Pourquoi faut-il donc, cependant, que nous ayons en économie à déclarer forfait sur des faits à propos desquels, s’agissant d’une théorie physique, on attendrait certainement d’un savant qu’il livre des informations précises? Il n’est sans doute pas surprenant que ceux qu’impressionne l’exemple des sciences physiques trouvent cette situation-là frustrante et continuent d’exiger les niveaux de preuve qu’ils sont habitués à y trouver.
La raison de cet état de choses est le fait, que j’ai déjà brièvement évoqué, que les sciences sociales, comme une grande partie de la biologie mais à la différence de la plupart des domaines de la science physique, doivent traiter de structures essentiellement complexes, c’est-à-dire de structures dont les caractéristiques ne peuvent se représenter par des modèles que si ceux-ci possèdent un nombre de variables assez considérable. La concurrence, par exemple, est un processus qui ne produira certains résultats que s’il implique un assez grand nombre d’acteurs individuels. On peut surmonter ces difficultés dans certains domaines, notamment là où des problèmes de même nature se sont posés dans les sciences de la nature, en utilisant, à la place des informations spécifiques sur les différents éléments, des données sur la fréquence ou la probabilité d’apparition des différentes caractéristiques de ces éléments. Ce n’est vrai, cependant, que là où nous avons affaire à ce que le Dr Warren Weaver (ancien de la Fondation Rockefeller) appelle, dans une distinction qu’on devrait vraiment saisir plus souvent, des « phénomènes de complexité non organisée », par opposition à ces « phénomènes de complexité organisée », auxquels les sciences sociales nous confrontent[2]..
Ce que veut dire ici complexité organisée, c’est que le caractère des structures qui présentent celle-ci dépend non seulement des propriétés des différents éléments qui les constituent, et de la fréquence relative avec laquelle celles-ci apparaissent, mais aussi de la manière dont ces différents éléments sont liés les uns avec les autres. C’est pour cette raison-là que, pour expliquer comment fonctionne ce genre de structures, on ne peut pas se contenter de remplacer les informations sur chacun de leurs éléments distincts par une information statistique : cette explication-là exige une information complète sur chacun de ces éléments, si nous voulons déduire de notre théorie des prédictions précises quant à des événements singuliers. Si nous n’avons pas ce genre d’informations spécifiques sur les éléments individuels, nous en serons réduits à ce que, à une autre occasion, j’ai appelé des prévisions de structure (pattern predictions) - qui prédiront certaines des caractéristiques générales des structures qui vont se former, mais ne contiendront aucun énoncé spécifique sur les élément individuels dont ces structures-là sont faites[3]..
C’est particulièrement vrai de nos théories qui rendent comptent de la formation des systèmes de prix et salaires relatifs sur un marché qui fonctionne bien. Entreront dans la détermination de ces prix et salaires les conséquences de certaines informations détenues par chacun des participants au processus du marché - une masse de faits qu’aucun observateur scientifique, ni aucun autre cerveau, ne peut connaître dans leur intégralité. Et c’est bel et bien ce qui fonde la supériorité de l’ordre du marché et la raison pour laquelle, lorsque les pouvoirs étatiques ne le répriment pas, celui-ci supplante régulièrement les autres types d’ordre : l’affectation des ressources qui s’ensuit aura utilisé plus d’information sur les faits particuliers qu’aucun individu ne peut en posséder, cette information-là n’existant que dispersée entre d’innombrables personnes. Et c’est justement parce que cela nous empêche, nous les savants qui observons tout cela, de jamais connaître l’ensemble des déterminants d’un ordre ainsi constitué, que nous ne pouvons pas non plus savoir pour quelle structure de prix et de salaires les demandes seraient partout égales aux offres, ni mesurer les écarts par rapport à cet ordre-là ; et que nous ne pouvons pas davantage tester statistiquement notre théorie selon laquelle ce sont les écarts par rapport à ce système « d’équilibre » du système des prix et des salaires qui font qu’il est impossible de vendre une partie des produits et des services aux prix auxquels ils sont offerts.
« Cette incapacité des économistes à mieux guider les politiques est étroitement liée à leur propension à imiter d’aussi près que possible les procédures des sciences physiques, avec leurs éclatants succès. »
Avant de poursuivre sur mon propos immédiat, l’effet de tout cela sur les politiques de l’emploi que l’on mène aujourd’hui, permettez-moi de définir plus précisément les limites intrinsèques de nos connaissances numériques, que l’on néglige si souvent. Je veux le faire pour éviter de donner l’impression que je rejette la méthode mathématique en économie. Je considère en fait que le grand avantage de la technique mathématique est que celle-ci nous permet de décrire, par des équations algébriques, le caractère général d’une structure, même si nous sommes ignorants des valeurs numériques qui détermineront sa manifestation particulière. Nous aurions difficilement pu obtenir cet image complète des interdépendances mutuelles sur un marché sans cette technique algébrique.
Celle-ci n’en a pas moins conduit à l’illusion comme quoi on pourrait s’en servir pour déterminer et prévoir les valeurs numériques de ces grandeurs, et cela a conduit à une recherche de constantes quantitatives ou numériques qui est vouée à l’échec. Cela s’est produit en dépit du fait que les fondateurs de l’économie mathématique moderne n’entretenaient pas de telles illusions. C’est vrai que les systèmes d’équations qui décrivent le réseau d’un équilibre de marché sont formulés de telle manière que, si nous pouvions remplir toutes les cases vides de leurs formules abstraites, c’est-à-dire, si nous connaissions tous les paramètres de ces équations, nous pourrions calculer les prix et les quantités de toutes les marchandises et services échangés. Cependant, comme Vilfredo Pareto, l’un des fondateurs de cette théorie, l’avait nettement fait savoir, son objet ne peut pas être « d’obtenir un calcul numérique de ces prix », parce que, comme il l’a dit, il serait « absurde » de penser que nous puissions nous assurer de l’ensemble des données[4]. Et fait, l’essentiel était déjà compris de ces remarquables précurseurs de la théorie économique contemporaine qu’étaient les Scolastiques espagnols du XVIème siècle, qui soulignaient que ce qu’ils appelaient le pretium mathematicum, ou « prix mathématique », dépend d’un si grand nombre de circonstances particulières qu’il ne pourrait jamais être connu de l’homme, mais n’est connu que de Dieu[5]. Il m’arrive de souhaiter que nos économistes mathématiciens se pénètrent de cela.
Je dois avouer que je ne suis toujours pas persuadé que leur recherche de grandeurs mesurables ait apporté des contributions notables à notre compréhension théorique des phénomènes économiques - par opposition à leur valeur en tant que description de situations particulières. Je ne suis pas non plus disposé à accepter l’excuse comme quoi cette branche de la recherche serait encore très jeune : après tout Sir William Petty, fondateur de l’économétrie, n’était-il pas quelque peu l’aîné de Sir Isaac Newton à la Royal Society ?
Il pourrait y avoir peu de cas où la superstition comme quoi seules les grandeurs mesurables pourraient avoir de l’importance a causé des dommages décisifs dans le domaine économique ; mais les problèmes actuels de l’inflation et du chômage en représentent un, qui est très grave. Son effet a été que ce qui est probablement la cause véritable d’un chômage important a été écarté par la majorité scientiste des économistes, parce que sa manière d’opérer ne peut pas être confirmée par des relations directement observables entre grandeurs mesurables, de sorte qu’une concentration presque exclusive sur des phénomènes de surface quantitativement mesurables a produit une politique qui a fait empirer les choses.
Il faut, bien entendu, admettre d’emblée que le type de théorie que je considère comme la véritable explication du chômage est une théorie au contenu quelque peu limité, car elle nous permet de ne faire que des prédictions très générales, sur le type d’événements auxquels nous devons nous attendre à dans une situation donnée. Mais les effets sur la politique des construction plus ambitieuses n’ont pas été très heureuses et je dois avouer que je préfère une connaissance vraie mais imparfaite, même si elle en laisse beaucoup à l’indétermination et l’imprévisibilité, à un simulacre de connaissance exacte qui a des chances d’être fausse.
Le crédit que l’apparente conformité avec les normes scientifiques reconnues peuvent valoir à des théories apparemment simples mais fausses peut, comme le montre la situation présente, avoir de graves conséquences.
En fait, dans le cas qui nous occupe, ce sont les mesures mêmes que la théorie « macroéconomique » dominante avait recommandées comme remède au chômage – à savoir, accroître la demande globale – qui sont devenues la cause d’une mauvaise allocation des ressources, très étendue et qui risque à terme de rendre inévitable un chômage massif.
L’injection continuelle de nouvelles sommes d’argent à certains points du système économique, où celle-ci provoque une demande temporaire qui doit cesser lorsque l’augmentation de la quantité de monnaie s’arrête ou ralentit, en même temps qu’on s’attend à un accroissement continu des prix correspondants, attire la main-d’œuvre et autres ressources vers des emplois qui ne peuvent durer que tant que l’accroissement de la quantité de monnaie se poursuit au même rythme – voire continue d’accélérer à un rythme donné.
Ce que cette politique a produit, ce n’est pas tant un niveau d’emploi qu’on n’aurait pas pu obtenir autrement qu’une distribution des emplois qu’on ne peut pas indéfiniment maintenir et qui, au bout d’un certain temps, ne pourrait s’entretenir qu’au prix d’un taux d’inflation qui conduirait rapidement à une désorganisation totale de l’activité économique.
Le fait est que c’est une erreur d’interprétation théorique qui nous a conduits à cette situation précaire, où nous ne pouvons pas empêcher un chômage important de réapparaître, non pas parce que, comme on présente parfois faussement ce point de vue, il faudrait délibérément provoquer ce chômage comme moyen de lutter contre l’inflation, mais parce que celui-ci doit désormais forcément se produire comme conséquence des erreurs du passé, conséquence profondément regrettable mais inévitable dès lors que l’inflation cesse de s’accélérer.
Toutefois, il me faut maintenant laisser de côté ces problèmes d’importance pratique immédiate que je n’ai présentés, essentiellement, que comme une illustration des conséquences majeures qui peuvent naître d’erreurs commises sur des questions abstraites en philosophie des sciences. En effet, si on a autant de raisons d’appréhender les dangers à long terme qu’engendre l’acceptation non critique d’affirmations qui n’ont que l’apparence d’être scientifiques, c’est dans un domaine beaucoup plus vaste que celui des problèmes que je viens de mentionner. Ce que j’ai surtout voulu mettre en évidence par cet exemple d’actualité est que, dans mon domaine assurément, mais je crois aussi généralement dans les sciences de l’homme, ce qui ressemble superficiellement le plus à la méthode scientifique est le plus souvent ce qui l’est le moins et, au-delà, qu’il y a dans ces domaines des limites décisives à ce que nous pouvons attendre de la science.
Cela veut dire que confier à la science - ou à un contrôle délibéré en fonction de principes scientifiques – davantage que la méthode scientifique ne peut en faire peut avoir des effets déplorables. Les progrès des sciences naturelles à l’époque moderne a bien entendu à ce point dépassé toutes les attentes que toute suggestion selon laquelle ceux-ci pourraient avoir des limites doit forcément éveiller les soupçons. Résisteront en particulier à une telle compréhension tous ceux qui avaient espéré que notre pouvoir croissant de prédiction et de contrôle, que l’on considère généralement comme le résultat caractéristique de l’avance scientifique, appliquée aux processus sociaux, allait bientôt nous permettre de façonner une société entièrement à notre goût. Il est vrai que, contrairement à l’euphorie que les découvertes des sciences physiques ont tendance à produire, ce que nous apprenons en étudiant la société a souvent l’effet d’une douche froide sur nos aspirations, et il est peut-être pas surprenant que les jeunes membres les plus impétueux de notre profession ne soient pas toujours prêts à l’accepter.
Pourtant, la confiance dans le pouvoir illimité de la science est trop souvent fondée sur cette fausse croyance que la méthode scientifique consisterait en l’application d’une technique toute prête, ou en imitant la forme plutôt que le fond de procédure scientifique, comme s’il suffisait de suivre quelque recette de cuisine pour résoudre l’ensemble des problèmes sociaux. On a parfois l’impression que les techniques de la science s’apprennent plus facilement que la pensée, laquelle nous enseigne ce que sont les problèmes et comment les aborder.
"Confier à la science... davantage que la méthode scientifique ne peut en faire peut avoir des effets déplorables."
Le conflit entre ce qui, dans son état d’esprit actuel, le public attend que la science réalise pour satisfaire les espoirs populaires et ce qui est réellement en son pouvoir est une affaire grave parce que, même si les vrais savants devraient tous reconnaître la limite de ce qu’ils peuvent faire dans le domaine des affaires humaines, aussi longtemps que le public en attend davantage il y en aura toujours pour faire semblant, voire pour s’imaginer sincèrement qu’ils pourraient en faire plus pour satisfaire ces demandes populaires qu’il n’est réellement en leur pouvoir.
Il est souvent assez difficile pour l’expert, et bien entendu dans de nombreux cas impossible pour le profane, de distinguer, des affirmations faites au nom de la science, celles qui sont légitimes et celles qui ne le sont pas. L’immense publicité donnée récemment par les médias à un rapport qui se prononçait au nom de la science sur les limites de la croissance, et le silence de ces mêmes médias sur la critique ravageuse que ce rapport a reçu de la part des experts compétents[6], doivent forcément inspirer une certaine appréhension quant à l’exploitation dont le prestige de la science peut faire l’objet. Mais ce n’est pas seulement dans le domaine de l’économie que l’on émet de vastes prétentions au nom d’une direction scientifique de toutes les activités humaines et de la nécessité prétendue de remplacer les processus spontané par un « contrôle conscient par les hommes ». Si je ne me trompe, la psychologie, la psychiatrie, et certaines branches de la sociologie, sans parler de la prétendue philosophie de l’histoire, sont encore davantage affectées par ce que j’ai appelé le préjugé scientiste, et par des prétentions fallacieuses sur ce que la science serait capable de faire[7].
Si nous voulons préserver la réputation de la science, et empêcher l’affirmation d’une fausse science fondée la base d’une ressemblance superficielle de procédure avec celles de sciences physiques, il va falloir consacrer beaucoup d’efforts à réfuter ces prétentions, dont certaines correspondent désormais aux intérêts en place de départements universitaires ayant pignon sur rue. Nous ne pouvons pas assez remercier des philosophes de la science moderne tels que Sir Karl Popper pour nous avoir donné un test qui nous permette de distinguer ce que nous pouvons ou ne pouvons pas tenir pour scientifique - test dont je suis bien sûr que certaines doctrines désormais largement admises comme telles ne le passeraient pas avec succès.
Il existe toutefois des problèmes spécifiques, liés à ces phénomènes essentiellement complexes dont les formations sociales sont un exemple si important, qui m’amènent en conclusion à souhaiter reformuler en termes plus généraux les raisons pour lesquelles dans ces domaines, non seulement il existe des obstacles absolus à la prédiction d’événements particuliers, pour lesquelles agir comme si l’on possédait une connaissance scientifique permettrant de les transcender pourrait devenir en soi un obstacle sérieux aux progrès de l’intelligence humaine.
Le fait principal que nous devons garder à l’esprit est si les sciences physiques ont fait de grands et rapides progrès, c’est dans des domaines où elles avait prouvé que l’explication et la prévision peuvent s’appuyer sur des lois qui rendent compte des phénomènes observés en fonction d’assez peu de variables – qu’il s’agisse de faits particuliers ou de la fréquence relative des événements. Cela pourrait même bien être la raison ultime pour laquelle ce sont ces domaines-là que nous distinguons comme « physiques », par opposition aux structures plus hautement organisées que j’ai appelées ici des phénomènes essentiellement complexes. Or, il n’y a aucune raison pour qu’on doive adopter dans ce dernier domaine la même position que dans le premier. Les difficultés que nous y rencontrons ne sont pas, comme on pourrait d’abord le croire, des difficultés à formuler des théories pour expliquer les événements observés - même si elles engendrent également une difficulté particulière à tester des hypothèses et donc à éliminer les mauvaises théories. Elles sont dues au problème principal qui se pose lorsque nous appliquons nos théories à n’importe quelle situation particulière du monde réel.
«Si nous voulons sauvegarder la réputation de la science... il faudra consacrer de nombreux efforts à réfuter ces prétentions, dont certaines correspondent désormais aux intérêts en place de départements universitaires ayant pignon sur rue."
Une théorie des phénomènes essentiellement complexes doit se référer à un grand nombre de faits particuliers, et pour en tirer une prédiction, ou pour la tester, il faudrait s’assurer de chacun de ces faits particuliers. Une fois que nous y serions parvenus il ne devrait y avoir aucune difficulté particulière pour en déduire des prévisions testables - avec les ordinateurs modernes, ce devrait être assez facile d’introduire ces données dans les cases appropriées de la formule théorique et d’en tirer une prédiction. La véritable difficulté, à la solution de laquelle la science ne peut guère contribuer, et qui est parfois bel et bien insoluble, consiste dans la collecte effective de ces faits.
Un exemple simple montrera la nature de cette difficulté. Considérons un jeu de ballon pratiqué par un petit nombre de personnes de capacité à peu près égale. Si nous savions que quelques faits particuliers, en plus de notre connaissance générale de la capacité des acteurs individuels, tels que l’état de leur attention, leurs perceptions et l’état de leur cœur, poumons, muscles, etc., à chaque moment du jeu, nous pourrions sans doute en prévoir l’issue. En fait, si nous étions familiers à la fois du jeu et des équipes, nous devrions avoir une idée assez perspicace de ce dont l’issue dépendra. Mais bien entendu, nous ne serons ne pas en mesure de nous assurer de ces faits-là et, en conséquence, le résultat du match doit demeurer en-dehors de ce qui est scientifiquement prévisible, si exactement que nous puissions savoir quels effet tel événement particulier pourrait avoir sur le résultat de la partie. Cela ne veut pas que nous ne puissions faire aucun pronostic sur le cours d’un tel match. Si nous connaissons les règles des différents jeux, nous apprendrons bien vite, à les regarder, quel jeu on est en train de jouer et à quels types d’actions nous pouvons nous attendre ou non. En revanche, notre capacité à prévoir sera limitée à ces caractéristiques générales des événements à prévoir, et ne comprendra pas la capacité de prédire des événements particuliers.
Voilà qui correspond à ce que j’ai appelé la prévision limitée aux principes, à laquelle nous sommes de plus en plus réduits à mesure que nous quittons le domaine où dominent des lois relativement simple pour celui des phénomènes où ce qui règne est la complexité organisée. A mesure que nous avançons, nous découvrons de plus en plus souvent que dans les faits nous pouvons nous assurer de certaines circonstances particulières qui déterminent le résultat d’un processus donné mais pas de toutes, de sorte que nous ne sommes en mesure de prédire que certaines des propriétés des résultats que nous devons en attendre, mais pas toutes. Il arrivera souvent que tout ce que sommes capables de prévoir sera quelque caractéristique abstraite du réseau qui va apparaître - des relations entre des types d’éléments dont, individuellement, nous savons très peu. Pourtant, comme je tiens à le répéter, nous ferons encore des prévisions qui peuvent être réfutées et qui auront de ce fait une signification empirique.
Bien sûr, comparée aux prédictions précises que nous avons appris à attendre dans les sciences physiques, cette espèce de prévision de principe est un pis-aller dont on ne voudrait pas avoir à se contenter. Cependant, le danger contre lequel je voudrais mettre en garde c’est précisément cette croyance comme quoi, pour qu’on vous accepte comme scientifique, il faudrait en faire davantage que cela. C’est là que se trouve le charlatanisme, et pire encore. Agir selon la croyance comme quoi nous possèderions l’information et le pouvoir qui nous permettraient de façonner les processus sociaux entièrement à notre convenance alors que cette information, en fait, nous ne la possédons pas, peut vraiment nous amener à faire beaucoup de dégâts. Dans les sciences physiques, on ne peut guère vous en vouloir d’essayer de faire l’impossible ; on pourrait même avoir l’impression qu’il ne faut pas décourager les prétentieux parce qu’après tout leurs expériences pourraient livrer de nouvelles bonnes idées.
Dans le domaine social, en revanche, la fausse croyance comme quoi l’exercice d’un certain pouvoir aurait des conséquences bénéfiques va probablement faire attribuer à quelque autorité un pouvoir nouveau de s’imposer à d’autres hommes. Même si un tel pouvoir n’est pas mauvais en soi, son exercice risque d’entraver le jeu des forces d’ordonnancement spontané qui, sans qu’il les comprenne, assistent tellement l’homme dans la recherche de ses objectifs.
Nous commençons seulement à mesurer la subtilité du système de communication dont dépend le fonctionnement d’une société industrielle avancée - système de communication que nous appelons le marché et qui s’avère être un mécanisme plus efficace pour digérer une information dispersée qu’aucun de ceux que l’homme a délibérément conçus.
Si on veut que l’homme ne fasse pas plus de mal que de bien dans ses efforts pour rendre meilleur l’ordre social, il lui faudra apprendre que, dans ce domaine-là comme dans tous les autres domaines où ce qui prévaut est une complexité essentielle de type organisé, il ne pourra jamais acquérir l’information nécessaire pour rendre possible la maîtrise des événements. Il lui faudra donc utiliser l’information qu’il peut effectivement obtenir, non pour disposer des résultats comme l’artisan façonne son ouvrage, mais plutôt pour soigner une culture en fournissant les conditions appropriées, comme le jardinier le fait pour ses plantes.
Il y a du danger dans l’exubérant sentiment de puissance sans cesse croissante que le progrès des sciences physiques a engendré et qui donne à l’homme la tentation d’essayer, dans l’« ivresse du succès » pour utiliser une expression caractéristique des débuts du communisme, de soumettre non seulement notre milieu naturel mais aussi notre société au contrôle d’une volonté humaine.
La reconnaissance des limites insurmontables à sa connaissance devrait effectivement donner à celui qui étudie la société, une leçon d’humilité qui devrait lui éviter de se faire complice de cette propension fatale des hommes à vouloir contrôler la société - tendance qui en fait non seulement les tyrans de leurs semblables, mais qui pourraient bien en faire les destructeurs d’une civilisation qu’aucun cerveau n’a conçu, mais qui est née des libres efforts de millions d’individus.
F A Hayek (1899-1992) fut membre du conseil de fondation de l’Institut Mises. Il a partagé le prix Nobel d’économie en 1974 avec son rival idéologique Gunnar Myrdal
« pour leur travail de pionniers dans la théorie de la monnaie et des fluctuations économiques et pour leur analyse pénétrante de l’interdépendance des phénomènes économiques, sociaux et institutionnels ».
Notes
[1] « Scientism and the Study of Society », Economica, vol. IX, no. IX, no. 35, August 1942, réimprimé dans The Counter-Revolution of Science, Glencoe, Ill, 1952, p. 15 de la réimpression courante.
[2] Warren Weaver, « A Quarter Century in the Natural Sciences, » The Rockefeller Foundation Annual Report 1958 , chapter I, « Science and Complexity. »
[3] Voir mon essai “The Theory of Complex Phenomena” dans The Critical Approach to Science and Philosophy: Essays in Honor of Karl R Popper, éd. M. Bunge, New York 1964, et réimprimé (avec des ajouts) dans mes Studies in Philosophy, Politics and Economics,, Londres et Chicago, 1967.
[4] V. Pareto, Manuel d’économie politique, 2e. ed., Paris 1927, pp. 223–4. 223-4.
[5] Voir, par exemple, Luis Molina, De Iustitia et iure, Cologne 1596-1600, tom. II, disp. II, disp. 347, no. 347, no. 3, et particulièrement Johannes de Lugo, Disputationum de iustitia et iure tomus secundus , Lyon 1642, disp. 26, sect. 4, no. 40.
[6] Voir : Halte à la croissance ? Rapport sur les limites de la croissance (éd. Fayard, 1973) ; pour un examen systématique par un économiste compétent, cf. Wilfred Beckerman, In Defence of Economic Growth , Londres, 1974, et, pour une liste de critiques plus anciennes par des experts, Gottfried Haberler, Economic Growth and Stability, Los Angeles 1974 ; celui-ci y décrit à juste titre ces critiques comme « ravageuses ».
[7] J’ai donné quelques illustrations de ces tendances dans d’autres domaines dans ma leçon inaugurale de Professeur visitant à l’Université de Salzbourg, Die Irrtümer des Konstruktivismus und die Grundlagen legitimer Kritik gesellschaftlicher Gebilde [« Les erreurs du constructivisme et les fondements d’une critique légitime des formations sociales »)], Munich 1970, aujourd’hui réimprimé pour le Walter Eucken Institute à Fribourg en Brisgau par JCB Mohr, Tübingen, 1975.