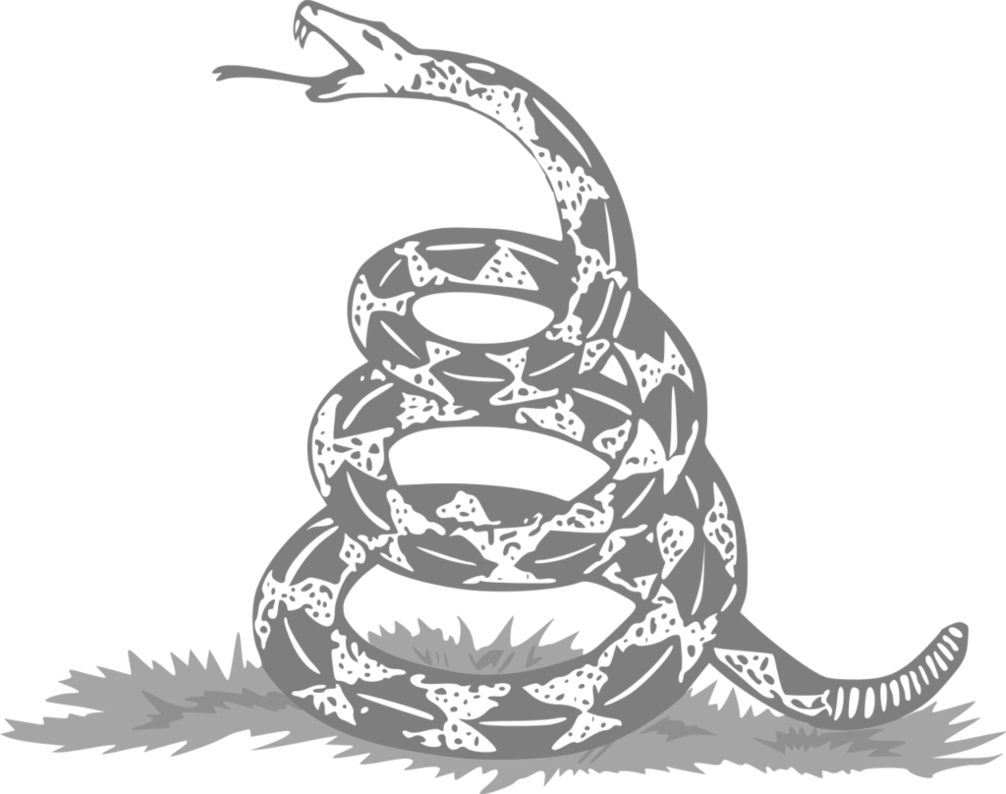Murray Rothbard
Murray Newton Rothbard (2 mars 1926 - 7 janvier 1995), fut un économiste et philosophe politique américain, théoricien de l’École autrichienne d’économie (élève de Ludwig von Mises), du libéralisme et de l’anarcho-capitalisme.
L’économiste du laissez-faire
En économie, Murray Rothbard a popularisé la pensée de Ludwig von Mises, dans un langage et avec des arguments plus propres à convaincre les économistes contemporains, formés à l’empirisme. Son premier essai économique fut un coup de maître : dans un recueil d’articles publiés en 1956, sous le nom de Towards Liberty il publiait un article intitulé « Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics », il y réfutait dès l’origine ces rationalisations encore courantes de l’étatisme que sont les « externalités » et les « services collectifs » — aussi parfois appelés « biens publics », montrant que ces rationalisations refusent le seul critère objectivement observable de l’accroissement d’utilité — l’action volontaire — au profit de gloses arbitraires sur des préférences dont la prétendue mise en forme mathématique n’est là que pour faire oublier qu’en réalité on ne peut pas les connaître, ni les mesurer, ni les comparer : l’action, et seule l’action, permet de connaître les préférences, elle en est la preuve authentique et unique.
Le critère de la préférence démontrée comme seule preuve de l’action productive permettra à Rothbard de dépasser son maître Mises dans la compréhension du monopole. Mises admettait la possibilité d’un « monopole » sur un marché libre ; dans le chapitre 10 de Man, Economy and State, intitulé « Monopole et concurrrence », Rothbard démontre que le concept est contradictoire — et il l’est depuis ses origines grecques : toute forme d’organisation contractuelle est a priori productive (et conforme à la justice naturelle), tout acte de violence agressive fausse la concurrence (et viole la justice naturelle) et de ce fait mérite qu’on l’appelle « privilège de monopole ».
C’est ainsi que Murray Rothbard établit le caractère productif de tout acte pacifique, et l’impossibilité de prétendre scientifiquement qu’un acte qui viole le consentement d’un propriétaire ajouterait à une quelconque « production totale ». Ce qui lui pemet de conclure que le laissez-faire capitaliste réalise la production maximum, et que quiconque affirme que l’intervention de l’état pourrait accroître cette production est ipso facto un charlatan.
À l’imitation de L’Action humaine de Mises, Rothbard entendait mettre en avant un système complet d’économie politique. D’où les deux tomes de Man, Economy and State, complétés par Power and Market, développement des effets destructeurs de l’intervention étatique déjà évoqués à la fin du premier Traité. Rothbard y fait un large usage du raisonnement à l’équilibre, mais dans les conditions énoncées par Mises et sans y parvenir à la Loi de la Destruction Totale. Il y développe aussi la théorie autrichienne de la conjoncture, et le caractère nécessaire du revenu d’intérêt.
L’épistémologue réaliste
Rothbard a aussi établi la « Loi de Rothbard », loi empirique comme quoi c’est dans le domaine où ils sont les plus mauvais que les gens se croient les meilleurs, et s’est employé à l’illustrer lui-même : disciple du plus grand économiste monétaire du XXe siècle, Ludwig von Mises, il a réussi à ne pas comprendre les conditions de l’ajustement monétaire et à prôner l’étalon-or avec 100% de réserves, ce qui est aussi incompatible avec la liberté des contrats qu’implique sa philosophie politique qu’avec toute compréhension de ce qu’est un instrument financier.
Si Rothbard était capable de remettre en cause les plus anciens concepts, et de reconnaître pour vrais des faits généraux de l’action humaine qu’on ne peut pas imaginer autres qu’ils ne sont, c’est parce qu’il ne cherchait pas à « vérifier » expérimentalement les propositions de type 2 + 2 = 4. Il tenait pour définitivement établi tout axiome, c’est-à-dire toute proposition dont on est obligé de se servir au cours de toute tentative pour la réfuter. C’est dire qu’il n’était pas empiriste ni positiviste.
Ce parti pris permet aux économistes autrichiens de se libérer des analyses et des concepts qui dépendent de la possibilité d’obtenir des statistiques dans les domaines qui relèvent de la seule logique. Par exemple dans celui de l’incertitude, ou dans celui de l’information, tout comme celui du monopole. Pour illustrer les progrès possibles en appliquant cette méthode appropriée à son objet, on peut rappeler que, s’il a fallu 70 ans à Hayek pour comprendre que la « justice sociale » n’a pas de sens comme concept normatif, c’est parce qu’il faut commencer par se poser la question.
Cependant, à la différence de Mises, Rothbard fondait le raisonnement logique non sur une conception kantienne de l’apriori mais sur une théorie aristotélicienne des concepts, qu’on pourrait rattacher à l’objectivisme de Ayn Rand, Nathaniel Branden et Leonard Peikoff. Ainsi, c’est dans la tradition même d’Aristote qu’il l’avait réfuté sur le monopole, comme Böhm-Bawerk en 1881 sur le revenu d’intérêt.
Le philosophe politique
Il restait à démontrer que le laissez-faire capitaliste est conforme à la justice : c’est ce qu’il fait dans L’Éthique de la Liberté. Il y montre que la seule définition cohérente de la justice est la propriété naturelle, la libre disposition reconnue comme juste de toute possession qu’on n’a pas volée, c’est-à-dire prise à un autre sans son consentement. L’Éthique de la liberté décline les conséquences de cette définition, reprenant de nombreuses solutions de la tradition juridique et en contestant d’autres.
L’application des principes libéraux se heurte évidemment aux dilemmes qu’engendre l’emploi de la force pour protéger le Droit, dans la mesure où, sans l’avoir voulu, cet emploi de la force implique le risque de faire du tort à des innocents. Murray Rothbard n’en tirait pas des conclusions pacifistes ni non-violentes. Dans L’Éthique de la liberté, il a cherché à définir, de façon forcément contestable, les cas où cet emploi de la force reste justifié. Rothbard condamnait les guerres du XXe siècle avec leur proportion croissante de civils massacrés, interprétant à sa manière leur déroulement ainsi que ce qu’il pouvait comprendre de la politique internationale. Ses successeurs ont « résolu » une bonne partie des cas de conscience posés aux décideurs politiques en réécrivant l’histoire ou en faisant comme s’ils n’existaient pas. À cet égard, ils méritent le titre d’historiens révisionnistes, certains d’entre eux dans tous les sens du terme.
S’opposant à l’ordre moral imposé par les hommes de l’État et dénonçant les subventions et privilèges de monopole que les hommes de l’état attribuent aux grandes entreprises, Murray Rothbard aurait pu passer pour « de gauche » sur l’échelle idéologique contemporaine. En fait, par son réalisme épistémologique et éthique, il appartenait bien davantage à la droite traditionnelle, la compétence économique en plus : à l’âge de 12 ans, il demandait à sa famille communiste ou anarchiste atterrée ce qu’ils reprochaient exactement à… Francisco Franco ! Contre ce qui fait aujourd’hui l’essence de la gauche, il a toujours condamné au nom de l’objectivité du Bien les vices mêmes qu’il reprochait aux hommes de l’état de prétendre interdire en violation du Droit, et dénonçait plus que tout les mises en cause du Droit de propriété qu’inspirent le relativisme et le socialisme contemporains. Son anarchisme était un anarcho-capitalisme, et dénonçait en priorité l’intrusion des hommes de l’état dans les droits de propriété et dans l’économie de marché au moyen de contrôles, réglementations, subventions et interdictions.
Les sophismes isolationnistes
De même qu’en théorie économique Murray Rothbard recommandait une politique monétaire incompatible aussi bien avec ses propres principes politiques qu’avec l’ajustement monétaire, en politique internationale sa pensée était marquée par des erreurs de raisonnement, nées de la prétention à employer une approche philosophique, a priori, au-delà des limites de sa validité, c’est-à-dire dans un domaine où une analyse historique préalable est au contraire absolument nécessaire.
Il faut insister sur ce fait, que l’isolationnisme de principe des rothbardiens est inspiré par des sophismes et pas seulement par des différences d’appréciation ou une plus ou moins grande tendance au compromis, parce que ses critiques comme ses partisans s’imaginent encore que l’isolationnisme de Rothbard serait une conséquence directe de ses principes anarcho-capitalistes, alors que ce n’est pas le cas : il résulte au contraire de son incapacité à les appliquer sérieusement à une réalité politique complexe.
L’erreur de catégorie de la politique étrangère a priori
En effet la politique internationale, comme toute politique mais plus encore que la politique nationale parce qu’elle oppose deux ou plusieurs états, par définition agressifs et violents, est le domaine du dilemme, de la recherche du moindre mal, où les principes de la liberté ne peuvent pas s’appliquer directement ni certainement.
Au contraire, on ne peut connaître la politique à mener que par l’intuition politique, à la suite d’une analyse approfondie de ses relations causales. Cela exige une connaissance, et une expérience directe des sociétés politiques en cause, ainsi que de leurs relations mutuelles, qu’on ne peut évidemment pas acquérir si on croit pouvoir en décider à l’avance.
De même, l’opportunité d’une politique dépend essentiellement des circonstances, ne serait-ce que parce qu’elle dépend de rapports de forces qui changent constamment. Prétendre en décider a priori, c’est garantir l’échec de la politique en question, en quoi que celle-ci puisse consister.
Prétendre définir a priori une politique étrangère est donc une erreur de catégorie philosophique qui à son tour garantit l’incompétence en la matière de celui qui la commet.
Une conséquence logique du fait que l’opportunité d’une politique doit forcément dépendre des circonstances, que tout jugement sur celle-ci doit être le produit final d’une étude historique localisée et datée, et non d’un raisonnement philosophique général est que les notions mêmes d’« isolationnisme » ou d’« interventionnisme », de « pacifisme » ou de « bellicisme » n’ont aucun sens dans l’absolu, c’est-à-dire indépendamment du contexte politique auquel le jugement d’opportunité s’applique.
Or c’est précisément ce que Murray Rothbard avait prétendu faire dans For a New Liberty : définir a priori l'isolationnisme comme « la » politique étrangère libérale.
Conséquence : quiconque a étudié sérieusement une question de politique internationale n’a pu que constater que Rothbard et les rothbardiens y méconnaissent les faits qui ne vont pas dans le sens de leurs conclusions préétablies. Ne connaissant que les États-Unis et se croyant dispensés de connaître les autres états, ils n’ont pas mesuré à quel point ces derniers étaient plus criminels et menteurs encore, de sorte qu’ils ont plus souvent qu’à leur tour pris le parti des pires assassins contre ceux qui essayaient de les neutraliser, et repris à leur compte les mensonges de leur propagande.{1}
La fausse « exception » de l’isolationnisme
L’incapacité à penser la politique qu’engendre cette erreur de catégorie a inspiré à ses adeptes un ensemble de sophismes secondaires qui consistent essentiellement à postuler des différences de nature purement imaginaires entre la politique qu’ils prônent et celle qu’ils prétendent condamner chez les autres :
Le leurre des frontières
Le leurre des frontières consiste à croire que les lois de la politique seraient différentes une fois qu’on a franchi les frontières en question :
Alors qu’il sait mieux que quiconque que si vous ne vous occupez pas de politique, ça n’empêchera pas la politique de s’occuper de vous, l’isolationniste rothbardien s’imagine que, une fois passé les frontières, alors il faudrait que ça change, et qu’il n’y ait pas d’agresseurs chez les étrangers :
- « si on les laisse tranquilles, ils nous laisseront tranquilles ».
L’anthropologie pourrait suffire à dissiper cette illusion en réfutant ses présupposés racistes sous-jacents comme quoi les non-Occidentaux n’auraient pas d’efficace propre, et ne feraient que réagir aux initiatives des Occidentaux — lesquels, dans la version antiblancs de ce racisme-là, seraient les seuls qui puissent jamais commettre des agressions.
Cependant, l’histoire même des États-Unis aurait dû y suffire aussi : au cours du premier quart de siècle de leur existence, les États-Unis ont été attaqués par les pirates barbaresques, par la France, et par l’Angleterre.
C’est pour cela qu’ils ont passé le reste du XIXe siècle à conquérir préventivement l’espace stratégique extérieur à leur état : c’était cela la « Frontière ».
Maintenant que les territoires conquis y ont été incorporés, on oublie qu’ils n’en faisaient pas partie et on prétend faire naître un « impérialisme » américain à la fin du XIXe siècle ; cette façon d’écrire l’histoire repose sur un choix tronqué, et une interprétation contestable, des événements, qui laissent bel et bien soupçonner une recherche de preuves à l’appui exclusif de conclusions préétablies.
C’est facile d’avoir raison quand on écrit soi-même l’histoire
Un autre type de sophisme, emprunté à la gauche, et qui prétend lui aussi affirmer des lois a priori dans un domaine qui relève en fait de l’analyse historique, est l’argument du welfare-warfare state : il consiste à présenter comme un lien nécessaire et universel la coïncidence entre le développement de l’état-providence et la guerre observée aux États-Unis au cours des années 1960.
Sans même devoir expliquer cette coïncidence historique, il suffit logiquement d’un seul contre-exemple pour réfuter ces prétentions à l’universalité, et on peut déjà en donner deux : l’évolution de la Grande-Bretagne vers le laissez-faire au moment où elle développait son empire,
et a contrario, l’expansion de l’état-providence bismarckien en Europe occidentale aux dépens de tout entretien sérieux d’une défense propre depuis le milieu des années 1960.
Quand ils ne demeurent pas aveugles aux événements qui les contredisent, les isolationnistes de principe ont beau jeu de nous expliquer à quel point les choses se seraient mieux passées si on les avait écoutés quand on ne l’a pas fait : on ne risque pas d’être démenti par les événements quand on réécrit l’histoire de la Première guerre mondiale en supposant que les États-Unis n’y soient pas intervenus à partir de 1917. Bien entendu, si on ne risque rien, si c’est tellement facile de la réécrire, cette histoire, c’est justement parce qu’on ne sait rien du tout de ce qui se serait passé autrement. Et de toutes façons il faut encore une fois choisir soigneusement ses exemples pour prétendre, faussement, tirer des conclusions générales de ce type d’histoire virtuelle réécrite.
Quant à réfuter cette histoire virtuelle réécrite il suffit, pour y parvenir, de lui opposer l’argument de l’opacité et de l’imprévisibilité — en plus, bien sûr, celui de l’ignorance absolue.
Les fausses déductions tirées de la complexité sociale
Un argument tiré de l’observation historique et qui s’appuie aussi sur des constantes générales authentiques de l’action humaine consiste en effet à invoquer l’opacité de la société à ceux qui prétendent la changer pour démontrer que la politique étrangère est vouée à l’échec parce que la société y est trop complexe et imprévisible pour qu’on puisse y agir efficacement.
C’est vrai que la politique internationale est encore plus complexe que la politique nationale ; et c’est donc aussi vrai qu’on doit pouvoir en déduire que l’action politique y est plus incertaine encore et devrait donc être plus prudente qu’en politique nationale - reste à savoir ce qu’on appellera « prudence » en l’espèce, puisque ne rien faire, c’est encore faire quelque chose (cf. infra).
En revanche, cette complexité de la politique internationale est un argument dont un rothbardien peut difficilement se servir sans contradiction, puisqu’il signifie qu’il aurait dû l’étudier encore davantage pour éviter d’en dire n’importe quoi, alors que lui prétend, avec sa « politique étrangère libérale » définie a priori, qu’on s’en dispense au contraire complètement.
En fait, si l’argumentaire sur la complexité prouvait que tout « interventionnisme » à l’étranger est forcément voué à l’échec, il prouverait la même chose de toute action politique, et d’abord de toute politique étrangère quelle qu’elle soit — y compris isolationniste. Encore une fois, les frontières n’y changent rien : celui qui prône l’isolationnisme en attend certains effets, lesquels peuvent très bien ne pas se produire, a fortiori si cette politique se fondait sur des erreurs de raisonnement ayant inspiré un refus de s’informer réellement.
En outre, si le caractère opaque et imprévisible de la société vouait nécessairement à l’échec tout interventionnisme à l’étranger, ce ne serait guère moins vrai de toute action politique, y compris dans le cadre national. Or, que fait-on quand on dénonce une politique étrangère au nom du caractère « inconnaissable et imprévisible » de la société internationale, sinon de la politique, « inconnaissable et imprévisible » d’après ses propres disqualifications ? N’est-ce pas une contradiction pratique que de prétendre fonder une position politique sur une disqualification de toute politique pour des raisons de principe ?
Pour écarter ce type d’argument, il suffit de rappeler que le critère du succès en politique c’est la victoire, et qu'en politique il y a forcément à un moment ou à un autre un vainqueur et un vaincu : ce fait suffit à réfuter définitivement l’idée suivant laquelle toute politique serait nécessairement vouée à l’échec par le caractère opaque et imprévisible de la réalité sociale.
Le seul fait qu’en politique il doit y avoir un vainqueur pour qu’il y ait un vaincu réfute donc l’idée suivant laquelle toute politique serait inéluctablement vouée à l’échec parce que les événements sont par nature imprévisibles. En fait, il y a des politiques qui gagnent parce qu’elles étaient adaptées à une situation complexe, et de ce fait, des politiques qui perdent parce qu’elles ne l’étaient pas.
Si on veut gagner en politique, il faut analyser la situation, et non, en effet, on n’a aucune garantie qu’on ne s’y trompe pas, ni qu’un événement imprévisible ne viendra pas tout changer, et oui, c’est parce que les gens sont rationnels et inventifs — et, à l’étranger, différents. En revanche on sait qu’il y aura un vainqueur et un vaincu, de sorte qu’on peut réussir, mais qu’on peut aussi être écrasé — y compris si on ne fait rien.
Et on peut tout autant savoir que si on prétend définir une politique a priori, c’est-à-dire en se croyant dispensé de connaître la situation concrète où on prétend la mener, eh bien on est sûr de se faire écraser.
Interpréter les échecs de l’interventionnisme en dehors de leur contexte
L’argument de la complexité est en fait une variante, un aspect, d’objections plus générales à l’intervention de l’état, qui sont le pain quotidien des économistes dignes de ce nom, mais dont l’interprétation erronée se traduit par l’argument comme quoi l’« interventionnisme » à l’étranger ne pourrait qu’échouer, du fait que l’« interventionnisme » économique échoue toujours à réaliser ses objectifs prétendus.
La première réponse, qui relève de ce qu’on vient de rappeler, est que si l’« interventionnisme » économique échoue bel et bien à réaliser ses objectifs prétendus, il réalise par définition l’un au moins de ses objectifs réels, qui résulte de son existence même, et qui est de permettre aux puissants de voler les faibles.
En revanche, ce n’est pas une erreur de catégorie mais une vérité universelle que l’action politique ne peut pas escompter des profits certains, de sorte qu’on ne peut logiquement associer de gain net à aucun type de politique définie à l’avance :
ce gain ne peut venir à l’entrepreneur politique que de sa supériorité sur les autres, ou de la chance pure et simple :
avec la découverte d’une égalité de principe entre les butins et les destructions de la redistribution politique c’est d’ailleurs la deuxième conclusion majeure de la Démonstration de Bitur-Camember ;
cependant, cette constatation-là ne fait que confirmer qu’en politique internationale comme ailleurs il n’existe aucun type de politique qu’on puisse a priori définir comme opportune ; et, cela, c’est précisément ce que prétend faire l’isolationnisme de principe.
C’est aussi vrai des autres aspects de l’interventionnisme économique, comme l’identité réelle de ses victimes et bénéficiaires, qui relèvent bien des lois économiques a priori de l’incidence réelle et de la protection effective, lesquelles nous enseignent que, même en termes de redistribution brute — c’est-à-dire compte non tenu des pseudo-investissements des uns et des autres — la redistribution politique échouera généralement à appauvrir ceux qu’elle voulait appauvrir et à enrichir ceux qu’elle voulait enrichir : cependant, l’identification des victimes et des receleurs réels ne sera pas indépendante des circonstances.
C’est évidemment aussi vrai de l’« interventionnisme » à l’étranger où tout ce qu’on peut savoir a priori c’est que des bandes d’agresseurs s’y opposent à d’autres bandes d’agresseurs, de sorte que logiquement, l’opportunité de prendre parti ou non pour les uns ou pour les autres ne peut pas, justement, se décider a priori.
Et pour ce qui est de l'efficacité de cette intervention-là, c’est la victoire, et non la production qui est le critère ostensible de sa réussite ou de son échec, et elle peut parfaitement servir la production, dans la mesure où elle s’en prend à des criminels, ce que sont par définition les hommes de l’état.
L’aspect normatif qui relève de principes a priori, c’est dans le but de la politique qu’il réside
Pour celui qui a quelque compétence dans le raisonnement normatif, ce qui fait que l’« interventionnisme » économique est injustifié, c’est qu’il est par définition voleur, qu’il s’empare des biens d’autrui sans son consentement ;
de même, s’il ne peut jamais qu’ échouer dans ses objectifs affichés, c’est parce qu’il prétend servir la production alors qu’il est par définition agressif, et que la violence agressive est pure destruction.
Une politique qui vise au contraire à combattre la spoliation légale, si elle
ne peut pas apporter a priori d’avantage net à tous ceux qui la promeuvent même en cas de victoire — car cela dépend de l’ampleur de leurs pseudo-investissements personnels, il suffit de voir ce que sont devenu les signataires méconnus de la Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776, elle n’en est pas moins justifiée parce que la spoliation légale est criminelle et qu’à l’occasion de ses crimes elle détruit a priori autant qu’elle vole.
Et, bien entendu, une politique étrangère qui entend atténuer la spoliation légale chez les autres — empêcher des massacres, abattre des tyrans, les contraindre à moins de pillage arbitraire, même s’il est tout aussi certain que cette politique ne peut pas apporter d’avantages nets garantis à tous ceux qui la paient, elle n’en est pas moins justifiée a priori, et pour les mêmes raisons : elle est juste, conforme au bien commun ; ce qu’on ne peut pas prouver a priori, c’est son opportunité et notamment ses chances de succès ;
pas plus, et pas moins, qu’on ne peut prouver celles de l’isolationnisme.
C’est en cela que consiste le véritable raisonnement a priori sur l’« interventionnisme » : et on peut y voir que les confusions qu’y faisait Rothbard en politique étrangère est sophistique et conduit donc inéluctablement à l’erreur.
Ce qui nous amène au dernier aspect de la sophistique des différences imaginaires :
Le mythe de la politique innocente
L’isolationnisme rothbardien repose finalement sur le présupposé utopique suivant lequel certains types de choix politiques pourraient être exempts des incertitudes et des responsabilités morales qui sont en fait inhérentes à la politique, de sorte qu’aucune politique ne saurait y échapper :
On vient de conclure que si la complexité sociale et le libre arbitre des acteurs vouait inéluctablement à l’échec l’intervention à l’étranger, ce serait tout aussi vrai de n’importe quelle politique étrangère.
C’est le moment de rappeler que quand on peut agir, ne rien faire, c’est encore agir. C’est une illusion — du type « principe de précaution » — que d’imaginer que l’action aurait des conséquences tandis que l’inaction n’en aurait pas.
Comme l’a montré l’exemple des socialismes léniniste et hitlérien, qu’on aurait pu et dû écraser dans l’oeuf, l’inaction aussi a des conséquences imprévisibles et potentiellement catastrophiques sur une réalité opaque et dangereuse.
Refuser d’employer la violence contre un agresseur alors qu’on pourrait le faire, c’est autoriser ses agressions. Refuser la violence contre les tyrans sous prétexte de ne pas « ajouter la guerre à la guerre », c’est laisser libre cours à la violence agressive, comme si on n’admettait pas que la violence peut et doit être défensive et réparatrice : c’est confondre le libéralisme avec le pacifisme, lequel est une philosophie politique distincte voire contradictoire, puisqu’en condamnant également la violence agressive et la violence défensive, on ne peut fonder la défense d’aucune définition de la justice.
C’est dans le contexte d’un rapport de forces que l’on prend des positions politiques
Autre aspect de l’illusion de la politique innocente, l’idée des rothbardiens suivant laquelle ils pourraient prendre des positions politiques sans se soucier de leurs implications dans la société politique réelle.
Ainsi, les rothbardiens s’étonnent périodiquement d’être mis dans le même sac que les fanatiques de l’« anti-impérialisme » esclavagiste-absurdiste qui, comme eux, défendent des tyrans génocidaires à la suite de raisonnements absurdes, alors que si eux aussi les défendent avec des raisonnements absurdes, les raisonnements absurdes dont eux se servent sont parfois différents.
Cet étonnement leur vient de l’incapacité qu’ils se sont infligée à eux-mêmes de faire une analyse politique. Pour ceux qui la pratiquent naturellement, cette analyse politique, il est évident que dans un conflit il y a deux camps, et que si on dénonce l’un on est dans l’autre ; évident qu’en temps de guerre, ceux qui demandent à leur état d’abandonner le combat militent pour la victoire de ses ennemis.
Si on ne le comprend pas, on ne devra pas être surpris que d’autres le comprennent quand même et en tirent les conséquences.
Conclusion : si on veut faire de la politique, il faut admettre l’ensemble de ses règles et implications
Murray Rothbard et ses successeurs en politique étrangère ont donc dénoncé certaines politiques pour en exiger une seule autre, au nom de postulats généraux qui sont controuvés, notamment :
- — leur prétention sophistique à trancher a priori de la politique étrangère, prétention qui garantit l’incompétence de quiconque en est la dupe ;
Erreur de fond qui s’accompagne de
- — l’affirmation implicite de prétendues « différences de nature » entre les politiques qu’ils critiquent et la leur, « différences » qui en réalité n’existent pas.
En termes libéraux, la politique internationale traite par définition de relations complexes entre bandes de criminels. Si on prétend en juger, on doit analyser à chaque fois la situation politique concrète, pour savoir quelle démarche se trouve être la moins nuisible, et quand, et où.
L’hostilité particulière qu’ils leur vouent à propos de politique étrangère, alors que les objectivistes, qu’ils n’attaquent pas autant, n’en diffèrent vraiment que parce qu’ils y sont moins experts, souvent moins subtils dans leurs analyses et plus brutaux et expéditifs dans leurs préconisations, montre qu'il y a de la jalousie dans l’hostilité de Rothbard et des rothbardiens envers les néo-conservateurs ; mais si les néo-conservateurs ont du pouvoir alors que les rothbardiens n’en ont pas, c’est aussi parce qu’ils ne se sont pas, sur la foi de faux raisonnements, dispensés d'étudier sérieusement la politique internationale.
L’historien de la société
Outre ses œuvres dans les domaines de l’économie et de la politique, Rothbard s’est également intéressé à l’histoire économique. Il a commencé sa carrière avec Conceived in Liberty, histoire des États-Unis avant la Déclaration d’indépendance. En 1963, il publiait America’s Great Depression, explication autrichienne de la crise de 1929 et des sottises de la politique américaine avant et après le Krach que l’historien Paul Johnson devait reprendre dans son ouvrage Modern Times. Il est un des rares auteurs qui ait disserté dans son œuvre Perspective autrichienne sur l’histoire de la pensée économique sur les écoles qui ont précédé Adam Smith, telles que celles des scolastiques et des physiocrates.
Le politicien manqué
L’action partisane de Murray Rothbard ne traduit pas, on l’a vu, une intuition de l’opportunité politique aussi sûre que la plupart de ses démonstrations de philosophie et d’économie politiques. Elle a au contraire traduit les difficultés du philosophe qui voudrait bien appliquer directement ses principes de justice face à une société politique complexe et changeante, et dont la plupart des acteurs cherchent justement à les violer, ces règles de justice.
Incompétent en politique intérieure
Ainsi, Murray Rothbard n’a pas réussi à donner une importance réelle au Libertarian Party américain qu’il avait contribué à fonder. Cherchant à peser sur la politique sans transiger sur ses principes, il s’est retrouvé à prendre des positions politiques qui n’étaient pas seulement fluctuantes mais le mettaient en porte-à-faux vis-à-vis des « camps » susceptibles de prendre le pouvoir.
Pendant la guerre du Vietnam, on l’a vu s’acoquiner avec la gauche communiste et défaitiste qui a provoqué en 1975 la chute du Sud-Viêtnam avec les 3 millions d’assassinats qui en ont résulté. Après que Reagan, qu’il traitait d’« idiot », avait gagné la Guerre froide, son dégoût des candidats réellement éligibles aux postes de pouvoir l’a conduit à faire gagner la gauche en 1992 en soutenant ce candidat de diversion qu’était Ross Perot, puis donner son appui au socialiste de droite (protectionniste) Patrick Buchanan.
À la fin de sa vie, il passait moins de temps à dénoncer les pires ennemis de la liberté que ses propres alliés potentiels dans l’arène politique, parce que ceux-ci font une analyse réaliste de la situation politique et admettent que pour y exercer une influence il faut afficher une position claire et compatible avec l’appartenance à un camp.
Nuisible en politique étrangère
Ses positions en politique étrangère traduisaient en outre ses erreurs philosophiques en la matière. Murray Rothbard, qui ne lisait aucune langue étrangère et qui avait peur de prendre l’avion, aurait pu s’y reconnaître incompétent. Au lieu de cela, élevé dans la tradition isolationniste du sénateur Taft, et croyant pouvoir y appliquer directement ses principes, il prétendait définir a priori une politique étrangère libérale comme « non interventionniste ».
Fort de cette erreur de catégorie, connaissant mieux que quiconque les turpitudes de son propre état et incapable de mesurer celles des autres, il n’a cessé de dénoncer la politique étrangère des seuls États-Unis, exaltant à l’occasion les pires tyrannies et répétant leurs mensonges de propagande.
Certains de ses successeurs le suivent encore sur cette voie, le génie en moins. Sans influence aucune, ils cherchent à se donner de l’importance par des déclarations scandaleuses au profit de quelque massacreur génocidaire, pourvu qu’il soit l’ennemi des États-Unis : ils se contentent visiblement de l’illusion d’exister que leur donnent certains des commentateurs qui comptent à droite lorsque, à l’occasion, ils leur font l’aumône de les dénoncer.
Notes
{1} NDL: Rothbard avait résumé correctement la position libérale vis-à-vis de l’État par « if you wish to know how libertarians regard the State and any of its acts, simply think of the State as a criminal band, and all of the libertarian attitudes will logically fall into place », mais semble ne pas en avoir déduit la position libérale vis-à-vis des États au pluriel : ceux-ci sont des gangs de criminels, certains sont pires que d’autres, et on ne peut pas a priori savoir lesquels.
Oeuvres
- 1962 : Man, Economy and State
- 1963 : America’s Great Depression
- 1970 : Power and Market
- 1973 : For a New Liberty: The Libertarian Manifesto
- 1982 : The Ethics of Liberty (L'Éthique de la Liberté)
- 1983 : ’’The Mystery of Banking, New York: Richardson and Snyder, 1983.
- 1997 : The Logic of Action (2 volumes)
- 1999 : A History of American Money and Banking: The Colonial Period Until World War II
- Sociology of the Ayn Rand Cult
Voir aussi
- Les émissions de Georges Lane et François Guillaumat sur Lumière 101 :
- https://mises.org/library/soviet-foreign-policy-revisionist-perspective
- https://mises.org/library/war-guilt-middle-east
- https://mises.org/library/ernesto-che-guevara-rip
- Rothbard was attracted to the growing student movement and actually entered the Students for a Democratic Society (SDS) with his small following. He broke with those libertarians still clinging to an alliance with the anti-New-Deal Right by opposing Barry Goldwater in 1964 and beginning publication of Left & Right in 1965. He actively attended New Left meetings, wrote for Ramparts magazine, and even formed tactical alliances at the Freedom & Peace Party conventions with Maoists against old-line socialists.
- Strategy was always an issue of primary concern for Rothbard, and he always aligned himself with the anti-state forces of the moment, wherever they were. In the late 1960s, this was obviously the radical Left. It would have been insanity for anarchists to attempt an alliance with conservatives at the height of the Vietnam War, while the Cold War was still raging, and when virtually all right-wingers were cheering on police repression of the antiwar movement. Instead, the natural allies of libertarians for the moment were the antiwar protestors, student rebels, youth counterculture, the black power movement, and other popular radical strands of the time. Rothbard even participated in a coalition with Trotskyists and Maoists under the banner of the Peace and Freedom Party. These efforts worked remarkably well for a time, and the libertarian movement experienced much growth during the late 1960s and early 1970s, due in large part to an influx of countercultural radicals from the New Left.
Articles sur Murray Rothbard
« The life and times of Murray N. Rothbard, who showed why private individuals can do just about everything that needs to be done », Great Thinkers of Liberty.