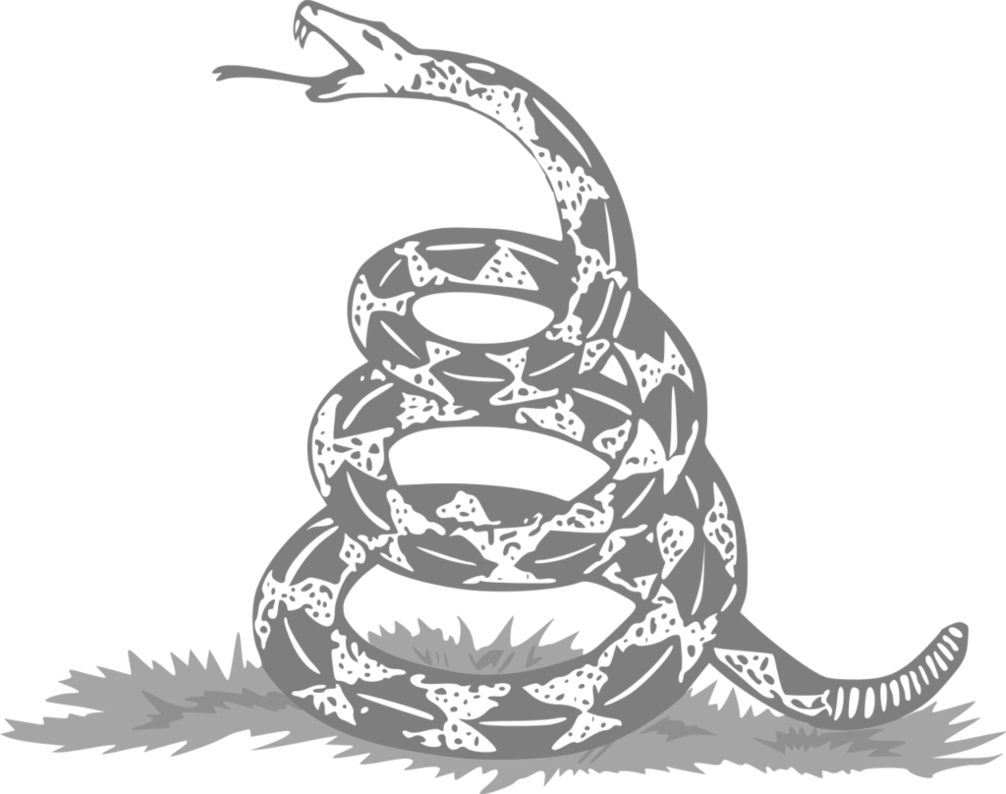L’analyse de classe marxiste et celle des Autrichiens
Présentation
« Marxist and Austrian Class Analysis », Journal of Libertarian Studies, Vol IX n°2, automne 1990. Repris comme chapitre 4 de The Economics and Ethics of Private Property (Boston : Kluwer Academic Publishers, 1993). Traduit et résumé par François Guillaumat.
Le reproche principal que l’on peut faire aujourd’hui au marxisme c’est d’avoir, par ses erreurs, ses crimes et son effondrement final, presque complètement discrédité une vision conflictuelle de l’histoire sociale et une dénonciation des classes exploiteuses qui sont pourtant plus pertinentes et plus urgentes que jamais. Cette analyse de classe, cette dénonciation des exploiteurs appartiennent à la tradition de la liberté naturelle. Marx n’a fait que la neutraliser et la pervertir au profit de l’oppression, en l’asservissant à une définition absurde de l’exploitation et à une méprise tragique sur l’identité des exploiteurs et la nature du pillage [F. G.].
Voici ce que j’entends faire dans cet article : tout d’abord, présenter des thèses qui constituent le noyau dur de la théorie marxiste de l’histoire. J’affirme que toutes sont justes pour l’essentiel. Ensuite, je montrerai comment, dans le marxisme, ces conclusions correctes sont déduites d’un point de départ erroné. Enfin, je montrerai comment l’école autrichienne, dans la tradition de Mises et Rothbard, peut donner une explication correcte, quoique catégoriquement différente, de leur validité.
L’accusation marxiste
Commençons par le noyau dur du système marxiste [1] :
— « L’histoire de l’humanité est l’histoire de la lutte des classes [2] » C’est l’histoire des luttes entre une classe dirigeante relativement restreinte et une classe plus large d’exploités. La première forme d’exploitation est économique : la classe dirigeante exproprie une partie de la production des exploités ou, comment disent les marxistes, « elle s’approprie un surplus social » et en dispose à ses fins propres de consommation.
— La classe dirigeante est unie par son intérêt commun à maintenir sa position exploiteuse et accroître au maximum son surplus d’exploitation. Elle n’abandonne jamais délibérément son pouvoir ni son revenu d’exploitation. Bien au contraire, on ne peut lui faire perdre pouvoir et revenu que par la lutte, dont le résultat dépend de la conscience de classe des exploités, c’est-à-dire de la mesure dans laquelle ces exploités sont conscients de leur propre sort et sont consciemment unis avec des autres membres de leur classe dans une opposition commune à leur exploitation.
— La domination de classe se manifeste principalement par des dispositions spécifiques sur l’affectation des droits de propriété ou, dans la terminologie marxiste, par des « relations de production » particulières. Pour protéger ces dispositions ou relations de production, la classe dirigeante forme et dirige l’État comme l’appareil de contrainte et de coercition. L’État impose et contribue à reproduire une structure de classe donnée par l’administration d’un système de « justice de classe », et favorise la création et l’entretien d’une superstructure idéologique destinée à fournir une légitimité au système de domination de classe.
— A l’intérieur, le processus de concurrence au sein de la classe dirigeante engendre la tendance à une concentration et à une centralisation croissantes. Un système polycentrique d’exploitation est progressivement remplacé par un système oligarchique ou monopolistique. De moins en moins de centres d’exploitation demeurent en fonction, et ceux qui restent sont de plus en plus intégrés dans un ordre hiérarchique. A l’extérieur, c’est-à-dire vis-à-vis du système international, ce processus interne de centralisation conduira (avec d’autant plus d’intensité qu’il sera plus avancé) à des guerres impérialistes entre États et à l’expansion territoriale de la domination exploiteuse.
— Finalement, la centralisation et l’expansion de la domination exploiteuse se rapprochant progressivement de sa limite ultime de domination mondiale, la domination de classe sera de moins en moins compatible avec le développement et l’amélioration ultérieures des « forces productives ». La stagnation économique et des crises deviennent de plus en plus caractéristiques et créent des « conditions objectives » pour l’émergence d’une conscience de classe révolutionnaire chez les exploités. La situation devient mûre pour l’établissement d’une société sans classes, le « dépérissement de l’État », le remplacement du « gouvernement des hommes par l’administration des choses [3] », et il en résulte une incroyable prospérité.
Toutes ces thèses peuvent faire l’objet d’une justification parfaitement satisfaisante, comme je vais le montrer. Mais malheureusement, c’est le marxisme, lequel souscrit à chacune d’entre elles, qui a plus fait que n’importe quel système idéologique pour les discréditer, en des déduisant d’une théorie de l’exploitation dont l’absurdité est patente.
En quoi consiste cette théorie marxiste de l’exploitation ? Pour Marx, les systèmes sociaux précapitalistes tels que l’esclavagisme et la féodalité sont caractérisés par l’exploitation. Jusqu’ici, pas d’objection ; à l’évidence, l’esclave n’est pas un travailleur libre, et on ne peut pas dire qu’il gagne à être réduit en esclavage. Bien au contraire, sa satisfaction en est réduite pour accroître la richesse de son maître. L’intérêt de l’esclave et celui de son maître sont donc, pour dire le moins, antagonistes. Il en est de même des intérêts du seigneur féodal qui exige du paysan un loyer pour la terre que lui-même (le paysan) avait été le premier à mettre en valeur pour son propre compte. [Lorsqu’il a volé sa terre et sa liberté] le gain du seigneur a été la perte du paysan. Et il n’est pas non plus douteux que l’esclavage aussi bien que la féodalité entravent le développement des forces productives. Ni l’esclave ni le serf ne seront aussi productifs qu’ils le seraient en l’absence d’esclavage ou de servage.
Non ; la seule idée nouvelle de Marx est que pour l’essentiel rien ne change pour ce qui est de l’exploitation dans un système capitaliste, c’est-à-dire lorsque l’esclave devient un travailleur libre, ou si le paysan décide de cultiver une terre qu’un autre a été le premier à mettre en valeur, et paie un loyer [fermage, etc.] en échange du droit de le faire. Il est vrai que Marx, dans le fameux chapitre 24 du premier tome de son Kapital, donne un compte-rendu de l’apparition du capitalisme qui entend démontrer qu’une grande part, sinon la plupart de la propriété capitaliste initiale résulte du pillage, de l’accaparement des terres et de la conquête. De même, dans le chapitre 25 sur la « théorie moderne du colonialisme », il souligne lourdement le rôle de la force et de la violence dans l’exportation du capitalisme [vers ce que nous appellerions] le Tiers-monde. On veut bien que tout cela soit grosso modo exact, et dans la mesure où ça l’est, on ne cherchera pas querelle à quiconque appellerait « exploiteur » ce capitalisme-là [4]. Cependant, on doit rester conscient du fait qu’ici, Marx se livre à une manipulation. En se lançant dans toutes ces recherches historiques pour exciter l’indignation du lecteur sur des brutalités commises en constituant la plupart des fortunes capitalistes, il esquive en réalité la question qui fait l’objet du débat. Il détourne notre attention du fait que sa thèse est en fait essentiellement différente, à savoir que, même si nous avions un capitalisme « propre », c’est-à-dire un capitalisme dans lequel l’appropriation originelle du capital ne résulte de rien d’autre que de la première mise en valeur, du travail et de l’épargne, le capitaliste qui embaucherait des travailleurs avec ce capital-là n’en serait pas moins exploiteur. En fait, Marx considérait même sa démonstration de cette thèse comme sa contribution la plus importante à l’analyse économique.
Quelle est donc sa fameuse démonstration du caractère exploiteur d’un capitalisme propre ?
Elle consiste à observer que des prix des facteurs de production, et notamment des salaires payés aux travailleurs par les capitalistes, sont plus faibles que des prix des produits vendus. Le travailleur, par exemple, touche un salaire représentant des biens de consommation qui peuvent être produits en trois jours, mais travaille en fait cinq jours pour ce salaire-là, et produit donc en biens de consommation davantage qu’il ne reçoit comme rémunération. La production de ces deux jours supplémentaires, la plus-value en termes marxistes, est appropriée par le capitaliste [5]. Par conséquent, prétend Marx, il y a exploitation [6].
Qu’est-ce qui cloche dans cette analyse [7] ? La réponse devient évidente, une fois qu’on s’est demandé pourquoi le travailleur accepterait jamais un tel échange. Il accepte parce que son salaire représente des produits actuels — alors que les services de son travail ne représentent que des produits futurs, et qu’il donne plus de valeur aux biens présents. Après tout, il pourrait aussi décider de ne pas vendre les services de son travail au capitaliste et récupérer lui-même la « valeur totale » de son produit. Mais cela impliquerait bien sûr qu’il attende plus longtemps que les produits de consommation lui deviennent accessibles. En vendant les services de son travail, il démontre qu’il préfère recevoir moins de produits de consommation aujourd’hui à en avoir éventuellement davantage demain. De son côté, pourquoi le capitaliste est-il d’accord pour faire affaire avec le travailleur ? Pourquoi accepte-t-il d’avancer des produits actuels (de l’argent) au travailleur en échange de services qui ne rapporteront que plus tard ? À l’évidence, il ne voudrait pas payer aujourd’hui 1 000 F s’il ne devait recevoir la même somme que dans un an. Dans ce cas, pourquoi ne pas garder des 1 000 F et avoir en plus l’avantage de l’avoir à portée pendant une année entière ? Non, il faut qu’il puisse s’attendre à recevoir davantage que les 1 000 F à l’avenir s’il doit des abandonner maintenant au travailleur. Il faut qu’il puisse faire un bénéfice, ou plus exactement recevoir un revenu d’intérêt. D’ailleurs il est aussi contraint d’une autre manière par la préférence temporelle, par le fait que celui qui agit préfère toujours une satisfaction immédiate à une même satisfaction dans l’avenir. Car si l’on peut obtenir une somme plus importante dans l’avenir quand on l’abandonne maintenant, pourquoi n’épargne-t-il pas davantage qu’il ne le fait ? Pourquoi n’embauche-t-il pas davantage de travailleurs, si chacun d’entre eux lui promet un revenu d’intérêt supplémentaire ? La réponse, ici, est aussi évidente : parce que le capitaliste est aussi consommateur, et qu’il ne peut éviter de l’être. Le montant de son épargne et de ses investissements est limité par ce fait nécessaire que lui aussi, comme le travailleur, a besoin d’une fourniture de produits actuels « assez grande pour assurer la satisfaction des besoins dont la satisfaction pendant l’attente est jugée plus urgente que des avantages qu’apporterait un allongement supplémentaire de la période de production [8]. »
Ce qui cloche, par conséquent, dans la théorie marxiste de l’exploitation est que celle-ci ne reconnaît pas le phénomène de la préférence temporelle comme catégorie universelle de l’action humaine [9]. Que le travailleur ne reçoive pas la « valeur totale » de son travail n’a rien à voir avec de l’exploitation mais reflète seulement le fait qu’il est impossible à un homme d’échanger des biens futurs contre des biens présents sans payer un escompte. Contrairement à la situation de l’esclave et du maître où le second exploite le premier, la relation entre le travailleur libre et le capitaliste est avantageuse pour les deux parties. Le travailleur entre dans l’accord parce que, étant donnée sa préférence temporelle, il préfère moins de biens tout de suite à davantage plus tard ; et le capitaliste le fait parce que, étant donnée sa préférence temporelle, il a un ordre de préférences inverse, qui place un plus grand volume de biens futurs au-dessus d’un plus petit maintenant. Leurs intérêts ne sont pas antagonistes mais harmonieux. Si le capitaliste n’attendait pas de revenu d’intérêt, le travailleur s’en trouverait plus mal, devant attendre plus longtemps qu’il ne souhaite attendre [10]. Et on ne peut pas non plus, comme Marx le fait, considérer le système salarial du capitalisme comme une entrave au développement ultérieur des forces productives. Si on ne permettait pas au travailleur de vendre ses services ni au capitaliste de des acheter, la production ne serait pas accrue mais amoindrie, parce qu’elle devrait se contenter d’un moindre capital accumulé.
Toujours contrairement aux proclamations de Marx, le développement de ces fameuses forces productives n’atteindrait pas de nouveaux sommets dans un système de production socialisée, mais s’effondrerait spectaculairement [11]. Car il est évident que le capital doit être créé à des endroits et à des instants déterminés, et ceci, par la première mise en valeur, par la production et l’épargne d’individus particuliers. Dans tous des cas, on l’accumule dans l’espoir qu’il amènera un accroissement dans la production de biens et services à venir. La valeur attachée à son capital par quelqu’un qui agit reflète la valeur qu’il attribue à l’ensemble des revenus qu’il peut attendre de sa coopération, escomptée par son taux de préférence temporelle. Si, comme c’est le cas de la possession collective des facteurs de production, un décideur n’a plus la maîtrise exclusive de son capital accumulé ni par conséquent des revenus futurs de son emploi ; si au contraire on permet à des non producteurs (au titre de la première mise en valeur ou de productions ultérieures) et à des non épargnants d’en disposer partiellement, cela réduira automatiquement la valeur pour lui des revenus futurs, et donc des capitaux matériels. La période de production, le caractère indirect de la structure de production, seront forcément raccourcis, et l’appauvrissement doit nécessairement en résulter.
Si la théorie de l’exploitation de Marx et ses idées sur la manière de mettre fin à l’exploitation et de faire régner la prospérité universelle sont fausses au point d’en être ridicules, il est clair que toute théorie de l’histoire qui en serait déduite doit être également fausse. Ou alors, si elle est juste, il faut qu’on l’en ait faussement déduite. Au lieu de m’astreindre à une laborieuse explication de toutes des fautes de raisonnement de l’argument marxiste, de son point de départ ridiculement erroné à la théorie de l’histoire que j’ai présentée au début — comme correcte - je vais prendre un raccourci. Je vais commencer par présenter, le plus rapidement possible, la théorie correcte de l’exploitation, c’est-à-dire la théorie autrichienne, celle de von Mises et de Rothbard ; je ferai une brève esquisse des justifications qu’elle donne à la théorie historique de la lutte des classes ; et au passage, je soulignerai aussi bien des différences essentielles entre la théorie autrichienne et la théorie marxiste que certaines affinités entre elles, issues de leur conviction commune que l’exploitation, la classe exploiteuse, ça existe bel et bien [12].
La définition autrichienne de l’exploitation
Le point de départ de l’analyse autrichienne de l’exploitation, comme il se doit, est simple et clair. En fait, on l’a déjà établi au cours de l’analyse de la théorie marxiste : l’exploitation caractérisait bel et bien la relation entre l’esclave et son maître ainsi qu’entre le serf et le seigneur féodal. Mais on n’a trouvé aucune exploitation possible dans le capitalisme propre. Quelle est la différence de principe entre des deux cas ? La réponse est : la reconnaissance ou non du principe du Droit de la première mise en valeur. Le paysan féodal est exploité parce qu’il n’a pas la maîtrise exclusive de la terre qu’il avait été le premier à mettre en valeur, et l’esclave n’est pas maître de son propre corps dont il était [c’est le cas de le dire] le premier occupant. Si, à l’inverse, chacun a la maîtrise exclusive de son propre corps (c’est à dire s’il est un travailleur libre) et agit en respectant le Droit du premier utilisateur, alors il ne peut pas y avoir d’exploitation. Il est logiquement absurde de prétendre que celui qui s’empare d’objets qui n’appartiennent encore à personne, ou qui emploie ces biens à des productions futures, ou épargne des biens ainsi appropriés ou produits pour accroître la disponibilité à venir des produits, pourrait exploiter qui que ce soit en le faisant. Personne n’a rien pris à personne au cours de ce processus, et on y a même produit davantage de biens. Et il serait également absurde de prétendre qu’un accord entre différents propriétaires initiaux, épargnants et producteurs quant à l’usage de leurs biens ainsi appropriés sans exploitation pourrait impliquer une injustice quelconque dans ce cas. Bien au contraire, c’est lorsqu’un écart, quel qu’il soit, se produit par rapport au principe de la première mise en valeur que l’exploitation a lieu. C’est de l’exploitation, lorsqu’une personne fait prévaloir ses prétentions à une maîtrise totale ou partielle de biens qu’elle n’a pas été la première à mettre en valeur, qu’elle n’a pas produits, ou qu’elle n’a pas acquis par contrat auprès d’un producteur-propriétaire antérieur. L’exploitation, c’est l’expropriation des premiers utilisateurs, producteurs et épargnants par des non premiers utilisateurs, des non producteurs, des non épargnants arrivés par la suite. C’est l’expropriation de gens dont des prétentions sur leur propriété se fondent sur le travail et le contrat par des gens dont des prétentions sortent on ne sait d’où, et qui ne tiennent absolument aucun compte du travail et des contrats des autres [13].
Inutile de dire que l’exploitation ainsi définie est partie intégrante de l’histoire humaine. Il y a deux manières de s’enrichir : ou bien on met en valeur des ressources inutilisées, on produit, épargne, passe des contrats, ou bien alors on exproprie ceux qui ont mis en valeur, produit, épargné et passé des contrats. Il y a toujours eu, à côté de la mise en valeur, de la production et de l’épargne, des acquisitions de propriété non productives et non contractuelles. Et au cours de l’évolution économique, tout comme des producteurs et des contractants peuvent se constituer en sociétés, en entreprises, en associations, des exploiteurs peuvent se combiner pour former des entreprises d’exploitation à grande échelle, États et gouvernements. La classe dirigeante (laquelle, encore une fois, peut être hiérarchisée) est au départ composée des membres de ces entreprises d’exploitation. De sorte qu’avec une classe dirigeante installée sur un territoire donné et se livrant à l’exploitation des ressources économiques d’une classe de producteurs exploités, le centre de toute histoire devient bel et bien la lutte entre exploiteurs et exploités. Alors, l’histoire, pertinente est essentiellement celle des victoires et des défaites des maîtres dans leurs tentatives pour accroître au maximum leur revenu d’exploiteurs et celle des sujets dans leurs tentatives pour freiner et inverser cette tendance. C’est sur cette évaluation de l’histoire que des Marxistes et des Autrichiens tombent d’accord, et c’est pourquoi il existe une affinité remarquable entre des recherches historiques de l’une et l’autre école. L’une et l’autre s’opposent à une historiographie qui ne reconnaît qu’actions et interactions, toutes traitées sur un pied d’égalité moral ou économique ; et des deux s’opposent également à une historiographie pour qui, en lieu et place de cette neutralité, il conviendrait de rehausser son récit par des jugements de valeur purement subjectifs. Non : il faut raconter l’histoire en termes de liberté et d’exploitation, de parasitisme et d’appauvrissement, de propriété privée et de sa destruction. Sinon, on la présente faussement [14].
Alors que des entreprises productrices apparaissent et disparaissent pour cause de soutien volontaire ou de son absence, une classe dirigeante n’arrive jamais au pouvoir parce qu’il existerait une demande pour ses services, et elle n’abdique pas non plus lorsqu’il est visible que l’on souhaite son abdication. C’est vraiment trop en demander à l’imagination que de prétendre que des premiers utilisateurs, producteurs, parties aux contrats, auraient exigé qu’on des exproprie. On doit des forcer à s’y résigner, et cela prouve de manière définitive qu’il n’existait aucune demande pour cela. On ne peut pas dire non plus qu’il soit possible de jeter à bas une classe dirigeante en s’abstenant de toute transaction avec elle, comme on réduit à la faillite une entreprise productive. C’est de transactions non productives et non contractuelles que la classe dirigeante tient son revenu, et aucun boycott ne peut l’affecter. Bien plutôt, ce qui rend possible l’émergence d’une entreprise d’exploitation, et ce qui à l’inverse peut l’abattre, est un état particulier de l’opinion publique ou, en terminologie marxiste, un état particulier de la conscience de classe.
Un exploiteur fait des victimes, et des victimes sont des ennemis potentiels. Il est envisageable que cette résistance puisse être durablement brisée par la force dans le cas d’un groupe d’hommes en exploitant un autre de taille à peu près semblable. En revanche, il faut bien davantage que la force pour développer l’exploitation d’une population plusieurs fois plus nombreuse. Pour y parvenir, l’entreprise doit avoir le soutien de l’opinion. Il faut qu’une majorité de la population accepte comme légitimes des actes qui assurent l’exploitation. Cette acceptation peut osciller entre l’enthousiasme actif et la résignation passive. Mais il doit s’agir d’acceptation, en ce sens que la majorité doit avoir abandonné l’idée de résister activement ou passivement à toute tentative pour imposer des acquisitions de propriété non productives et non contractuelles. La conscience de classe doit être faible, sous-développée, floue. C’est seulement si cet état de choses se maintient qu’une entreprise d’exploitation peut prospérer alors même que personne n’en a besoin. Le pouvoir de la classe dirigeante peut être brisé que si, et dans la mesure où, exploités et expropriés acquièrent une idée claire de leur propre état, et s’unissent à d’autres membres de leur classe dans un mouvement idéologique qui traduit l’idée d’une société sans classes où toute exploitation est abolie. Ce n’est que si, et dans la mesure où la majorité du public exploité s’intègre consciemment dans un tel mouvement, et si tous s’indignent des acquisitions de propriété non productives et non contractuelles, affichent leur mépris envers quiconque se livre à de tels actes, et refuse délibérément de contribuer en rien à leurs entreprises, qu’on peut amener ce pouvoir à s’effondrer.
L’affaiblissement historique de la conscience de classe
L’abolition progressive de la domination féodale et absolutiste, l’apparition de sociétés de plus en plus capitalistes en Europe occidentale et aux États-Unis, et en conséquence un développement inouï de la production et de la population, cette abolition avait été le résultat d’une prise de conscience accrue de la part des exploités, soudés ensemble par l’idéologie libérale des droits naturels. Jusqu’ici, marxistes et Autrichiens sont d’accord [15]. Là où ils ne le sont pas, en revanche, c’est le jugement porté sur ce qui suit : à la suite d’une dégradation de la conscience de classe, le processus de libéralisation s’est inversé, le niveau d’exploitation s’accroissant sans cesse dans ces sociétés depuis le dernier tiers du XIX° siècle, particulièrement depuis la première guerre mondiale. En fait, pour des Autrichiens, le marxisme porte une grande part de responsabilité de cette dégradation, en faisant perdre de vue la conception correcte de l’exploitation, celle dont des propriétaires initiaux, producteurs, parties aux contrats sont victimes de la part de ceux qui n’ont rien produit ni passé aucun contrat, et mettant en avant, dans la pire confusion, la fausse opposition du capitaliste et du salarié [16].
L’institution d’une classe dirigeante sur une classe exploitée plusieurs fois plus nombreuse par la violence et la manipulation de l’opinion publique, c’est-à-dire un niveau faible de conscience de classe chez des exploités, trouve son expression institutionnelle la plus fondamentale dans la création d’un système de « droit public » surimposé au droit privé. La classe dirigeante se met elle-même à part et protège sa situation dominante en adoptant une constitution pour le fonctionnement interne de son entreprise. D’un certain côté, en formalisant le fonctionnement interne de l’État de même que ses relations avec la population exploitée, une constitution crée un certain degré de stabilité juridique. Plus on incorpore de notions familières et populaires du droit privé dans le « droit » public et constitutionnel, et plus cela contribuera à créer des conditions d’une opinion publique favorable. En revanche, toute constitution ou « droit » public formalise en même temps le statut d’exemption de la classe dirigeante en ce qui concerne le principe de l’appropriation non agressive. Ils rationalisent le « droit » des représentants de l’État de se livrer à des acquisitions de propriété non contractuelles et non productives et la subordination finale du droit privé au « droit » public [17].
Une justice de classe, c’est-à-dire un dualisme qui institue un ensemble de lois pour des dirigeants et un autre pour des dirigés, finit par marquer ce dualisme entre « droits » public et privé, cette domination et cette infiltration du droit privé par le « droit » public. Ce n’est pas comme le croient des marxistes, parce que des droits de propriété sont reconnus par la loi qu’il y a une justice de classe. Bien au contraire, la justice de classe apparaît chaque fois qu’il existe une distinction légale entre une classe de personnes agissant selon le « droit » public et protégée par lui et une autre classe agissant selon une catégorie de droit privé qui lui est subordonnée, alors qu’il est censé la protéger. Plus particulièrement, donc, la proposition fondamentale de la théorie marxiste de l’État, (entre autres) est fausse. L’État n’est pas exploiteur parce qu’il protège des droits de propriété des capitalistes, mais parce qu’il est lui-même exempt de la contrainte d’avoir à acquérir sa propriété par la production et le contrat [18].
Que vaut l’analyse marxiste de l’état ?
En dépit de cette méprise fondamentale, cependant, le marxisme, parce qu’il interprète à juste titre l’État comme exploiteur (contrairement, par exemple, à l’école des choix publics, qui a tendance à le donner pour une entreprise comme des autres) , [19] a bien compris certains principes fondamentaux de son fonctionnement.
Pour commencer, il reconnaît la fonction stratégique des politiques redistributives de l’État. En tant qu’entreprise exploiteuse, l’État est à tout moment intéressé à ce qu’un bas niveau de conscience de classe règne parmi ses sujets. La redistribution de la propriété et du revenu - une politique du « diviser pour régner » - est le moyen que l’État utilise pour lancer des pommes de discorde au sein de la société et détruire la formation d’une conscience de classe unificatrice chez des exploités. En outre, la redistribution du pouvoir d’État lui-même en démocratisant la constitution de l’État, en ouvrant à tout le monde des positions de pouvoir et en donnant à tout le monde le droit de participer au choix du personnel et de la politique de l’État, est un moyen de réduire la résistance à l’exploitation en tant que telle.
Deuxièmement, l’État est bel et bien, comme des marxistes le conçoivent, le grand centre de la propagande et de la mystification idéologique : l’exploitation, c’est la liberté ; des impôts sont des contributions volontaires ; des relations non contractuelles sont « conceptuellement » contractuelles ; personne ne commande à personne, nous nous dirigeons nous-mêmes ; sans l’État il n’y aurait ni droit ni sécurité ; et des pauvres mourraient de faim, etc. Tout cela appartient à la superstructure idéologique qui vise à légitimer une infrastructure d’exploitation économique [20].
Et finalement, des marxistes ont aussi raison d’identifier une étroite association entre l’État et des capitalistes, et plus particulièrement la haute finance — même si l’explication qu’ils en donnent est indéfendable. La raison n’en est pas que l’établissement bourgeois considère l’État et le soutient comme garant des droits de propriété et du contractualisme. Bien au contraire, il le considère à juste titre comme l’antithèse même de la propriété privée (ce qu’il est bel et bien) et c’est bien pour cette raison qu’il s’y intéresse de très près. Plus une entreprise réussit, et plus grand est le danger qu’elle soit exploitée par l’État, mais aussi plus grands sont des gains potentiels à réaliser si elle peut se faire accorder par l’État une protection particulière qui l’exempte partiellement de la contrainte de la concurrence capitaliste. C’est pourquoi l’établissement capitaliste s’intéresse à l’État et souhaite l’infiltrer. De son côté, l’élite dirigeante s’intéresse à une coopération étroite avec l’établissement capitaliste à cause de son pouvoir financier. En particulier, la haute finance présente un intérêt, parce qu’en tant qu’entreprise d’exploitation, l’État désire naturellement posséder une autonomie complète pour faire de la fausse monnaie. En offrant d’associer l’élite bancaire à ses propres projets de faux monnayeur, et en leur permettant de profiter de la contrefaçon à partir de ses billets de la Sainte Farce dans le système bancaire à couverture partielle [21], l’État peut facilement atteindre ce but et instituer un système de monopole d’émission monétaire et de cartel bancaire dirigé par la banque centrale. De sorte que, à travers cette complicité directe dans la production de fausse monnaie avec le système bancaire et, par extension, avec des plus gros clients desdites banques, la classe dirigeante s’étend en fait bien au-delà de l’appareil d’État, jusqu’aux centres nerveux de la société civile - ce qui n’est pas très différent, en apparence, de la peinture que des marxistes prétendent faire de la coopération entre la banque, des élites capitalistes et l’État [22].
La concurrence au sein de la classe dirigeante et entre des différentes classes dirigeantes produit une tendance à la concentration croissante. En cela, le marxisme a raison. Cependant, sa fausse théorie de l’exploitation le conduit encore une fois à en voir la cause là où elle ne se trouve pas. Le marxisme croit que cette tendance est inhérente à la concurrence capitaliste. Or, c’est justement lorsque des gens pratiquent le capitalisme propre que la concurrence n’est pas une forme d’interaction à somme nulle. Le premier utilisateur, le producteur, épargnant, partie aux contrats ne profitent jamais aux dépens des uns des autres. Ou bien leurs gains laissent des possessions matérielles des autres complètement intactes ou bien (comme dans le cas de tous des échanges contractuels) ils impliquent en fait un profit pour des deux parties. C’est ainsi que le capitalisme peut justifier des accroissements de richesse absolus. Mais dans son système, il est impossible de prétendre qu’il existe une quelconque tendance systématique à la concentration [23]. En revanche, des interactions à somme nulle caractérisent non seulement des relations entre des maîtres et des sujets, mais entre des exploiteurs rivaux eux-mêmes. L’exploitation, définie comme des acquisitions de propriété non productives et non contractuelles, ne peut exister que là où il y a quelque chose à exproprier. A l’évidence, si la concurrence était libre dans le business de l’exploitation, il ne resterait évidemment plus rien à exproprier. De sorte que l’exploitation nécessite un monopole sur un territoire et une population donnés ; et la concurrence entre des exploiteurs est par sa nature même éliminatoire, et doit amener une tendance à la concentration des entreprises exploiteuses de même qu’à la centralisation au sein de chaque entreprise. L’évolution des États, par opposition à celle des entreprises capitalistes, fournit l’illustration la plus évidente de cette tendance : il existe aujourd’hui un bien plus petit nombre d’États, qui contrôlent et exploitent de bien plus vastes territoires qu’au cours des siècles passés. Et au sein de chaque appareil d’État, il y avait une tendance de fait à l’accroissement des pouvoirs de l’État central aux dépens de ses subdivisions locales et régionales. Cependant, et pour la même raison, on a aussi pu observer une tendance à la concentration relative en-dehors de l’appareil d’État. Ce n’est pas, comme on devrait le comprendre sans peine désormais, à cause d’un trait inhérent au capitalisme, mais parce que la classe dirigeante a étendu son emprise jusqu’au coeur de la société civile par la création d’une alliance entre l’État et la haute finance, et notamment l’institution d’un système de banque centrale. S’il se produit une concentration et une centralisation du pouvoir d’État, il est tout naturel que celles-ci s’accompagnent d’un processus parallèle de concentration relative et de cartellisation de la banque et de l’industrie. Avec l’accroissement des pouvoirs de l’État, s’accroît également celui de la Banque et de l’Industrie associées d’éliminer ou de défavoriser leurs concurrents économiques au moyen d’expropriations non contractuelles et non productives. La concentration des entreprises est un reflet de l’étatisation de la vie économique [24].
L'impérialisme
Les premiers moyens de l’expansion du pouvoir d’État et de l’élimination des centres de pouvoir rivaux sont la guerre et la domination militaire. La concurrence entre des États implique une tendance à la guerre et à l’impérialisme. En tant que centres d’exploitation, leurs intérêts sont par nature antagonistes. En outre, comme chacune possède - à l’intérieur - le contrôle du fisc et de la production de la fausse monnaie, il est possible aux classes dirigeantes de faire financer leurs guerres impérialistes par des autres. Naturellement, si on ne doit pas financer soi-même des paris risqués que l’on prend, si on peut forcer des autres à payer des pots cassés, on a tendance à prendre un peu de risques et à devenir un peu plus amoureux de la gâchette que si on ne le pouvait pas [25]. Le marxisme, contrairement à une bonne partie de la science dite bourgeoise, présente des choses telles qu’elles sont : il existe bel et bien une tendance à l’impérialisme à l’oeuvre dans l’histoire ; et des plus grandes puissances impérialistes sont bel et bien des pays capitalistes des plus avancés. Et pourtant, l’explication est une fois de plus erronée. C’est l’État, en tant qu’institution exempte des règles capitalistes d’acquisition de la propriété qui est par nature agressif. Et l’évidence historique d’une corrélation étroite entre le capitalisme et l’impérialisme ne contredit cette explication qu’en apparence. Il est extrêmement facile de l’expliquer en rappelant que, pour se tirer avec succès d’une guerre entre États, un gouvernement doit pouvoir disposer (en termes relatifs) de ressources suffisantes. Toutes choses égales par ailleurs, c’est l’État qui a le plus de ressources qui l’emportera. En tant qu’entreprise exploiteuse, l’État est par nature destructeur de richesse et de capital. La richesse est produite exclusivement par la société civile ; et plus faibles sont des pouvoirs d’extorsion de l’État, plus la société accumule de richesses et de capital productif. Ainsi, aussi paradoxalement que cela puisse paraître d’abord, plus un État est faible ou libéral et plus le capitalisme y est développé ; une économie capitaliste à piller rend l’État plus riche ; et un État plus riche permet de plus en plus de guerres expansionnistes menées avec succès. C’est cette relation-là qui explique pourquoi ce sont au départ des États d’Europe occidentale, et en particulier la Grande-Bretagne, qui furent des pays impérialistes dominants, et pourquoi au XX° siècle ce rôle a été repris par des États-Unis.
Il existe aussi une explication toute aussi directe et une fois de plus entièrement non marxiste à cette observation sur laquelle des marxistes insistent toujours, que l’établissement bancaire et industriel figure généralement parmi des défenseurs des plus ardents de la puissance militaire et de l’expansionnisme impérial. Ce n’est pas parce que l’expansion des marchés capitalistes aurait besoin de l’exploitation, mais parce que le développement des affaires privilégiées et protégées par des hommes de l’État nécessite que cette protection s’étende aussi aux pays étrangers et qu’ils entravent autant, sinon plus des concurrents non résidents par des acquisitions de propriété non productives et non contractuelles qu’ils ne le font aux concurrents résidents. Spécifiquement, il soutient l’impérialisme s’il promet de conduire à la domination militaire d’un pays par un autre. Car alors, à partir d’une position de force militaire, il devient possible d’établir - ce qu’on peut appeler - un système d’impérialisme monétaire. L’État dominant utilisera son pouvoir pour imposer une politique d’inflation internationale coordonnée. Sa propre banque centrale mène le train de la contrefaçon, et des banques centrales des États subordonnés reçoivent l’ordre d’employer sa devise comme réserves et de faire de l’inflation sur cette base. De cette manière, en même temps que l’État dominant et en tant que premiers receleurs de la fausse monnaie de réserve, son établissement bancaire et industriel peut se livrer à une expropriation quasi gratuite des propriétaires et producteurs étrangers. Une double couche d’exploiteurs s’impose désormais aux classes exploitées des territoires dominés : en plus de son propre État national et de son élite, l’État et l’élite d’un pays étranger, ce qui cause une dépendance économique prolongée et une stagnation économique relative vis-à-vis de la nation dominante. C’est cette situation - tout à fait non capitaliste - qui caractérise le statut des États-Unis et du Dollar U. S. et qui donne lieu à l’accusation - parfaitement justifiée - d’exploitation et d’impérialisme du dollar par des États-Unis [26].
La révolution à venir ?
Finalement, la concentration croissante et la centralisation des pouvoirs d’exploitation conduisent à la stagnation économique et créent par là des conditions objectives de leur chute finale, ainsi que de l’établissement d’une société sans classes capable de produire une prospérité économique inouïe.
Contrairement aux affirmations marxistes, cependant, ceci n’est pas le résultat de lois du développement historique. En fait, il n’existe rien de tel que ces prétendues lois inexorables de l’histoire telles que des marxistes des imaginent [27]. Il n’y a pas non plus, comme le croyait Marx, de « tendance à la baisse du taux de profit » du fait d’un « accroissement dans la composition organique du capital » (à savoir, un accroissement de la proportion du capital fixe par rapport au capital variable). De même que la théorie de la valeur-travail est irrémédiablement fausse, c’est aussi le cas de la baisse tendancielle du taux de profit, qui en est déduite. La source de la valeur, de l’intérêt et du profit n’est pas exclusivement la dépense de travail matériel, mais bien plus généralement : l’action humaine, c’est-à-dire l’emploi de ressources rares au service de leurs projets par des gens qui sont contraints par la préférence temporelle et par l’incertitude (la connaissance imparfaite). Il n’y a donc aucune raison de supposer que des changements dans la « composition organique » du capital doivent avoir aucune relation systématique avec des changements dans l’intérêt et le profit.
Ce qui se passe, c’est que l’éventualité des crises qui stimulent le développement d’un plus haut degré de conscience de classe (c’est-à-dire des conditions subjectives d’un renversement de la classe dirigeante) s’accroît à cause - pour employer un terme favori de Marx - de la « dialectique » de l’exploitation que j’ai déjà mentionnée plus haut : l’exploitation détruit la formation du capital. De sorte que, au cours de la concurrence entre firmes exploiteuses, c’est-à-dire des États, des moins exploiteuses ou plus libérales tendent à l’emporter sur celles qui le sont davantage parce qu’elles disposent de plus amples ressources. Le processus impérialiste commence donc par avoir un effet relativement libérateur sur des sociétés qui passent sous sa coupe. Un modèle de société relativement plus capitaliste est exporté vers des sociétés relativement moins capitalistes (c’est-à-dire plus exploiteuses). Cela stimule le développement des forces productives, favorise l’intégration économique, établit un véritable marché mondial. La population s’accroît en conséquence, et des espoirs concernant l’avenir économique s’élèvent à des hauteurs inouïes [28]. Cependant, à mesure que la domination exploiteuse raffermit son emprise, disparaissent progressivement des contraintes externes qui limitaient le pouvoir d’exploitation et d’expropriation internes de l’État dominant. L’exploitation interne, l’imposition et la réglementation commencent à s’accroître à mesure que la classe dirigeante se rapproche de son but final de domination mondiale. La stagnation économique s’installe et des espoirs - mondiaux - d’amélioration sont frustrés. Et cette situation : des espérances élevées et une réalité économique qui dément de plus en plus ces attentes, est la situation classique pour qu’un potentiel révolutionnaire se développe [29]. Apparaît alors un besoin désespéré pour des solutions idéologiques à la crise qui s’annonce, en même temps qu’une reconnaissance plus étendue du fait que la domination étatique, l’imposition et la réglementation - loin d’offrir une solution - constituent en fait le problème même qu’il faut surmonter. Si, dans cette situation de stagnation économique, de crises, et de désillusion idéologique [30], une solution positive est offerte sous la forme d’une philosophie libérale systématique couplée avec son homologue économique : la théorie économique autrichienne ; si cette idéologie est propagée par un mouvement activiste, alors des perspectives d’un embrasement effectif de ce potentiel révolutionnaire deviennent extraordinairement prometteuses et favorables. Les pressions antiétatiques s’élèveront et induiront une tendance irrésistible au démantèlement du pouvoir de la classe dirigeante et de l’État comme instrument de son exploitation [31].
Si cela se produit, et dans la mesure où cela le fera, cela ne signifiera pas - contrairement au modèle marxiste - la propriété collective des moyens de production. En fait, la propriété « sociale » n’est pas seulement inefficace comme nous l’avons vu ; elle est en outre incompatible avec l’idée que « l’État » puisse jamais « dépérir » . Car si des moyens de production sont possédés collectivement, et si l’on suppose, ce qui est réaliste, que des idées de tout le monde quant à l’emploi de ces moyens ne coïncideront pas toujours (le contraire serait miraculeux), alors ce sont précisément des facteurs de production socialement possédés qui nécessiteront une intervention perpétuelle de l’État, c’est-à-dire d’une institution qui puisse par la force imposer la volonté de l’un contre celle d’un autre qui s’y opposerait. Bien au contraire, le dépérissement de l’État, et avec lui la fin de l’exploitation et le début de la liberté ainsi que d’une prospérité économique inouïe, impliquent l’avènement d’une société de pure propriété privée sans autre régulation que celle du droit privé.
Notes
[1] Cf. sur ce qui suit : Karl Marx/Frederick Engels, The Communist Manifesto (1848) [Manifeste du Parti commu?niste] ; Karl Marx, Das Kapital, 3 t. (1867, 1885, 1894) [Le Capital] ; pour des marxistes contemporains, Ernest Mandel, Marxist Economic Theory (Londres, Merlin, 1962) ; Late Capitalism (Londres : New Left Books, 1975) ; P. Baran/P. Sweezy, Monopoly Capital (New York : Monthly Review Press, 1966). Pour un point de vue non marxiste, Leszek Kolakowski, Main Currents of Marxism (Oxford : Clarendon Press, 1976-78) ; G. Wetter, Sowjetideologie heute, t. 1 (Francfort/M. : Fischer, 1962) ; W. Leonhard, Sowjetideologie heute, t. 2, (Francfort/M. : Fischer, 1962).
[2] Manifeste du Parti communiste (1° partie).
[3] Manifeste du Parti communiste (section 2, 2 derniers paragraphes) F. Engels, Von der Autorität, in : K. Marx/F. Engels, Ausgewählte Schriften, 2 t. (Berlin-Est : Dietz, 1953), vol. 1, p. 606 ; du même, Die Entwicklung von der Utopie zur Wissenschaft, ibid. t. 2, p. 139. [4] [N.d.T.] On peut quand même souligner que parler de « capitalisme » à propos d’entreprises financées par le vol contredit la définition marxiste du capitalisme comme « système de la propriété privée ». C’est d’autant plus grave que le marxisme contribue par ailleurs à renforcer cette confusion, sous le même nom de « capitalisme », du régime de la propriété privée (lequel, par définition, respecte et fait respecter la propriété) et un pouvoir dominé par certains capitalistes, qui ont violé et violent le droit de propriété à leur profit .
[5] [N.d.T.] Ceci, rappelons-le, suppose un régime purement capitaliste : c’est-à-dire que des voleurs légaux ne viennent pas confisquer chez le capitaliste une partie du salaire du travailleur. Conditions fort différentes de ce qu’il en est aujourd’hui où les hommes de l’État, dont les exploiteurs syndicalistes, amputent de moitié la rémunération des travailleurs sous prétexte de « sécurité sociale », « versement transport », « 1 % logement », etc. Rappelons pour ceux qui ignorent la théorie économique, et notamment la théorie de l’incidence fiscale, que c’est aussi en partie le cas - en dépit de ce que prétend le droit positif - de la TVA, de la taxe professionnelle et même de l’impôt sur les sociétés, sans parler des diverses contraintes réglementaires qui toutes réduisent le salaire. Par conséquent, même si la « plus-value » du capitaliste était vraiment exploiteuse, elle serait complètement noyée aujourd’hui par l’exploitation démocrate-sociale.
[6] Cf. K. Marx, Das Kapital, t. 1 ; la présentation la plus courte est Lohn, Preis, Profit [« Salaire, prix, profit »]. En réalité, s’il s’agissait de prouver la thèse plus spécifiquement marxiste suivant laquelle le propriétaire du travail (le travailleur) est le seul exploité (mais pas le propriétaire de l’autre facteur de production d’origine : la terre), un autre argument serait nécessaire. Car s’il était vrai que l’écart entre le prix des facteurs et celui des produits traduit une exploitation, cela montrerait seulement que le capitaliste qui loue les services de son travail au propriétaire du travail, et les services de sa terre au propriétaire de la terre, exploiterait soit le premier, soit le second, soit les deux à la fois. C’est la valeur-travail, évidemment, qui est censée fournir le chaînon manquant en essayant d’établir que le travail est la seule source de la valeur. Je m’épargnerai le souci de réfuter cette théorie. Il y en a peu aujourd’hui, y compris parmi ceux qui se disent marxistes, qui ne reconnaissent pas le caractère erroné de la théorie de la valeur-travail. J’accepterai plutôt pour les besoins de la démonstration la suggestion faite par J. Roemer, qui se dit « marxiste analytique » [A General Theory of Exploitation and Class (Cambridge : Harvard University Press, 1982) ; du même, Value, Exploitation and Class (Londres : Harwood Academic Publishers, 1985)], comme quoi on pourrait analytiquement séparer la théorie de l’exploitation de la théorie de la valeur-travail, et formuler une théorie générale de l’« exploitation des facteurs de production » qui en serait distincte, et que l’on pourrait justifier que celle-ci soit vraie ou non. J’entends pour ma part démontrer que la théorie marxiste de l’exploitation est absurde même si on devait dispenser ses partisans de prouver la théorie de la valeur-travail, et même d’ailleurs si celle-ci était vraie. Même une théorie généralisée de l’exploitation des facteurs de production ne fournirait aucun moyen d’échapper à la conclusion que la théorie marxiste de l’exploitation est irrémédiablement fausse.
[(N.d.T.). Il y a lieu de distinguer la thèse correcte suivant laquelle le travail humain est la source de toute valeur produite de la fausse théorie de la valeur-travail, qui prétend que la valeur d’un produit serait « mesurée » par la « quantité de travail » qui a servi à le produire. La première thèse est parfaitement vraie, à condition qu’on définisse correctement le travail comme toute action accomplie en vue d’un résultat. En particulier, le facteur de production « terre » n’a pas de valeur qui ne lui ait été donnée au départ par l’action productive de quelqu’un. Il n’y a donc pas de « ressources naturelles » : c’est à dire qu’il n’y a pas de matières premières qui, ayant bien sûr une existence et des caractéristiques physiques, auraient une valeur, c’est-à-dire une existence économique, avant que l’esprit de quelqu’un n’en fasse le moyen d’un projet personnel. Si la théorie économique autrichienne distingue la terre des autres capitaux matériels, c’est dans la mesure où celle-ci, par définition, ne peut pas être renouvelée par des actes productifs. Mais comme pour tout capital matériel, c’est l’action humaine qui lui a donné de la valeur.
La seconde thèse commet l’erreur de confondre les caractéristiques matérielles de l’objet avec sa valeur, qui est l’opinion de celui qui agit sur la capacité éventuelle de ces caractéristiques matérielles à servir un projet particulier. Cette erreur avait conduit Ricardo à prétendre que les propriétés naturelles du sol ne sauraient avoir de valeur en soi parce qu’elles ne résultent pas d’un travail. Quiconque loue sa terre ne peut donc les monnayer que parce qu’il les « monopolise » en quelque sorte (ce sophisme contribue aujourd’hui encore à la domination du concept absurde de « monopole-sur-un-marché libre »). Et comme la propriété du sol est nécessaire à l’ordre social, la nature humaine est bien intrinsèquement immorale, comme l’envisage le Calvinisme de son Mentor James Mill. Marx suit fidèlement Ricardo : il n’aurait probablement pas cru que des « Marxistes » imagineraient que le capitalisme « exploite » les propriétaires de la terre. Il reprend l’idée d’« anomalie inhérente » à la propriété privée, mais dans le genre optimiste : celle-ci est censée disparaître dans l’étape ultérieure du développement historique. Son erreur à lui consiste à déduire du fait que le prolétaire est propriétaire de son travail (il reconnaît la propriété naturelle !) l’idée qu’il aurait « droit » à la valeur finale de son travail. Ce qui n’est pas seulement méconnaître la différence entre valeur actuelle négociée et valeur future éventuelle mais en fait n’a littéralement aucun sens puisque la valeur traduit un jugement personnel : on ne peut pas définir de « droits » sur la pensée de quelqu’un]
[7] Cf. sur ce qui suit : Eugen von Böhm-Bawerk, The Exploitation Theory of Socialism-Communism (South Holland : Libertarian Press, 1975) ; Shorter Classics of Böhm-Bawerk (South Holland : Libertarian Press, 1962).
[8] Ludwig von Mises, Human Action (Chicago : Regnery, 1966), p. 407 [L’Action Humaine (Paris : PUF, 1985)] ; cf. aussi Murray N. Rothbard, Man, Economy and State (Los Angeles : Nash, 1970), pp. 300-01.
[9] Sur la théorie de l’intérêt comme fondée sur la préférence temporelle, voir, en plus des ouvrages cités aux notes 5 et 6, Frank Fetter, Capital, Interest and Rent : Essays in the Theory of Income Distribution (Kansas City : Sheed Andrews & McMeel, 1977).
[10] L’auteur avait écrit ici : « et sans la préférence du travailleur pour des biens présents, le capitaliste s’en trouverait plus mal, étant forcé de recourir à des méthodes de production moins longues et moins efficaces que celles qu’il désire adopter ». Comme je traduis ce texte pour mes besoins propres, je m’autorise froidement à censurer cette sottise, qui est le contraire de la vérité : bien au contraire, si par extraordinaire impensable, ce travailleur-là n’avait aucune préférence temporelle, le taux d’intérêt sur les marchés du temps serait plus bas : en toute logique, si l’on peut dire, il serait même nul et la structure de production pourrait être indéfiniment allongée. Car si sa préférence temporelle disparaissait, cela voudrait dire que ses propres capitaux matériels seraient surabondants. Il pourrait alors prêter à l’infini au reste de la société, dont la préférence temporelle disparaîtrait alors à son tour. Si elle disparaissait ainsi, la structure de production serait infinie, etc. C’est dire si cette éventualité est absurde, même si les économistes néo-classiques l’envisagent comme « possible » et pour certains, « normale » [N.d.T.].
[11] Cf. sur cette question H. H. Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism (Boston : Kluwer Academic Publishers, 1989) ; du même, « Why Socialism Must Fail », Free Market, juillet 1988 ; « The Economics and Sociology of Taxation », Journal des Economistes et des Etudes Humaines (Aix en Provence, 1990) ; The Economics and Ethics of Private Property, ch. 2.
[12] Les contributions de Ludwig von Mises à la théorie de l’exploitation et de la lutte des classes ne sont pas systématiquement présentées. Cependant, dans l’ensemble de ses écrits, il présente des interprétations sociologiques et historiques qui sont des analyses de classe, même si ce n’est qu’implicitement. On peut notamment mentionner ici son analyse aiguë de la collaboration entre les hommes de l’État et l’élite bancaire dans la destruction de l’étalon-or, afin d’accroître leur pouvoir de faire de l’inflation comme moyen de fraude et d’exploitation pour redistribuer revenus et richesses en leur faveur. [Par exemple, cf. sa Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik (1928), traduit comme « Monetary Stabilization and Cyclical Policy » in : On the Manipulation of Money and Credit, ed. Percy Greaves (Dobbs Ferry : Free Market Books, 1978) ; du même, Socialism (Indianapolis : Liberty Fund, 1981) [Le Socialisme], ch. 20 ; The Clash of Group Interests and Other Essays (New York : Center for Libertarian Studies, Occasional Paper Series n°7, 1878)]. Cependant, Mises ne donne pas de statut systématique à l’analyse de classe et à l’exploitation parce que finalement il attribue à tort cette exploitation à l’erreur intellectuelle qu’un raisonnement économique correct pourrait dissiper. Il ne reconnaît pas assez que l’exploitation est tout autant, et probablement davantage un problème de morale et de motivations qui existe indépendamment de tout raisonnement économique. C’est Rothbard qui l’a compris, l’a ajouté à la construction misésienne de l’économie autrichienne et fait de l’analyse du pouvoir et de ses élites un élément à part entière de la théorie économique et des explications historico-sociologiques. Et il étend systématiquement l’argumentaire autrichien contre l’exploitation pour y ajouter la normative politique à la théorie économique, c’est-à-dire une théorie de la justice à une théorie de l’efficacité : de sorte que l’on peut aussi reprocher à la classe exploiteuse d’être immorale. Pour la théorie rothbardienne du pouvoir, de la classe et de l’exploitation, cf. en particulier son Power and Market (Kansas City : Sheed Andrews & McMeel, 1977) ; For a New Liberty (New York : MacMillan, 1978) ; The Mystery of Banking (New York : Richardson and Snyder, 1983) ; America’s Great Depression (Kansas City : Sheed and Ward, 1975). Sur des précurseurs importants de l’analyse de classe autrichienne, cf. Leonard Liggio, « Charles Dunoyer and French Classical Liberalism », Journal of Libertarian Studies (1977) ; Ralph Raico, « Classical Liberal Exploitation Theory », ibid. M. Weinburg, « The Social Analysis of Three Early 19th Century French Liberals: Say, [Charles N.d.T.] Comte and Dunoyer », Journal of Libertarian Studies (1978) ; Joseph T. Salerno, « Comment on the French Liberal School », ibid. D. M. Hart, « Gustave de Molinari and the Anti-Statist Liberal Tradition », 2 parties, Journal of Libertarian Studies (1981).
[13] Cf. aussi sur cette question H. H. Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism ; « The Justice of Economic Efficiency », Austrian Economics Newsletter, 1, 1988 (The Economics and Ethics of Private Property, ch. 9) ; « The Ultimate Justification of the Private Property Ethics », Liberty, septembre 1988 (The Economics and Ethics of Private Property, ch. 10).
[14] Sur ce thème cf. aussi Lord (John Emmerich Dalberg) Acton, Essays in the History of Liberty (Indianapolis : Liberty Fund, 1985) . Franz Oppenheimer, System der Soziologie, t. II : Der Staat (Stuttgart : G. Fischer, 1964) ; Alexander Rüstow, Freedom and Domination (Princeton : Princeton University Press, 1986).
[15] Cf. là-dessus Murray N. Rothbard, « Left and Right : The Prospects for Liberty », in : Egalitarianism As a Revolt Against Nature and Other Essays (Washington, D. C., Libertarian Review Press, 1974)
[16] Nonobstant toutes les arguties contraires de la propagande socialiste, la fausseté de la description marxiste des capitalistes et des salariés comme classes antagonistes apparaît aussi dans certaines observations empiriques : logiquement, il est possible de regrouper le gens en une infinité possible de classes différentes. A en croire la méthodologie positiviste orthodoxe (que je tiens pour fausse, mais que je suis disposé à accepter ici pour les besoins de la démonstration), le meilleur système de classification est celui qui nous permet de faire les meilleures prévisions. Or, classer les gens en capitalistes et travailleurs (ou les classer suivant divers degrés d’appartenance à la classe « capitaliste » ou « travailleuse ») est une démarche pratiquement inutilisable pour prédire quelle position une personne adoptera sur certaines questions politiques, sociales et économiques fondamentales. Bien au contraire, classer les gens, à juste titre, en producteurs d’impôt et réglementés d’une part, consommateurs d’impôt et réglementateurs de l’autre (ou en divers degrés d’appartenance aux « producteurs » ou aux « consommateurs d’impôt ») est pour sa part un excellent moyen de prédiction. Les sociologues ont négligé ce critère à cause des préjugés marxistes, presque universellement partagés. Mais l’expérience fournit tous les jours à ma thèse des confirmations écrasantes. Essayez donc de savoir d’un quidam s’il ne serait pas fonctionnaire (et de connaître son rang et son salaire) et, dans le cas d’une personne privée, dans quelle mesure son revenu et sa fortune dépendent des achats publics ou de la réglementation. Les gens se distingueront systématiquement dans leurs réponses aux questions politiques fondamentales suivant qu’ils font directement ou indirectement partie des producteurs ou des consommateurs d’impôt !
[17] Rappelons que le prétendu « droit public » viole par définition le principe du Droit dont tout le reste découle, celui de l’appropriation non-violente, et ne peut donc satisfaire aucun critère de cohérence ni invoquer aucun principe authentique. Fraus omnia corrumpit : l’absurdité initiale se reflète dans toutes les rationalisations ultérieures. Toutes les notions de « droit public » empruntées au droit authentique en sont donc forcément des dénaturations. Par exemple, la « non-discrimination » traduit le désir des hommes de l’État de simuler un « traitement égal » de leurs sujets. Cette « égalité » de traitement ne veut évidemment rien dire : il s’agit de caricaturer la cohérence du droit, qu’ils entendent justement violer. C’est donc une pure hypocrisie : le « droit » public est justement là pour faire des agresseurs et des victimes, des exploiteurs et des exploités, des voleurs et des volés. Le seul problème de « discrimination » du « droit public » est dans l’agression qu’il est précisément là pour instituer. Et c’est en outre l’irresponsabilité de celui qui impose sa violence aux autres qui le rend irrationnel. Cet exemple permet en outre d’illustrer une autre pratique liée à ces usurpations : une fois que les hommes de l’État ont habitué l’opinion aux faux principes du « droit public » comme Ersatz des vrais principes du droit privé, ils peuvent s’en servir comme prétexte à de nouvelles agressions contre les droits des personnes. Par exemple, le terme de « discrimination » ne désigne rien d’autre qu’un choix que vous désapprouvez ; toute action discrimine, parce que tout choix « préfère et écarte » (von Mises). Par conséquent, s’ils utilisent le prétexte d’interdire la « discrimination » par des personnes privées, les hommes de l’État peuvent en principe détruire toute liberté de choix de leurs sujets. Le même procédé est utilisé (à partir d’analyses plus ou moins marxistes, d’ailleurs), pour l’exploitation elle-même, pour le monopole, pour la censure, etc. Comme le dit Ayn Rand :
« L’astuce consiste à accuser les citoyens privés de violations particulières du Droit qui sont interdites aux hommes de l’État justement parce que lesdits citoyens privés n’ont pas le pouvoir de les commettre. Cela permet de délier les hommes de l’État de toute entrave à leurs interventions. Ce tour de passe-passe devient de plus en plus évident dans le domaine de la liberté d’expression. »
(« Man’s Rights », The Objectivist Newsletter avril 1963. Réédité dans The Virtue of Selfishness, New American Library, New York, 1964).
Ce processus d’usurpation puis de contamination du droit privé par le soi-disant « droit public » peut être qualifié de « vampirisme normatif » : tout en tuant le vrai droit - et pour pouvoir le tuer, les hommes de l’État se servent de son cadavre afin de créer l’illusion ; puis ils s’en servent à nouveau pour revenir tourmenter les vivants (cf. à ce sujet François Lefort, Le Pouvoir d’entreprendre, Paris, les Belles Lettres, 1993). Pour illustrer le même principe, on peut aussi dire que le « droit public » est au droit privé ce qu’un zombie est à un homme normal ; et par analogie, rappeler qu’en économie, les hommes de l’État utilisent sans cesse les désordres (crises, chômage, pauvreté) causés par leurs interventions comme prétextes pour intervenir à nouveau [N.d.T.].
[18] Franz Oppenheimer : System der Soziologie, t. II [Der Staat], pp. 322-23, présente les choses ainsi :
« La norme fondamentale de l’État est le pouvoir. C’est-à-dire, envisagée du point de vue de son origine : la violence transformée en pouvoir. La violence est l’une des forces les plus puissantes qui forment la société, mais elle n’est pas en elle-même une forme d’interaction sociale. Il faut qu’elle devienne une loi au sens positif du terme, c’est-à-dire, sociologiquement parlant, qu’elle doit permettre l’apparition d’une »réciprocité subjective« : et ceci n’est possible que si l’État s’impose à lui-même un système de restrictions à l’emploi de la violence, et accepte certaines obligations »en échange« des »droits« qu’il s’est arrogés. C’est ainsi que la violence se transforme en pouvoir, et qu’émerge une relation de domination qui est acceptée non seulement par les maîtres, mais aussi, lorsque les conditions ne sont pas trop oppressives, par les sujets, comme un système de »juste réciprocité« . A partir de cette norme fondamentale apparaissent alors des normes secondaires et tertiaires qui semblent en découler : normes de droit privé, des obligations, d’héritage, de droit pénal, droit constitutionnel. Toutes porteront la marque de la norme fondamentale du pouvoir et de la domination, et seront conçues pour façonner l’organisation politique de manière à accroître l’exploitation économique au niveau maximum compatible avec la perpétuation d’une domination réglée par la loi. »
Cette conclusion est fondamentale : « la loi pousse sur deux racines essentiellement différentes : d’un côté le droit qui naît d’une association entre égaux, que l’on pourrait appeler ’droit naturel’ même s’il n’y a pas de ’droit naturel’, et de l’autre de la loi de violence transformée en pouvoir légal, le droit des inégaux ».
Sur la relation entre droit privé et « droit » public, cf. aussi Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, 3 t. (Chicago : University of Chicago Press, 1973-79), partic. le t. I ch. 6 et le t. II, pp. 85-88 [Droit, législation et liberté, Paris, PUF, 1980, 1982 et 1983].
[19] Cf. James M. Buchanan et Gordon Tullock, The Calculus of Consent (Ann Arbor : University of Michigan Press, 1962), p. 19.
[20] Cf. H. H. Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat (Opladen, Westdeutscher Verlag, 1987) ; A Theory of Socialism and Capitalism.
[21] L’auteur avait écrit « faire de la contrefaçon ». C’est qu’il sous-entend que la possibilité de créer de la monnaie serait un privilège d’exemption au droit commun que les hommes de l’État accorderaient aux banques, comme moyen de partager le butin de la contrefaçon étatique. En fait, le partage du butin se fait par l’imposition par le monopole d’émission d’une monnaie de singe produite en quantité excessive, condition qui permet aux banquiers privés de produire à leur tour de la monnaie en excès et facilite la cartellisation du système bancaire en vue d’exploiter prêteurs et emprunteurs (les hommes de l’État reprennent d’ailleurs une partie de ce butin en imposant des réserves obligatoires). En tant que telle, en revanche, la création de monnaie par les banques est leur fonction normale, et la couverture partielle (en or) prévaut dans un système de capitalisme propre. Elle est même nécessaire à l’ajustement monétaire à court terme (cf. George Selgin : La Théorie de la banque libre, Paris, les Belles Lettres, 1991). Comme je traduis ce texte pour mes besoins propres, et comme je refuse qu’une si belle démonstration soit gâchée par une erreur (même si c’est Murray Rothbard qui l’a - inexplicablement - inspirée), je censure une fois de plus le texte [N.d.T.].
[22] Cf. H. H. Hoppe, « Banking, Nation States and International Politics », Review of Austrian Economics (1989) (réédité comme ch. 3 de The Economics and Ethics of Private Property). Murray N. Rothbard, The Mystery of Banking, chs. 15-16.
[23] Cf. notamment sur cette question Murray N. Rothbard, Man, Economy and State, ch. 10 [« Monopoly and Competition » (N.d.T.)], particulièrement la section « The Problem of One Big Cartel » ; cf. aussi Ludwig von Mises, Socialism [Le Socialisme], ch. 22-26.
[24] Cf. sur cette question Gabriel Kolko, The Triumph of Conservatism (Chicago : Free Press, 1967) ; James Weinstein, The Corporate Ideal in the Liberal State (Boston : Beacon Press, 1968) : Ralph Radosh/ Murray N. Rothbard, eds., A New History of Leviathan (New York : Dutton, 1972) ; Leonard Liggio/ J. J. Martin, eds. Watershed of Empire (Colorado Springs : Ralph Myles, 1976)
[25] Sur la relation entre l’État et la guerre, cf. E. Krippendorff, Staat und Krieg (Francfort/M. : Suhrkamp, 1985) ; Charles Tilly, « War Making and State Making as Organized Crime » in : P. Evans et al., eds, Bringing the State Back In (Cambridge : Cambridge University Press, 1985) ; cf. aussi R. Higgs, Crisis and Leviathan (New York : Oxford University Press, 1987).
[26] Pour une version ultérieure, plus développée, de cette théorie de l’impérialisme militaire et monétaire, cf. H. H. Hoppe, Banking, Nation States and International Politics (The Economics and Ethics of Private Property, ch. 3).
[27] Cf. en particulier sur ce sujet Ludwig von Mises, Theory and History (Auburn, Al. : Auburn University, Ludwig von Mises Institute, 1985), partic. la 2° partie.
[28] On pourra noter ici que Marx et Engels, dans le Manifeste du Parti communiste, se sont faits les champions du développement économique capitaliste et n’avaient que louanges pour ses réalisations sans précédent. En fait, conclut Schumpeter rendant compte des passages correspondants du Manifeste,
- « jamais, je le répète, aucun défenseur de la civilisation bourgeoise n’a rien écrit de tel, jamais on n’a composé un éloge de la classe d’affaires à partir d’une compréhension aussi large et aussi profonde de ce qu’est sa réussite et de ce qu’elle signifie pour l’humanité. »
- « The Communist Manifesto in Sociology and Economics », in : Essays of J. A. Schumpeter, ed. Clemence (port Washington, N. Y. : Kennikat Press, 1951), p. 293.
Etant donné sa conception du capitalisme, Marx était même allé jusqu’à justifier la conquête britannique des Indes, par exemple, comme un élément de progrès historique. Cf. les articles de Marx dans la New York Daily Tribune du 25 juin, 11 juillet et 8 août 1853 [Marx/Engels, Werke, t. 9 (Berlin-Est : Dietz, 1960)]. Comme marxiste contemporain adoptant la même position sur l’impérialisme, nous avons B. Warren, Imperialism, Pioneer of Capitalism (Londres : New Left Books, 1981).
[29] Sur la théorie de la révolution, cf. en particulier Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1978) ; As Sociology Meets History (New York : Academic Press, 1981).
[30] Pour une analyse néo-marxiste de la période actuelle de « capitalisme tardif » comme caractérisée par une « nouvelle désorientation idéologique » née de la stagnation économique permanente et de l’épuisement des pouvoirs de légitimation du conservatisme et de la démocratie sociale, (que les Américains appellent « liberalism »), cf. Jürgen Habermas, Die Neue Unübersichtlichkeit (Francfort/M. : Suhrkamp, 1985) ; du même, Legitimation Crisis (Boston : Beacon Press, 1975) ; C. Offe, Strukturprobleme des kapitalistischen Staates (Francfort/M. : Suhrkamp, 1972).
[31] Pour une évaluation autrichienne-libertarienne du capitalisme tardif comme sujet aux crises et des perspectives d’émergence d’une conscience de classe révolutionnaire libérale, cf. Murray N. Rothbard, « Left and Right » ; For a New Liberty, ch. 15 ; The Ethics of Liberty (Atlantic Highlands : Humanities Press, 1982) [L’Ethique de la liberté (Paris, les Belles Lettres, 1991)], V° partie.
[32] Sur les incohérences internes de la théorie marxiste de l’État, cf. aussi Hans Kelsen, Sozialismus und Staat (Vienne, 1965).