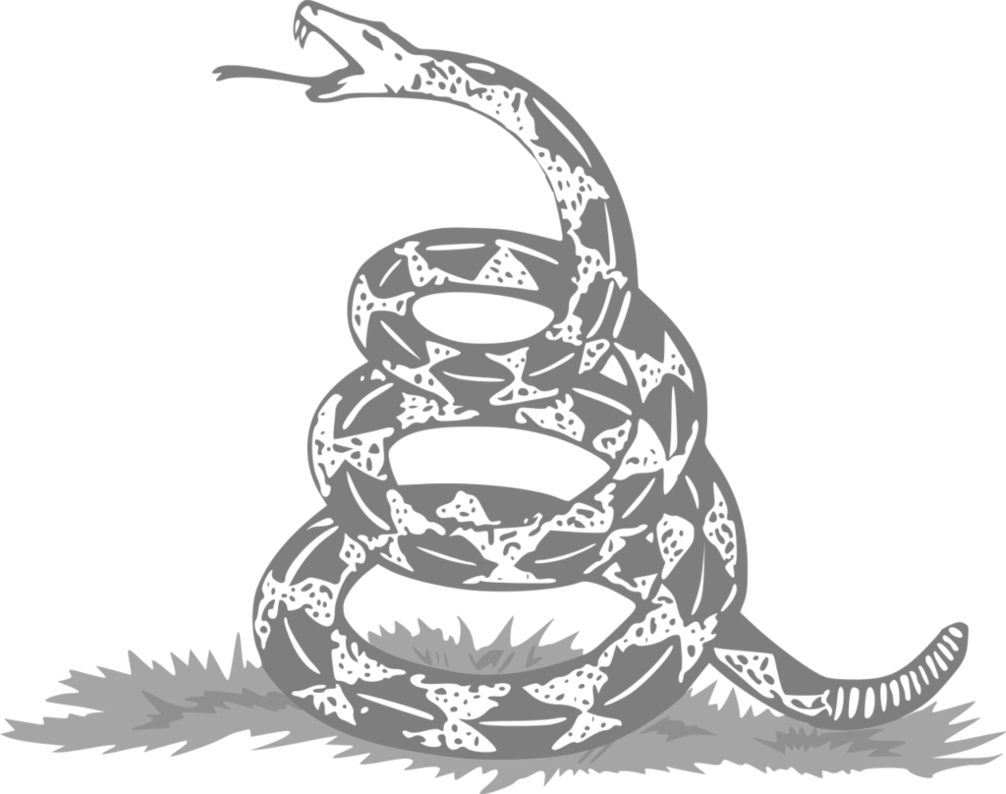« La Micropolitique : troisième partie » : différence entre les versions
Kae (discussion | contribs) Aucun résumé des modifications |
Kae (discussion | contribs) |
||
| Line 48: | Line 48: | ||
A première vue, cela ressemble à "Mission impossible". L'intérêt des groupes minoritaires est de recevoir des privilèges particuliers sur le dos de tous les autres. Et comment imaginer que les hommes de l'Etat puissent trouver leur intérêt ailleurs que dans un secteur public bien gras et bien étouffant ? Il faudrait vraiment des politiques bien paradoxales pour retourner ces intérêts-là contre les privilèges et autres prébendes accordés par les systèmes publics, ou pour réduire la part des biens et des services produits par leur secteur d'activité. A priori, ces politiques devraient amener ces gens à agir directement contre leur propre intérêt. | A première vue, cela ressemble à "Mission impossible". L'intérêt des groupes minoritaires est de recevoir des privilèges particuliers sur le dos de tous les autres. Et comment imaginer que les hommes de l'Etat puissent trouver leur intérêt ailleurs que dans un secteur public bien gras et bien étouffant ? Il faudrait vraiment des politiques bien paradoxales pour retourner ces intérêts-là contre les privilèges et autres prébendes accordés par les systèmes publics, ou pour réduire la part des biens et des services produits par leur secteur d'activité. A priori, ces politiques devraient amener ces gens à agir directement contre leur propre intérêt. | ||
Eh bien justement, l'analogie avec "Mission impossible" est exactement appropriée : comme dans la série télévisée américaine, quelques spécialistes, décidés à consacrer leur ingéniosité et leur | Eh bien justement, l'analogie avec "Mission impossible" est exactement appropriée : comme dans la série télévisée américaine, quelques spécialistes, décidés à consacrer leur ingéniosité et leur connaissance experte à la résolution de ce problème apparemment insoluble, ont finalement découvert certaines manœuvres et procédés techniques capables de surmonter cette contradiction apparente. En fait, il est même possible d'imaginer un grand nombre de façons d'aborder les gens, et qui les persuaderont bel et bien d'accepter certaines politiques, voire de les soutenir, alors même que leur effet sera de réduire le volume d'ensemble des privilèges accordés aux minorités dominantes et de diminuer globalement le pouvoir et les dépenses des hommes de l'Etat. | ||
===Comment persuader les gens d'abandonner leurs privilèges ?=== | ===Comment persuader les gens d'abandonner leurs privilèges ?=== | ||
Version actuelle datée du 3 April 2008 à 17:33
La Micropolitique
DEUXIEME PARTIE : LE SECTEUR PUBLIC
TROISIEME PARTIE : LA MICROPOLITIQUE
De la critique à la créativité
La théorie des choix publics explique la croissance de l'Etat
La théorie des choix publics est une critique. C'est un outil d'analyse qui permet de comprendre et d'expliquer pourquoi certains phénomènes se produisent dans le secteur public, et pourquoi ils le font ainsi. Elle nous invite à rechercher les intérêts des différents groupes impliqués dans la conception et l'exécution des politiques publiques, ceci nous permettant de prévoir et d'expliquer les réactions que celles-ci vont engendrer.
Grâce à cette approche, il devient possible de comprendre certains phénomènes qui, sinon, nous sembleraient inexplicables, voire irrationnels. Elle nous montre immédiatement pourquoi il est inévitable que les programmes politiques conservateurs s'épuisent dans des difficultés du genre de celles qu'ils ont rencontrées. L'essence de la formule traditionnelle de "la droite" est de diminuer le rôle joué par les hommes de l'Etat dans la vie économique, et la charge qu'ils imposent à leurs concitoyens. Elle essaie de réduire l'importance et l'étendue de leurs actions, et de diminuer le fardeau réglementaire qu'ils imposent aux entreprises ; elle voudrait qu'ils cessent de confisquer une si grande partie de l'argent des individus et des entreprises, leur interdisant de le dépenser suivant leurs lumières propres.
Evidemment, ces projets se heurtent directement à l'intérêt de la plupart des groupes associés aux ambitions étatiques. Ils pourraient bien favoriser l'ensemble de la société, permettre enfin la création de richesses, et par conséquent améliorer le sort d'une majorité écrasante de la population, mais rien de tout cela ne suffit à les faire passer dans le domaine de la politique pratique. Toutes les conceptions "de droite" du pouvoir, et les projets qu'on leur prête, s'opposent dans une certaine mesure à ce que les groupes de pression perçoivent comme leur intérêt vital. N'importe quelle minorité peut se laisser démontrer qu'elle y perdra des plumes si les dépenses totales sont réduites. Alors qu'elle pourrait, dans l'abstrait, soutenir le principe d'une diminution générale des dépenses publiques, chacune se battra pour maintenir sa part du butin, et bien plus âprement que d'autres n'essayeront de la réduire.
La bureaucratie comprend immédiatement qu'un programme "de droite" constitue une menace réelle pour ses perspectives d'enrichissement et de pouvoir. Ce qu'elle veut, c'est accroître le domaine de ses prérogatives et le nombre de ses subordonnés. Son intérêt en tant que classe est qu'il y ait davantage de programmes publics, et de plus vastes encore. Toute annonce d'un projet de réduction de l'activité et de la dépense publiques devrait suffire à la mobiliser contre lui, jusqu'à la faire capoter si besoin est.
On a donc maintenant les moyens identifier la raison d'un phénomène majeur dont tous les adversaires du socialisme ont eu l'occasion de se plaindre. Ils ont souvent observé que le pouvoir et les dépenses des hommes de l'Etat se développaient rapidement sous les gouvernements collectivistes et centralistes, et seulement moins vite sous un gouvernement de "droite". Ils parlent d'un "cliquet socialiste", qui ne tournerait que dans un sens : celui de l'augmentation de la taille de l'Etat. Si un gouvernement de tendance libérale parvenait à obtenir un arrêt temporaire, empêchant l'accroissement du pouvoir étatique au cours de son mandat, on considérait cela comme le maximum de ce qu'il était possible d'espérer.
Pour leurs partisans, et pour tous ceux qui avaient pris part à ces gouvernements, le phénomène était aussi confondant qu'exaspérant. ¨Privés de l'éclairage de la théorie des choix publics, ils ne savaient où chercher son origine. Grâce à ce nouveau type d'analyse, en revanche, il nous est désormais possible de comprendre pourquoi les choses devaient se passer ainsi. Quand l'on considère l'opposition de tous les groupes qui bénéficient d'un privilège d'Etat, et les agissements d'une Administration directement opposée aux objectifs essentiels du programme de "la droite", on découvre tout de suite l'explication. Ce n'est pas parce que les politiques proposées seraient "incompatibles avec notre monde moderne", voire "inapplicables dans le monde réel" ; c'est parce qu'elles sont politiquement trop difficiles à imposer par la seule volonté du gouvernement, face au bunker des intérêts en place qui se mobilisent contre elles.
Nixon et Heath dans l'ornière
Reprenons donc notre tentative d'explication des échecs relatifs des gouvernements de Richard Nixon aux Etats-Unis et d'Edward Heath au Royaume Uni. Ni l'un ni l'autre ne disposaient d'une technique efficace face aux phénomènes que nous venons de voir, et qui s'opposent à toute mesure de désétatisation. Dans un climat en principe plutôt favorable à une diminution du rôle et des ponctions de l'Etat, ni l'un ni l'autre n'avaient pressenti les difficultés pratiques qu'impliquait la mise en œuvre de ce type de projet, a fortiori les tactiques nécessaires pour les surmonter. Pensant apparemment que les événements succèdent naturellement à l'adoption des idées, ni l'un ni l'autre n'avait l'avantage de connaître l'analyse proposée par la théorie des choix publics. Celle-ci existait, mais n'en était qu'aux premiers stades de son développement, et n'avait pas encore suffisamment attiré l'attention.
Or, cette dernière permet de beaucoup mieux apprécier leurs échecs, aussi bien que de juger la variété des explications qu'on leur a trouvées. D'un côté, on trouvait les gouvernements avec leurs intentions et leurs programmes, et de l'autre, les forces réelles inhérentes au système, et auxquelles ils voulaient s'attaquer. Résultat, aussi bien sous Nixon que sous Heath : le pouvoir réglementaire des hommes de l'Etat et leur rôle dans l'économie furent accrus. De même, bien entendu, que ce qu'il en coûtait aux autres.
Sans théorie valide permettant de rendre compte des comportements du secteur public, aucun des deux gouvernements ne pouvait imaginer ce qui l'attendait. Les conseillers et autres experts sur lesquels ils comptaient pour appliquer leurs politiques, étaient ceux-là même dont ces politiques menaçaient les intérêts. Les deux gouvernements, par exemple, se rendirent compte que les salaires et les prix montaient plus vite qu'ils ne le souhaitaient, sans comprendre les pressions qui poussaient dans cette direction. Tous deux imposèrent des contrôles administratifs aux salaires et aux prix, étendant ainsi considérablement le pouvoir d'ingérence de la bureaucratie [1].
En somme, ni l'administration Nixon ni le gouvernement Heath ne connaissaient vraiment les contraintes qui pèsent sur l'action publique, et qui sont imposées par les conduites égoïstes de ceux qui y participent. S'ils avaient compris quelle force d'opposition serait mobilisée par les groupes de pression voyant leurs privilèges mis en cause, ou par la bureaucratie craignant pour ses perspectives de carrière, peut-être auraient-ils essayé des politiques totalement différentes, et obtenu un autre résultat. A tout le moins, l'échec de leurs programmes affichés aurait été justement attribué à leur compétence insuffisante pour traiter avec le système politique.
Alors, on se résigne ?
L'approche des choix publics explique aussi bien la croissance irrépressible du secteur public année après année, que les échecs des tentatives faites à diverses occasions pour inverser ce processus. Elle explique même le fatalisme de ceux qui, tout en le considérant comme pervers et en s'y opposant en principe, pensent néanmoins que personne n'y peut rien. Cependant, c'est là tout ce qu'elle fait. L'école des choix publics a proposé une nouvelle méthode d'analyse. Elle fournit une critique ; elle nous montre ce qui ne va pas. La question reste de savoir s'il est possible de construire quelque chose sur ces découvertes.
La nouvelle analyse a du moins le mérite de faire connaître leurs limites aux politiciens. Elle leur permet de prévoir quelles sont les politiques qui n'ont que peu de chances de réussir. Si l'on ne pouvait en tirer que ce résultat, ce serait déjà fort précieux. Cela nous épargnerait de nourrir de faux espoirs, pour les voir ensuite déçus. En comprenant comment les groupes d'intérêt vont réagir à l'intérieur du système, les dirigeants politiques pourraient au moins éviter les mesures qui sont condamnées à se les mettre à dos. Ainsi, l'analyse des choix publics, même si elle n'est qu'une critique, offre déjà au politique un moyen de filtrer à l'avance, de retenir les réformes qui ne peuvent qu'échouer. Elle permet par conséquent de s'épargner des affrontements inutiles, sources de discorde et d'affaiblissement, et offre aux hommes politiques le moyen de restreindre leurs ambitions pour se fixer des objectifs plus réalistes. Ces résultats sont déjà appréciables en eux-mêmes, mais ils se bornent à signaler aux hommes politiques ce qu'il ne faut pas faire. Aucun n'indique aux gouvernements comment mettre en œuvre les politiques qu'ils jugeraient devoir appliquer.
Simple critique ou point de départ ?
Raisonnons, cependant : si la théorie des choix publics est une critique, pourquoi n'impliquerait-elle pas, de façon latente, des propositions créatives symétriques de ses conclusions ? Si le système politique dominant agit de manière à bloquer certains types de réformes, alors savoir lesquels et comment ne pourrait-il pas aider à en imaginer d'autres ? Des réformes qui, au lieu d'essayer de forcer les contraintes du système, essayeraient de s'en servir pour parvenir à leurs fins. Ces déterminismes, nous les connaissons maintenant : nous savons à quoi ils conduisent, nous savons d'où ils viennent. Alors pourquoi ne pourrait-on pas créer des politiques qui sauraient s'en servir, s'en jouer ou même les neutraliser ?
Mission impossible
A première vue, cela ressemble à "Mission impossible". L'intérêt des groupes minoritaires est de recevoir des privilèges particuliers sur le dos de tous les autres. Et comment imaginer que les hommes de l'Etat puissent trouver leur intérêt ailleurs que dans un secteur public bien gras et bien étouffant ? Il faudrait vraiment des politiques bien paradoxales pour retourner ces intérêts-là contre les privilèges et autres prébendes accordés par les systèmes publics, ou pour réduire la part des biens et des services produits par leur secteur d'activité. A priori, ces politiques devraient amener ces gens à agir directement contre leur propre intérêt.
Eh bien justement, l'analogie avec "Mission impossible" est exactement appropriée : comme dans la série télévisée américaine, quelques spécialistes, décidés à consacrer leur ingéniosité et leur connaissance experte à la résolution de ce problème apparemment insoluble, ont finalement découvert certaines manœuvres et procédés techniques capables de surmonter cette contradiction apparente. En fait, il est même possible d'imaginer un grand nombre de façons d'aborder les gens, et qui les persuaderont bel et bien d'accepter certaines politiques, voire de les soutenir, alors même que leur effet sera de réduire le volume d'ensemble des privilèges accordés aux minorités dominantes et de diminuer globalement le pouvoir et les dépenses des hommes de l'Etat.
Comment persuader les gens d'abandonner leurs privilèges ?
Une des possibilités envisagées est que les gens abandonnent leurs privilèges actuels, si on peut trouver un autre type d'avantage pour les dédommager. Pour conserver leur privilège, les gens sont prêts à se battre à concurrence de sa valeur perçue, celle-ci étant plus grande pour eux que les autres ne perçoivent ce qu'elle coûte. Cependant, rien ne leur interdit de renoncer à cet avantage particulier à l'occasion d'un échange où ils se sentiraient gagnants. Cela suppose qu'ils reçoivent en l'échange de leur privilège d'origine une chose qui ait plus de valeur, et surtout pour eux.
S'il en est ainsi, ne pourrait-on pas supprimer tous ces privilèges d'un seul coup, par exemple en les échangeant contre la liberté retrouvée ? Après tout, il est fort vraisemblable que, si l'on supprimait tout l'appareil de la redistribution politique, l'immense majorité des gens s'en trouveraient mieux, puisque la plus grande partie de ce qui leur est donné d'une main leur est repris de l'autre, avec le poids mort des hommes de l'Etat à entretenir en sus. Cependant, il faut se rendre à l'évidence : c'est une politique qui ne marcherait pas, parce que cet avantage net pour chacun serait beaucoup trop difficile à faire voir concrètement. Quiconque reçoit un privilège de l'Etat ressent fortement cet avantage, alors que son coût est presque insignifiant pour les autres.
Par conséquent, s'il doit y avoir une politique qui offre une compensation, il ne suffit pas que le nouvel avantage soit en fait plus important : il doit apparaître évidemment comme tel au bénéficiaire visé. Cette précision est essentielle parce qu'en politique justement, les gains et les charges sont rarement perçus pour ce qu'ils sont. C'est une des perversions constantes de l'intervention de l'Etat que d'inspirer à toutes les parties prenantes, profiteurs supposés, victimes réelles et nuisibles bien intentionnés, des illusions qui empêchent de la mettre en cause. C'est d'ailleurs pourquoi il est si fréquent que les réformes doivent d'abord être entreprises pour que les opinions changent.
Conclusion : il n'y aura de gain politique à l'échange proposé que si l'on s'arrange vraiment pour que les gens aient effectivement l'impression de s'en tirer à leur avantage. Il suffira donc de mettre sur pied des politiques d'échange, conçues pour que les substituts qui remplaceront les privilèges soient perçus comme plus importants. Ce système revient-il à donner un nouveau tour au "cliquet socialiste", en accroissant le volume de la distribution des prébendes ? Pas nécessairement. Car justement, le nouvel avantage peut être de nature totalement différente.
Des avantages d'une autre nature
On peut par exemple imaginer des politiques qui conduiraient les gens à accepter de perdre un privilège d'Etat en échange d'un avantage privé qui leur semblerait plus grand. Alors, le système prébendier des hommes de l'Etat serait progressivement érodé par la substitution de droits privés en leur lieu et place.
Il peut y avoir des cas où les gens sont prêts à abandonner un privilège permanent et à long terme, en échange d'un avantage immédiat qui vaudrait plus à leurs yeux... et mettrait fin au système. Dans ce cas, les politiques à créer proposeraient aux gens un gain substantiel et immédiat en échange de leur privilège perpétuel. S'ils donnent plus de valeur au bénéfice immédiat, et si cette proximité dans le temps leur permet de l'emporter sur la valeur actuelle cumulée du privilège permanent, alors il y aura une bonne base pour faire l'échange.
Si des gens acceptent de perdre un privilège d'Etat parce que la politique choisie leur remet un avantage privé plus important en contrepartie, alors cette politique peut bel et bien diminuer le rôle des hommes de l'Etat. Si les gens pensent qu'un gain immédiat remplacera avantageusement la perpétuation d'un privilège politique, alors la politique qui en fait l'offre pourra, petit à petit, diminuer à terme le fardeau de l'Etat, même si elle doit l'alourdir dans le court terme immédiat. Aucune de ces deux conclusions ne devrait nous surprendre. Une fois que l'on adopte l'approche des choix publics, et considère que le système politique comporte un véritable marché, alors des transactions normales de ce genre devraient passer comme allant de soi.
Il ne s'agit que de rendre explicite une pratique qui existe déjà
Sur les marchés privés, les gens s'échangent tous les jours des profits marchands, abandonnant une chose à quoi ils donnent moins de valeur contre une autre à laquelle ils tiennent davantage. C'est la raison d'être de l'échange volontaire. C'est aussi une banalité quotidienne de l'économie privée, que les gens vendent du long terme contre du court terme. Certains vont renoncer à une partie de leur pouvoir d'achat aujourd'hui pour s'assurer un revenu régulier plus tard. D'autres abandonnent leur revenu futur en échange d'une somme liquide à dépenser dans l'immédiat. De telles transactions sont de pure routine dans une économie de marché ; il n'empêche, dans un contexte politique, l'idée de les intégrer à une approche systématique prend un air de nouveauté.
En réalité, tout ce que feraient les politiques en question serait de rendre explicites les principes de l'échange qui existent et fonctionnent déjà sur le marché politique. Il ne s'agit que de reconnaître le marché qui existe qu'on le veuille ou non, et s'y engager pour y passer des contrats. Au lieu d'essayer, sans autre arme que la seule autorité du gouvernement, de s'opposer aux forces et aux contraintes qui dominent ce marché, on utilise ces déterminismes mêmes pour obtenir des résultats plus acceptables.
Accepter l'existence du marché politique est la clé qui ouvre les portes
Les deux approches que nous venons d'examiner ne sont que les premières pièces d'une batterie de techniques que l'on peut déduire des mêmes principes. Dès lors que l'on aura accepté l'existence et le fonctionnement d'un marché politique, on aboutira à une gamme complète de politiques spécifiquement conçues pour ce marché. Le conflit idéologique, sur le mode conventionnel de l'activité politique, sera alors relayé par le jeu des groupes d'intérêts, et l'on mettra au point des politiques faites sur mesure pour la situation de chacun sur le marché. Au lieu d'affronter bille en tête l'opposition des différents groupes qui s'accrochent à leurs privilèges étatiques, les nouvelles politiques iront chercher la transaction et proposer, chaque fois que c'est possible, d'offrir un avantage dont la valeur perçue sera supérieure, et qui permettra néanmoins de réduire la taille et les prérogatives de l'appareil d'Etat.
Bien sûr, il existe des cas où la situation d'un groupe lui donne un pouvoir tel qu'il puisse exiger davantage que tout ce qu'il est raisonnablement possible de lui offrir en échange. Ce type de situation inspire une autre gamme de politiques. Peut-être pourra-t-on constituer un nouveau groupe qui sera plus puissant que le premier. Une politique qui aura décidé de s'en prendre au groupe d'origine y trouvera un partenaire potentiel. L'hostilité de l'ancien groupe sera alors plus que compensée par le soutien du nouveau. Forts de ce soutien, les législateurs seront alors en mesure de supprimer les privilèges de l'ancien.
On pourrait aussi imaginer que des politiques réussissent à contourner, puis à neutraliser le pouvoir du groupe dominant, avant de s'attaquer au privilège dont il jouit aux dépens de la société. Une fois son pouvoir amoindri, il en ira de même de sa capacité d'exiger et de conserver un privilège de cette taille. Sa capacité de nuire ayant diminué avec son pouvoir, il aura moins à échanger, et recevra donc moins en échange.
Ces politiques portent en filigrane la marque d'une origine commune : chacune d'elles transcrit, dans le domaine de l'action créatrice, une des conclusions critiques de la théorie des choix publics. S'il est vrai qu'il existe un marché politique, où les gens font des échanges, ce fait doit limiter ce qu'un gouvernement peut espérer obtenir par le moyen classique de l'autorité. Mais il lui donne aussi l'occasion de trouver, pour préparer ses politiques, de nouvelles approches qui pourront réussir parce qu'elles seront en prise avec ce marché et utiliseront ses lois propres, là où les autres échouaient pour s'y être opposées.
Quelle procédure suivre ?
Puisqu'il existe une approche commune, quelle est la procédure générale qui pourrait la traduire ? A supposer qu'on puisse la mettre en œuvre, ce type de politique prendrait comme point de départ la critique des choix publics. D'abord comprendre, pour en tirer les leçons, pourquoi les politiques précédentes ont échoué. Démonter, par l'analyse des choix publics, le processus qui a conduit les groupes d'intérêt à mettre en échec les politiques de type traditionnel, ce qui donne la bonne base de départ pour en refaire d'autres. La nouvelle politique visera à créer de toutes pièces des situations où les groupes d'intérêt chercheront d'eux-mêmes à saisir les nouveaux objectifs mis à leur portée, ou se trouveront neutralisés par des groupes plus puissants créés exprès pour les mettre sur la touche, ou encore verront rogner le pouvoir qui garantissait leurs privilèges. En théorie, toutes ces tactiques pourraient permettre de réduire le rôle des hommes de l'Etat comme distributeurs d'avantages particuliers sur le dos des autres.
La révolution du réalisme politique
On voit évidemment que cela implique un style de politique radicalement différent. Car ce dont il s'agit maintenant, c'est de prêter une attention extrême aux détails pratiques. Il faut, armé de la théorie des choix publics, identifier tous les avantages acquis par les différents groupes d'intérêt, tout comme les influences et les soutiens qui s'échangent sur le marché. Ce ne sera qu'après avoir parfaitement compris la situation existante, que l'on pourra se mettre à préparer des politiques jouant avec les forces en présence pour changer la situation. C'est le travail d'un créateur. Il est aussi, bien entendu, fait pour les "bûcheurs", car il n'y a pas de formule idéologique toute faite qui produise automatiquement les bonnes réponses. En fait, il se peut même qu'il n'existe pas de "bonnes" réponses, mais uniquement des solutions meilleures et d'autres moins bonnes.
La caractéristique la plus spectaculaire, si l'on peut dire, de ce type de création politique, c'est l'échelle à laquelle on la pratique. Il faudra faire descendre l'analyse jusqu'au niveau où les individus expriment leurs préférences sur le marché politique, et c'est aussi à ce niveau-là qu'il faudra négocier. La différence est aussi grande que celle qui sépare la macro-économie de la micro-économie. La première traite de grands agrégats et autres statistiques qui représentent ou ne représentent pas — les événements réels. La seconde traite des actes voulus par des personnes qui cherchent à réaliser leurs projets. Elle tient compte des raisons d'agir concrètement présentes, et elle se soucie de savoir quels arbitrages seront faits lorsque les conditions du choix auront changé.
La politique, comme l'économie, doit s'aborder comme un réseau d'interactions entre les personnes
Nous avons déjà observé que nombre d'économistes, alors qu'ils reconnaissent l'importance primordiale des facteurs micro-économiques, n'appliquent pas cette sagesse au domaine de la politique. Il est courant d'entendre des économistes, dont l'analyse s'inspire pourtant de la micro-économie, appeler à des politiques telles que "l'abolition des entreprises d'Etat" ou "la suppression de toutes les subventions". Ils conseillent aux Premiers Ministres britanniques d'"en finir avec la médecine d'Etat", aux Présidents américains de "supprimer la sécurité sociale". Les politiques savent très bien qu'on ne peut pas obtenir ces résultats par un simple acte de la volonté, et considèrent par conséquent des avis aussi désinvoltes comme étrangers à toute réalité politique. La théorie des choix publics donne à penser qu'ils ont raison.
Si bon nombre d'économistes considèrent que l'étude au niveau micro-économique est indispensable à une vision réaliste de l'économie, alors disons qu'il ne serait pas inutile non plus d'appliquer ce type de raisonnement au domaine politique. S'il est exact que les gens font des offres et des demandes sur les marchés politiques comme ils en font sur les marchés de la production, alors il se pourrait bien que l'approche de la politique à l'échelle "micro" en donne une image bien plus claire et conduise à des solutions bien plus applicables.
Il existe une micropolitique, qui est à la politique ce que la microéconomie est à l'économie
Voilà donc la nouveauté théorique que je propose dans ce livre : il doit exister une "micropolitique", qui sera à la politique ce que la microéconomie est à l'économie. La microéconomie examine la conduite des personnes et des groupes sur les marchés économiques ; la micropolitique l'étudiera sur les marchés politiques. En outre, de même que la microéconomie est plus proche du niveau où les décisions sont prises et les actions entreprises sur les marchés économiques (ce qui veut dire qu'elle est plus proche des événements réels), il en sera de même de la micropolitique sur les marchés politiques.
Il est facile de parler, en termes "macro", de mettre un terme à l'étatisation, ou d'abolir toutes les subventions, mais les gouvernements ne sont pas près de suivre ces conseils-là, parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Quand les gouvernements connaîtraient tous les défauts de la médecine étatisée ou de la sécurité sociale, cela n'empêcherait pas qu'ils soient impuissants à y changer quoi que ce soit. La macropolitique propose les solutions globales et drastiques que personne n'applique, et qui ratent quand d'aventure on les essaie quand même. Elles échouent parce qu'elles ne tiennent pas suffisamment compte de la réalité politique, celle des décisions prises par les individus et les groupes qui négocient leurs avantages sur le marché politique.
La micropolitique, à l'inverse, va conduire à formuler des programmes qui prennent en compte les conclusions de la théorie des choix publics, et s'en servir pour réorienter la conduite des personnes et des groupes concernés. Au lieu d'essayer d'agir à grande échelle contre les privilèges dont les groupes de pression bénéficient aux dépens de tous les autres, la micropolitique s'attachera à créer des politiques qui modifieront les choix que font les gens, en transformant les conditions de ces choix.
L'intérêt personnel l'emporte le plus souvent sur les principes
Nous restons encore au niveau théorique, et pourtant nous avons déjà fait bon nombre de découvertes, annonçant une manière de concevoir les politiques publiques bien différente de l'approche traditionnelle, dans le style comme dans le contenu. En premier lieu, on trouve le postulat implicite que l'action politique ne concerne pas seulement la bataille des idées. La micropolitique, forte des conclusions de la théorie des choix publics, partira au contraire du présupposé que l'intérêt personnel joue un rôle prédominant dans la manière dont les gens réagissent aux politiques publiques.
Etant établi qu'il existe un marché politique, et que les gens y font des échanges, c'est à la lumière de leurs effets éventuels sur la valeur de ce qui est échangé qu'ils jugeront les politiques en cause. Il est donc tout à fait possible qu'un groupe soutienne dans l'abstrait une idéologie donnée, et qu'on le voie dans la pratique saboter toute tentative faite pour appliquer ses principes à son cas particulier. Même s'il arrivait que les employés du secteur public se mettent à penser que l'Etat est trop gros, il s'en trouvera bien peu pour accepter que l'on fasse maigrir leur petit morceau d'Etat à eux.
On ne persuadera pas les gens de renoncer à leurs privilèges parce qu'ils sont injustes
Une deuxième différence essentielle réside dans l'attitude adoptée par la micropolitique face aux multiples privilèges que les groupes minoritaires reçoivent des hommes de l'Etat. L'attitude libérale classique consiste, les tenant pour illégitimes, à vouloir les éliminer. Etant donné que les gens défendent leurs fromages, et qu'il y a peu de soutien à attendre de ceux qui doivent les payer, cette ambition ne conduit jamais qu'au ressentiment et à l'hostilité des groupes dont les privilèges sont menacés ; d'où l'échec qui s'ensuit généralement.
L'attitude de la micropolitique consiste à s'accommoder du fait que le privilège existe, et qu'il sera défendu, quoi que puisse valoir sa prétention à être légitime. Si l'on veut que les gens acceptent son élimination, il faudra leur offrir quelque chose de plus intéressant en échange, ou alors commencer par réduire le pouvoir qui leur permet de conserver cet avantage. Ce qu'on oublie dans l'analyse traditionnelle est que le statu quo lui-même est considéré comme une source de légitimité. Si un privilège existe depuis longtemps, ses bénéficiaires vont le considérer comme un droit acquis, un élément "à part entière" de la société établie. Ils se battront pour le défendre, se sentant agressés par l'initiative qui le menace, et n'étant certes pas en peine de trouver l'idéologie adéquate pour justifier leur attitude. Telle était d'ailleurs — en gros — la situation fondamentale pendant la lutte pour l'indépendance américaine ; si on se battait, c'était pour préserver des avantages déjà acquis [2] contre de nouvelles prétentions, et non pour réclamer des privilèges inédits.
Il ne manque sans doute pas de bonnes raisons pour contester la légitimité des privilèges particuliers. Ces arguments peuvent être importants pour les principes, mais il n'y a aucune raison d'en attendre qu'ils réussissent à éliminer les avantages en question. On a bien plus de chances d'obtenir un changement en ayant recours à des politiques d'échange de ces privilèges, qu'à l'occasion d'une confrontation directe visant à les abolir. Ce n'est pas que la micropolitique refuse de tenir compte des principes moraux ; simplement, elle va mieux comprendre le point de vue de ceux dont l'assiette est beurrée par les hommes de l'Etat. En descendant au niveau où les décisions sont prises par les personnes et les groupes, et en examinant leurs raisons d'agir, elle est naturellement amenée à envisager la manière dont ils perçoivent la situation. Sans l'accepter le moins du monde pour autant, elle va tenir compte de leur prétention à faire de l'usage une source de légitimité, et rechercher des politiques leur offrant compensation pour ce qu'ils doivent perdre.
Adieu au "grand soir"
La micropolitique ne sera pas seulement moins agressive que les méthodes conventionnelles, elle sera aussi moins globale dans ses ambitions. Elle abandonne l'idée d'appliquer la vision d'une économie de liberté immédiatement et dans tous les domaines. A la place, elle va partout chercher des politiques qui permettront de faire des brèches, puis des incursions dans la forteresse de l'Etat ; elle veut créer une situation dans laquelle les privilèges redistributifs des hommes de l'Etat seront peu à peu négociés en échange de droits qui paraîtront avoir plus de valeur. En somme, le coup de balai est remis aux Calendes grecques, et la micropolitique propose des coups de pinceau ; il s'agit d'étudier attentivement chaque situation, et d'imaginer d'une politique qui devra réussir dans ce domaine-là. Elle est donc plus détaillée et plus progressive.
Pour réussir, au lieu de prendre à rebrousse-poil les groupes d'intérêts en place, elle propose de leur tenir la main. Il lui arrivera d'envisager une augmentation temporaire des dépenses publiques, afin de pouvoir enclencher un processus de diminution par la suite. Parfois, elle offrira à un groupe particulier ce qui a tout l'air d'être une faveur injuste, pour l'inciter à abandonner un privilège plus détestable et plus durable encore.
Un opportunisme d'apparence
Non seulement elle est moins globaliste, mais elle semble aussi moins cohérente. Elle n'entend pas appliquer le principe simple d'une société libre, débarrassée dans tous les domaines des subventions et des ingérences des hommes de l'Etat. Ce principe-là est davantage un objectif à long terme qu'un guide pratique pour la formulation d'une politique. La micropolitique produira des politiques différentes dans presque tous les cas, parce qu'elle sait que chaque activité pose des problèmes particuliers. Chacun des groupes d'intérêt, les caractéristiques de son privilège, et son mode de fonctionnement initial varient d'un secteur à l'autre. Il n'existe pas de formule simple. Si les problèmes sont différents dans chaque domaine, les solutions doivent l'être aussi.
La micropolitique a bel et bien une cohérence, mais celle-ci tient à l'unité de son approche. Politiques et recommandations vont changer d'un domaine à l'autre, mais la méthode qui les aura produites sera toujours celle que la théorie commune a imaginée. Tout commence par une analyse détaillée du statu quo ; différents privilèges et rentes obtenus, nature des groupes d'intérêts concernés, pouvoir et pressions qu'ils peuvent exercer. De là, on imagine les politiques d'échange des avantages, pour modifier la structure des incitations et changer les rapports de pouvoir entre les différents groupes. Ces réformes créeront une nouvelle situation qui, pour ainsi dire par construction, devra être acceptée par les personnes et les groupes et conduire, à terme, à diminuer les rentes de redistribution et à réduire la part des biens et services fournis par le secteur d'Etat.
Peut-on mettre en place un processus d'évolution spontanée ?
L'approche micropolitique est plus conservatrice que les politiques libérales classiques, précisément parce qu'elle est plus graduelle et plus progressive. Il est rare qu'elle propose des politiques faites pour obtenir un changement soudain et un impact immédiat. Elle essayera plutôt de déclencher une suite de décisions qui, au bout du compte, mèneront aux objectifs désirés.
Ce processus exige du temps. Il prend la société comme elle est. Il introduit çà et là des réformes qui la feront changer progressivement, mais inexorablement, dans le sens d'une diminution des subventions et de l'influence des hommes de l'Etat dans l'économie. Le résultat cumulé de cette approche politique sera d'accroître le degré d'autonomie au sein de la société, d'élargir les domaines de décision qui échappent au contrôle étatique et relèvent du choix des particuliers et des associations volontaires. Alors qu'il est le contraire d'un programme révolutionnaire, il vise cependant à susciter un mouvement massif, régulier et cohérent, dans une seule direction.
C'est une chose de se faire une image de ce que pourrait être une société meilleure. C'en est une autre d'analyser le fonctionnement de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Le rôle de la micropolitique sera de se placer sur le terrain intermédiaire, et d'imaginer les politiques qui, prenant le monde tel qu'il est, le rapprocheront de ce qu'il pourrait être. Le rêve est que les hommes de l'Etat cessent d'intervenir dans les choix économiques, de réglementer et de confisquer l'argent des gens au mépris de leurs préférences. La réalité est qu'il ne suffit pas de le vouloir, ni même d'en persuader les autres pour y arriver. Seules des politiques peuvent le faire, si elles conduisent les gens à renoncer aux privilèges et au pouvoir de dominer les autres que leur donnent les hommes de l'Etat, d'une manière qui rapportera plus de sympathie que d'hostilité au gouvernement qui les mène.
La réforme micropolitique n'est pas conçue pour être tolérée, mais préférée à la situation existante
Il y a une distinction très nette à faire entre cette approche et le simple gradualisme. Ce dernier implique une politique des petits pas, pour ainsi dire à un train de sénateur. Ces petits pas peuvent très bien aller à l'encontre des intérêts de la société, supposant que s'ils sont suffisamment modestes, ils ne déclencheront pas d'opposition assez forte pour les empêcher de s'imposer. Le fabianisme [3] en est un bon exemple, dont l'idée de base était d'instaurer le socialisme — qui à l'époque était totalement rejeté — à travers une série d'étapes dont chacune serait assez minime pour "passer" sans rencontrer l'opposition que l'objectif final aurait immanquablement suscitée.
La micropolitique n'est pas gradualiste. Les politiques conçues à l'intérieur de ce cadre ne sont pas faites pour être tolérées, mais pour être préférées à l'état actuel de la société. Certaines de ses réformes pourront être massives si un nombre suffisant de groupes et de personnes adopte la solution proposée à la place. Elle n'a pas non plus la moindre conception d'un projet terminal pour la société ; elle ne se soucie que d'instaurer un processus qui réduira les transferts forcés et autres ingérences des hommes de l'Etat. Quel que soit le type de société qui émergera de ce processus, ce sera le produit spontané du jeu réciproque entre des millions de décisions et d'actions différentes, et non un ordre social déclaré "supérieur" par on ne sait quelle autorité planificatrice. En outre, son approche s'appuie essentiellement sur les forces établies de la société, s'efforçant seulement de créer les conditions nécessaires pour les réorienter.
La micropolitique n'est pas un programme : c'est un mode d'emploi
Par conséquent, s'il est possible que ses réformes se fassent progressivement, elle n'est pas gradualiste. Elle ne cherche pas à faire les mêmes choses que les politiques classiques, en se contentant de les réaliser plus lentement. Elle cherche à créer des politiques nouvelles, pour faire des choses différentes. Plus précisément encore, elle cherche à les faire d'une autre façon. Elle ne part pas avec une liste de mesures à prendre, pour s'y atteler ensuite tout doucement. Elle part en ignorant ce qu'il faut faire, armée seulement d'une technique qui lui permettra de faire naître des politiques en réponse aux différentes situations qu'elle rencontre. C'est une approche et non un ensemble de priorités. Au lieu d'un programme à mettre en œuvre, on trouve un mode d'emploi pour la fabrication des politiques.
Du rêve à la réalisation
Notre projet est donc complet. L'analyse des choix publics nous a permis de comprendre pourquoi la réaction aux politiques traditionnelles prenait la forme qu'on lui connaît : elles méconnaissent le marché politique qui est à l'œuvre, ou ne savent pas s'y adapter. Alors apparaît cette idée d'un système qui concevrait les politiques publiques en se fondant sur cette analyse même, et contre lequel ces obstacles seraient inopérants, parce qu'il tiendrait compte du marché politique et fonctionnerait dans son cadre de référence. Un tel système, semble-t-il, permettrait de créer des politiques à la demande, chacune en réponse à une situation différente. Son unité serait au niveau de la méthode, et non plus du contenu.
Alors, voilà la question qui se pose maintenant : cette belle théorie, peut-elle s'incarner dans une pratique, et produire un tel système ? Existe-t-il dans les faits une approche "micropolitique", qui réaliserait ce que la théorie affirme être possible ? La réponse est oui. L'approche existe bel et bien, et qui plus est, elle est déjà à l'œuvre. Conformément à notre thèse, suivant laquelle en politique la théorie explique la pratique, et la précède rarement, tout ce que nous venons d'envisager décrit quelque chose qui existe déjà. La pratique micropolitique est déjà à l'œuvre, et ne compte plus ses succès. Les programmes issus de cette pratique ont déjà permis d'obtenir ce que les tentatives précédentes n'avaient pas su réaliser. Les gouvernements de droite qui l'ont utilisée ont pu faire aboutir une bonne partie de leurs projets initiaux. Qui plus est, à mesure que ses résultats concrets devenaient visibles, elle a déclenché une cascade de changements dans le monde entier.
C'est le choix d'une approche micropolitique qui a déterminé les succès de Thatcher et Reagan
Cette fameuse différence entre les gouvernements Nixon et Heath dans les années soixante-dix, et les gouvernements Reagan et Thatcher dans les années quatre-vingts, rien ne nous empêche plus de la reproduire, connaissant désormais tous ses secrets. Aucune nouvelle victoire notable dans la bataille des idées, pas de différences de caractère suffisantes entre les protagonistes ; aucun changement dans le monde rendant subitement viables des politiques impraticables dix années plus tôt. C'est dans les politiques elles-mêmes que se trouvait le changement. Et ce changement, nous lui avons donné un nom et une explication théorique : ce changement, c'était la micropolitique.
Les propositions de réforme dont les gouvernements récents s'étaient pourvus provenaient d'une approche micropolitique. Comme les précédents, ils savaient ce qu'ils voulaient. Cependant, à la différence de ces derniers, ils avaient dans leur sac un certain nombre de programmes qui, eux, permettaient effectivement de l'obtenir. L'émergence, dans le courant des années soixante-dix, d'une méthode radicalement nouvelle pour formuler les politiques, avait mis une panoplie complète d'applications détaillées à la disposition de ces gouvernements. Au lieu de se jeter tête baissée dans le piège d'un affrontement avec les groupes d'intérêt mis en cause, ils surent alors proposer à ces groupes des politiques qui leur offraient l'occasion d'obtenir, en échange, des avantages supérieurs.
Les programmes conservateurs des années soixante-dix ont échoué. Ceux des années quatre-vingts ont largement réussi. La différence résidait dans la technique politique. Elle tenait directement à l'assimilation du concept de "marché politique" par les professionnels de la mise au point des réformes.
Problèmes, leurres et solutions
Deux domaines où la micropolitique a renouvelé l'approche des problèmes
Poursuivons l'analyse de la micropolitique en comparant les propositions concrètes de la politique conventionnelle avec celles qui sont nées de la vision de la politique comme lieu d'échanges. Le meilleur moyen de percevoir leurs différences peut être de montrer en quoi elle s'opposent sur la solution de certains problèmes particulièrement tenaces.
Les "services publics" locaux
Parmi les nombreux domaines de la société et de l'économie qui méritent la critique des gens "de droite" ou des "libéraux", on peut citer les prestations offertes par les "services publics" locaux : l'essentiel du problème est que les collectivités ont progressivement pris le contrôle d'un grand nombre de services locaux, ce qui a largement politisé la vie économique, avec tous les problèmes qu'entraîne la production de type "public".
Typiquement, un "service public" local est directement contrôlé par les élus de la collectivité locale, qui gère ses services et emploie directement son personnel. Le service est financé par les recettes publiques locales, qui proviennent d'impôts sur les entreprises, sur les propriétaires fonciers locaux ou les particuliers, et aussi par des subventions de l'Etat qui constituent une part croissante du total. Le financement et la production des "services publics" locaux sont donc fournis par le secteur "public" de l'économie.
Excès de dépenses et dégradation du service
Comme l'a montré l'étude du fonctionnement des services étatisés, tout cela force le public à payer sans qu'il puisse contrôler le niveau de la production ni la qualité du service. A long terme, le service tend à être produit en excès, le rapport efficacité/coût diminue, avec un personnel en surnombre et un capital dégradé, et le service est capturé par les producteurs, méprisant entièrement les préférences des consommateurs. Les finances publiques locales n'échappent pas à la loi du genre et sont délibérément redistributives ; les charges élevées constituent un handicap réel pour les entreprises locales, et la forte imposition foncière tombe de façon discriminatoire sur certaines catégories de propriétaires immobiliers qui, dans bien des cas, ne représentent qu'une petite minorité de l'électorat.
Les lois du marché politique qui devaient y conduire sont faciles à retrouver : la petite proportion de ceux qui font l'acte de payer les taxes locales est moins nombreuse que ceux qui pensent en profiter à leurs dépens. Les entreprises locales n'ont pas de suffrages à échanger, et le système n'impose guère de sanctions aux élus dont les excès affaiblissent leur propre base d'imposition, parce que le système compense la différence par une dotation de l'Etat central. Les candidats aux élections locales ont donc intérêt à offrir le plus possible de services, car ils sont quasiment perçus comme "gratuits" là où ils sont reçus.
La réforme technocratique
Le paradigme conventionnel a inspiré deux propositions de réforme. La première, qui ne mérite qu'un bref examen, entendait refondre l'ensemble du système des collectivités locales. L'amalgame en unités plus grandes était censé permettre des économies d'échelle, conduisant à de nouveaux sommets dans l'efficacité productive des services. Cette solution, qui fut appliquée en Grande-Bretagne au début des années soixante-dix, engendra exactement le contraire de ce que l'on avait prétendu souhaiter. Les nouvelles entités étaient trop grandes et trop éloignées des électeurs pour subir la moindre influence de leur part, ce qui, bien sûr, réduisait d'autant l'intérêt qu'ils pouvaient y trouver. Ils ne trouvaient pas du tout à leur goût ce nouveau gigantisme, ni ces administrations trop grosses, trop puissantes et trop lointaines pour qu'on puisse se faire entendre d'elles.
L'inefficacité et le gaspillage se développèrent en conséquence, et les abus devinrent rapidement endémiques. Certains élus locaux s'étaient rendus compte que le nouveau système mettait à leur disposition des ressources supplémentaires, littéralement pour acheter les suffrages de groupes minoritaires dans leur région. Ils se mirent à distribuer force subventions à toutes sortes de causes, dont le principal point commun semblait être leur dépendance vis-à-vis des politiciens qui les leur avaient octroyées.
La "macro"-politique libérale
Une autre proposition fut avancée à plusieurs reprises. Elle proposait de pallier l'impuissance du consommateur en lui permettant de ne payer le service qu'au moment de sa fourniture. Les services continueraient à être fournis par les autorités locales, mais seraient réglés directement par les consommateurs au moment où ils les recevaient, au lieu d'être financés par l'imposition générale [1]. Cette proposition visait à faire ressentir aux consommateurs le coût de chacun des services, ce qui n'était pas possible lorsque le financement avait lieu par l'impôt. Contraints à un paiement direct, sonnant et trébuchant, les citoyens prendraient la mesure du coût réel de chaque service, et feraient pression sur les autorités locales afin d'en avoir pour leur argent.
L'avantage supplémentaire offert par ce système était la possibilité pour le consommateur de limiter la quantité du service à ce qu'il était effectivement prêt à payer. On tenait pour acquis que le tarif à la fourniture devrait couvrir la plus grande partie du prix de revient, et que la quantité fournie s'ajusterait donc progressivement à ce que le consommateur était prêt à dépenser. Par exemple, si les coûts du ramassage des ordures étaient directement facturés à l'usager, peut-être serait-il prêt à accepter une seule collecte hebdomadaire au lieu de deux, et peut-être même une tous les quinze jours. La fourniture serait alors ajustée à cette demande.
A première vue, ce système offrait au consommateur un pouvoir de décision considérable, là où il n'en avait eu aucun. Devant payer directement, il apprécierait le coût de chaque service, d'une manière que le financement centralisé interdit de réaliser, et deviendrait maître de sa propre consommation. Economiquement, c'était un avantage indiscutable. Le citoyen ferait sentir au "service public" le poids de son porte-monnaie. Faute d'avoir le choix du fournisseur, il pourrait au moins décider de la quantité de service demandée.
On aurait continué à subir les tares de la fourniture publique
Or, du point de vue des marchés politiques, ce système est beaucoup moins intéressant. Pour commencer, il laisse la production du service intégralement entre les mains des personnages publics, ne transférant que son financement à des mains privées. Ce qui veut dire que tous les effets de la fourniture publique se perpétuent imperturbablement. L'inefficacité relative, les sureffectifs, la décapitalisation, l'absence de choix et la capture par les producteurs, autant de caractéristiques de la production par un monopole public, et transférer son financement au secteur privé n'en atténue pas forcément les effets.
On négligeait les illusions que l'intervention publique engendre systématiquement
Non moins importante est l'objection qu'au départ, la plupart des usagers perçoivent les avantages du service bien plus qu'ils ne perçoivent la charge de son coût. Même si l'objectif — fort louable — est de faire en sorte qu'ils perçoivent ce dernier, ils n'ont aucune raison de désirer en prendre conscience. Nombre d'entre eux s'imaginent que ce sont "les autres" qui paient la plus grande partie des services reçus, et ne se rendent pas compte de ce qu'ils paient eux-mêmes, par l'imposition directe et surtout indirecte. Par conséquent, alors même que leur liberté de choisir en serait évidemment accrue, envisager une tarification directe pour leur faire payer l'intégralité du service risque en fait de provoquer leur opposition furieuse à un tel projet.
Bien sûr, le corollaire du système de la tarification directe est que l'impôt servant généralement à financer les services locaux et nationaux serait réduit en conséquence. Les gens pourraient alors disposer de l'argent pour acheter ou non les services, comme ils l'entendent. Cependant, rendre aux gens leur argent en lieu et place de services (pseudo-)gratuits ne s'accorde pas avec les conclusions de l'analyse des choix publics, suivant lesquelles un groupe donne davantage de valeur aux services qu'il reçoit que les autres ne souffrent d'avoir à les payer. En d'autres termes, passer de la pseudo-gratuité à la tarification directe en matière de "services publics" méconnaît les réalités du marché politique au lieu de les prendre en compte.
Le jeu continuel des pressions politiques aurait progressivement érodé les disciplines envisagées
A propos de l'impact politique, autre chose mérite d'être noté : ce système de tarification exige que le prix des services soit fixé par les autorités locales. Il se peut bien qu'à l'origine, le tarif soit établi d'après le prix de revient réel, mais il faudra bien qu'il soit révisé périodiquement par l'assemblée locale, ne serait-ce que pour tenir compte des accroissements des coûts de production. Ce qui signifie que les élus devront envisager des augmentations de tarifs, et prendre leurs responsabilités en la matière. C'est à ce stade qu'ils sont exposés à des pressions extrêmement fortes de tous les groupes minoritaires qui pensent que leur cause est juste, ou dont les porte-parole et autres "conseillers en communication" ont jugé qu'elle pouvait l'emporter. On leur demandera d'exempter les chômeurs de ces augmentations, et aussi peut-être les personnes âgées et les bénéficiaires de l'aide sociale. S'ils refusent, on fera connaître à l'opinion la dureté de leur cœur de pierre.
Les groupes de pression pourront alors être abordés sur le marché politique par des candidats qui proposeront de leur offrir les mêmes services à des tarifs spéciaux subventionnés, et la pression s'exercera partout pour réduire l'impact des augmentations de prix. Au bout d'un certain temps, il n'est pas impossible du tout que ce qui avait démarré sous la forme d'un financement intégral par l'usager termine sa carrière sous la forme d'un paiement de plus en plus symbolique, le déficit étant couvert par la subvention pour entretenir certains groupes clés de la population. C'est ainsi que les pressions politiques peuvent conduire le principe du paiement direct à se détruire lui-même, les élus qui voudraient imposer un système de vérité des prix s'exposant inutilement aux inconvénients électoraux d'une impopularité que d'autres auront su éviter.
Pour éviter cela, peut-être faudrait-il que le Parlement vote une loi pour abolir le pouvoir discrétionnaire de fixer les tarifs publics. Mais une telle décision engendrerait à son tour une tempête d'opposition de la part des élus locaux dépouillés de leurs prérogatives, ainsi que des groupes minoritaires menacés dans leurs privilèges. Son incapacité à reconnaître la force des marchés politiques condamne donc vraisemblablement le système du paiement direct à l'échec. Il est de fait qu'on ne le voit guère fonctionner au niveau local.
La proposition micropolitique : privatiser non pas le financement, mais la fourniture des services publics locaux
Voyant peut-être mieux que d'autres les ouvertures et les impasses de cette configuration politique, les tenants de la micropolitique ont, à la place du paiement direct des services, mis au point la proposition symétrique, qui consiste à faire appel aux entreprises privées pour fournir les services habituellement fournis par le secteur public. C'est ce qu'on appelle la "convention", transfert par contrat de la fourniture des services au secteur privé. Cette démarche laisse les autorités locales responsables des services, qu'elles continuent à financer à l'aide des fonds publics locaux et nationaux. La différence est qu'au lieu d'employer son propre personnel et ses propres cadres, la collectivité locale paie des entreprises privées pour exécuter la mission de fournir les services, les ayant mises en concurrence pour l'obtention des contrats.
Le système du paiement par l'usager envisageait de confier le financement au secteur privé, tout en laissant la production entre des mains publiques. Le système de la convention, à l'inverse, transfère la production au secteur privé, tout en lui conservant un financement public. Cela ne donne aux usagers aucun contrôle direct sur la consommation, comme l'aurait fait le système du paiement direct, et ils n'ont pas davantage le choix de leurs fournisseurs qu'avec le système du paiement direct ou de la régie [2] locale. Ce que fait la convention, c'est créer une concurrence entre les candidats pour la fourniture des services.
Des contraintes qui poussent à l'amélioration du service
Avec le système de la convention, les entreprises doivent surenchérir pour les contrats de service local. C'est ainsi que l'on introduit la concurrence, les fournisseurs devant maintenir les coûts les plus bas possibles pour une qualité élevée. S'ils ne le font pas, le contrat ira à d'autres entreprises. En général, les conventions seront de courte durée, par exemple trois ans, cela dépend du type de service. Les entreprises qui répondront aux appels d'offre doivent rester efficaces, et se maintenir à niveau en matière d'équipement et de technique. Celle qui n'y parviendrait pas verrait le contrat passer à des entreprises restées compétitives.
Le résultat est que la plupart des traits caractéristiques de la fourniture publique disparaissent. Avec la fourniture privée, l'inefficacité, les sureffectifs et le manque de capital ont beaucoup moins de chances de persister, pour la raison bien simple que les entreprises qui se laissent aller à ce genre de pratiques savent qu'elles perdront leur marché au profit de celles qui savent s'en garder. La capture par les producteurs y est également beaucoup plus difficile, parce que les contrats peuvent être repris par des concurrents capables de satisfaire le consommateur, et que ceci entraîne un risque de faillite pour celles qui ne le feraient pas.
Il en résulte que la collectivité bénéficie d'un service meilleur et moins cher. Les économies ainsi réalisées sont estimées entre 20 et 40 %, selon le type de service et le pays. En Grande-Bretagne, les premières économies calculées par l'Institut des Etudes Fiscales étaient de 22 % en moyenne. Ce chiffre est probablement en-deçà de la réalité, car les économies sont généralement moindres la première année. Les chiffres représentent la différence entre le prix de revient des services municipaux et celui d'un équivalent privé, y compris les bénéfices de l'entreprise et les impôts qu'elle doit payer.
Bien ménager les intérêts tels que les groupes les perçoivent
Il y a donc là un gain possible pour les élus locaux, qui n'ont pas toujours tout l'argent nécessaire pour leurs projets, comme pour le public, qui n'aime pas payer plus cher que nécessaire. Le système conventionnel offre potentiellement un avantage net s'il est possible de le mettre en place en prenant en compte les contraintes du marché politique. C'est loin d'être une tâche facile, et cela exige que les projets s'inspirent de l'analyse des choix publics, les différents groupes d'intérêt devant tous être pris en considération.
Le public est surtout sensible à la qualité du service. Par conséquent, tout transfert à un contractant extérieur doit essayer d'obtenir une qualité au moins égale. Ce qui peut se faire si les contrats sont rédigés avec rigueur, comportant clauses de pénalité et garanties d'exécution. Le public souhaite aussi qu'on tienne compte de ses besoins, et nombre d'entreprises, dès qu'elles ont remporté un contrat avec une collectivité locale, prennent la peine de faire des études de marché pour se tenir au courant de ce que désire le public.
La bureaucratie locale risque de perdre position et avantages si ses tâches sont dévolues au secteur privé. Il faut donc que les élus qui passent les conventions forment leurs équipes d'encadrement à la tâche de suivi et de police des contrats. Cela leur donnera une occasion de remplacer les responsabilités perdues par un travail plus intéressant encore.
C'est le personnel des "services publics" qui est le plus menacé, et par conséquent le plus susceptible de s'opposer fortement à ce qu'on remette les tâches au secteur privé. C'est pourquoi les collectivités locales stipulent souvent que leur personnel aura priorité pour les nouveaux emplois créés dans le privé. Nombre d'entre elles neutralisent aussi l'opposition potentielle par une politique évitant toute perte d'emploi forcée. Elle consiste à recaser leur personnel en lui offrant les emplois qui, sinon, auraient été occupés par des nouveaux venus. Une autre politique est encore de leur offrir des indemnités de départ à des conditions suffisamment généreuses pour amener assez d'employés à les accepter volontairement.
Les dirigeants syndicaux sont les plus difficiles à traiter, car on ne peut pas leur offrir de poste qui puisse se comparer au pouvoir dont ils jouissaient dans leurs fonctions antérieures. En conséquence, il faut habituellement offrir au personnel des conditions suffisamment intéressantes pour passer par-dessus la tête des chefs syndicalistes et obtenir un accord direct des employés.
Les salariés satisfaits
L'expérience pratique de l'appel aux entreprises privées pour les services locaux en Grande-Bretagne a montré que les services pouvaient fonctionner avec 15 à 20 % de personnel en moins. Les salariés en surnombre peuvent être affectés ailleurs, éventuellement après recyclage. Ceux qui sont engagés par le contractant privé y trouvent des emplois plus qualifiés et des conditions d'avancement plus favorables. La sécurité de l'emploi est moindre dans le privé, et les systèmes de retraite moins avantageux, dans une large mesure parce qu'aucune entreprise privée ne peut se permettre d'indexer les retraites comme le fait le secteur public. En revanche, le salaire est aussi bon, et les avantages sont les mêmes. Le travail n'est pas plus dur, mais il est utilisé de façon plus efficace, et beaucoup de salariés se félicitent d'avoir sauté le pas.
La satisfaction de l'usager dépendra des procédures prévues pour garantir la qualité des services
Cependant, si l'élu, soumis à tant de pressions, est fort sensible aux économies de coûts, il ne faut pas en attendre trop de satisfaction de la part du consommateur. Il n'est pas contre l'abaissement des coûts et des impôts locaux qu'apporte la convention, mais nous savons qu'il perçoit le service lui-même beaucoup plus directement que ce qu'il lui en coûte. C'est pourquoi le contrôle de la qualité est si important pour le succès de cette politique. Si l'on peut mettre en place un nouveau service qui sera plus efficace et attentif à ses besoins, le consommateur verra vraiment la différence avec le service déplorable et souvent hautain qui résulte de la capture par les producteurs dans le secteur public.
Ceci, à son tour, exige la mise en œuvre d'un certain nombre de techniques détaillées. Beaucoup de collectivités locales "pré-qualifient" les soumissions, examinant soigneusement les offres pour éliminer celles qui n'atteindraient pas les normes de qualité requises. La sélection finale se fait à partir d'une liste des entreprises jugées suffisamment compétentes et expérimentées. Nombre d'élus font appel à des consultants extérieurs pour mettre au point les contrats, et presque tous exigent des garanties d'exécution, de sorte que si l'entreprise fait défaut, ou faillite, le service n'en pâtisse pas. Une autre procédure prévoit des pénalités pécuniaires au cas où le service ne correspondrait pas aux normes fixées, chose qu'aucune collectivité ne pourrait se permettre d'exiger de ses propres services. Bien sûr, la corruption demeure possible dans le système d'octroi des contrats mais, avec un appel d'offre largement public, elle est bien moins développée que dans les services locaux, qui échappent largement à la vigilance des citoyens.
Une réforme typiquement micropolitique
Les méthodes de la micropolitique transparaissent à toutes les étapes du processus. L'analyse identifie tous les groupes du marché politique en question, et repère l'avantage particulier de chacun. Puis une politique est mise au point, qui offrira un avantage supérieur au plus grand nombre possible. Toutes les oppositions sont envisagées, la politique étant faite pour en neutraliser la plupart à l'avance. Le résultat est une politique qui marche, et dont le succès inspire tellement confiance qu'il permettra de l'appliquer ailleurs.
La convention n'est pas la solution libérale pour les "services publics" locaux. C'est un succès parce qu'elle conduit à de meilleurs services, et pour moins cher. Elle introduit des éléments de liberté en soustrayant la production au secteur public pour la restituer au secteur et à l'entreprise privés. Elle introduit la concurrence, aussi bien pour la qualité des services que pour la détermination des prix, et encourage l'innovation et la performance.
Les macro-politiciens la critiqueront et la critiquent parce qu'elle ne va pas assez loin. La vraie liberté, font-ils valoir, serait que les habitants d'une circonscription quelconque décident eux-mêmes directement à quelle entreprise ils feront appel pour les fournir, et quelle quantité de service ils vont recevoir. La critique est parfaitement juste ; faire appel à des contractants privés n'est pas la libre entreprise. Le financement est toujours collectivisé, et refuse sa place au choix personnel. Le problème se pose lorsque, voulant mettre en place un système totalement libre, la théorie des choix publics annonce que vous vous heurterez à un mur du fait des pressions des groupes d'intérêt concernés, alors qu'un système de contrats serait accepté. Le résultat ? Alors que les partisans d'une solution complète s'efforçaient encore de gagner la bataille des idées, en Grande-Bretagne les micropoliticiens se sont entre-temps débrouillés pour porter le système de la convention à un niveau de réussite tel que le gouvernement, bien assuré sur ses arrières, a rendu obligatoire l'appel à des entrepreneurs privés par les collectivités locales.
Le contraste entre la solution micropolitique et celles du paradigme conventionnel (comme le paiement direct par l'utilisateur), montre à quel point extrême la première s'implique dans le monde réel. Elle veut tellement transformer l'idée en réalité sur le marché politique qu'en mettant au point ses techniques, elle recherche le moindre détail lui permettant de contourner les obstacles éventuels. Son souci n'est donc pas de chercher une solution passe-partout, mais de tailler sur mesures une politique pour chaque situation. Et elle réussit souvent parce que, lorsqu'elles sont faites sur mesure, les politiques sont évidemment mieux ajustées.
Deuxième exemple : l'enseignement étatisé
Un autre exemple de problèmes sérieux engendrés par la production étatisée est l'enseignement public. En Grande-Bretagne, environ 93 % des enfants dépendent du secteur public et de lui seul pour leur instruction primaire et secondaire. Il existe un substitut théorique sous la forme d'écoles entièrement payantes, mais comme tout le monde doit payer l'impôt au système d'Etat, seule la minorité des gens qui peuvent se permettre de payer deux fois a effectivement accès à ces écoles privées. En conséquence, les écoles payantes apparaissent trop chères, alors que leurs tarifs ne font que correspondre en gros à ce que coûte l'enseignement public, si l'on y inclut les dépenses administratives au niveau local et national.
L'inversion classique du "service public" : impuissance des bénéficiaires prétendus, tyrannie des employés officiels
La plupart des parents n'avaient aucune option réelle dans le cadre du système d'Etat. Leur enfant était affecté à l'école la plus proche, et bien qu'on ait prévu une possibilité de choisir, il suffisait aux autorités locales d'invoquer les "intérêts de l'éducation" pour la faire annuler. La plupart des tares de l'offre publique y apparaissaient au grand jour. Les parents étaient mécontents de la qualité de l'enseignement, et pouvaient constater qu'on répondait à la baisse du niveau en essayant d'empêcher qu'on le mesure, au lieu de chercher à l'améliorer.
A toute occasion, on se heurtait aux effets de la capture par les producteurs . La "qualité du service" par exemple, n'était pas appréciée d'après les résultats, mais d'après les ressources utilisées. Ainsi, ce n'était pas le niveau de connaissances des enfants qui était censé compter, mais l'effectif des classes et le niveau de qualification supposé des enseignants. Le coût et la taille des services administratifs prenaient une part énorme, et croissante, du budget global. Les tentatives pour faire des économies n'affectaient en rien le gaspillage, mais touchaient en revanche le capital et l'équipement, ainsi que les services essentiels.
Les parents étaient forcés par l'impôt de payer une somme qu'ils ne pouvaient pas contrôler, pour financer un enseignement où ils n'avaient aucun choix et aucune possibilité de faire connaître leurs préférences. En somme, ils payaient cher une ration imposée. L'uniformité était reine, sans variété ni choix, et les priorités "pédagogiques" étaient bien sûr dictées par les producteurs. Quelle idée, de demander leur avis aux consommateurs ! Ces priorités comprenaient évidemment ce que nombre de parents comprenaient comme un endoctrinement politique, n'ayant rien à voir avec de l'enseignement [3].
Comment privatiser les décisions sans toucher au mythe de la "gratuité" ?
Réintroduire dans le système éducatif des disciplines de marché pour laisser un peu de place aux besoins des consommateurs, posait aux législateurs un double problème. Aussi mécontents qu'ils aient été du produit fourni, les gens avaient pris l'habitude d'un service d'enseignement "gratuit" lors de sa consommation.
Faciliter l'inscription aux écoles privées ?
Un type de solution envisagé consistait à se tourner vers les écoles privées, en cherchant les moyens d'en ouvrir l'accès à un plus grand nombre de parents ordinaires, pour accroître le nombre des enfants qui leur étaient confiés.
L'une des mesures proposées consistait à permettre de déduire des impôts les frais de scolarité privée, ce qui en réduisait le coût en termes réels, et donnait à davantage de gens les moyens d'accéder aux écoles payantes. Une variante similaire proposait d'offrir un abattement fiscal à ceux qui quitteraient l'enseignement d'Etat pour choisir une école privée. Ces solutions s'appuyaient sur l'idée que ces parents épargnaient à "l'Etat" le coût de l'éducation de leurs enfants, et que peut-être une petite incitation en encouragerait d'autres à les imiter. Si l'abattement était bien calculé, l'"Etat", en n'ayant pas à instruire ces enfants, pourrait épargner davantage qu'"il" n'y perdrait en impôts non versés.
Il fallait trouver une solution pour tout le monde
Toutes ces propositions souffraient de cette faiblesse fondamentale que le nombre des bénéficiaires éventuels du secteur privé serait de toutes façons trop restreint. On a de bonnes raisons de penser qu'il existe dans les classes moyennes un groupe de pression latent qui ne demande qu'à s'exprimer, pour avoir davantage les moyens d'accéder aux écoles privées. Les sondages ne montrent aucune hostilité de la part de la majorité des parents, lesquels semblent plutôt enclins à laisser le libre choix à ceux qui peuvent se le permettre. Politiquement parlant, il semble donc tout à fait possible de faciliter l'accès au privé. Le problème est que, même si l'on y doublait le nombre de places, cet événement improbable laisserait quand même quelque 86 % des parents piégés dans le système public. Par conséquent, pour la plupart des parents, la réforme devait passer par l'amélioration du secteur public.
La "macro"-solution semi-libérale : le "bon scolaire"
Les partisans des solutions de liberté prônent depuis longtemps la mise en place d'un système de bons scolaires. Dans un système de bons, on ne donnerait plus aux parents une place (pseudo-) gratuite dans une école publique. Ils recevraient à la place un bon, de valeur équivalente à ce que coûterait cette place, et seraient libres de le donner en paiement à l'école de leur choix. Le bon prendrait la place de l'argent. Plutôt que de leur rendre leur argent, avec obligation de le consacrer à l'école, les hommes de l'Etat donneraient aux parents un coupon de papier qui fonctionnerait comme lui, avec cette différence importante qu'ils ne pourraient pas le "détourner" à d'autres fins. Ce système répond ainsi à l'objection selon laquelle, si on laissait aux parents la possibilité de payer directement, ils iraient dépenser l'argent au jeu ou alors le boire.
Le système du bon scolaire ne vise en rien à instituer un système de liberté authentique. Subventions et transferts persistent, les contribuables qui n'ont pas d'enfants sont toujours forcés de payer des bons qu'ils ne reçoivent pas, de sorte que les parents se font entretenir par les non-parents. En outre, le montant du bon impose une somme minimum à consacrer à l'école, interdisant aux parents d'y dépenser moins. On pourrait envisager l'apparition d'un marché noir, d'un commerce illégal où les bons s'échangeraient contre de l'argent, de sorte que les gens pourraient en fait choisir ; mais cela se ferait contre la législation du bon scolaire, et non sous son égide.
L'objectif de ce système est d'introduire un élément de discipline marchande. En choisissant où dépenser leurs bons, les parents choisiraient le type d'école qu'ils préfèrent. Les écoles considérées comme "mauvaises", ne recevant plus assez de bons pour payer leurs frais, devraient réduire leurs activités, voire envisager la fermeture. Les écoles bien cotées, attirant une demande supplémentaire, obtiendraient grâce aux bons suffisamment d'argent pour prendre de l'extension. En outre, elles serviraient de modèle aux autres. Petit à petit, l'éducation prendrait la forme que les parents souhaitent pour leurs enfants. Elle se dégagerait de l'emprise des producteurs, et se retrouverait aux ordres des consommateurs, désormais admis à faire prévaloir leurs choix.
Il existe plusieurs variantes du système de bons, mais la plupart d'entre elles permettent aux parents d'ajouter de l'argent à la valeur de leur bon pour acheter une place dans une école plus chère. Ce qui implique que les parents pourraient choisir une école privée s'ils le souhaitent, en compensant la différence entre le prix de l'école et la valeur du bon. Ceci implique également que certaines écoles d'Etat choisiraient de proposer une éducation plus coûteuse que les autres. L'effet net serait d'apporter davantage de ressources au système éducatif, tout en rapprochant encore davantage le niveau de sa production de ce que les parents souhaitent, et sont prêts à financer par leurs bons et leur argent.
Les obstacles politiques
Le système des bons présente bien des aspects intéressants et pourrait, s'il pouvait être réalisé, constituer une amélioration bien réelle par rapport au quasi-monopole des hommes de l'Etat dans le domaine de l'enseignement. Malheureusement, l'expérience semble montrer que le système des bons ne peut pas être mis en application. Malgré ses indubitables atouts économiques, il présente des faiblesses politiques qui le font gravement déconseiller. Sous sa forme moderne, cela fait plus de soixante ans qu'il fait l'objet de débats. Il a été sérieusement examiné par les gouvernements conservateurs anglais, mais jamais introduit. Même une conjoncture exceptionnelle, où l'on comptait à la fois le Ministre et le secrétaire d'Etat à l'Education parmi ses partisans, n'a pas suffi pour le mettre en pratique.
Pour commencer, il y a une opposition très forte de la part de ceux qui produisent l'enseignement. Les syndicats d'enseignants résistent parce qu'ils ne veulent pas que leurs adhérents soient exposés aux disciplines du marché. Les bureaucrates des ministères sont absolument fanatiques dans leur opposition. Ils comprennent bien, et avec juste raison, que ce système rendrait aux parents le pouvoir, qu'ils ont confisqué, de contrôler ce qui est enseigné. Les parents eux-mêmes se laissent facilement inquiéter par la perspective de perdre la place (pseudo-)gratuite qui leur est garantie à l'école locale. Ils craignent d'être obligés de payer davantage pour assurer à leurs enfants une éducation correcte.
La peur de l'inconnu
En outre, il n'est pas vraiment possible de mettre en place ce projet de façon progressive. On peut bien parler d'expériences limitées, ce système ne peut pas être vraiment efficace ni offrir la diversité et le choix, s'il ne concerne pas l'ensemble des écoles, et sur un espace assez large. A cette échelle, il est exposé au sabotage de ceux qui refusent de perdre leur pouvoir abusif sur l'enseignement. C'est donc un projet globaliste, où tous les changements doivent se produire d'un seul coup. Les parents recevraient une feuille de papier par la Poste, au lieu d'une place "gratuite" dans une école. Les écoles, aussi bien que les parents, se trouveraient tout-à-coup plongées dans l'incertitude. Rien n'est plus facile que de présenter tout cela comme un projet de théoriciens, jamais vraiment essayé, et qui ferait courir un danger à l'éducation des enfants. Plusieurs gouvernements ont essayé d'imposer des systèmes de bons, mais ont dû à chaque occasion battre en retraite face à l'opposition politique des groupes d'intérêt.
Le triptyque des micropoliticiens
Une proposition de remplacement, qui doit beaucoup à l'analyse micropolitique et à sa manière de faire, propose trois réformes indépendantes, dont chacune peut en soi être justifiée, mais dont la combinaison forme un nouveau système.
Supprimer la "carte scolaire"
Tout d'abord, elle prétend que les parents aient un véritable Droit de choisir, et propose en conséquence que l'entrée soit totalement libre dans le système d'Etat, de sorte qu'un enfant puisse être envoyé à toute école qui l'acceptera.
Cette politique-là est calculée pour faire plaisir aux parents. Nombre d'entre eux sont piégés par leur lieu de résidence dans la zone d'affectation d'une mauvaise école. La liberté de choisir l'école doit leur permettre de s'échapper. Le Droit de choisir, en présence d'une sectorisation de droit ou de fait, est réservé à ceux qui ont les moyens de déménager à proximité d'une bonne école. Il n'est pas rare, d'ailleurs, que des maisons situées du "bon" côté de la rue affectées à la bonne école vaillent plusieurs milliers de livres de plus que leurs vis-à-vis, physiquement identiques. La politique du libre accès laisse toujours les parents se débrouiller avec les problèmes de transport. Elle doit aussi conduire les bonnes écoles à un excédent d'inscriptions, les obligeant à refuser des candidats. Il n'empêche que ce serait un mieux, et un mieux apprécié.
Rapatrier la responsabilité au niveau où les problèmes se posent
Le second pilier de la réforme est une politique qui rend les écoles beaucoup plus indépendantes dans leur fonctionnement. Dans chaque école, un Conseil où le vote des parents serait fortement représenté, prendrait en charge l'ensemble des décisions. Il aurait le pouvoir de choisir son directeur, et de lui donner l'autorité nécessaire pour embaucher le personnel et le renvoyer, avec approbation du Conseil. L'école déterminerait sa propre politique en ce qui concerne la discipline et les programmes, avec une inspection régulière des résultats de ses élèves dans un tronc commun minimum.
Avec une telle réforme, les écoles sont enfin autorisées à offrir davantage de diversité, de même que des approches différentes de l'enseignement et de la pédagogie. A son tour, cette diversité permettra de donner un contenu concret au choix entre les écoles exprimé par les parents. Les parents apprécient cette politique, qui leur promet voix au chapitre dans les orientations de l'école. Elle reçoit un accueil mitigé de la part du personnel, les directeurs y étant globalement favorables pour le meilleur statut et le pouvoir qu'elle leur donne, et les enseignants étant plus divisés. Certains y reconnaissent des possibilités d'avancement et de rémunérations accrues, d'autres craignent pour la sécurité de leur emploi. Des garanties précisant la durée de l'emploi et les motifs de licenciement pourraient faire beaucoup pour calmer de telles inquiétudes.
Subordonner étroitement le financement de l'école à la présence de l'élève
Le troisième pilier de la réforme impose un financement direct des écoles sur la base du nombre d'enfants inscrits. Notre système les finance actuellement par l'impôt, par l'intermédiaire de l'administration du Conseil Local de l'Enseignement. La réforme court-circuitera la bureaucratie installée, autorisant les écoles à choisir de quitter son orbite, en étant financées directement par le centre, en fonction des effectifs. Bien sûr, cette solution déplaît fortement aux Conseils en place, mais ces derniers sont tout petits, et n'auront plus grand-chose à offrir sur le marché politique. Notre administration centrale y est plus favorable, car elle voit peut-être davantage d'ouvertures pour ses membres dans la supervision d'un tel projet, sans pour autant avoir à envisager des pertes d'emploi ou de statut.
On propose que le financement pour chaque élève soit calculé d'après le coût de l'enseignement pour chaque classe d'âge, avec peut-être des exceptions vers le haut pour les établissements urbains où les problèmes de langue sont importants, ainsi que pour les écoles de campagne isolées qui ont davantage de charges fixes par élève. Deux groupes qui auraient pu se sentir menacés par la réforme sont donc pris en charge. Les parents, dans l'ensemble, n'ont rien à perdre à un financement direct des écoles, et ils y gagnent l'économie qui résulte de ce qu'on supprime toute une strate de l'administration, ce qui en laisse davantage pour financer le service.
Un quasi-marché pour les services d'enseignement
Une fois ces trois piliers de la réforme mis en place, il deviendra évident que leur effet combiné est de créer un marché de l'enseignement. Comme les écoles sont désormais contrôlées par leurs propres Conseils, elles suivent leurs propres priorités pédagogiques, et diffèrent par la qualité et le type des formations. Comme les parents ont la liberté d'accès, ils choisissent pour leurs enfants le type d'enseignement qu'ils préfèrent. Comme les écoles sont directement financées d'après le nombre d'élèves, celles qui reçoivent une demande accrue reçoivent aussi plus d'argent. Les écoles mal vues des parents se réforment, ou doivent fermer.
Le changement se fera exactement au gré des personnes directement concernées
Un des grands avantages de cette réforme micropolitique est que chacune de ces étapes peut être appuyée indépendamment par des groupes différents, et le changement résultant de la synthèse de leurs effets. On n'impose aux parents aucun bouleversement soudain contre leur volonté, car pour ceux qui n'en demandent pas davantage que de disposer de la place "gratuite" à l'école du quartier, celle-ci est toujours là pour eux. La liberté de choisir n'est offerte qu'à ceux qui en veulent, personne n'y est poussé contre son gré. Bien sûr, à mesure que ce système se développe, un nombre croissant de parents va profiter du choix offert. Il faudra donc y intégrer de nouvelles techniques pour permettre de créer de nouvelles écoles publiques là où il existe une demande, et attirer d'autres sources de financement de la part du secteur privé.
Cette politique n'institue pas un marché complètement libre. A cet égard, elle en fait même moins que le système de bons, car elle ne concerne que les écoles publiques. Elle laisse les écoles payantes telles qu'elles sont ; celles-ci ne sont pas touchées par le nouveau système, et n'y prennent aucune part. Elle vise directement le système public qui concerne tout de même 93 % des élèves, et cherche à l'améliorer en transférant le pouvoir des producteurs au consommateur. Les écoles sont toujours des écoles d'Etat, toujours pour l'essentiel financées par l'impôt. Les nouvelles écoles fondées par les parents et les enseignants restent aussi des écoles de l'Etat, directement financées par lui.
Une "micro-révolution"
Malgré ces lacunes, le nouveau système est un véritable bouleversement. Les écoles publiques sont gérées de façon indépendante, alors même qu'elles restent dans le secteur public. Les parents ont une possibilité de choisir, qui détermine l'endroit où ira l'argent pour financer l'éducation de leur enfant. Les écoles doivent répondre à la demande pour attirer les effectifs dont leur budget dépend. La frontière très nette qui existe, dans l'ancien système, entre le secteur public et les écoles privées devient, avec le nouveau système, un peu plus floue. Des forces et des pressions sont libérées, qui poussent à l'amélioration progressive du niveau d'éducation à atteindre dans le secteur d'Etat. Elles ont été voulues par ces réformes, calculées pour s'attirer le soutien d'une bonne partie des groupes qui ont un intérêt direct dans l'enseignement public.
Invisible, le bon scolaire "passe" mieux
Il existe des différences clés entre le système des bons et la nouvelle approche. Une d'entre elles est que la nouvelle méthode obtient les mêmes résultats qu'un système de bons, tout en dispensant de les utiliser. Car l'argent peut tout aussi bien suivre l'enfant, une fois que ses parents ont fait leur choix parmi toute une gamme d'écoles.
Une autre différence est que la proposition est une politique praticable, qui va dans le sens du marché politique. On peut la mettre en place par étapes et, petit à petit, en tirer un système d'enseignement plus souple, plus varié et plus en phase avec les besoins et les désirs des parents. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais c'est une solution viable à notre problème. Et il est significatif, alors que le bon scolaire est rejeté depuis des années, que le nouveau système ait figuré dans le programme conservateur pour l'élection de 1987 ; ses éléments ont été présentés dans le discours de la Reine consécutif à la nouvelle victoire des conservateurs, des propositions comparables étant faites pour l'Ecosse plusieurs mois plus tard.
Détails pratiques
Le détail des programmes conservateurs des années 1980
Nous savons désormais ce qui, au-delà de leur inspiration commune, distingue historiquement les programmes conservateurs des années 70 et ceux des années 80 : les professionnels du projet politique s'emparant de la théorie des choix publics avec sa critique de la conception traditionnelle du changement politique, pour en faire un outil de création systématique. Cette créativité érigée en principe, nous allons maintenant voir à quel point elle caractérise les nouvelles politiques par opposition aux anciennes [1].
Avant tout, un état d'esprit différent
La différence essentielle, on ne le rappellera jamais assez, était avant tout une différence d'approche. Le présupposé initial était que, pour inverser la dérive vers le socialisme, on allait imposer les solutions de liberté, même si cela devait conduire à provoquer la fureur des groupes de pression susceptibles d'y perdre. La nouvelle approche mettait au contraire l'accent sur la recherche de techniques nouvelles, applicables dans la pratique, donnant aux personnes visées un avantage net par rapport à leur situation antérieure.
Les privilégiés du logement "social"
Prenons les choix qui furent faits en matière de logement "social". A l'époque, quelque 35 % de la population vivaient dans des logements publics, aux loyers en général fortement subventionnés, et qui, dans certains cas, coûtaient plus cher à entretenir qu'ils ne rapportaient. Naturellement, toute redistribution profite d'abord aux gens bien placés, et les locataires des municipalités (la Ville étant propriétaire dans la plupart des cas) avaient, comme partout en pareil cas, un revenu moyen plus élevé que celui des locataires du secteur privé. Les Conservateurs voyaient une injustice évidente dans le fait d'obliger ceux qui s'efforçaient de se loger par leurs propres moyens, allant jusqu'à se priver pour s'acheter un logement, à payer un surcroît d'impôts et de taxes pour permettre à d'autres, éventuellement plus riches qu'eux-mêmes, de ne payer que des loyers de faveur.
Imposer le retour à un loyer "normal" ?
Les candidats conservateurs aux élections locales et nationales avaient préconisé de réévaluer les loyers au niveau du marché ; mais ils se rendirent vite compte que, pour sa part, le locataire moyen des HLM préférait un loyer subventionné à un loyer de marché. Ainsi, le milieu des HLM formait un bloc d'opposition résolue à la réforme du système, alors que celui-ci paralysait l'offre de logement et entravait la mobilité des locataires. Ces derniers rechignaient à déménager, par crainte de perdre leur place s'ils habitaient déjà un logement subventionné, ou leur tour sur la liste d'attente s'ils l'attendaient encore.
Comme dans bien d'autres cas d'avantages réservés aux minorités, les bénéficiaires du privilège lui donnaient plus de valeur que ses victimes ne trouvaient à s'en plaindre. Les bureaucraties locales s'étaient constitué de véritables empires sous prétexte d'administrer ces logements "sociaux", lesquels avaient aussi permis aux élus locaux de "bétonner" leurs majorités électorales. Bref, les intéressés étaient tous acquis au système en place, et toute proposition de réforme vouée à une hostilité unanime.
Permettre aux bénéficiaires de racheter leur logement à un prix de faveur
La nouvelle politique, sans laisser tomber l'idée de la vérité des prix, fit tout pour faciliter aux locataires l'achat de leur logement, s'efforçant en outre d'attirer toute l'attention sur elle. Les locataires HLM étaient tout acquis à l'idée que les autres soient forcés de leur payer le logement, mais il s'en trouva un bon nombre pour apprécier encore davantage la perspective de devenir propriétaire. Pour s'assurer leur appui, le gouvernement fit bien en sorte que les logements leur fussent vendus à un prix inférieur à celui du marché. Celui qui habitait son logement depuis deux ans avait une réduction de 20 % sur la valeur vénale, le rabais pouvant atteindre 50 % pour ceux qui étaient là depuis vingt ans. Si grand que fût leur goût pour le parasitisme locatif, on découvrit que la perspective de posséder leur propre maison, en faisant au passage un bénéfice de plusieurs dizaines de milliers de francs, était encore plus alléchante pour une bonne partie des locataires HLM.
Bouleverser, comme en se jouant, les données du problème
Que s'était-il passé? c'est bien simple : en faisant une nouvelle offre sur le marché politique, on avait créé une situation nouvelle, à laquelle les groupes de pression avaient tout naturellement adapté leur position ; et pour certains, l'offre proposée avait décidément plus de valeur que la subventionnite. Les municipalités se virent alors ardemment pressées de vendre leurs logements. Certaines essayèrent de résister, utilisant tous les moyens pour faire obstruction, mais les partisans de la réforme étaient devenus suffisamment nombreux pour permettre au gouvernement d'instituer un "droit d'acquisition", qui obligeait les autorités locales à vendre si les locataires le demandaient. Les rabais furent d'abord relevés à 60 %, pour passer ensuite jusqu'à 80 %.
Une force irrésistible
En septembre 1986, sur les cinq millions de locataires "municipaux", un million avait déjà acheté sa maison, et une loi était en préparation pour disposer de même des appartements. Le groupe des nouveaux propriétaires formait déjà une force considérable dans l'arène politique. Le parti travailliste, qui s'était toujours prononcé contre les ventes, dut, à son corps défendant, reconnaître la nouvelle situation et brûler ce qu'il avait adoré. Il lui fallut non seulement renoncer à toute idée de renationaliser les logements vendus mais encore, mangeant son chapeau jusqu'au bout, s'engager à poursuivre la politique de ventes à des prix de faveur.
Impuissants, les bureaucrates locaux assistèrent à l'écroulement de leurs empires, et quant aux élus, ils virent leur échapper les électeurs qu'ils avaient cru tenir captifs pour toujours. La pression exercée par le nouveau lobby était irrésistible. Pour la première fois, le gouvernement avait domestiqué la force du marché politique en surenchérissant sur ses acteurs habituels [2]. Le transfert de pouvoir et de propriété qui en résulta fut considérable. Rappelons que, de 1979 à 1986, un cinquième des locataires HLM avaient déjà choisi de devenir propriétaires de leur maison. Dans l'intervalle, la recherche micropolitique s'était ingéniée à trouver d'autres moyens pour accroître le nombre de ceux qui pourraient être persuadés de le faire à l'avenir.
La magie de la nouvelle approche
Alors que le gouvernement précédent avait échoué à imposer les disciplines du marché libre, le gouvernement Thatcher réussit à en introduire quelques-unes, simplement parce que ses propositions avaient pris le marché politique tel qu'il est. L'ancienne approche cherchait à passer outre aux intérêts des locataires HLM, en les privant du privilège des subventions locatives dont ils jouissaient depuis longtemps ; la nouvelle essayait de leur offrir en échange quelque chose qui valait davantage. Le résultat fut qu'on vit les opposants farouches de l'ancienne méthode se métamorphoser, comme par magie, en ardents partisans de la nouvelle. Elle avait permis non seulement de rapatrier un grand nombre de logements dans le secteur privé, où ils étaient soumis à des prix et des charges d'entretien réels, mais aussi d'assurer au gouvernement un soutien électoral substantiel.
Le logement locatif privé paralysé par la politique
Les problèmes du logement locatif en Grande-Bretagne ne se bornent pas au secteur public. Il existe encore un logement locatif privé, mais l'intervention des hommes de l'Etat l'a rendu bien malade. En fait, il ne représente plus qu'un faible pourcentage du marché. La concurrence déloyale du logement d'Etat subventionné en est certainement responsable, mais le coup de grâce lui a été porté par deux politiques dont l'effet est immanquablement de détruire le parc immobilier : le contrôle des loyers, associé à un "droit à" un maintien dans les lieux. Les locataires avaient su former un groupe de pression puissant, bien plus nombreux que les propriétaires, et qui multipliait les prétextes à l'ingérence des organisations "humanitaires" et autres lobbies intéressés [3].
Les premières victimes : les locataires à venir
Le résultat est que les locataires en place ont reçu des privilèges, non seulement aux dépens des propriétaires — c'était voulu, mais aussi des locataires à venir. Car la politique en question a naturellement eu pour effet de tarir presque complètement l'offre de nouveaux logements à louer. Là encore, la main invisible du marché politique est à l'œuvre : pas plus que les propriétaires, les futurs locataires ne peuvent former un groupe de pression efficace. Les propriétaires sont trop peu nombreux, et quant aux locataires à venir, ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils perdent à l'affaire [4].
Qui serait volontaire pour se faire voler ?
La loi a donc fixé les loyers bien au-dessous de leur prix de marché, tout en refusant, bien sûr, aux propriétaires le droit de récupérer leur bien, même pour y habiter eux-mêmes ou en cas de risque grave de cessation de paiement. Comme les locataires sont autorisés à occuper le logement d'un autre pour un loyer moindre que le propriétaire ne l'accepte, voire inférieur aux coûts d'entretien, il est difficile de voir en quoi cela se distingue d'un vol pur et simple, à cela près que ce vol-là est reconnu par la loi. Naturellement, les propriétaires rechignent à louer dans ces conditions. Ceux qui, par exemple, ont hérité de leurs parents un logement supplémentaire se refusent à le louer, par crainte de le perdre au profit des "locataires".
Les privilégiés ont bien appris à se servir des pauvres
Comme on a tout de même besoin d'un secteur locatif privé en état de marche, les gouvernements conservateurs ont essayé de faire avancer les choses dans le sens d'une suppression du contrôle des loyers et du "droit" au maintien dans les lieux. La seule évocation de cette idée a toujours provoqué une réaction indignée non seulement des locataires, mais plus encore de ceux dont le fonds de commerce est de les représenter, ou dont l'idéologie est hostile à la propriété privée. Elle a toujours donné l'occasion de manifester, ou d'écrire article sur article dans les média sur les souffrances qu'une telle réforme ne manquerait pas d'occasionner aux malheureux locataires. Quant aux tourments des propriétaires, ils ne feront jamais couler d'encre, parce que ceux-ci sont piégés dans la caricature du riche-qui-exploite-le-désespoir-des-pauvres-sans-logis. Si l'on devait choisir un saint patron des propriétaires, Monsieur Vautour ferait un bon candidat aux yeux des média. Si bien que les timides tentatives faites pour libérer le marché n'ont jamais pu aller très loin.
Rétablir la liberté des contrats de location privée augmenterait immédiatement l'offre de logements sur le marché, et engendrerait probablement une stabilisation des prix en accroissant considérablement la construction. Malheureusement, comme dans bien d'autres cas, la solution la meilleure et la plus juste ne peut pas être réalisée par les moyens habituels. Les groupes qui profitent de ces privilèges se battront avec plus d'acharnement pour les conserver que d'autres pour les abolir.
Faire la part du feu
Les solutions mises en avant par la micropolitique ne prétendent certainement pas être justes. Elles consistent essentiellement à maintenir les privilèges de la génération actuelle des locataires, mais en précisant que tout nouveau bail échappera au contrôle des loyers et autres maintien dans les lieux. Le raisonnement est que les locataires en place n'auront aucune raison de s'opposer à cette mesure, puisque leurs propres avantages ne seront pas menacés. En revanche, une situation aura été créée, où toute nouvelle location sera libre de ces contraintes. Au départ ou au décès des locataires en place, les logements qu'ils occupaient seraient reloués à des loyers de marché. On pourrait même favoriser certains départs à l'aide de dessous de table. Le nombre de locations protégées diminuerait progressivement, jusqu'à ce que toutes les locations finissent par se trouver sur le marché libre.
Séparer les idéologues de leurs complices intéressés
Le résultat ne serait pas moins injuste pour les propriétaires actuels que le système en place, mais au moins, il empêcherait l'injustice à venir tout en amenuisant progressivement son étendue. C'est une politique réaliste, puisqu'elle est taillée sur mesure pour neutraliser l'opposition du groupe visé. Les lobbies idéologiques y seraient toujours hostiles mais, tout comme les propriétaires, ils sont peu nombreux. Sans l'armée des locataires pour défiler derrière leurs banderoles et jouer le mélodrame de la misère devant les caméras de télévision, ils sont parfaitement impuissants.
Distinguer les "catégories" pour exorciser le fantasme
Une deuxième proposition tirée de ce type d'approche est de distinguer entre différentes catégories de propriétaires, chacune étant soumise à un type de contrôle différent. Par exemple, le petit propriétaire qui loue un ou deux logements à l'occasion n'appartiendrait pas à la même catégorie que le propriétaire établi comme tel et qui possède plusieurs immeubles de rapport. De même, un propriétaire institutionnel, comme l'Eglise d'Angleterre ou en France la Caisse des Dépôts, ainsi qu'une grande société immobilière, ne serait pas dans la même catégorie que le particulier qui loue quelques logements. Une fois de plus, l'objectif d'une telle subdivision est d'introduire quelques éléments de libéralisation dans le marché locatif actuel, même si on ne peut pas les lui appliquer dans son ensemble.
L'idée de départ est qu'il y a certains groupes qui ont plus d'influence que d'autres (ce pouvoir, rappelons-le, ne tient pas forcément aux seuls effectifs ; cela peut être leur visibilité, ou leur capacité de nuire, qui leur donnent du poids). Dans ce contexte, l'expulsion d'un logement a une puissance d'émotion difficile à parer. C'est un fantasme terrible que celle des malheureux-chassés-de-chez-eux-parce-qu'ils-n'ont-plus-les moyens-de-payer-le-loyer. Il n'y a pas un homme politique qui ne préférerait se casser une jambe plutôt que d'en être tenu pour responsable. Conséquence : on connaît des sociétés immobilières qui pourraient louer à des particuliers, et qui se l'interdisent résolument par crainte du dommage que subirait leur réputation si une telle situation se présentait.
Des baux à court terme ?
Une solution pourrait être trouvée dans des baux à court terme, parce qu'ils prévoient que le propriétaire récupérera les locaux vides à leur expiration. Il est toujours possible alors de négocier de nouveaux baux. Le bail à court terme n'évoque pas les mêmes images immémoriales de Familles Chassées de leur Maison de Toujours, avec un propriétaire rapace à montrer du doigt. Des variantes de ces idées ont été essayées, et d'autres encore sont à l'étude. L'idée fondamentale est que l'on renonce à libéraliser le marché pour imposer la justice à tout prix, et à braver la tempête en racontant aux parlementaires que toute cette agitation finira bien par se calmer. Au contraire, on tente de contourner l'hostilité des groupes en cause en s'assurant que la politique, telle qu'elle est conçue, ne sera pas une menace pour eux.
Les "canards boiteux"
Les changements de style qu'apporte l'approche micropolitique sont aussi visibles dans les méthodes employées face aux secteurs déficitaires des entreprises d'Etat. Lorsque l'accumulation des déficits attire l'attention du gouvernement sur des implantations ou des usines qui sont causes d'une proportion particulièrement importante du déficit total, l'évocation de la fermeture provoque une réaction trop prévisible. Les travailleurs défilent dans la rue, scandant des slogans et menaçant de faire grève. Dans les cas extrêmes, ils vont jusqu'à occuper les locaux. Les élus de la région font pression sur le gouvernement, qui se retrouve finalement confronté à une forte opposition, avec bien peu d'appuis. Comme toujours, les bénéficiaires de la subvention sont ceux qui militent avec le plus d'ardeur.
Des offres généreuses à la main-d'œuvre
Les gouvernements du passé ont souvent battu en retraite sous le feu, retirant leur projet de fermeture, prévoyant de moindre dégâts politiques en maintenant les subsides qu'en allant jusqu'au bout de leur choix de les supprimer. Or, l'approche a récemment changé en Grande-Bretagne : maintenant, l'effort consiste essentiellement à essayer d'obtenir le consentement de la main-d'œuvre. Les dirigeants et autres délégués syndicaux continuent à freiner des quatre fers ; cependant, en faisant des offres très généreuses, aussi bien en indemnités de licenciement qu'en primes de transfert, le gouvernement embellit fortement la proposition aux yeux des salariés.
Pour remplacer les subventions à l'emploi, en associant les aides de l'Etat à un capital substantiel, on propose aux employés une somme suffisante pour permettre à certains de créer une entreprise ou, pour les plus âgés, de s'assurer une retraite anticipée confortable. On compense parfois l'éventualité de perdre un emploi avantageux à un endroit par l'offre d'un reclassement ailleurs. Tout est fait pour minimiser le nombre d'emplois effectivement perdus : c'est une des zones les plus sensibles du marché politique, où il est vraiment nécessaire de faire des concessions.
Des indemnités de licenciement vraiment coquettes, parallèlement à des offres de reconversion parfois associées à des cours de recyclage, ou à des possibilités de reclassement dans l'entreprise elle-même, tout cela finit par désarmer la résistance rencontrée. Le résultat est qu'il devient désormais possible de fermer une partie des activités déficitaires. A court terme, cela peut coûter plus cher qu'une fermeture pure et simple, mais, lorsqu'on a réussi à le faire, cela représente une économie sur les subventions à venir, dont on est privé lorsque l'on a laissé les perdants potentiels empêcher la fermeture.
La réforme du droit syndical
La manière dont le droit syndical a été réformé illustre aussi excellemment la différence de style entre les deux approches. Les gouvernements précédents, travaillistes aussi bien que conservateurs, s'étaient rendus compte que la législation protectrice des syndicats leur avait accordé trop de pouvoir et d'immunités. La crainte que ce pouvoir ne finisse par détruire l'économie et la société s'il restait incontrôlé avait conduit Harold Wilson, en tant que Premier Ministre travailliste, et Edward Heath, quand il était Premier Ministre conservateur, à tenter des réformes pour les ramener sur le chemin du Droit. Or, tous deux avaient échoué. Le projet travailliste dut être retiré ignominieusement, et la loi d'origine conservatrice fut rendue inapplicable par la résistance massive des travailleurs ; elle fut d'ailleurs immédiatement révoquée par le gouvernement qui suivit.
L'administration Thatcher, pour sa part, a lancé une série de réformes dans le droit du travail qui ont transformé le climat social et l'activité syndicale en Grande-Bretagne. On la crédite d'avoir réussi là où ses prédécesseurs avaient échoué. Or ce qu'elle a obtenu en fait, c'est un résultat différent.
L'échec de la confrontation directe
Les deux tentatives avortées avaient pour l'essentiel essayé de priver de leurs pouvoirs les syndicats et leurs adhérents. L'une et l'autre étaient caractérisés par l'imposition de nouvelles entraves et de nouvelles restrictions à leurs activités, soutenues par des sanctions légales. Certains types d'action syndicale, auparavant autorisés, devenaient interdits. Les dirigeants et les membres des syndicats qui violaient la nouvelle législation devaient verser de lourdes amendes, le défaut de paiement étant puni d'emprisonnement. Dans chacun des cas, le Parlement avait pris la peine de donner à cette réforme la sanction d'une loi solennelle.
Le projet Wilson fut retiré au niveau du Conseil des Ministres, lorsqu'il devint évident que l'hostilité des syndicats, de leurs appuis au sein du gouvernement et des parlementaires dépendants de leur soutien, serait trop forte. La proposition Heath, quant à elle, fut votée, mais aussitôt impunément bafouée, le gouvernement reculant devant la perspective d'une confrontation majeure s'il avait vraiment essayé de l'imposer. Les deux tentatives de réforme firent contre elles l'unité du mouvement syndical. Les dirigeants syndicaux appelèrent à la résistance, et la base les suivit pour défendre ce qu'elle considérait comme ses droits. Les syndicats de Grande-Bretagne jouissaient donc d'une protection légale, voire d'une impunité judiciaire, qui étaient sans précédent et semblaient devoir s'accroître indéfiniment. Il était devenu possible, au cours d'un conflit du travail, de commettre des actions qui, dans un autre cadre, auraient été punies comme des atteintes au Droit, voire des délits purs et simples. Le groupe en cause défendait tout naturellement ses privilèges, et y réussissait fort bien.
Surtout pas de "grande" réforme
Les réformes Thatcher eurent un tout autre visage. Tout d'abord, elles ne prirent pas la forme d'une grande loi, mais d'une succession de petits amendements au droit. Lorsque le premier fut inauguré par James Prior, Ministre de l'Emploi, bien des gens s'imaginèrent que ce serait le seul. En fait, il l'a peut-être cru lui-même, jusqu'à ce que la pression des députés conservateurs de la base en impose une autre. Chaque mesure semblait très limitée dans sa portée, peut-être calibrée pour rester toujours en-deçà du seuil qui provoquerait une forte réaction protestataire. Chacune d'entre elles semblait relativement anodine... Ce fut l'accumulation de leurs effets qui constitua la véritable réforme. Ainsi, en l'absence de tout "grand projet" susceptible d'attirer l'attention et de coaliser les résistances, le public finit par s'habituer à l'idée qu'on continuerait à faire des réformettes, jusqu'à ce que l'effet désiré eût été obtenu.
Instituer une vraie représentation
La seconde différence importante est que le but officiel des réformes Thatcher n'était pas du tout de limiter le pouvoir des syndicats. Au lieu d'attribuer au gouvernement de nouveaux moyens pour s'imposer à eux, la plupart ne firent que donner aux camarades syndiqués le pouvoir... de contrôler réellement leurs dirigeants. Loin de supprimer ces pouvoirs, ces réformes se contentaient de les redistribuer, de manière à rendre obligatoire la consultation des salariés. Les militants ordinaires s'étaient habitués à voir leurs meneurs passer d'abord à l'action, et ensuite demander à "la base" de les soutenir lors des assemblées générales par le moyen — passablement intimidant — du vote à main levée. Or, les nouvelles lois obligeaient à les consulter, bien en amont dans le processus, grâce au vote à bulletin secret. Elles leur donnèrent également, par le même biais, le droit effectif de choisir leurs dirigeants. En d'autres termes, des forces qui œuvraient précédemment au profit exclusif des permanents étaient désormais employées pour donner le pouvoir au militant de base.
Agir au civil et non pas au pénal
Une autre différence essentielle est que réformes Thatcher les plus importantes étaient de droit civil et non de droit pénal. S'ils violaient les dispositions du code, les contrevenants n'étaient pas traînés en correctionnelle : on leur faisait un procès civil. Si par exemple un piquet de grève s'installait à la porte d'entreprises autres que celles impliquées dans le conflit, les entrepreneurs concernés pouvaient engager des poursuites, obtenir des astreintes, voire des dommages et intérêts. Si les grèves étaient déclenchées sans un vote à scrutin secret des travailleurs syndiqués, leurs responsables perdaient les immunités légales applicables aux ruptures du contrat de travail par fait de grève.
C'étaient là trois différences essentielles : les réformes étaient progressives, elles forçaient les dirigeants à laisser le pouvoir à la base, et aucune ne donnait l'occasion aux dirigeants ni aux militants de jouer les martyrs devant un tribunal répressif. C'est ce qui explique le succès des réformes Thatcher, par opposition aux échecs des tentatives précédentes.
Ce n'est pas le chômage qui avait affaibli les syndicats
On ne peut pas dire que ces réformes aient réussi parce que le gouvernement avait affaire à un mouvement syndical affaibli par le chômage. Personne n'a expliqué comment cette influence aurait pu s'exercer. Si une grève avait conduit à licencier les ouvriers pour les remplacer par des chômeurs, cela aurait pu être le cas ; mais qu'une entreprise ait pu s'en tirer en ayant recours à une tactique de ce genre était alors tout aussi impensable que par le passé.
Pas de quoi fouetter un chat
Les réformes Thatcher ont réussi parce qu'elles prenaient en compte les groupes d'intérêts concernés, et se donnaient un mal de chien pour éviter le type de confrontation directe qui avait garanti l'échec des projets précédents. Les dirigeants syndicaux avaient toutes les peines du monde pour mobiliser l'opposition de la base, parce que chacune de ces mesures était relativement indolore. Chacune n'était qu'un petit pas de plus par rapport aux précédentes, pas vraiment de quoi fouetter un chat. En outre, on ne pouvait guère compter sur le militant de base pour se mobiliser contre des mesures qui allaient lui donner davantage voix au chapitre. Les dirigeants syndicaux pouvaient grimper aux rideaux à l'idée de devoir se soumettre à un vote de leurs adhérents, mais ces derniers n'étaient pas près de réagir comme eux. Le gouvernement ne les privait d'aucun de leurs droits : il les répartissait différemment entre adhérents et activistes. Enfin, il n'y avait aucune répression pénale à braver, aucune possibilité d'évoquer le fantasme du Valeureux Leader ou du Camarade-Syndiqué-Traîné-en-Prison-en-Martyr-de-la-Cause-Ouvrière. Cette nouvelle législation n'offrait aucune prise aux meneurs pour Mobiliser contre elle la Solidarité des Masses Travailleuses.
Le triomphe de la micropolitique
Si ces réformes ont réussi, c'est parce qu'elles traduisaient un nouveau style politique, une manière nouvelle d'aborder la formulation des politiques publiques. Elles tenaient compte des forces réellement en présence dans l'arène politique, au lieu de considérer celle-ci comme une table rase attendant seulement que le Législateur y impose sa Marque Souveraine. Les tentatives précédentes commettaient toutes l'erreur fondamentale de la macropolitique : elles avaient étudié la situation existante, imaginé celle qui aurait dû régner à sa place, sans tenir le moindre compte des réalités intermédiaires. La nouvelle méthode avait soigneusement balisé le chemin à suivre pour passer de l'une à l'autre. C'est une de ses caractéristiques principales que d'agir de cette façon.
Le test décisif : la grève des mineurs
La grève des mineurs de 1984-1985 fut une bonne occasion de mettre à l'épreuve les méthodes que l'on avait mises au point pour traiter le problème des entreprises déficitaires du secteur public ou pour faire passer la réforme dans les relations de travail. C'était d'ailleurs une grève des mineurs qui avait fait tomber le gouvernement Heath, après avoir forcé le pays à vivre dans le noir et à ne travailler que trois jours par semaine. Or, sous le gouvernement Thatcher, la même grève fut un échec. Les différences sont pleines d'enseignements.
Seuls les activistes avaient vraiment intérêt au conflit
Alors que le président de la NUM, le Syndicat National des Mineurs, en avait pris personnellement la tête, la seconde grève ne fut jamais celle de l'ensemble du syndicat. A quelques mois près, la direction syndicale eût été contrainte d'organiser un référendum pour pouvoir déclencher la grève, et la base avait voté contre à deux reprises lors de consultations organisées dans les houillères. Comme elle avait été déclenchée sans vote préalable, plusieurs sections du syndicat, notamment les mineurs du Nottinghamshire, se sentirent en droit de ne pas suivre le mouvement. Le nouveau droit contre les piquets "de solidarité" empêchait en partie de faire pression sur les autres syndicats pour qu'ils soutiennent le mouvement. Les entrepreneurs pouvaient obtenir des tribunaux des astreintes contre les actions "de solidarité", et le syndicat des mineurs fut condamné pour outrage à magistrat pour avoir refusé de les payer. Ses dirigeants virent leurs comptes bloqués jusqu'à ce qu'ils eussent payé les amendes.
Alors que le syndicat des mineurs passait pour l'organisation la plus forte et la plus militante, il ne cessait de se heurter à la nouvelle donne que les réformes avaient instaurée dans les relations de travail. En outre, le combat lui-même était loin d'être tranché quant à ses enjeux essentiels. Les meneurs présentaient la grève comme une lutte pour sauver les emplois en empêchant les fermetures par la direction des houillères. Or, les propositions de la direction garantissaient qu'aucun mineur ne serait forcé de quitter son travail. Tous ceux qui quittaient les puits à fermer devaient être recasés ailleurs, avec de fortes indemnités de transfert à la clé. Ceux qui choisissaient de partir en retraite se voyaient offrir les primes de départ les plus somptueuses de toute l'Histoire britannique. Comme personne n'était forcé de perdre son emploi, et comme ceux qui choisissaient de partir plutôt que d'être recasés recevaient un énorme magot, il n'était pas très facile de voir où se trouvait le motif de la querelle. Il se réduisait à demander quelle devrait être la taille à venir de l'industrie, problème certes fort intéressant pour le syndicat, mais sûrement pas un souci majeur pour les salariés.
Contrairement à la précédente, cette grève fut un échec, échec qui provoqua l'éclatement du syndicat des mineurs. Un élément décisif de cette défaite avait été la nouvelle manière dont on avait traité les suppressions d'emplois et fait passer les réformes dans les relations de travail. Au lieu de jouer la confrontation directe pour aborder les deux questions comme l'avait fait le gouvernement Heath, le gouvernement au pouvoir une décennie plus tard utilisa des méthodes qui rassuraient les groupes d'intérêts et offraient des compensations en échange des privilèges mis en cause par le changement.
Les meneurs ne sont rien si la base ne suit plus
L'expérience des syndicats sous l'administration Thatcher permet d'évoquer une conclusion très importante de la micropolitique. A savoir que les dirigeants des groupes d'intérêts et des minorités ne représentent pas nécessairement le point de vue de la base. Cela peut se vérifier, même lorsqu'ils sont démocratiquement élus au cours d'élections honnêtes. Lorsque l'action politique passe par l'affrontement, avec des groupes qui se battent pour défendre leurs privilèges, l'intérêt de la base est de se choisir des dirigeants doués pour ce type d'activité. Elle aura souvent tendance à les choisir plus militants et plus agressifs qu'elle ne l'est elle-même : c'est cela qui en fait de bons dirigeants. La société sera confrontée à des cliques véhémentes, revendiquant sans cesse et prêtes à employer la force au premier désaccord. Voilà quel type de chefs on choisit dans un tel climat, type dont les représentants syndicaux de l'époque constituaient un exemple véritablement achevé.
Lorsque l'on gouverne en ménageant les forces politiques en présence, l'atmosphère n'est plus à la confrontation. On ne supprime pas unilatéralement les avantages ; bien au contraire, on offre des compensations. A-t-on encore tellement besoin de meneurs agressifs ? Les membres d'un groupe de pression peuvent même en arriver à percevoir un conflit direct entre leur propre intérêt et celui de leurs dirigeants. Ces derniers sont peut-être bien arrivés au sommet grâce à leur aptitude à se battre, et peuvent encore chercher à justifier leur place par ce moyen, mais leurs adhérents ont quelque chance de gagner davantage à des compromis, plutôt que de continuer sur la voie des extrêmes.
Voici un scénario qu'on a vu se dérouler à maintes reprises sous le gouvernement Thatcher : la hiérarchie fait des propositions, et celles-ci sont immédiatement rejetées par la direction syndicale. Puis on organise le référendum prévu par la loi pour décider de l'action à mener... et voilà que les adhérents, désavouant leurs "représentants", votent contre la grève. L'expérience des syndicats illustre donc cette vérité plus générale sur les groupes d'intérêts, que leurs dirigeants n'en sont pas nécessairement représentatifs. La leçon à en tirer est que les politiques doivent être faites pour les membres ordinaires, et non pour les meneurs. Les permanents de la direction hurleront toujours pour en avoir plus et avoueront rarement que l'offre qu'on leur fait est bien davantage qu'un os à ronger ; c'est pour cela qu'on les paie. En revanche, la base peut trouver tout à fait à son goût les propositions en question. En pratique, cela pourra conduire à des cas où les dirigeants de groupes minoritaires lancent aux quatre vents protestations et insultes, tandis que les minorités, de leur côté, s'installent tout tranquillement dans le nouvel équilibre du marché politique.
- Les événements sont plus importants que les mots qui les accompagnent.
La privatisation
Une proposition de la micropolitique
Le terme, comme l'idée de privatisation, sont venus relativement tard à l'équipe Thatcher. Le Manifeste électoral de 1979 mentionnait la vente de l'industrie aérospatiale, des chantiers navals et de la National Freight Corporation, mais ne précisait pas que l'on entendait aller au-delà de la "dénationalisation", présentée depuis longtemps comme un objectif de la politique conservatrice sans jamais y parvenir. Dans The Right Approach, ouvrage publié par le parti Conservateur en 1976, on lisait "dans certains cas, il peut aussi être désirable de revendre à l'entreprise privée des actifs ou des sociétés pour lesquelles on pourra trouver un repreneur". Le mot-clé est le préfixe re-, qui indique une volonté de défaire ce que des années de nationalisation avaient fait, même si on n'y arrivait qu'à petite échelle.
La privatisation n'est jamais un retour en arrière
La privatisation effectivement pratiquée n'a rien eu à voir avec le caractère symbolique de la petite brasserie et de l'agence de voyages que le gouvernement Heath était péniblement arrivé à vendre entre 1970 et 1974. Pas grand-chose non plus, en fait, avec le retour au secteur privé de certains éléments de la sidérurgie pendant la législature 1951-55. Dans les deux cas, il s'agissait de dé-nationalisation, terme qui implique que l'on dé-fait quelque chose qui a été fait auparavant. C'est en 1979 que l'on a commencé à employer le terme de "privatisation", lorsque tout le monde s'est aperçu qu'on avait affaire à un spécimen tout à fait inconnu. Car il ne s'agissait pas de revenir en arrière, mais de créer une situation radicalement nouvelle.
Jamais, après 1979, on n'a rendu les éléments du secteur étatisé à leurs anciens propriétaires. Dans chaque cas de privatisation, ils se sont retrouvés dans des mains également privées, mais à maints égards totalement différentes de celles des propriétaires précédents. La privatisation est une politique nouvelle, un pur produit de la micropolitique.
Un système intégré
Bien que le profane n'y voie généralement rien d'autre qu'une simple vente des actifs de l'Etat, la privatisation est en réalité un système intégré de mesures pour rétablir une gestion responsable, c'est-à-dire privée, dans des activités auparavant contrôlées par le secteur public. Il n'existe pas de formule ni de recette simple pour arriver à ce résultat. Bien au contraire, une grande diversité de techniques ont été mises au point, chacune conçue pour traiter une entreprise ou un "service public" particulier.
L'essentiel du savoir-faire est tiré de la pratique
Nous avons vu les raisons théoriques de la privatisation, aussi bien que les principes de la micropolitique qui la guident aujourd'hui ; mais prendre la mesure des rapports de force est une question empirique, et découvrir les politiques qui marchent ne peut se faire que par l'expérience.
C'est pourquoi une part considérable du savoir-faire désormais acquis en matière de privatisations l'a été grâce à la pratique. Le gouvernement, au cours de son mandat, a suivi un processus d'apprentissage, s'exerçant à distinguer les méthodes efficaces de celles qui ne le sont pas, et à traiter les divers groupes d'intérêts concernés pour s'assurer l'appui, ou du moins l'assentiment de puissantes factions qui auraient pu s'opposer à ses tentatives.
Quand on ne sait pas faire... et quand on a appris
On mesurera l'importance de ce processus en comparant l'échec de la dénationalisation des boutiques du Gaz en 1981-82 avec l'énorme succès rencontré par la privatisation de British Gas en 1986. La différence entre les approches suivies est une bonne illustration des progrès accomplis dans l'approche analytique.
Dans le premier cas, on avait voulu vendre le réseau de distributeurs en le détachant du reste de l'entreprise, parce qu'il était le seul à rapporter de l'argent. A première vue, cela semblait raisonnable, puisque les magasins en question n'avaient aucun lien organique avec la production ni la distribution du gaz lui-même : ce n'étaient que des boutiques, et si l'on y vendait ou réparait quelque chose, ce n'étaient jamais que des appareils ménagers.
Or, ce modeste projet s'attira immédiatement les foudres de la direction de l'entreprise. Son président, Sir Dennis Rookes, se lança à la tête d'un groupe d'action pour s'opposer au "démantèlement" de son empire, avec le soutien unanime de l'équipe de direction. Le personnel menaça de faire grève si on "lui" retirait "ses" points de vente pour les brader aux capitalistes. On fit circuler des histoires d'horreur sur les "cow-boys" qui allaient débouler sur le marché, ne songeant qu'à faire un profit facile au mépris de la sécurité. Les usagers se mirent à exprimer leurs craintes à voix haute : est-ce qu'on n'allait pas leur couper le gaz, ou leur installer des appareils dangereux ? Les parlementaires sentaient croître la pression des opposants, et le gouvernement se rendit compte qu'en face d'une telle campagne, le soutien du député de base se faisait de plus en plus rare. Le projet fut retiré, ayant trouvé le moyen de s'aliéner l'Administration, la direction de l'entreprise, son personnel, ses usagers, et les parlementaires eux-mêmes.
Le contraste entre cette débâcle et la mise en vente publique de British Gas de 1986 n'aurait pu être plus marqué. La privatisation de 1986 obtint l'adhésion de l'ensemble des principaux groupes impliqués, et fut un immense succès pour le gouvernement. La différence, bien entendu, c'est dans la politique proposée qu'on pouvait la trouver. On en avait beaucoup appris en cinq ans...
S'assurer le soutien des dirigeants
Les dirigeants s'étaient opposés de toutes leurs forces au "démantèlement" qu'impliquait la première proposition. La seconde version conserva l'entreprise en un seul morceau, et obtint le soutien de sa direction. L'austère Sir Dennis lui-même se mit en quatre pour promouvoir la privatisation (même si on ne l'a tout de même pas vu sourire à cette occasion). Le soutien de la hiérarchie d'entreprise semble bien être une condition nécessaire pour qu'une privatisation réussisse. En effet, celle-ci a le pouvoir de faire énormément de dégâts, réduisant les résultats anticipés et, partant, le prix que l'on pourra tirer de la vente. Elle dispose également d'un pouvoir de pression efficace dans le débat public, surtout vis-à-vis des adversaires du secteur privé. La première tentative, avec démantèlement, et vente des magasins d'appareils à gaz, avait donné l'occasion à un lobby rusé et entreprenant de faire triompher ses intrigues au Parlement même. A la deuxième tentative, en gardant l'entreprise intacte, on avait créé la possibilité d'un échange : les dirigeants avaient pris goût au pouvoir et à l'autorité en dirigeant une grande entreprise publique, mais ils allaient encore mieux aimer se trouver à la tête d'une grande entreprise privée, puissante... et rentable.
Privilégier les salariés en place
Les salariés, qui avaient menacé de se mettre en grève et même organisé un arrêt de travail symbolique contre la première tentative, appuyèrent la seconde. Parmi les actions émises, une bonne partie était d'ailleurs réservée aux employés du gaz. Chacun reçut son petit lot gratuit, avec le privilège de pouvoir en réserver un grand nombre sans devoir participer au tirage au sort. Comme l'optimisme était très grand sur les perspectives de la vente et la valeur future de l'entreprise, plus de 90 % des salariés se portèrent acquéreurs. Ainsi, ils réalisèrent deux objectifs importants à leurs yeux : ils devinrent co-propriétaires de leur entreprise, avec un intérêt personnel dans ses résultats à venir, et firent par-dessus le marché un gain en capital substantiel, de plusieurs milliers de livres dans certains cas. En outre, les acheteurs potentiels aiment bien les entreprises dont les salariés sont devenus actionnaires ; cela veut dire qu'ils travailleront vraiment pour elle, au lieu de la traiter comme une puissance étrangère.
Rassurer les groupes d'usagers
Les utilisateurs du gaz, auquel l'idée d'un personnel non qualifié voire prêt à rogner sur la qualité avaient fait craindre toute privatisation la première fois, ne furent pas les derniers à participer au rachat de British Gas. Ils avaient droit à l'attribution d'actions privilégiées s'ils en faisaient la demande, obtenant un traitement favorable dans tout tirage au sort d'actions en cas de souscription excédentaire. On leur offrit en outre, s'ils conservaient leurs actions, le choix entre des bons de réduction sur leurs factures de gaz et l'attribution d'actions gratuites.
Enrôler le grand public
Pour encourager une participation maximum du grand public, les actions furent mises en vente avec des facilités de paiement, la mise de fonds initiale ne dépassant pas cinq francs et le solde étant réglable par la suite. Enfin, l'émission fit l'objet d'un matraquage publicitaire complet, avec un budget de communication dans les centaines de millions de livres. Le succès se mesura au très fort afflux de premiers actionnaires, dont la plupart choisirent de conserver leurs actions malgré une plus-value initiale de plus de 30 %.
Un succès politique considérable
Le gouvernement et ses partisans l'avaient emporté parce qu'ils avaient su faire gagner aussi les autres groupes. Le succès de l'aventure profita à tous. Plus précisément, le gouvernement pouvait à présent compter un nombre record d'actionnaires-capitalistes, plus de cinq millions de propriétaires de British Gas qui s'opposeraient à toute renationalisation par un gouvernement mal intentionné. Il récoltait aussi les fruits d'une campagne de publicité qui vantait les mérites de la privatisation et du capitalisme tout en faisant l'article pour les actions vendues. Certains observateurs l'avaient bien noté, c'était "la campagne politique la plus chère de l'histoire".
Privatiser, c'est le rêve fou du politicien : pouvoir distribuer de l'argent sans devoir le voler à qui que ce soit
Encore un autre avantage pour le gouvernement : les cinq milliards de livres que la vente avait rapportées. Il put les reverser dans son budget courant pour réduire les impôts ou satisfaire les revendications de dépenses. Bien que cette pratique ait fait et fasse encore l'objet de critiques, elle est parfaitement licite. Dans le budget britannique, il n'existe pas de compte pour le capital, qui n'y est pas non plus correctement amorti. L'argent dont on s'était servi pour acheter les entreprises au secteur privé avaient dû être prélevé sur les dépenses courantes ; rien ne s'opposait donc à ce que les sommes tirées d'une vente y soit reversées. Par ailleurs, présenter la privatisation comme un "gaspillage de la richesse nationale" est foncièrement inexact. La richesse ne cesse pas d'être "nationale" quand elle passe dans des mains privées, et en fait, la privatisation lui donne même bien meilleure allure.
Si l'on échoue, ce n'est jamais que parce qu'on s'y est mal pris
Les leçons à tirer de ces deux tentatives ? Naturellement, qu'il vaut mieux ménager les groupes d'intérêts, et réussir, que se les aliéner pour aller à l'échec : en l'occurrence, satisfaire les divers groupes impliqués dans les entreprises publiques, leur offrir des compensations acceptables pour leurs avantages acquis. Cela, les hommes politiques pragmatiques s'en laisseront volontiers persuader. Ce qu'ils risquent de méconnaître en revanche, c'est cette leçon très importante : que l'échec d'une politique de libéralisation ne signifie jamais que le projet soit mal inspiré ; mis en œuvre, il ne saurait qu'améliorer les choses. Il signifie seulement qu' on s'y est mal pris. Rien n'empêche de réussir. Ce qu'il faut, c'est être intellectuellement armé aussi bien pour conserver le cap que pour tirer profit de l'expérience acquise.
Un transfert d'expérience
Car le procédé employé pour la vente de British Gas était un pur produit de cette expérience même : il avait été testé lors de la vente deux ans plus tôt, en 1984, de British Telecom, l'ancien "service public" du téléphone et des télécommunications. Ce n'était en aucun cas une dé-nationalisation, puisque cette industrie appartenait au secteur public depuis sa création, ayant toujours fait partie de l'administration des Postes. British Telecom fut le premier grand "service public", par opposition à une entreprise nationalisée, à être privatisé. C'était donc une première.
Lors de sa privatisation, British Telecom était la plus grande entreprise à jamais faire l'objet d'une introduction en bourse, tout comme British Gas devait l'être deux ans plus tard. Avec une valeur de plus de trois milliards, elle doublait la vitesse à laquelle on pouvait estimer la vente des entreprises d'Etat au secteur privé. Dans le cas de British Telecom, la pratique des contreparties offertes aux groupes d'intérêts en cause, connue de tous après la vente de British Gas, fut justement mise en œuvre avec une précision implacable.
Privatiser d'abord
Pour commencer, la direction fut autorisée à vendre l'entreprise en un bloc au privé. Les puristes de la concurrence menèrent un combat d'arrière-garde pour que British Telecom soit divisée en plusieurs entreprises rivales, ou du moins en sociétés régionales dont les performances auraient alors pu être comparées. Il ne semblait pas leur être venu à l'esprit que, si cela pouvait être la solution idéale, ce n'était pas celle qui était possible. Insister pour que British Telecom soit privatisée par morceaux revenait à opter pour une politique qui ne "passerait" jamais. La direction de British Telecom soutenait certes la privatisation de l'entreprise, mais seulement dans les termes où elle avait été proposée.
Les syndicalistes neutralisés
Les dirigeants syndicaux donnèrent l'ordre aux salariés de s'opposer à la manœuvre, et une campagne fut mise sur pied. Elle avait fait faire un logo représentant un fil téléphonique coupé par des cisailles, qui était censé symboliser le destin qui attendait le "service public" après son passage au capitalisme. C'est pourquoi la direction avait réservé pour les employés de British Telecom un bon paquet d'actions mises de côté pour la circonstance ; cela en faisait des co-propriétaires de l'entreprise et leur donnait la possibilité de réaliser des plus-values si la valeur en Bourse augmentait. En l'occurrence, 96 % des salariés se portèrent acquéreurs. C'est ainsi que le personnel, qui aurait pu s'opposer à la vente, fit aussi partie de l'équipe.
Le public séduit
Le grand public fut autorisé à acheter les actions à tempérament, n'ayant à verser comptant que cinq francs par action. On offrit aux nouveaux actionnaires le choix entre une émission d'actions gratuites et des réductions sur leur facture de téléphone. A la fin de l'introduction en Bourse, quelque deux millions de personnes possédaient ces actions, la demande ayant largement dépassé l'offre, et deux tiers des acheteurs choisirent de les conserver, alors même que leur cours avait immédiatement monté de près de 100 %. C'est à l'occasion de la vente de British Telecom que fut organisée la première grande campagne de publicité, laquelle obtint du public la réaction voulue.
Traiter systématiquement les oppositions possibles
British Telecom servit ainsi de banc d'essai pour les techniques de privatisation d'un grand "service public". La moindre objection éventuelle de tous les groupes concernés avait été prévue, et traitée, chaque fois que c'était possible. Comme on avait évoqué la crainte que ce "service public stratégique" ne passe aux mains de l'Etranger, on intégra dans la vente une action spécifique (une "golden share") pour le gouvernement britannique, qui lui conférait un droit de blocage dans le cas d'une tentative de rachat étranger. Comme on avait aussi raconté qu'un British Telecom privé ne trouverait pas rentable d'exploiter et d'entretenir les cabines téléphoniques rurales, il fut précisé que l'entreprise serait tenue de conserver un nombre donné de cabines. Cette obligation, malgré son faible impact, était largement connue des acheteurs potentiels.
Et la concurrence ?
On avait beaucoup mis en cause le "monopole de fait" dont British Telecom allait jouir dans le secteur privé, exprimant la crainte qu'il n'"abuse de sa position dominante". Naturellement, jamais on ne mettait ce "monopole" et ces "abus" en parallèle avec ceux qui découlent nécessairement du statut de "service public". Pour traiter ce problème, outre les obligations intégrées dans le projet de loi, on fit appel à deux méthodes. L'une consistait à susciter une "concurrence à la marge" dans laquelle British Telecom, sans avoir en face de soi un concurrent de sa taille et de sa puissance, serait confronté à des concurrents plus petits sur chacun de ses marchés. Il fut ainsi confronté à Mercury pour les télécommunications d'affaires, à Racal/Vodafone pour le radiotéléphone cellulaire, à d'autres concurrents pour la fourniture d'équipements, la transmission de données informatiques et pour la plupart de ses autres activités. Aucun de ces concurrents n'était bien gros, mais pris ensemble, ils faisaient ressentir à British Telecom le risque de perdre ses clients sur bon nombre de ses marchés.
On créa aussi un organisme chargé de surveiller l'industrie et de promouvoir la concurrence. Plutôt que de suivre l'exemple des Etats-Unis, où les organismes réglementaires font obstacle à l'entrée des nouveaux venus sur le marché [1], l'OFTEL fut expressément chargé de la promouvoir. Lorsque Mercury demanda l'autorisation d'étendre ses services à la clientèle des particuliers, l'OFTEL la lui accorda, puisqu'il était là pour ça.
La combinaison utilisée pour contenir les "abus du monopole" associe donc des contraintes légales, la concurrence à la marge et un organisme de promotion de la concurrence. Elle a été faite sur mesures pour British Telecom, et ne serait pas nécessairement instituée sous la même forme pour d'autres entreprises. Elle contient une bonne dose d'empirisme, et le souci d'accumuler de l'expérience pour les projets à venir.
Encore heureux que le Parlement puisse toujours revenir à la charge, si le premier essai n'était pas concluant. En 1987, la qualité du service offert par British Telecom après sa privatisation avait provoqué un mécontentement certain, et ceci amena l'OFTEL à faire des propositions de réforme. Critiqué aussi bien par ses actionnaires que par ses clients, le président démissionna en septembre 1987, et l'on parla d'imposer de nouveaux contrôles si British Telecom ne s'en tirait pas mieux que cela. Voilà une autre leçon très importante à tirer de ces événements : s'il ne parvient pas à obtenir un résultat satisfaisant du premier coup, le Parlement peut toujours remettre son ouvrage sur le métier. Si la vente de British Telecom avait dû attendre que l'on trouve un système parfait, elle attendrait encore.
"Brader le patrimoine national" ?
On a reproché au gouvernement d'avoir "bradé" British Telecom. Après tout, une plus-value de 100 % laissait penser que la vente aurait pu obtenir le double. Or, cette interprétation est presque certainement fausse. Il était important, pour que la première vente d'un "service public" réussisse, que l'émission d'actions soit entièrement souscrite. Il était également important d'impliquer les usagers, et de donner envie au plus grand nombre possible de devenir actionnaires. Il s'agissait de multiplier le nombre des détenteurs d'actions, afin de rendre plus difficile toute nationalisation éventuelle par un gouvernement ultérieur. Tout cela veut dire qu'il était vraiment nécessaire qu'il y eût une plus-value sur le prix de vente. Le prix d'émission était difficile à fixer, parce que personne ne savait ce que l'entreprise pourrait valoir. Nombre d'entreprises nationalisées, British Telecom inclus, avaient pendant des années connu des pratiques comptables qui auraient suscité l'hilarité, voire des poursuites pénales, si elles avaient sévi dans le secteur privé.
Il faut souligner que le gouvernement n'avait pas cherché à établir lui-même le prix de vente. Il fit appel à des experts financiers de la City pour ce faire, de sorte que, s'ils se trompaient, la responsabilité fût partagée. De toute façon, une erreur dans la fixation du prix n'était pas dramatique. En effet, en ne vendant qu'un peu plus de 50 % de l'entreprise, le gouvernement conservait l'option de se débarrasser du reliquat à un prix bien plus élevé par la suite. Comme les entreprises deviennent généralement plus rentables et plus efficaces dans le secteur privé, la tactique consistant à ne mettre qu'un peu plus de 50 % des actions en vente au départ et à se défaire ensuite du reste par tranches permet au gouvernement d'obtenir davantage lors des ventes ultérieures. Ce fut le cas, entre autres, de British Telecom.
Privatiser... la privatisation
Une caractéristique de la vente de British Telecom était donc la forte participation des experts privés. Au cours du programme de privatisation, on s'était vite rendu compte qu'il n'y avait aucune bonne raison pour ne pas privatiser le processus lui-même. On fit donc de plus en plus appel à des entreprises de la City. Elles ont fourni des analystes, des banquiers d'affaires, ainsi que la compétence nécessaire en relations publiques. Le gouvernement ne s'est pas embarrassé d'apprendre comment on fait pour vendre des entreprises ; il a acheté les services de ceux qui le savaient déjà. Ces cabinets sont eux-mêmes devenus un groupe d'intérêt qui tire profit des privatisations, et ont eux-mêmes été à l'origine de nouvelles propositions dans ce sens, tant en Grande-Bretagne qu'à l'étranger.
Faire appel à des experts privés pour mener la privatisation à son terme présente un avantage, petit quoique important : le gouvernement et le Parlement peuvent ainsi se tenir à quelque distance du processus. Une fois entre les mains des spécialistes, il devient leur responsabilité. Ce n'est pas seulement un prétexte pour accuser les autres si les choses tournent mal. Le gouvernement assume de toutes façons la responsabilité de l'ensemble quand il engage les entreprises concernées. Ce que permet le recours à l'expertise privée, c'est de tenir les élus à l'écart du détail. Il ne serait pas souhaitable que ce soit le Parlement qui fixe la date de lancement de l'émission, le prix d'émission ni le nombre d'actions. Rien ne serait facilité non plus, si les parlementaires se sentaient pressés par leurs électeurs de rechercher quelque privilège à leur accorder au moment de fixer de telles modalités.
Fixer le prix de vente est des plus difficile
Un coup d'œil aux différents prix pratiqués lors de la vente des entreprises d'Etat montre à quel point ce terrain est semé d'embûches. Dans le cas d' Amersham International, petite entreprise de radio-sources qui fut l'une des premières ventes au public, il y eut une grosse plus-value sur le prix d'émission. Les adversaires de la privatisation accusèrent le gouvernement d'avoir vendu un "bien national" à un tarif de faveur, au bénéfice de ses "amis argentés" de la City. On entend ce genre d'accusation chaque fois qu'il y a eu un gain en capital.
La tactique qui consiste à garantir une vaste participation du grand public à la vente émousse l'accusation, mais ne l'élimine pas. Etre accusé de brader des richesses "nationales", au profit de "pékins" ordinaires est plus facile à assumer qu'un même reproche impliquant "les copains de la haute finance", mais cela veut tout de même bien dire qu'une faute a été commise. Lorsque le cours de l'action est fixé trop haut et qu'il n'y a pas suffisamment de souscripteurs, les actions perdent de la valeur dès qu'on les met sur le marché. Les opposants parlent alors d'échec. La demande est trop élevée ? C'est un échec. Trop faible, c'est toujours un échec. Apparemment, seule une faible marge d'écart pourrait passer pour un succès.
Soulignons tout de même que, lorsque la demande est faible et que les actions démarrent à perte, le gouvernement, et les contribuables, touchent tout de même leur argent. La pratique de la garantie d'émission auprès des banques d'affaires et des institutions financières a pour conséquence que la vente des actions sera de toutes façons assurée. La vente n'est interprétée comme un "échec", que dans la mesure où elle n'a pas réussi à attirer un nombre suffisant de souscripteurs au sein du public.
Même la vente des actions BP encore dans les mains de l'Etat, qui fut interrompue par la chute brutale des valeurs boursières du 19 octobre 1987, a rapporté la somme escomptée. Les banques qui garantissaient l'émission, et que l'on accusait depuis des années de "se sucrer à bon compte", se retrouvèrent dans l'obligation de reprendre à 120 pence des actions invendues, alors qu'elles étaient descendues à 70-80 pence. Elles payèrent. Le vent de panique se calma lorsque le Ministre des Finances Lawson garantit un prix de rachat de base de 70 p par action, mais en l'occurrence il n'y eut que 2 % des actionnaires à se défaire des leurs. Le gouvernement fit valoir, à juste titre, que c'était pour subir ce genre de risques que ceux qui garantissent les émissions étaient payés. Il doit bien arriver un jour que le risque se réalise.
En fait, on ne s'est pas trop mal tiré de ces évaluations, surtout si l'on tient compte de la nouveauté du procédé. L'absence d'une comptabilité décente et l'inexpérience en fait de vente des actifs de l'Etat ne facilitaient pas le choix d'un prix. Et pourtant, il y a eu peu de véritables erreurs. Le principe était que les actions devaient rapporter une plus-value, afin d'encourager les investissements futurs et d'obtenir l'appui politique des bénéficiaires. De toutes les privatisations par émission publique d'actions, seules celles liées au pétrole démarrèrent à perte. Etant donné l'inquiétude internationale quant à l'avenir de l'industrie, sa vulnérabilité aux événements à l'extérieur et les fortes fluctuations du prix du brut, c'était compréhensible.
Il importe que le nouvel actionnaire fasse une bonne affaire
Dans d'autres cas, non seulement il y a eu plus-value le jour de la mise en vente, mais la valeur en Bourse des entreprises privatisées a ensuite dépassé régulièrement la moyenne du marché boursier. Ces deux effets doivent être délibérément recherchés au début du processus de privatisation. Ils apportent maintes satisfactions à bon nombre de groupes d'intérêt impliqués, notamment ceux qui viennent de se constituer. Tout le monde peut voir que la direction et les salariés y gagnent, par l'augmentation de la valeur des actions qu'ils détiennent et de la rentabilité de leur entreprise. Il est essentiel qu'ils tirent du nouvel état de choses plus d'avantages que de l'ancien. Cela encouragera les employés d'autres entreprises d'Etat à prendre fait et cause pour la privatisation lorsqu'elle leur sera proposée.
La nouvelle classe d'actionnaires, dont beaucoup achètent des actions pour la première fois ou sont de petits porteurs, doit pouvoir toucher du doigt ses gains en capital. En devenant propriétaire d'une partie du capital de la nation, elle devient intéressée à ce que le climat politique soit favorable aux entreprises productives. Si elle pense tirer des avantages personnels de politiques favorables à la libre entreprise, elle sera d'autant plus disposée à les soutenir. En outre, plus elle possède de richesse sous la forme d'actions des anciennes entreprises d'Etat, plus il sera difficile à un gouvernement futur de comploter pour les lui confisquer. Déjà, les adversaires de la privatisation qui souhaitent un retour en arrière ne parlent plus de reprendre leurs actions aux petits porteurs. Ils parlent maintenant de "ramener l'entreprise dans le secteur public", mais tout en laissant les actions à des particuliers. Il reste à voir si les entreprises obtiendraient d'aussi bons résultats sous le contrôle des hommes de l'Etat qu'elles en ont avec des dirigeants privés et surtout, comment les électeurs-actionnaires vont estimer cette perspective au moment de voter. En tous cas, lorsqu'on leur en a donné le choix en 1987, c'est une option qu'ils ont rejetée [2].
Privatiser ne supprime pas toute l'irresponsabilité institutionnelle ; mais le progrès à en attendre vaut bien qu'on s'en donne les moyens
Face à la privatisation, il existe une grande différence d'attitudes entre ceux qui prônent des solutions de pur laissez-faire et ceux qui, partant de l'analyse des choix publics, envisagent les politiques en tenant compte des marchés politiques existants. Le premier groupe reproche constamment au gouvernement d'être incapable d'instituer la pure liberté des contrats, et considèrent les échanges de privilèges avec les groupes de pression comme une marque de faiblesse et un manque de résolution. Ils n'ont pas l'air de saisir que ce sont justement ces compromis qui permettent l'opération. Ils ne comprennent pas non plus qu'en l'absence de telles mesures, la réforme ne survivrait pas à son passage dans les remous de la politique.
Certains partisans de l'économie de marché ont l'air de supposer que l'objectif unique de la privatisation doit être d'exposer les entreprises d'Etat à tous les vents de la concurrence. A moins que la privatisation n'aboutisse à une situation de concurrence pure, ils la considèrent comme un échec. C'est une erreur de conception : l'objectif premier de la privatisation n'est pas de développer la rivalité au sein du secteur d'Etat, mais d'abord de le privatiser. La concurrence est indiscutablement souhaitable et doit être recherchée chaque fois que cela est possible, mais la privatisation présente encore des avantages, même lorsque le degré de concurrence atteint est loin d'être parfait.
Une entreprise "publique" est une entreprise politisée'
L'analyse des choix publics est parvenue à la conclusion — peu surprenante — que les activités du secteur d'Etat appartiennent au domaine politique. Elles ne sont pas confrontées à des disciplines marchandes et concurrentielles, mais soumises aux pressions de la politique. Se trouvant directement sous la coupe du "législateur", elles sont asservies aux contraintes qui déterminent les choix de ce "législateur". Les choix faits dans le secteur public relèvent donc d'un marché politique, et non pas économique.
Quelques exemples tirés de la vie de tous les jours : si les entreprises d'Etat ont besoin d'argent pour s'agrandir ou faire des investissements, cela peut être enregistré comme un emprunt "public". De telles décisions se retrouvent alors soumises aux contraintes imposées au Besoin en Financement du Secteur Public [3], et cette demande se retrouve alors en concurrence avec d'autres priorités du gouvernement. Si ce dernier a décidé de réduire l'endettement total, on n'aura pas l'argent, aussi justifié que soit son emploi. A l'inverse, dans le secteur privé, une entreprise attire toujours les financements si elle prouve qu'elle est capable d'en faire bon usage et de les rentabiliser. Il n'est pas possible de concevoir un financement public sur une base commerciale.
Les décisions prises dans les entreprises du secteur public sont soumises à l'influence politique jusque dans leurs moindres détails. La décision de construire une nouvelle usine dans le secteur privé est prise en fonction de critères commerciaux, d'après des facteurs tels que les prix de revient, ou la proximité des marchés. Dans des circonstances analogues, l'entreprise du secteur public est confrontée à des données politiques, avec des élus qui font pression pour faire venir l'usine dans leur circonscription. On a déjà vu à quelles extrémités on est conduit pour fermer une installation dans le secteur public. Le fait est qu'une entreprise d'Etat est comme un ballon de football, ballottée entre les groupe de pression et les politiciens qui les représentent. Elle ne prend pas plus ses décisions sur des critères commerciaux qu'elle ne collecte ses fonds à des conditions de marché.
A ces facteurs, il faut ajouter le fait que la gestion publique se caractérise souvent par le monopole d'Etat, avec tout ce que cela implique de capture par les producteurs, de sureffectifs et de mépris du consommateur. Si la privatisation peut remettre tous ces compteurs à zéro pour un nouveau départ dans le secteur privé, c'est indiscutablement un bon point pour elle. Si on ne peut effacer qu'une partie de l'ardoise, eh bien le jeu en vaut encore la chandelle ; et si, en nettoyant cette partie, on expose une entreprise à des conditions qui permettront finalement d'effacer le reste, il en vaut d'autant plus la peine.
De tous les désordres causés par l'intervention étatique, la politisation est bien pire que le monopole
Certains observateurs considèrent que si le monopole public est mauvais, c'est parce qu'il est un monopole. Or, le fait est qu'un monopole public combine deux inconvénients : le fait qu'il soit public, et le fait qu'il s'agisse d'un monopole. De ces deux maux, le plus grand est qu'il soit public. C'est une bien plus grande source de désordres et de gaspillages. Dans le cas où un monopole est privatisé en tant que monopole, on peut dire au moins qu'un monopole privé est préférable à un monopole public. Un monopole privé est plus vulnérable à l'innovation de ses concurrents. Il dépend moins de la politique que les monopoles d'Etat, et il n'a pas leur puissance politique. Alors que les monopoles privés finissent par disparaître avec le temps, les monopoles publics sont entretenus en permanence par de nouvelles lois, qui sont votées pour les protéger contre les nouvelles menaces de la concurrence.
Il n'était pas possible de donner à British Telecom un caractère suffisamment concurrentiel lors de son transfert au secteur privé. L'analyse micropolitique suggère que, si on avait essayé de le faire à ce moment, la privatisation elle-même n'aurait pu aller à son terme. Toutefois, British Telecom est exposée à bien plus de disciplines marchandes qu'auparavant, et se trouve confrontée à une plus grande concurrence. Ce sont deux avantages importants d'une solution réalisable, qu'il ne faut pas écarter au profit de solutions plus parfaitement concurrentielles, et qui ne marcheraient pas.
Privatisée, l'entreprise a moins d'influence politique
L'élément temps joue un rôle important. Avec le développement de nouvelles techniques, British Telecom n'aura plus le pouvoir de les faire interdire, ni de se les accaparer par la loi comme elle le faisait auparavant. On peut aussi envisager une action législative ultérieure pour augmenter la concurrence à laquelle il sera exposé. Dans ce cas, les entreprises, une fois privatisées, découvriront qu'elles ne bénéficient plus des appuis en haut lieu que leur apportait leur statut public. En tant qu'entreprises privées, on leur demandera de se passer de l'appui des gendarmes pour faire face aux pressions de la concurrence.
La privatisation institue immédiatement des disciplines permanentes
Au minimum, la privatisation soumet des entreprises d'Etat aux disciplines de la gestion commerciale. Au mieux, elle les transforme en organisations viables et compétitives, capables de réussir et de tenir leur rôle sur un marché ouvert. De nombreux cas de privatisation se situent entre ces deux cas de figure. L'important est que l'on mette en place les éléments qui conduiront progressivement au second scénario. Si on ne peut créer un cadre complètement concurrentiel dès le départ, on doit s'arranger pour qu'il le devienne davantage à l'avenir, et ne pas lui permettre de glisser en arrière.
Dans plusieurs entreprises, on a pu constater que les préparatifs de la privatisation induisaient d'importantes réformes, avant même le passage à l'acte. Savoir qu'une entreprise d'Etat va être vendue, comme de savoir qu'on sera pendu dans quinze jours, donne une merveilleuse puissance de concentration. L'efficacité s'améliore, on fait des économies. Quand arrive la date fixée, l'entreprise est devenue bien plus vendable qu'avant le déclenchement du processus. Avec cette politique de préparation, on a vu que des entreprises, au départ pléthoriques en effectifs et asservies aux producteurs pour cause d'appartenance au secteur public, étaient devenues efficaces et rentables au moment de leur arrivée sur le marché.
Comment une entreprise publique déficitaire devient privée et rentable
British Airways en est un exemple classique. Lorsque la décision de la privatiser fut prise en 1983, elle faisait d'énormes pertes, qui étaient prises en charge par les subventions de l'Etat. Elle avait trop de personnel, avec un relâchement certain dans tous les aspects de sa gestion. Au moment de sa vente en février 1987, elle était redevenue populaire, et bénéficiaire. Le nombre de ses salariés était passé de 59 000 à 39 000. Elle se souciait visiblement de ses clients, prenant soin de connaître et de prévenir leurs besoins. De nombreuses catégories de passagers la désignaient régulièrement comme la meilleure compagnie aérienne internationale. L'obèse paresseux et égrotant s'était transformé en une société commerciale, saine et très compétitive. Au moment de sa vente au public, British Airways était un bon placement financier. Et ce n'est pas pour avoir vécu dans le secteur privé qu'elle avait opéré cette transformation. C'est parce qu'elle avait dû se préparer à y vivre.
Comment avait-on pu le faire, alors que l'entreprise était encore dans le secteur d'Etat, soumise à toutes les pressions qui y règnent ? Ce qui avait rendu cela possible était l'ensemble des techniques employées, avec la carotte qui attendait tout le monde à la sortie. Personne n'a été mis à la porte ; on avait offert des conditions avantageuses pour partir volontairement à la retraite. Quant aux pensions de retraite indexées, on ne les avait pas supprimées, mais rachetées cash. Il a fallu beaucoup investir pour transformer British Airways, mais cet investissement a été plus que compensé par la nouvelle rentabilité de l'entreprise et la valeur que l'on a pu tirer de sa vente. La Compagnie avait tellement le moral que, comme des procès successifs retardaient la date de la mise sur le marché, les employés menacèrent de faire grève si l'on n'accélérait pas le processus.
Comme on l'avait fait si souvent dans d'autres entreprises, les salariés avaient choisi d'être partie prenante dans le rachat. On peut pour le moins douter que ces changements eussent pu avoir lieu dans une entreprise publique sans la perspective de sa privatisation. Sans la nécessité d'être compétitif et rentable dans le secteur privé, les intérêts des groupes impliqués auraient été autres, et la direction n'aurait pas réussi à améliorer la productivité.
La leçon tirée de l'expérience de British Airways est qu'une entreprise qui fonctionne à perte peut toujours être vendue. On vend tous les jours en Bourse des entreprises déficitaires. Cette expérience de British Airways a démontré qu'on pouvait redresser une organisation qui est dans le rouge, et en faire une entreprise viable. Par ailleurs, les préparatifs de la privatisation peuvent en eux-mêmes constituer un système d'incitations suffisant pour la transformer dans ce sens.
Des résultats spectaculaires
Sur les marchés, on dit qu'une réputation est très difficile à récupérer une fois perdue. Facile ou non, British Airways a bel et bien récupéré en un temps record sa réputation de premier plan. En quelques années, elle est passée d'un rang très médiocre à une position lui permettant de disputer la première place. Et ce n'est pas un cas isolé. Les voitures Jaguar avaient perdu leur ancienne image de qualité après leur passage dans le secteur public. Elles avaient perdu du terrain en Amérique parce qu'à juste titre, on les tenait pour peu fiables. Le contrôle de la qualité avait cédé la place à des pratiques de "service public", où les considérations politiques prenaient le pas sur le souci du client. Après la privatisation, Jaguar retrouva son ancienne tradition d'excellence et de fiabilité à une vitesse incroyable. De ce fait, les actions achetées par les salariés à l'époque augmentèrent de 2 000%, ce qui n'est pas le moins important de l'affaire.
Et les travailleurs ?
Quel avantage le salarié trouvera-t-il à la privatisation ?
Un élément qui a beaucoup compté dans la réussite des privatisations était le soutien du personnel. Quand on privatise, il faut faire au salarié une offre qu'il perçoive comme au moins équivalente aux avantages dont il bénéficiait déjà. Il se peut, évidemment, que la valeur actuelle de ces avantages acquis implique une décote. Si, dans le secteur public, l'avenir de l'entreprise est compromis, le personnel peut donner moins de valeur à la garantie normalement associée à un emploi dans ce secteur. Il peut alors accepter la privatisation, même au prix d'une réduction sensible de ses avantages. Un emploi certain dans le secteur privé a beaucoup plus d'intérêt que la simple éventualité du maintien de l'emploi "garanti" dans le secteur d'Etat.
Dans ces cas-là, on a vu le personnel accepter la vente d'une entreprise d'Etat, même avec réduction d'effectifs, ayant compris que la seule autre solution était de cesser complètement l'activité. Le traitement réservé aux employés reclassés a été un facteur majeur du succès de ces tentatives. En effet, quand il n'est pas question de licenciements forcés, alors le nombre des gens réellement forcés de changer d'emploi tombe ipso facto à zéro. Dans les faits, cela réduit l'opposition aux seuls militants syndicaux, car ils sont les seuls à se soucier des effectifs en tant que tels.
L'offre faite aux mineurs dont les puits étaient condamnés à fermer montre bien comment on fait pour négocier les avantages acquis. On leur avait tout offert : un reclassement dans d'autres puits, une prime de déménagement ainsi que des cours de recyclage. Le montant des indemnités de préretraite, on l'a vu, était absolument sans précédent. Si le projet de fermeture était confirmé, un mineur risquait de perdre un emploi chez lui ; mais la certitude de pouvoir être embauché sur un autre site, associée à l'indemnité de déménagement, lui semblait être un substitut raisonnable, ayant bien compris qu'il n'était plus possible de maintenir tous les puits en activité.
Distribuer la propriété de l'entreprise
Le moyen habituel pour s'assurer le soutien du personnel en cas de transfert au secteur privé reste la distribution d'actions. Un bloc de titres est mis en réserve pour les salariés de l'entreprise, et ils peuvent en prendre s'ils le désirent [1]. Parfois, comme dans le cas de British Gas, un certain nombre d'actions sont offertes gratuitement. Il arrive même que les employés s'en voient offrir davantage qu'il n'en est mis à la disposition du grand public. Ce fut le cas aussi bien pour British Gas que pour British Telecom. On peut aussi autoriser le personnel à financer l'achat des actions sur son salaire en bénéficiant d'un prêt à long terme, généralement sans intérêt. C'est ce qui a été fait chez Jaguar et pour certains chantiers navals.
Tous capitalistes!
Le but de la direction est que le personnel participe au maximum à la vente de l'entreprise. C'est un moyen de s'assurer son adhésion au projet, et de neutraliser ce qui pourrait être une source d'opposition sérieuse. Cela va même encore plus loin. Quand le personnel a un intérêt immédiat dans l'entreprise, il identifie son avenir avec le sien. Cela permet d'en finir avec cette attitude de "nous" opposés à "eux" ; les ouvriers se reconnaissent dans l'entreprise au lieu de la considérer comme un adversaire. Cela améliore les relations de travail et diminue les conflits. Cela fait aussi monter le cours de l'action, toutes choses égales par ailleurs, dans la mesure où les acheteurs potentiels réévaluent à la hausse les résultats à venir de l'entreprise.
Pour le gouvernement, l'intérêt supplémentaire est qu'une société dont les ouvriers sont actionnaires risque fort de s'opposer aux prises de contrôle par les hommes de l'Etat, et autres charlataneries du centralisme que pourraient proposer les partis politiques concurrents. Il existera un préjugé général en faveur du capitalisme et de la libre entreprise si leurs avantages sont assez visibles et partout diffusés, et si le travailleur ordinaire, vu les bénéfices qu'il en tire, se considère lui-même comme appartenant au système.
La reprise par une autre société...
Néanmoins, toutes les privatisations ne se font pas par émission d'actions. Une fraction petite mais significative a lieu par reprise directe. En l'occurrence, comme dans les cas où l'on charge des entrepreneurs privés d'assurer un "service public", il importe de bien s'assurer que le personnel en place sera pris en compte dans la prise de contrôle. Il faut être sûr que les avantages dont ils bénéficiaient comme employés du secteur public seront remplacés par d'autres, tout aussi acceptables.
Il est arrivé que la reprise passe pour une occasion à saisir, comme par exemple lorsque, ayant commencé par annoncer la fermeture de l'entreprise d'Etat, on présentait ensuite sa vente à un industriel privé comme une chance de "sauvetage" permettant de la maintenir en activité. L'acheteur privé est souvent en mesure d'offrir un avenir plus brillant, intégrant l'activité dans un ensemble plus vaste avec le savoir-faire de gestion et la force de vente nécessaires pour la moderniser et la rééquiper. On peut en trouver de bons exemples dans certains chantiers navals de la Marine ou encore les ferries de la Manche.
Le rachat de l'entreprise par ses salariés
A l'autre bout de l'échelle, on trouve les cas où aucun acheteur extérieur n'intervient, mais dans lesquels la privatisation se fait par un rachat au nom de l'encadrement, du personnel ou des deux à la fois. La reprise transforme aussi bien le climat du travail que la viabilité économique des sociétés publiques. Quels qu'aient pu être les intérêts du personnel en tant qu'employés de l'Etat, ils deviennent radicalement autres quand ils sont devenus propriétaires de leur propre entreprise. L'ensemble de leurs priorités se transforme, et surtout ce qu'ils attendent du processus politique. C'est ainsi que bon nombre de rachats par les salariés ont valu un soutien accru au gouvernement.
L'exemple de la National Freight Corporation
L'un des premiers rachats par la direction et les employés fut celui de la National Freight Corporation, qui assure le transport routier du fret en Grande-Bretagne. Le rachat avait été lancé à l'initiative de la hiérarchie, initiative bien souvent imitée par la suite dans d'autres entreprises. Il est très fréquent que ce soit une idée de la direction, et que ce soit elle qui fasse l'offre. Dans le cas de National Freight, bien que la plupart des actions aient été rachetées par les cadres avec l'appui des banques, on fit son possible pour que le personnel y soit aussi associé. Ce fut une réussite, et aussi un précédent désormais classique.
Le personnel de National Freight : chauffeurs, chargeurs, vérificateurs et trieurs, tous achetèrent leur part de la nouvelle entreprise. Il y en eut pour hypothéquer leur maison afin d'acquérir des actions. D'autres mirent dans la cagnotte les économies de toute une vie. Ayant décidé que la nouvelle entreprise serait rentable, ils ne ménageait pas leur soutien. Plusieurs, interrogés par la Télévision, expliquèrent ce que cela représentait pour eux d'être propriétaires de leur entreprise [2].
La nouvelle société connut une réussite immédiate. Elle s'avéra très rentable dans son statut privé, sa réussite commerciale traduisant une connaissance parfaite et un souci extrême des vœux de ses clients. Les employés actionnaires virent la valeur de leurs actions d'abord multipliée par quatre, puis par huit, dix, puis par cinquante-quatre. Tous les actionnaires, employés comme direction, avaient fait un gain de plusieurs milliers pour cent par rapport à leur investissement initial.
Il vint un jour où la National Freight dut procéder à une réduction d'effectifs. Elle le fit en douceur, bien que sans joie, pour des raisons — et sur des critères — de rentabilité. Ce qui, dans une entreprise publique, aurait engendré une tempête et occasionné des grèves, voire des occupations d'usines, passa comme une lettre à la Poste. L'entreprise est toujours rentable. Elle avait loué une salle de concert pour la première assemblée annuelle de ses actionnaires, ne sachant pas du tout, parmi les milliers qui existaient, combien se déplaceraient. Ils sont venus par milliers, et l'on considère les participants aux réunions annuelles des actionnaires comme l'un des auditoires les mieux informés de Grande-Bretagne, puisqu'ils travaillent tous aussi pour l'entreprise.
Des réussites un peu méconnues
Si National Freight est un modèle, on en a fait de nombreuses copies3. Les rachats par l'encadrement ont été les plus nombreux, même si ceux qui impliquaient une plus large participation du personnel ont eu plus de publicité. Aucun de ces deux types de rachat ne bénéficie d'autant de réclame qu'une émission publique d'actions ; c'est pourquoi ils comptent quelques-uns des succès les plus méconnus de la privatisation.
Tout faire pour mettre les salariés "dans le coup"
Dans les cas où les employés représentent une partie significative du consortium, on a recours à des méthodes inédites pour accroître au maximum le nombre des actions qu'ils pourront acheter. Celui qui ne voit dans la privatisation qu'une simple vente des actifs de l'Etat devrait étudier l'extraordinaire imagination et l'inventivité des techniques utilisées pour convaincre l'ensemble du personnel de s'engager dans ces opérations. Par exemple, les employés peuvent payer à crédit, par versements mensuels prélevés sur leur salaire. Parfois les actions sont immobilisées dans une caisse pour les salariés, et libérées à mesure qu'elles ont été payées. On peut aussi faire intervenir des banques locales, qui mettront au point des conditions de paiement sur mesure pour les salariés acquéreurs. Dans de nombreux cas, comme la majorité du personnel est néophyte en matière financière, on organise des programmes d'initiation aux opérations boursières, au rôle de l'investissement et à l'importance des bénéfices. Les observateurs pourront noter que c'est en soi un grand service rendu à la société, et qui ne vient pas trop tôt par dessus le marché.
La privatisation est une opération politique
Tout cela montre à quel point la privatisation est une opération politique, et pas seulement économique. Car elle vise aussi bien les marchés politiques que les marchés économiques. Associer les travailleurs à l'achat des actions permet de modifier profondément les termes de l'échange sur le marché politique.
Le rachat des chantiers navals Vickers par le consortium du personnel en 1986 mit en œuvre aussi bien les bonnes vieilles techniques essayées et éprouvées que des innovations en la matière. Son histoire illustre bien jusqu'à quelles extrémités les responsables de cette politique sont prêts à aller pour atteindre les objectifs souhaités. Dans ce cas précis, pour permettre à la masse des ouvriers des chantiers navals de participer, on associa des conditions de crédit inouïes à un programme de formation intensif. Comme c'était un groupe qui n'avait ni économies de quelque importance ni aucune connaissance en matière financière, il fallut tout monter à partir de zéro pour qu'il puisse vraiment participer. Outre les employés, l'encadrement, les banques et autres investisseurs, l'originalité de la vente Vickers fut que l'on offrit des actions à des tarifs avantageux non seulement aux ouvriers, mais aussi aux membres des communautés locales de Barrow et de Birkenhead, les sites des deux chantiers concernés.
L'événement le plus spectaculaire de la privatisation de Vickers fut que l'on ne vendit pas au plus offrant, mais au second enchérisseur. L'offre la plus élevée était celle de Trafalgar House, un conglomérat géant. Or, ce fut le consortium formé par la direction, les employés et les habitants des communes qui emporta l'affaire, bien que son offre d'argent eût été moindre. Avec un tel engagement personnel dans l'affaire, c'était à eux que l'on donnait le plus de chances de réussir. Certains commentateurs ont trouvé bon de critiquer ce choix, parce qu'il était politique et non purement économique ; en tous cas, voilà qui montre bien à quoi sert la privatisation.
L'équipe dirigeante installée est souvent la mieux placée pour reprendre l'entreprise
Le rachat par la direction ou le personnel a très bien marché pour privatiser des entités relativement réduites, par comparaison avec des colosses comme British Telecom ou British Gas. Lorsque la société est assez petite pour que s'y développe un véritable sens de la communauté, nous avons là un candidat potentiel pour le rachat direct. Il y a de fortes chances que la direction connaisse à la fois le potentiel et les problèmes de son outil de travail, ayant pu observer plusieurs années ses performances à l'intérieur du secteur d'Etat. Elle est bien placée pour savoir quelles améliorations l'on obtiendrait s'il était possible de modifier les procédures et d'obtenir du personnel une attitude différente. C'est pourquoi il est essentiel de la mettre dans le coup, quelle que soit l'ingéniosité comptable nécessaire pour y parvenir [4].
On peut dire que la roue de la politique a vraiment bien tourné, quand c'est un gouvernement conservateur qui favorise la constitution de petites coopératives. Or, le rachat par la direction et les employés est l'une des techniques de privatisation qui ont le mieux réussi.
La privatisation déplaît généralement aux syndicalistes
Il existe une interrogation évidente sur le rôle des syndicats en tant qu'ils affirment représenter le personnel. La privatisation a bien montré que, s'il est possible de considérer les syndicats comme représentatifs des intérêts de leurs membres en matière de salaires ou de conditions de travail à l'intérieur de la structure existante, ce n'est plus le cas lorsque cette structure elle-même est en discussion. Dans bien des cas de privatisation, si ce n'est la plupart d'entre eux, on a pu observer une différence assez nette entre les intérêts de la base et ceux de la direction syndicale.
Les dirigeants syndicaux ont depuis longtemps un intérêt personnel attaché au secteur public en tant que tel. La participation syndicale, aussi bien chez les cols blancs que chez les cols bleus, a toujours été plus élevée dans le secteur d'Etat que dans le privé, surtout pour les premiers. Les syndicats du secteur public ont généralement pu établir des relations de travail douillettes avec la hiérarchie et l'encadrement, également publics. Chacun voyait bien l'intérêt qu'il avait à ménager ses autres partenaires, au mépris sinon des employés, du moins de la clientèle et de la population dans son ensemble5.
Les syndicats sont donc généralement hostiles à la privatisation, sachant pertinemment que le privé leur fera la vie moins belle. Les seules exceptions notables ont été les cas où, le gouvernement ou la direction ayant clairement affiché sa résolution de fermer une usine ou un secteur, la privatisation faisait figure de bouée de sauvetage. Par conséquent, la réaction syndicale a toujours été de s'opposer à la vente, sauf dans les cas où la seule autre possibilité était la fermeture immédiate. Alors, on peut se demander pourquoi leur riposte a été aussi inopérante, étant donné l'énorme pouvoir dont ils semblaient jouir en 1979.
D'où vient que l'énorme pouvoir syndical n'ait pu s'opposer à la privatisation ?
Une réponse envisageable est qu'une partie de cet énorme pouvoir ne tenait qu'à l'image qu'on s'en faisait. Tant que le gouvernement et les "responsables" syndicaux se rencontraient deux fois par semaine au 10, Downing Street pour débattre des Intérêts Supérieurs de la Nation, le pouvoir des syndicats semblait faire partie intégrante des institutions britanniques, comme les gardiens de la Tour de Londres, ou la Colonne de Nelson à Trafalgar Square. Leur pouvoir se serait évanoui le jour où le Premier Ministre eut décidé de ne plus les consulter sur autre chose que les relations de travail, parce qu'il n'avait jamais eu d'autre source que sa bonne volonté. Une autre explication serait que le pouvoir des dirigeants syndicaux avait tellement été érodé par l'action législative du nouveau gouvernement, qu'il était désormais trop faible pour faire obstacle à la privatisation. La première explication a quelque valeur, mais la seconde ne tient pas chronologiquement, dans la mesure où les syndicats échouaient déjà dans leur opposition, bien longtemps avant que les nouvelles mesures n'eussent commencé d'entamer le pouvoir de leurs dirigeants.
Un effet de la micropolitique
En fait, l'explication la plus plausible est que, les propositions de privatisation ayant été soigneusement conçues pour neutraliser l'opposition syndicale, elles y sont effectivement parvenues. Un examen des tactiques auxquelles les dirigeants syndicaux durent avoir recours montre bien à quelles difficultés ils s'étaient brusquement heurtés.
Le rouleau compresseur de la publicité officielle
Certains s'étaient lancés dans de coûteuses campagnes de propagande. Ce fut le cas des fonctionnaires locaux qui ne voulaient pas que l'on sous-traite certains services municipaux à des entreprises privées, qui dépensèrent plus d'un million de livres en une année, et du syndicat des PTT [6], qui dépensa un million et demi de livres pour une campagne de dix-huit mois. Dans les deux cas, ils s'efforcèrent d'atteindre leurs adhérents et le grand public au moyen de brochures, autocollants et films vidéo projetés en réunion. On chapitra dûment des militants bien choisis, pour qu'ils viennent faire leur numéro à la télévision. On s'adressait particulièrement aux indécis, ainsi qu'aux groupes tels que les personnes âgées, les handicapés et les personnes isolées, susceptibles de craindre d'être un jour privés d'un service téléphonique indispensable.
Tout cela eut peu d'impact, l'une des précautions du gouvernement ayant été de lancer une vaste campagne de publicité pour promouvoir les émissions d'actions. Même une communication d'un million de livres ne fait pas le poids face à des campagnes évaluées à des centaines de millions. Ces campagnes, rondement menées par des professionnels, avaient peut-être été conçues pour vendre des actions, mais elles vendaient en même temps le principe de la privatisation. Une partie de leur message visait à rassurer les usagers quant à l'avenir du service.
Quand la micropolitique a réponse à tout
Au niveau pratique, les mesures particulières démolissaient un par un tous les prétextes éventuels pour monter une opposition. Les habitants des campagnes étaient inquiets ? Eh bien, on ferait une clause pour imposer le maintien des cabines téléphoniques dans les zones rurales. Si les consommateurs s'inquiétaient d'une hausse éventuelle de leurs factures, alors on lierait les tarifs au taux d'inflation pour plusieurs années. Si une éventuelle prise de contrôle par l'étranger était une menace, pas de problème ! L'action préférentielle de l'Etat y ferait face. Le terrain sur lequel les syndicats auraient pu rassembler une opposition leur était enlevé, centimètre carré par centimètre carré.
Face à la hiérarchie
Une tactique plus prometteuse au départ pour les syndicats avait été de faire front commun avec la direction. Si la hiérarchie et les syndicats d'une entreprise s'opposaient à la privatisation, il devenait difficile de la mener à bien. Ainsi, on les vit s'associer avec Lord Kearton de la British National Oil Corporation, qui s'opposait à la vente de son holding de pétrole et de gaz, et avec Robert Atkinson des British Shipbuilders, qui ne voulait pas entendre parler de vendre les chantiers de la Marine. Il y eut quelques autres opposants dans le groupe des Présidents des Sociétés Nationalisées, mais le gouvernement leur coupa l'herbe sous le pied de deux manières. Tout d'abord, dès qu'un poste était vacant dans les conseils de direction, il y nommait des partisans de la privatisation. Ensuite, il constitua à son tour un front uni des dirigeants, en les associant aux enjeux de la privatisation.
Vanité de la grève
L'action revendicative classique dans les entreprises fut rarement utilisée. Il y avait eu des grèves symboliques dans l'industrie du gaz pour s'opposer à la vente des magasins de détail, dans les ferries de la Manche pour protester contre la vente de Sealink, et dans les usines des Armureries Royales. Un an avant la vente de British Telecom, il y eut des grèves contre Mercury, le concurrent en télécommunications d'affaires qui devait être autorisé après la vente. Elles furent interrompues par les jugements des tribunaux sans avoir jamais eu assez d'impact pour influencer la décision de privatiser.
Ce type de démarche était donc vain, et s'en est finalement tenu à quelques initiatives de petite envergure lancées par des activistes, en partie parce que les dirigeants syndicaux savaient ne pas pouvoir compter sur le soutien de la base pour des actions plus ambitieuses ou de plus longue haleine. C'était l'opposition de la direction qui avait empêché la vente des magasins de détail de gaz ; or ce fut cette même direction que l'on vit mener la vente de British Gas en 1986.
Faire directement des offres alléchantes court-circuite complètement les hiérarques syndicaux
Cette incapacité des manœuvres syndicales traditionnelles à influencer le cours des événements traduit d'une certaine manière la position inconfortable où la politique du gouvernement avait placé les dirigeants syndicaux. Les propositions détaillées de privatisation finalement présentées n'exprimaient pas du tout l'opinion selon laquelle les employés du secteur public étaient surpayés, privilégiés et trop puissants. Au contraire, elles cherchaient à garantir les intérêts de ces employés dans le nouvel état de choses. Elles eurent pour effet de détacher les intérêts des travailleurs syndiqués de ceux de leurs camarades dirigeants. A la suite de quoi ces derniers se mirent vraiment à sentir du mou dans les rangs, de sorte qu'ils ne pouvaient plus faire appel aux réflexes de "solidarité" qui les avaient si bien servis dans les confrontations directes. Pour la National Freight Corporation, par exemple, il était trop manifeste que l'intérêt de la base était de soutenir la privatisation et d'y être associée.
La politique des directions et du gouvernement a été d'obtenir aussi souvent que possible ce type de résultat. Non seulement les offres faites étaient assez alléchantes pour donner aux travailleurs l'envie d'en être, mais il y avait aussi des campagnes de formation et de promotion pour les pousser à participer. Lorsque les salariés eurent comparé ce qu'on leur offrait de ce côté-là et leur avenir probable dans le secteur d'Etat, ils choisirent massivement de dire "oui" au changement, méprisant l'hostilité des hiérarques syndicaux. On en apprend pas mal sur la popularité réelle des industries nationalisées quand on constate l'enthousiasme avec lequel, à plusieurs reprises, les salariés ont participé à la privatisation, et leur fierté manifeste d'avoir pris part à cette nouvelle aventure.
Résignation des syndicats
Entre-temps, les chefs syndicalistes, dont la première réaction avait été de voter motion sur motion au cours des conférences annuelles pour appeler à renationaliser sans indemnités, et de faire campagne au sein du parti travailliste pour qu'il s'engage à revenir sur tout ce qui avait été fait, ont fini par se résigner à considérer comme irréversible une bonne partie de ce qui s'était produit. Les nouveaux groupes d'intérêts, constitués aussi bien par les employés que par le grand public, étaient désormais trop puissants pour qu'on les attaque de front.
If you can't beat 'em, join 'em [7]
On peut voir un signe des temps dans la vitesse à laquelle certains syndicats, pourtant en principe si lents à changer de position dans d'autres domaines, ont relevé le défi en changeant d'attitude face à la privatisation. Des quatre syndicats impliqués dans la National Freight Corporation, trois ont fini par soutenir le consortium direction/ouvriers qui avait assuré le passage au privé. Le Syndicat National des Cheminots est devenu actionnaire des Gleneagles Hotels, l'une des entreprises qui gère par le biais de British Rail certains des hôtels anciennement possédés par l'Etat. D'autres syndicats n'ont pas manqué de noter la bonne image que l'attribution d'actions aux employés avait valu à British Aerospace, Amersham International et Cable and Wireless auprès de leurs propres adhérents. Cela n'a pas échappé au gouvernement non plus : la bonne réaction des militants syndicaux à l'occasion de ces premiers exemples de privatisation était un précédent utile, précédent dont il s'est servi par la suite pour obtenir le soutien massif du personnel à l'occasion des ventes de British Telecom et de British Gas.
Y a-t-il une vie après la privatisation ?
Il reste à savoir si les travailleurs, en tant qu'employés, tirent également parti de la privatisation. Qu'ils y gagnent en tant qu'actionnaires ne fait aucun doute. La stratégie micropolitique a consisté en partie à donner aux travailleurs un nouveau statut d'actionnaires-capitalistes afin qu'ils aient le sentiment d'être gagnants, quelles que soient les conséquences de ce nouvel état de fait pour leur première casquette.
En l'occurrence, les premiers résultats sont favorables, malgré les sinistres augures des dirigeants syndicaux, mais l'opération est trop récente pour permettre une évaluation définitive. En termes relatifs, les salaires n'ont pas baissé. En fait, à mesure que les entreprises privatisées tiraient parti de leur nouvelle liberté pour élargir leur marché et accroître leur rentabilité, les employés ont bénéficié d'augmentations de salaire en même temps que des plus-values sur leurs actions.
Les relations de travail ne se sont pas dégradées. Il est frappant de constater que la plupart des grands conflits du travail depuis l'avènement du gouvernement en 1979 se sont produits dans le secteur public. Les entreprises passées au privé n'ont connu aucun accroissement notable des conflits du travail. Il y en a eu dans des entreprises récemment privatisées, dont Jaguar et British Telecom. Ils tendaient à être brefs, et cherchaient à préserver la viabilité de l'entreprise. La règle générale est qu'il y a moins d'affrontements dans le secteur privé, et les nouvelles entreprises se sont conformées à cette règle.
Les dirigeants syndicaux s'alarmaient d'éventuelles réductions d'effectifs après transfert au secteur privé. Associated British Ports, par exemple, sous-traite à présent certains services qui étaient assurés par son propre personnel. Cable and Wireless a procédé à des licenciements, de même que British Aerospace. En revanche, Amersham International et Britoil ont embauché. La privatisation a des conséquences contrastées sur le niveau de l'emploi, la position compétitive étant le facteur le plus décisif. C'est à cette position que les pertes d'emploi chez British Aerospace et Cable and Wireless ont été attribuées, ce qui semble indiquer que le niveau de l'emploi dans les entreprises privatisées est désormais soumis aux disciplines concurrentielles, et qu'il s'y adapte en conséquence.
Des salaires plus conformes aux qualifications
Un effet possible du passage au privé est imputable à un phénomène caractéristique du secteur public, où le pouvoir syndical a souvent pour effet d'écraser les écarts de rémunération entre salariés qualifiés et non qualifiés. En d'autres termes, dans les entreprises publiques, les syndicats font monter le salaire des non-qualifiés — plus nombreux — aux dépens de ceux, moins nombreux, qui ont des qualifications ou des talents particuliers. On pouvait s'attendre à ce que le tir soit rectifié dans le secteur privé. Les entreprises doivent payer davantage les ouvriers qualifiés, sous peine de les voir partir chez des rivaux plus offrants. De ce fait, une fois passées au privé, les entreprises doivent offrir les avantages correspondants à ceux qui ont une compétence particulière. Et c'est exactement ce qui s'est passé8.
Ayant fait du travailleur un capitaliste, la privatisation ménage aussi ses intérêts de salarié
Conclusion : à voir les avantages reçus par les travailleurs, il apparaît possible de mettre au point des politiques qui leur apporteront des profits immédiats en tant qu'actionnaires de l'entreprise, sans mettre en danger les avantages à long terme qu'ils perçoivent en tant qu'employés. En outre, la privatisation s'accompagne souvent de meilleures perspectives d'avancement. Tout cela étant avéré, démontré à profusion par les nombreux exemples de privatisations réussies jusqu'à présent, il n'est guère surprenant que le personnel des entreprises du secteur public ait perçu ce qu'il pouvait gagner à ce qu'on privatise, et qu'il ait le plus souvent coopéré dans ce sens. Là encore, par conséquent, les détails de la politique mise en œuvre ont atteint les résultats visés lors de leur mise au point.
NOTES
Notes du chapitre huit : de la critique à la créativité
- 1 ... même si, dans ce domaine, elle reste sans pouvoir sur les résultats ; le plus fort des Etats du monde n'a jamais été capable d'ériger que des obstacles temporaires contre les faits de la réalité que les salaires et les prix ne font que représenter. Quand ces derniers rompent la digue et déferlent sur les fragiles résistances des prétentions étatiques, ils atteignent bientôt le niveau naturel dicté par la rareté.
- 2 Il s'agissait de privilèges d'exemption fiscale.
- 3 Du nom de Fabius Cunctator, "le temporisateur". La Société Fabienne fut créée par les socialistes anglais à la fin du siècle dernier. Ils voulaient imposer une société communiste, mais le faire par paliers successifs. Beatrice et Sidney Webb et George Bernard Shaw comptaient parmi ses fondateurs.
Notes du chapitre neuf : problèmes, leurres et solutions
- 1 Que cette solution ait pu être envisagée prouve bien qu'il s'agit en fait de service marchands, et que la raison d'être du "service public" est donc purement redistributive. On comprend mal pourquoi une proposition qui voulait supprimer cet aspect redistributif admettait que le service reste entre les mains d'une collectivité publique. La privatisation complète aurait été bien plus efficace à tous égards, tout en n'étant pas politiquement plus difficile à réaliser.
- 2 En France, on parle de "régie" lorsque la fourniture est assurée et administrée par le personnel de la collectivité locale elle-même [N.d.T.].
- 3 Dans le genre : "problèmes de la paix dans le monde" (propagande d'extrême gauche pour un désarmement unlatéral) et autres "problèmes sociaux", "ouverture au monde", "accueil de la différence", etc.
Notes du chapitre dix : détails pratiques
- 1 Il y aura toujours des gens pour dire, au seul vu d'une différence de style, voire de résultats, qu'après tout, si le gouvernement s'en tire mieux, ce n'est jamais que parce qu'il a l'avantage de connaître les échecs du premier. La réponse est que cette supériorité lui aurait seulement permis d'éviter de toucher aux domaines trop sensibles alors que, nous allons le voir, la différence entre les nouvelles politiques et les anciennes ne porte en aucune manière la marque d'une moindre ambition.
- 2 Se servir de la force de l'adversaire pour le déséquilibrer, voilà qui n'est pas sans rapport avec le judo.
- 3 Par contraste, on peut remarquer que s'il existe un marché actif pour des locaux professionnels qui coûtent pourtant fort cher, c'est parce que dans ce cas-là, le preneur à bail se trouve être une personne morale et non un individu, et que les personnes morales, qui ne votent pas et dont les dirigeants ne sont guère plus nombreux que leurs propriétaires, sont beaucoup moins bien placées sur le marché politique pour voler ces derniers.
- 4 Il en est même qui, attribuant sans doute la pénurie de logements à l'opération du Saint-Esprit, à moins que ce ne soit à la "spéculation", se réjouissent du contrôle des loyers dont ils sont les premières victimes, croyant en bénéficier. Subtile et délicieuse justice immanente, qui fait que le candidat voleur est dépouillé et trompé par la mesure même grâce à laquelle il s'imagine voler les autres !
Notes du chapitre onze : la privatisation
- 1 On a observé que la réglementation n'avait aucun effet sur la qualité (ni la sécurité) des produits, n'ayant pour effet que de multiplier les privilèges de monopole qui font monter les prix et les coûts de production.
- C'est évidemment un pur produit du marché politique, la réglementation étant le fait d'un monopole d'Etat : étant ceux qui ont le plus grand intérêt à contrôler la réglementation, les entrepreneurs en place s'arrangent toujours pour la "capturer" elle aussi ; pour qu'elle préserve leurs intérêts et empêche l'entrée de concurrents potentiels. Les bureaucrates acceptent cela, non seulement parce que leur irresponsabilité les dispense de se soucier des vraies conséauences de leurs actes, ni même parce qu'ils seraient corrompus , mais aussi parce qu'une réglementation accrue permet d'accroître leur pouvoir.
- 2 En 1992, il n'en était même plus question, les travaillistes étant revenus à la vieille illusion de John Stuart Mill, suivant laquelle confisquer les revenus ne serait pas équivalent à confisquer le capital. Les électeurs ont eu l'air de ne pas croire à ce "socialisme de marché"-là.
- 3 Le Public Sector Borrowing Requirement ou PSBR, qui était alors un objectif important de la politique conjoncturelle britannique [N.d.T.].
Notes du chapitre douze : et les travailleurs ?
- 1 A noter que, chaque fois que la vente d'une entreprise d'Etat prévoyait de réserver un paquet d'actions au personnel, son taux de souscription a toujours dépassé 90 %.
- 2 Une des conditions de la reprise était que les actions ne pourraient pas être revendues avant deux ans. Ainsi, les salariés se sentaient vraiment tenus d'identifier leurs intérêts avec ceux de l'entreprise lors de la phase de démarrage. Cette obligation vise à accélérer l'évolution des esprits, elle est donc inspirée par l'opportunité "micro"-politique. Car la théorie financière ne permet pas de conclure a priori qu'une entreprise possédée par son personnel soit généralement mieux gérée. Elle rappelle au contraire que le salarié, n'ayant pas intérêt à concentrer les risques, devrait plutôt mettre ses économies ailleurs que dans l'entreprise dont dépend son emploi.
- 3 Il y a des rachats directs par la direction, comme dans le cas de Leyland Bus et de la filiale Unipart de Leyland. Une bonne partie des services de l'ancienne compagnie National Bus vont être rachetés par leur encadrement. Même dans les cas où la direction est seule à mener la danse, on s'efforce d'intégrer les employés en les associant à un enjeu commun.
- Dans bien des cas, les fonds ont été fournis par Unity Trust, qui investit pour le compte des syndicats. Ce n'est certes pas la même chose qu'un actionnariat exercé individuellement par chacun des employés, mais cela permet une prise de participation collective qui neutralise en partie l'opposition politique qu'ils pourraient orchestrer.
- 4 Il est donc normal qu'un grand nombre de rachats directs se soient produits à petite échelle. La première fournée comprenait certains des hôtels de British Rail, qui furent vendus très tôt au cours du processus, et la dernière en date inclut une grande partie des firmes issues du réseau de National Bus.
- 5 Les retraites, bien plus intéressantes que dans le privé, ou le monopole d'embauche par les syndicats étaient quelques-uns des avantages que les syndicalistes avaient réussi à engranger grâce au statut public.
- 6 Le ci-devant Post Office Engineering Union, désormais connu sous le nom de National British Telecommunications Union.
- 7 "Si t'arrives pas à les battre, t'as plus qu'à aller les rejoindre".
- 8 Bien sûr, une fois que la distribution statistique des rémunérations caractéristique du secteur privé a été atteinte, on peut s'attendre à ce que les conventions salariales de ces entreprises s'ajustent aux niveaux du marché.