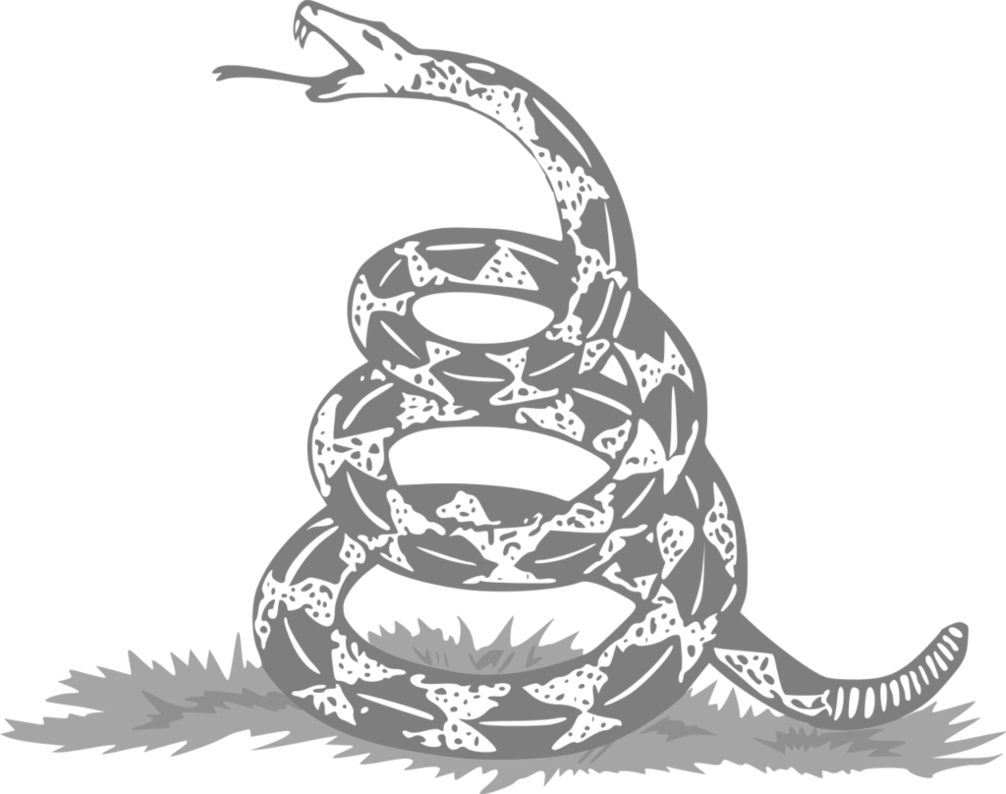La Micropolitique : quatrième partie
La Micropolitique
TROISIEME PARTIE : LA MICROPOLITIQUE
QUATRIEME PARTIE : TECHNIQUES PARTICULIERES
Approfondissements
Il n'y a pas deux privatisations identiques
La privatisation est l'une des techniques de la micropolitique. Pour être plus précis, c'est une gamme complète de techniques, car l'un des faits essentiels de la micropolitique, et qui a sauté aux yeux dès qu'on s'y est mis concrètement, est qu' il n'y a pas deux situations identiques. Nous avons vu que chacune des activités du secteur public possède des caractéristiques uniques, et que toutes posent des problèmes particuliers. On ne peut donc pas se contenter de transposer d'un domaine à un autre une technique qui marche, sans tenir compte des différences. En fait, s'il existe une autre activité que l'on puisse comparer au démantèlement du secteur public, c'est au désamorçage d'une bombe qu'il ressemble le plus. La première chose à faire est d'ôter le couvercle pour examiner les fils. Une fois que vous avez repéré tous les contacts, que vous vous êtes fait une bonne idée du rôle joué par chacun d'entre eux, il vous faut préparer la liste de ceux que vous devrez débrancher, et dans quel ordre. Le but est le même à chaque fois, mais il n'y a pas deux bombes identiques. L'analogie laisse certes à désirer mais, dans les deux cas, vous risquez de tout vous faire sauter à la figure si vous vous y prenez mal.
Ajuster chaque politique à chaque situation concrète
Bien connaître les principes généraux de la micropolitique ne suffit donc jamais au micropoliticien pour résoudre le cas particulier qu'il a en face de soi. Personne ne peut savoir à l'avance quelles méthodes marcheront ; et chaque cas doit être étudié avant d'expérimenter les solutions possibles. Par exemple, malgré les similitudes évidentes, les ventes de British Gas et de British Telecom n'ont pas été conduites dans les mêmes conditions ; dans le premier cas, c'est la totalité des actions qui était mise en vente, alors que dans le second, il n'y en avait que 51 %.
Il n'y a donc pas d'exception au grand principe micropolitique qui exige toujours d'examiner chaque cas individuel ; même lorsqu'il s'agit d'une privatisation. L'analyste doit d'abord se concentrer sur les divers groupes d'intérêt qui tirent avantage du statu quo dans le secteur public. Ce repérage fait, il passe à la formulation de la politique. C'est un exercice d'imagination, exigeant des solutions inédites pour chaque situation concrète, et une politique capable de les traiter. Il arrivera qu'une mesure faite pour ménager les intérêts d'un groupe, en indispose un autre ; il faudra donc veiller à ce que la politique proposée évite ces tensions internes. La politique qui en résulte présente rarement le profil net et élégant d'une belle construction idéologique. Elle a bien plus de chances de grouiller de clauses ad hoc, rajoutées pour tenir compte d'intérêts particuliers.
Variations autour d'un thème
Les privatisations, avec la diversité de leurs techniques et leur raison d'être commune, illustrent bien ces variations autour d'un thème. Ici on vend tout en bloc, là on morcelle. On vend 100% des actions, ou seulement 51%. Qui achète ? Ce peut être une entreprise privée, un consortium salariés-direction ou bien le grand public. On peut vendre comptant ou avec des facilités de paiement. Faire appel à des cabinets d'experts ou non ; recourir ou non à la publicité. Le prix des actions peut être fixé à l'avance ou déterminé au gré de la demande. Jusqu'à présent, on a utilisé diverses variantes de ces méthodes. Il y en a autant que de privatisations1.
On peut aussi privatiser l'activité en facilitant le développement de concurrents privés
Une autre méthode de privatisation consiste à ne pas toucher à l'entreprise d'Etat, tout en ménageant la place pour un concurrent privé. Sans mise en cause directe des producteurs en place, on crée des conditions où les usagers ont un véritable choix. A mesure qu'augmente le nombre de ceux qui exercent ce choix, la part de la production publique décroît.
Une privatisation spontanée par les citoyens
Lorsque c'est cette méthode-là qui est utilisée, c'est le public qui détermine la vitesse et le taux de la privatisation. Les gens privatisent eux-mêmes le service, à mesure que s'accroît le nombre de ceux qui choisissent la solution privée. Ainsi, des lignes d'autocars interurbaines à longue distance, qui ont été déréglementées en 1981, reconnaissant aux entrepreneurs privés le droit d'offrir leurs services en concurrence. Leur arrivée sur le marché a entraîné des baisses de prix spectaculaires sur les billets — dans certains cas jusqu'à un tiers des tarifs pratiqués par le monopole d'Etat, une forte amélioration de la qualité des services et nombre d'innovations en matière de confort. Le public a adopté les services privés dès le premier jour, réduisant ipso facto la part des transports routiers assurés par le secteur public.
Recommandé pour les secteurs "tabous"
Cette technique est recommandée dans les domaines plus sensibles, ceux où le public aimerait bénéficier d'une meilleure qualité de service sans que cela remette en cause l'existence du "service public". La sécurité sociale et la santé sont des candidats évidents, dans la mesure où la population, à tort ou à raison, attache manifestement une grande valeur à la sécurité qu'elle croit découler au financement public [2], aussi inférieur que soit le service dans ces conditions. Quand il encourage le développement des fournisseurs privés sans toucher aux organismes publics, le gouvernement peut créer des conditions qui conduisent la part du secteur privé à s'accroître, à mesure que davantage de gens choisissent d'y avoir recours.
Comment privatiser sans problèmes l'assurance-maladie
Ce phénomène a pris son essor lorsque le Chancelier de l'Echiquier a rétabli pour les bas salaires l'exonération d'impôts sur les régimes d'assurance-maladie privés, financés par l'employeur. Bien que pour le moment le niveau du salaire annuel doive être inférieur à 8 500 livres sterling, et que cette mesure soit encore limitée à des régimes financés par "l'entreprise", cela incite un plus grand nombre de gens à se tourner vers un régime privé. Le nombre des personnes ayant adopté ce système a quadruplé depuis 1979, et comprend des centaines de milliers d'ouvriers syndiqués pour lesquels cet avantage est inscrit dans les conventions collectives.
L'avantage de cette approche est que le système d'Etat, pseudo-gratuit, demeure pour ceux qui en ont besoin ou veulent y avoir recours. Cependant, à mesure que s'accroît le nombre de ceux qui ont recours à la médecine privée, ils déchargent le secteur public d'une partie de son fardeau, lui permettant ainsi de consacrer ses ressources rares à ceux qui en ont vraiment besoin.
Contrairement aux mythes, la privatisation soulage les régimes publics
La micropolitique, donc, se met à la recherche des groupes susceptibles d'être intéressés par la médecine privée. La théorie des choix publics lui indique qu'ils doivent appartenir à la classe moyenne intellectualisée, bien placée pour se faire entendre et faire pression sur le système. En effet, les discours sur la "solidarité" n'empêchent pas qu'en général, dans des circonstances comparables, les gens aisés soient plus entreprenants et mieux organisés sur le marché politique, et coûtent donc plus qu'ils ne rapportent aux systèmes redistributifs d'Etat.
Le micropoliticien va s'arranger pour que le passage au privé de gens politiquement si intéressants en fasse une coalition d'intérêts importante, prête à tout pour défendre les avantages particuliers de ses régimes. Plus on pourra pousser les membres de cette classe à faire ce choix, plus la médecine privée aura de poids, ainsi que les groupes qui se battront pour la défendre. Moralité : il faut trouver tous les moyens pour favoriser le développement d'une médecine (et donc d'une assurance-maladie) totalement privée. Cela peut impliquer d'accroître les dégrèvements d'impôts qui sont encore modestes, ou de développer la déductibilité fiscale des dons aux organismes de santé.
Une liberté qui profite à tous
C'est donc une technique essentielle, notamment lorsque la privatisation directe est politiquement exclue : on favorise le développement du secteur privé en parallèle avec l'offre d'Etat, de manière à ce qu'il crée une alternative qui ne menace pas l'existence du "service public", mais offre au public une véritable possibilité de choix. La politique du gouvernement et l'élévation progressive des exigences de qualité peuvent amener des gens de plus en plus modestes à passer au privé. En outre, chacun ayant le choix, la concurrence contraindra progressivement le système d'Etat à fournir les services que l'on attend de lui.
Les "micro-développements" permettent aux gens de modifier eux-mêmes la situation en prenant leurs propres décisions
L'offre d'un substitut privé à un "service public" est une stratégie micropolitique que l'on désigne sous le terme générique de "micro-développements". Ces stratégies permettent aux gens de modifier eux-mêmes la situation en prenant leurs propres décisions. L'équipe de recherche, par ses propositions, crée une situation où le public est amené à se rendre compte que la liberté du choix est une chose qui compte. Il découvre alors que son avantage est de choisir la solution privée et non le "service public". Ces choix, en s'accumulant, finissent par créer une réalité nouvelle. Les révolutions les plus sûres sont celles que les personnes font elles-mêmes au cours du temps ; celles qu'on appelle des "évolutions".
Reconnaître à tous un Droit qui est aujourd'hui le privilège des riches
Les mesures qui encouragent à quitter le "service public" participent donc de ces "micro-développements". Au cœur d'une stratégie de liberté du choix, on doit trouver des dispositions qui rendront le substitut envisagé plus intéressant parce que meilleur marché, de meilleure qualité, et plus accessible. Cette démarche s'inspire aussi de ce fait essentiel que les gens ont déjà payé le service fourni par les hommes de l'Etat. Si les autres conditions restaient les mêmes, seuls les très riches auraient le choix, ayant les moyens de payer deux fois. La politique mise en œuvre peut faire en sorte, justement, que les autres conditions ne soient plus les mêmes.
La liberté de choix peut être étendue au plus grand nombre si l'on met en place diverses stratégies pour faciliter l'accès à la concurrence et donc encourager les gens à abandonner le service d'Etat. On peut exonérer d'impôts la dépense, l'inclure dans les frais professionnels reconnus, annuler une réglementation monopolistique (on a l'embarras du choix) ; supprimer certains des obstacles qui s'opposent à la fourniture privée, et atténuer certaines des charges qui pèsent sur elle.
On ne règlera pas tout en même temps
Rien de tout cela ne constitue une solution "nette" ; absolument pas. Une politique de libéralisme traditionnel recommanderait certainement de prendre le taureau par les cornes, et entreprendrait purement et simplement de tordre le cou à ce monstre de tyrannie hypocrite qu'est le prétendu "service public". Une telle politique serait vouée à l'échec, parce qu'elle méconnaîtrait tout autant les peurs et les fantasmes des usagers que l'origine des privilèges dont jouissent les groupes de pression dans le secteur d'Etat. En s'attaquant de front au problème, on se mettrait tous les ennemis à dos, et tous en même temps.
Les ennemis en question, le B.A. BA de la stratégie micropolitique est bien entendu de ne pas les affronter tous à la fois. Au contraire, il faut déployer le meilleur de son génie, et une énergie considérable, pour se faire des amis de plusieurs d'entre eux, et passer des alliances avec certains groupes pour contrer l'opposition des autres.
La subdivision des classes permet de rassembler les bénéficiaires, de limiter l'opposition, et de régler une bonne partie des problèmes
On utilise encore une autre tactique innovante pour y arriver, qui passe par la subdivision des classes. Il est courant de considérer les questions à résoudre en termes de larges classes d'activité ou de statut : on parlera donc des "propriétaires", des "locataires" ou des "patrons", et on cherchera des solutions applicables à l'ensemble de la classe concernée. Or, cette approche présente deux inconvénients. Tout d'abord, elle pousse à envisager les choses de façon collectiviste, à considérer l'ensemble d'une classe comme une entité agissante. On perd alors de vue que ce ne sont jamais que des personnes qui décident, et on oublie d'étudier la diversité des conditions du choix de chacun [3]. Par ailleurs, toutes les propositions susceptibles de naître de cette approche risquent d'engendrer l'opposition de vastes groupes, dans la mesure où ceux qu'elles avantagent et pénalisent constituent eux-mêmes des rassemblements importants, ainsi d'ailleurs que ceux qui contestent leurs privilèges. Ainsi des mesures qui favorisent ou soulagent les "propriétaires" risquent-elles de susciter l'hostilité des "locataires", et celles qui "favorisent le 'patronat'" peuvent s'attirer la colère des "salariés", ou des "consommateurs".
La micropolitique a établi qu'on trouvera un avantage à subdiviser ces classes en des groupes plus petits, pour les traiter séparément. Tout d'abord, cette approche réduit l'ampleur des oppositions en réduisant la taille des groupes concernés. Plus important encore, elle identifie les éléments de ces classes qui peuvent poser le problème ou lui fournir sa solution, et ne s'adresse qu'à eux. Alors que la macro-analyse traitera des grands groupes, la micro-analyse va donc procéder à une étude plus pointue en s'intéressant aux sous-sections de ces groupes, pour voir où se trouve le problème et comment il pourrait être résolu.
Comment ça marche
Prenons un exemple : la pénurie de logements locatifs privés peut devenir un problème aigu. Bien entendu, elle est causée par le contrôle des loyers, associé à un maintien total dans les lieux. En théorie, rien ne devrait donc empêcher de résoudre le problème en s'attaquant à l'ensemble de la classe du logement locatif privé. Mais en pratique, l'opposition de tous les locataires et de tous les groupes qui les soutiennent est assez puissante pour bloquer cette tentative. Une analyse plus fine reconnaîtra que c'est l'absence de nouveaux logements à louer qui cause une bonne partie des difficultés. Elle sera donc prête à envisager une subdivision de la classe, afin de réserver un traitement particulier aux "nouveaux propriétaires". Elle pourra montrer que le problème pourrait être réglé si les propriétaires d'une ou plusieurs résidences secondaires pouvaient être persuadés de les louer, et proposera alors que l'on crée une sous-catégorie des "petits propriétaires", avec ses règles et ses immunités particulières.
De même, les entreprises sont considérablement gênées par les impôts et charges pesant sur elles, qui découragent le développement et la création des emplois. Une bonne partie de l'effort qui pourrait aller à la production est stérilisé par ces contraintes, et les emplois sont créés en quantité insuffisante.
La macro-analyse le sait depuis longtemps, et elle propose en conséquence de réduire les impôts et d'alléger les réglementations. Ce serait une solution excellente si elle était possible, mais elle implique souvent une confrontation majeure avec des groupes nombreux et puissants. Elle a donc peu de chances de réussir, vu l'état des marchés politiques régnants. La micro-analyse, de son côté, a permis de découvrir que le fardeau pèse relativement plus lourd sur les petites entreprises, parce qu'elles n'ont ni le personnel ni les ressources qui permettent aux grandes d'y faire face. Par ailleurs, dans une économie, les nouveaux emplois sont créés dans une proportion écrasante par les entreprises les plus petites. La solution micropolitique pourra consister à reconnaître une nouvelle catégorie, celle des "petites entreprises", que l'on traitera à part puisqu'elles pâtissent plus gravement du problème et peuvent fournir la solution. On pourrait par exemple proposer des conditions spéciales pour les sociétés employant moins de vingt personnes. Ce faisant, on ne s'attirera pas l'hostilité globale qu'aurait suscité une refonte totale des lois imposées aux sociétés commerciales.
Traiter avec des sous-classes a deux conséquences : les groupes d'opposants seront également divisés, et il sera plus facile de se concentrer sur l'origine du problème et les moyens de la solution. La micropolitique envisage donc par principe de créer de nouvelles distinctions pour des sous-classes de groupes plus importants, et pour lesquelles des mesures spéciales seront prévues.
Une démarche plausible
Tout cela n'est en rien aussi tiré par les cheveux qu'il y paraît. Pour le micro-analyste, il est évident que la boutique du coin, avec ses deux employés, ne rencontre pas les mêmes problèmes que la chaîne de grands magasins avec ses vingt mille salariés. Si l'application des règles destinées aux grands magasins cause des charges excessives aux petits, il semble raisonnable de reconnaître cette différence, et de les traiter en conséquence. Il y a manifestement quelque chose qui cloche si les lois destinées à protéger les ouvriers d'usine obligent le petit entrepreneur n'ayant qu'un assistant à passer son temps à vérifier la température ambiante ou la taille du siège des toilettes, au lieu de s'employer à accroître ses ventes et à créer davantage d'emplois.
Inconvénients et avantages de la multiplication des seuils
Cette attitude appelle deux questions. La première concerne les distinctions à créer : si l'on réserve un traitement particulier à des catégories particulières, cela produit un effet de dissuasion au moment de franchir le seuil, qui décourage les gens de passer d'une catégorie à une autre. Si les petits propriétaires font l'objet de mesures spéciales, il n'est peut-être pas dans leur intérêt d'en devenir des gros. Si les entreprises de moins de vingt salariés reçoivent un traitement spécial, elles ne chercheront pas à embaucher le vingt-et-unième. C'est exact, mais cela ne change rien sur le fond. Subdiviser les classes crée certes des frontières, mais ce qui change, c'est que les barrières ont été déplacées, et que l'on a divisé un gros obstacle en plusieurs petits. Pour un entrepreneur, c'est toujours un pas important à franchir que d'embaucher son premier salarié. Une subdivision créant une catégorie des "petites" entreprises réduit l'importance de l'effort impliqué, même si elle crée un autre obstacle, quoique moindre, à franchir plus tard. Au lieu que l'entreprise soit confrontée d'un coup à toutes les difficultés, la subdivision les lui fait rencontrer progressivement à mesure que sa taille augmente.
Cela dit, les micro-analystes qui proposent ces réformes dépensent des trésors d'ingéniosité pour atténuer l'impact éventuel des effets de seuil. Ils sont constamment à la recherche de propositions inédites pour abaisser les barrières entre catégories. Une des choses que l'on espère, évidemment, c'est que la déréglementation et l'allégement des charges rapporteront tellement à leurs bénéficiaires que le passage à l'étape suivante en sera facilité. Bien que les premières initiatives se limitent à ces sous-classes afin de circonscrire les oppositions, et de n'attaquer le problème que là où il est le plus aigu, on peut espérer qu'un succès incitera d'autres sous-groupes à réclamer un traitement équivalent, et que l'hostilité à leur extension sera en partie désarmée par le spectacle de leurs résultats concrets.
Doit-on refuser de libérer certains parce que les autres restent captifs ?
L'autre objection est qu'il n'est pas juste de créer des catégories particulières pour leur distribuer des exemptions. S'il est bon d'alléger les charges réglementaires et fiscales, alors il faut que tout le monde en profite. Peut-être, mais la question est de savoir s'il est vraiment possible de le faire pour tout le monde. Si la réponse est non, parce que les groupes de pression s'y opposeront avec succès, il faut alors se demander s'il ne vaut pas mieux le faire pour quelques-uns que pour personne. Le micro-analyste suggère qu'en fait il est préférable de commencer par ces quelques-uns-là, a fortiori si l'on peut résoudre la plus grande partie du problème en ce faisant. Il y a toujours ce bonus supplémentaire qu'en réussissant pour certains aujourd'hui, on facilite la chose pour les autres demain.
La politique du pire
Pour être juste, il faut reconnaître qu'il existe un raisonnement de type macro-politique pour lequel distribuer des exemptions à des catégories réduit en fait la probabilité que la mesure puisse être étendue à tous. On soutient que si l'essentiel du problème est réglé par une discrimination savante, on réduira la pression qui aurait pu conduire à une solution globale. En revanche, si on laisse se détériorer la situation au maximum, on entretient la pression qui finira par rendre la réforme inévitable pour l'ensemble. Le principe logique de cette position est qu'il faut éviter l'amélioration, parce qu'elle empêche d'obtenir la perfection. C'est la politique du pire, consistant à ne rien faire jusqu'à ce qu'arrive le Grand Soir, le jour où l'on pourra résoudre tous les problèmes à la fois. Cela n'a guère de rapports avec le monde réel, où toute amélioration est progressive, et où les problèmes que l'on n'a pas traités continuent indéfiniment à s'envenimer. Adam Smith le remarquait déjà, il y a "beaucoup de ruine dans une nation".
L'"expérience" limitée
Il existe une tactique comparable au découpage des catégories : elle consiste, plutôt que de distinguer selon le statut social, à faire des classifications spatiales. C'est le principe de l'expérience à petite échelle. Etant donnés les remous et l'opposition que provoque toute tentative de déréglementation, on propose d'"expérimenter" l'idée sur une zone limitée pour en observer les effets. Si les catastrophes annoncées se produisent, alors on se passera d'élargir l'expérience à l'ensemble de la société. En revanche, si les avantages dépassent de loin les inconvénients, ces mesures pourront être appliquées à plus grande échelle.
Montrer une réalisation concrète
C'est ce type d'approche qui a conduit à des innovations comme les zones d'entreprises et les zones franches dans les ports. Le fait est qu'un milieu déréglementé, comme l'affirment ses partisans, peut tout à fait encourager l'entreprise productive et permettre la création de richesses et d'emplois. Cependant, beaucoup craignent d'être précipités dans l'inconnu si la main de la réglementation n'est plus là pour guider leurs activités. La zone spéciale est précisément là pour en faire l'expérience. Une fois ses résultats connus, on n'aura plus besoin d'en débattre au niveau théorique ; on aura une application pratique à quoi se référer.
Un projet qui séduit les élus locaux
En outre, ces expériences trouvent facilement leur place dans le tissu politique parce qu'elles offrent des privilèges spécifiques à des régions données. Comme toujours, ceux qui attendent ces avantages se battront mieux que ceux qui auront à les concéder. De la sorte, les zones susceptibles d'être désignées pour l'expérience formeront un groupe de pression actif au service du projet. La proposition de ports francs en Grande-Bretagne fut suivie par quarante-six candidatures de localités, chacune défendant le projet dans l'espoir de figurer parmi ses bénéficiaires particuliers. Des représentants locaux élus de tous les partis appuyèrent les candidatures de leur propre région, illustrant une fois de plus la prépondérance de l'intérêt sur l'idéologie.
Encore une fois, il n'est pas possible de généraliser immédiatement les principes mis en œuvre, si excellents soient-ils
Dire que c'est à l'ensemble du pays qu'il faudrait donner le statut de port franc ou de zone industrielle, c'est sortir des limites du raisonnement. Car la réalité des faits est que ce statut-là, le pays n'est pas près de l'avoir. Les expériences à petite échelle ont une chance de réussir, alors que la proposition globale, au niveau "macro", n'en a aucune. Ces petites zones expérimentales, si elles réussissent, peuvent conduire les autres à donner de la voix pour qu'on les traite de même, créant de fait un groupe de pression en faveur de la déréglementation.
L'effet différentiel
Il existe cependant des objections plus sérieuses. La première est que les expériences ne seraient pas valables sur une petite échelle parce qu'elles joueraient sur un effet différentiel. A savoir, qu'elles attireraient un surcroît d'activité grâce aux avantages spécifiques qu'elles offrent à l'intérieur de leur périmètre, mais que cette croissance se ferait aux dépens des autres endroits. C'est vrai dans une certaine mesure, et il importe de savoir dans laquelle. Il est certainement exact que les zones d'entreprises ont attiré des activités qui se seraient implantées ailleurs. Comme elles leur offrent un allégement des impôts locaux et une simplification réglementaire, ainsi que d'autres stimulants, il est plus avantageux pour certains types d'entreprises de développer leurs activités dans ces zones que dans leur région d'origine. Deux exemples sont les hypermarchés, qui ont eu tendance à s'y installer, et les imprimeries, déjà planifiées, et qui ont choisi de s'y installer plutôt qu'à l'endroit prévu.
La tendance est moins forte pour les zones franches portuaires, à cause de leur rôle particulier dans la promotion du commerce extérieur. En effet, les ports francs sont là pour attirer des emplois qui, autrement, s'installeraient à l'étranger. Toutefois, dans les zones d'entreprises comme dans les ports francs, il faut doubler l'expérience par une recherche du nombre d'emplois nouveaux qui ont seulement été "attirés" par l'effet différentiel. L'expérience britannique donne à penser qu'une forte proportion, en gros 'la moitié, des nouveaux emplois dans les zones industrielles ne seraient pas vraiment nouveaux (ce rapport ne s'appliquant pas au très petit nombre d'emplois créés dans certaines des zones portuaires). Ces résultats, même si on est conduit à les nuancer, laissent toutefois un gain net d'emplois dû au climat d'allégement des réglementations. Cela donne bien l'idée que l'on pourrait créer davantage d'emplois en déréglementant sur une plus large échelle.
Une illusion pour une fois bénéfique
S'il est prouvé que l'intervention de l'Etat est destructrice nette de richesses et d'emplois, alors l'effet différentiel de l'expérience locale ne fait que retourner dans le bon sens un type d'illusion qui joue généralement en faveur de l'étatisme, et donc contre l'emploi et la richesse. En effet, lorsqu'un privilège de subvention ou de monopole est accordé dans un domaine particulier, il semble y développer l'embauche, la production et la richesse, alors qu'il les détruit bien davantage ailleurs.
La règle générale, dans une économie mixte, est que la plupart des gens voient bien les avantages de l'action étatique, alors que ses inconvénients leur demeurent cachés.
L'un des buts de la micropolitique est justement d' inverser ce mécanisme en créant des situations où ce sera la liberté du choix dont les avantages sont mis en valeur. Quant à ces avantages, que les circonstances conduisent parfois à les surestimer, c'est pour ainsi dire de bonne guerre, et cela facilite la libéralisation.
Retourner au profit de la liberté la myopie naturelle des acteurs de la politique, qui profite ordinairement à l'étatisme, est donc un mécanisme fondamental de la micropolitique, et la distribution de privilèges d'exemption est une technique privilégiée pour ce faire.
A-t-on suffisamment pris en compte les intérêts de la bureaucratie ?
Une objection plus grave concerne la micro-analyse elle-même. Il se peut que l'on n'ait pas suffisamment tenu compte de la bureaucratie en tant que groupe d'intérêts. Alors que les expériences menées peuvent mobiliser le soutien des élus locaux tout en ne dérangeant pas assez d'intérêts pour rassembler une opposition de quelque ampleur, on n'offre pas assez de contreparties aux hommes de l'Etat censés superviser ces expériences. Il en résulte que, lorsque l'Administration fera connaître leurs modalités d'application, celles-ci tendront à les faire rentrer dans le moule conventionnel au lieu de leur laisser défricher le terrain.
Cette remarque explique d'ailleurs largement ce qui s'est effectivement passé pour les zones d'entreprises et les ports francs. Les premières étaient censées devenir des zones libres de toute réglementation et restriction ; à la place, l'Administration les a traitées comme des appendices de sa politique régionale, les transformant en îlots de subventions et non en zones d'exemption. Les ports francs ont été encore moins bien lotis, entravés à tout bout de champ par des fonctionnaires du Trésor bien déterminés à les soumettre au cadre réglementaire existant, et à n'autoriser aucune dérogation.
S'il en est ainsi, et il faut bien dire que bon nombre d'exemples le prouvent, ces tentatives particulières sont fortement compromises. En revanche, cela ne mettra pas en cause le principe des expériences localisées à petite échelle. Cela renverra simplement leurs partisans à leur table de travail, pour chercher de nouvelles politiques capables de surmonter ou de circonvenir l'opposition bureaucratique, tout en déjouant l'opposition des autres groupes.
Il est plus facile de changer les choses en petit
Le principe qui inspire les expériences géographiques limitées et le découpage des catégories, est qu'il est moins difficile de changer les choses à petite qu'à grande échelle. L'action sur des espaces ou des groupes limités s'adresse à des minorités, et c'est un axiome fondamental de la micropolitique que les minorités ont davantage de pouvoir que les majorités. Nous savons qu'elles savent bien plus vite comprendre l'enjeu et en estimer la valeur, que ce dont le reste de la population sera privé pour financer cet avantage sera toujours moins bien défendu et moins intéressant comme enjeu d'un engagement politique. Par conséquent, tout privilège particulier, qu'il s'agisse d'une déréglementation ou d'un allégement des charges, est plus facile à obtenir pour des groupes expérimentaux.
En Droit, ces distinctions sont arbitraires ; la micropolitique n'en sait pas moins où les placer
On espère bien sûr qu'une fois ces têtes de pont établies, il sera possible d'élargir l'offensive. Ce qui prête à la critique, à savoir que le choix de la limite à fixer est arbitraire, peut devenir une vertu. C'est vrai qu'elle est arbitraire. Ce qui est "considéré comme" une "petite" entreprise peut compter moins de vingt salariés ; mais il pourrait aussi bien s'agir de dix, vingt-sept ou cinquante. Du point de vue de la justice, la sélection d'une limite par la micropolitique n'est pas moins arbitraire et indéfendable que n'importe quelle réglementation étatique. Elle n'en a pas moins sur cette dernière l'absolu avantage de s'inspirer de deux considérations qui vont, elles, dans le bon sens, et lui fournissent ses normes.
Les normes du découpage : résoudre le problème, limiter l'opposition
Tout d'abord, elle est choisie en fonction de sa capacité à résoudre le problème. Si une proportion significative des nouveaux emplois sont créés par des entreprises de moins de vingt salariés, et si l'on constate un saut visible entre la contribution de ce groupe et celle des autres, alors il y a de bonnes raisons pour fixer à vingt la frontière initiale. Si des études montrent que 80 % de l'offre supplémentaire de logements locatifs privés viendra vraisemblablement des propriétaires de moins de cinq logements, c'est une raison a priori pour délimiter la catégorie des "petits propriétaires" de telle sorte qu'elle comprenne ceux qui correspondent à ce critère. En d'autres termes, la première sélection est empiriquement assise sur la capacité qu'a le groupe choisi de contribuer à la solution du problème.
Le second critère pour choisir la taille du groupe est le nombre envisageable de ses adversaires. Si, en accordant des exemptions particulières aux entreprises de moins de trente employés, on a bien plus d'ennuis que si on donne les mêmes avantages à celles qui en ont moins de vingt, la prudence recommande d'opter pour le chiffre le plus bas. Un critère semblable est applicable pour choisir qui appartiendra à la catégorie des "petits propriétaires". Aucun des deux n'a rien à voir avec la justice. Bien au contraire, le postulat de départ est que le système tout entier est injuste. Toute injustice éliminée est donc une amélioration. Pour déterminer le maximum qui peut être obtenu à chaque tentative, on s'en remet à l'enquête empirique, à partir des deux critères cités.
L'arbitraire des seuils est un bon prétexte pour desserrer les contraintes
En outre, le fait que ces seuils sont arbitraires peut être transformé en avantage. Une fois que les catégories ont été "reconnues", que les avantages du traitement particulier ont été empochés et que tout le monde a pu voir qu'ils venaient de la réforme, il n'y a aucune raison pour ne pas déplacer la borne. La réussite du procédé suscite d'elle-même les revendications du groupe limitrophe : "pourquoi eux et pas nous ?" Ainsi peut-on procéder par extension progressive des limites du groupe, jusqu'à accorder l'exemption privilégiée à bien plus de catégories qu'il n'était possible au départ. Si les critères de séparation sont effectivement arbitraires... alors rien n'empêche de les changer.
Ce souci de tenir compte de la situation concrète, qui commande à la sélection des groupes à privilégier par voie d'exemption, se retrouve dans l'ensemble des techniques étudiées dans cette partie de l'ouvrage. Tout comme le choix de la taille du groupe est déterminé par sa contribution prévisible à la solution du problème et le désir de maintenir le nombre des opposants à un niveau gérable, le choix des zones géographiques expérimentales, leur nombre et leur taille, sont déterminés sur des critères analogues.
Les contraintes financières
Si l'on veut encourager les gens à quitter le secteur d'Etat pour favoriser le développement des remplaçants privés, il faut aussi estimer l'ampleur des incitations nécessaires pour atteindre cet objectif. Les exemptions fiscales impliquent normalement des pertes de recettes, de sorte qu'il faut calculer en regard le niveau d'économies que l'on peut atteindre si les services de l'Etat n'ont plus à pourvoir aux besoins d'un nombre donné de personnes. Encore une fois, le calcul est empirique. Le calcul doit être fait de ce qu'on économisera si, par exemple, dix pour cent des gens optent pour une médecine purement privée, en regard de ce que coûteront toutes les concessions nécessaires pour tenir ces dix pour cent à l'écart du "service public".
Une bonne partie de ces calculs n'auront aucune expérience à quoi se référer, et devront s'en remettre à des conjectures assises sur des études de marché. Il n'y a pas de manière précise de déterminer le nombre de gens qui choisiront une solution privée pour une incitation donnée, avant qu'on la leur ait effectivement offerte. L'estimation peut se fonder sur des enquêtes d'intention, mais personne ne peut dire lesquelles de ces intentions affichées se transformeront en passages à l'acte. Néanmoins, pour obtenir l'accord d'un gouvernement qui cherche à instituer un régime de responsabilité budgétaire, on peut être contraint de ne proposer que des réformes qui soient au moins fiscalement neutres. Les stimulants devront alors être définis de manière telle que les économies obtenues soient supérieures aux coûts. Et cela, c'est une question de calcul pratique.
Le système est bel et bien clair et cohérent
Si quelqu'un avait pu penser que les éclairages apportés par l'école des choix publics permettaient de bâtir un système politique clair et cohérent, il commence peut-être à déchanter. Et pourtant, il aurait tort de le faire. Si l'on a bien compris ce qui précède, le système est bel et bien clair et cohérent. Seulement, les politiques qu'il engendre n'en présentent pas normalement l'aspect. Le critère consiste à soupeser les avantages, pour mettre au point des politiques offrant des avantages suffisants en échange de leur acceptation.
Les privilèges dont jouissent les groupes d'intérêt sont comparables aux antigènes, ces groupes de protéines saillant à la surface des corps étrangers qui ont pénétré dans le sang. La bonne manière de traiter ces groupes d'intérêt consiste, comme les anticorps qui s'attaquent aux envahisseurs, à sécréter une politique exactement adaptée à leurs caractéristiques, afin de les neutraliser. Chacune d'entre elles peut présenter un aspect bizarre, sembler avoir été construite de bric et de broc ; mais son unité essentielle est visible dans ses méthodes de construction, et dans les principes auxquels sa mise en œuvre est soumise.
Le rôle de la liberté du choix
L'uniformité des services "publics"
Quand il s'agit de fournir des services plutôt que des objets, le secteur public est résolument tourné vers la production d'un objet standardisé. L'uniformité prime, et la diversité n'est pas de mise. C'est d'ailleurs bien à cela qu'on doit s'attendre, étant donnés sa nature et son statut. Les décisions concernant la nature des services à fournir, et dans quelle mesure, sont largement politiques. Celles-ci dépendent en partie des crédits disponibles, eux-mêmes étant déterminés par la dépense que les dirigeants politiques jugent le public disposé à supporter.
Cette dernière norme n'a évidemment rien à voir avec ce que les gens dépenseraient d'eux-mêmes si la décision était vraiment la leur . Elle peut être influencée par la situation économique du pays, laquelle peut, à son tour, résulter pour une part d'événements internationaux. Les dirigeants politiques peuvent se tromper ; sous-estimer ce que les gens dépenseraient d'eux-mêmes ou, au contraire, y mettre un chiffre trop élevé, reflètant leur propre échelle de valeurs et non celle des autres.
Nous avons vu que le secteur public tend à surproduire, l'inadéquation de la qualité pouvant agir dans l'autre sens. Si l'on y ajoute les effets de la capture par les producteurs, des sureffectifs et de la sous-capitalisation, le consommateur est quasiment exclu de la définition du service, sauf de manière ténue et diffuse par le biais du processus politique.
Un service défini pour le confort des hommes de l'Etat
Dans un tel système, les producteurs trouvent à leur convenance d'offrir un service uniforme destiné à la grande majorité, et qui correspond rarement à ce que la majorité elle-même aurait spontanément choisi. En fait, il n'y a aucune raison pour que la quantité ou, a fortiori, la qualité décidée par les hommes de l'Etat corresponde aux préférences, nécessairement diverses, de chacun des millions d'usagers. Rien ne permet donc de penser que la fourniture "publique" corresponde à ce qui résulterait d'un choix responsable.
C'est le nombre qui compte
Une constante observable du marché politique est que les administrations d'Etat préfèrent ordinairement fournir un petit service au plus grand nombre plutôt qu'un service important à peu de gens. Le secteur public recherchant des suffrages et non des bénéfices, ce sont d'abord les têtes que comptent ses services. Sur le marché politique, ce qui rapporte des voix c'est un service, même petit, qui vise l'ensemble du groupe bénéficiaire, alors qu'on en gagne moins à concentrer sur quelques-uns un service plus important.
Dans notre système de santé, par exemple, environ neuf transports par ambulance sur dix sont classés "non urgents". Cela veut dire que des gens qui pourraient utiliser les transports publics, ou les leurs propres, se font offrir des petits tours en ambulance. On ne fait rien payer au moment du transport, et cela représente un petit service offert à un grand nombre de personnes. En revanche, le service d'ambulances manque d'un grand nombre d'équipements d'urgence, nécessaires pour sauver des vies. Ses véhicules ne sont pas équipés pour traiter les urgences cardiaques ni les traumatismes graves. D'autres pays, avec des procédures de financement et des marchés politiques différents, possèdent pour leur part des véhicules bien équipés, même s'ils ne consacrent pas autant de ressources à organiser des promenades en taxi aux frais de la Princesse.
Le "service public" est tout différent d'un véritable service rendu au public
Or, lorsque les gens choisissent eux-mêmes les services qu'ils sont prêts à payer, on observe qu'ils choisissent des services tout à fait différents. Les décisions auxquelles ils accordent vraiment le soin de la réflexion, notamment lorsqu'ils ont la liberté de dépenser eux-mêmes leur argent, traduisent un écart considérable entre le "service public" et ce qui serait un vrai service rendu au public.
Par exemple, lorsqu'il existe une concurrence au "service public", même hors de la portée de la plupart des gens, on peut trouver intérêt à observer ce qu'elle offre à ses clients, et qu'ils jugent digne d'être payé [1].
Dans le domaine de la santé, par exemple, c'est surtout la possibilité d'être soignés au moment où ce sont eux, les patients, qui le souhaitent et non quand cela arrange le personnel. Choisir le moment du traitement arrive en tête des priorités de ceux qui se tournent vers la médecine privée.
On cite ensuite le souci de la personne. Pour éviter d'avoir l'impression qu'on les traite comme des saucisses dans une énorme machine à fabriquer des saucisses, les patients, quand ils sont également clients, se paient un traitement plus personnalisé.
En troisième position viennent les petits conforts tels qu'une plus grande intimité, les hôpitaux au service du patient, et la plus grande dignité que la médecine privée parvient à accorder à ses clients.
Dans l'enseignement, ce qui pousse les parents à rechercher une solution payante est l'incapacité du système d'Etat à fournir ce qu'ils veulent. L'attention personnelle que chaque enfant est censé recevoir dans le secteur privé est citée comme la raison pour laquelle les parents acceptent de payer deux fois, rejetant l'enseignement d'Etat qu'ils ont pourtant déjà entretenu avec leurs impôts. L'impression dominante est que, dans le système public, les enfants sont davantage livrés à eux-mêmes. On juge que c'est une question de chance s'ils y obtiennent un enseignement acceptable. S'ils vivent auprès d'une bonne école ou héritent un bon professeur, ils s'en tireront. Autrement, c'est la roulette.
Les solutions privées sont réputées laisser moins de place au hasard, et s'efforcer de tirer le meilleur parti de l'enfant. Si c'est bien le cas, on comprend que les parents soient disposés à payer.
Par ailleurs, si les parents choisissent les écoles privées, c'est parce qu'on y donne l'éducation à laquelle ils tiennent, et non ce qui plaît aux "pédagogues" professionnels. Le secteur privé ne pratiquant pas la capture par les producteurs, ceux-ci n'y imposent pas leurs propres valeurs. Ainsi l'enseignement privé épargne-t-il aux parents l'impression que l'on traite leurs enfants comme des cobayes : il leur semble au contraire qu'on leur enseigne les disciplines fondamentales qu'ils désirent leur voir acquérir.
Une solution "moyenne" ?
On a parfaitement le droit de penser a priori que si les services d'Etat choisissent une production uniformisée, c'est parce que la plupart des gens veulent des produits relativement semblables (et que c'est ce qui est bon pour eux). Quiconque a des exigences particulières extraordinaires peut toujours se tourner vers une solution privée ; en attendant, la majorité n'a qu'à se contenter de ce que produisent les hommes de l'Etat. C'est un point de vue licite mais pas nécessairement exact, et il est sans aucun doute difficile à prouver (en supposant que ses tenants soient sincères). Si les gens peuvent obtenir la couleur de leur choix à condition que ce soit du noir, on aura de la peine à savoir s'ils ont des préférences pour d'autres couleurs.
Les choix effectifs réfutent la définition des "besoins" par les hommes de l'Etat
Or, ces préférences-là, les faits disponibles donnent en tous cas à penser qu'ils les ont bel et bien. Tout d'abord, dans le secteur privé, les gens choisissent spontanément une grande variété de services et de biens. Il semble n'y avoir aucune limite à la mesure dans laquelle un bien ou un service peut être personnalisé à l'intention des acheteurs, à part peut-être la capacité du producteur à s'adapter.
Deuxièmement, là où les "services publics" ont été ouverts à la concurrence, il est apparu une profusion d'offres diverses à la disposition des consommateurs et cette multiplicité du choix, les consommateurs ne l'ont certes pas boudée. Au temps où le service du téléphone était un monopole, être abonné c'était payer tous les trois mois la location d'un machin en bakélite noire avec le cadran qui tourne et un louque résolument années trente, le côté arts déco en moins.
Avec la privatisation et l'arrivée de la concurrence, les choix ont proliféré. On avait eu beau jeu d'affirmer que la plupart des abonnés se contenteraient de leur bon vieux téléphone noir standard. Or, ce qu'on a vu, c'est qu'ils préféraient les appareils à touches, les téléphones sans fil, les trucs multicolores ou avec la tête de Mickey. Tout ce que l'on a pu apprendre, aussi peu qu'on en sache, va dans un seul sens : lorsque l'on donne aux gens l'occasion de choisir, c'est la variété qui l'emporte.
La micropolitique va personnaliser les "services publics"
L'une des missions essentielles que la micropolitique s'est donnée est de "personnaliser" les "services publics". Il s'agit de transformer une production d'Etat, uniforme et dominée par les producteurs, en toute la gamme des choix individuels dont les gens aimeraient bien disposer pour satisfaire leurs besoins propres. On va "personnaliser" le service en subdivisant une production fondamentalement homogène en une riche palette de variétés conçues pour répondre aux préférences des consommateurs particuliers. Cela implique d'y introduire à la fois la variété et la liberté du choix. Pour ce faire, deux méthodes sont possibles : ou bien on réorganise les forces qui déterminent la production pour qu'elles court-circuitent complètement le processus politique et se plient exclusivement à la contrainte économique des consommateurs, ou alors on modifie le processus politique lui-même de sorte qu'il récompense ceux qui auront satisfait les préférences individuelles. Vaste programme.
Se passer du "service public" dépasse l'imagination de la plupart des gens
Une caractéristique de la fourniture par le secteur public, quand il exerce un quasi-monopole pour la plupart des gens, est qu'au bout d'un certain temps, il devient difficile de se rendre compte que l'on pourrait parfaitement s'en passer. En Grande-Bretagne, la perspective de vivre sans médecine et sans enseignement d'Etat est littéralement inconcevable pour la plupart des gens. Non pas que ce serait une catastrophe, mais parce que c'est tout simplement l'inconnu. N'ayant jamais vu fonctionner ce qui pourrait les remplacer, les gens n'imaginent même pas que cela puisse exister. Pour eux, la question est de savoir comment le "service public" pourrait être amélioré ou modifié afin de mieux répondre à leurs besoins. L'idée de lui donner un remplaçant ne trouve absolument aucune place dans leur imagination.
A peine moins difficile à traiter est l'accoutumance au monopole public. Même lorsqu'ils ont conscience de certains de ses inconvénients, les gens lui trouvent des avantages irremplaçables, et refusent de les voir remettre en cause. Une médecine d'Etat, cela semble promettre qu'on ne refusera à personne de le soigner sous prétexte qu'il est pauvre, et qu'aucun traitement ne ruinera le patient, aussi catastrophique que soit son état médical [2].
L'enseignement universel d'Etat prétend que tous les enfants ont "droit à la scolarisation'", quelles que soient les ressources de leurs parents. Les histoires d'enfants perdant leurs chances parce que leurs parents n'avaient pas les moyens, tout cela, affirme-t-on, appartient à un passé heureusement révolu [3]. Une fourniture d'Etat payée par l'impôt et la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans sont censés assurer une instruction de base, pour laquelle les parents n'ont pas à débourser grand-chose.
L'argumentation rationnelle ne peut convaincre qu'une petite élite
On ne peut pas traiter ces valeurs avec légèreté. Elles sont sincèrement crues, ainsi que celui qui tente de les réfuter ne tarde pas à s'en rendre compte. Les gens apprécient vraiment la sécurité promise par le service médical "gratuit". Ils voient les avantages d'une place "gratuite" à l'école pour leur enfant. On perd son temps à leur représenter que la sécurité sociale doit nécessairement s'effondrer si elle reste un monopole public, et que la bureaucratie soviétoïde de l'enseignement ne peut que compromettre l'avenir des enfants. Cela ne sert à rien de leur dire qu'en réalité les services ne sont pas gratuits, qu'ils les ont bel et bien payés par le biais des impôts, en l'absence desquels ils auraient donc forcément les moyens de se les offrir à titre privé : ce n'est pas ainsi qu'ils perçoivent la chose. La plupart des gens font le compte de ce qui leur reste après les dépenses indispensables, et concluent qu'il ne leur resterait rien pour des services privés s'ils devaient les payer. Le système d'imposition reste abstrait pour eux, parce que la plupart pensent en fait que les services leur sont offerts par "l'Etat", et que l'argent qui les alimente, croient-ils, est d'abord pris aux autres.
Le fait qu'ils ont tort n'est pas ce qui importe ici ; ils croient que c'est vrai. La réalité est totalement différente, c'est entendu. Non seulement ce sont eux qui paient les "services publics", mais — justice immanente pour ceux que cela ne gênerait pas de vivre par la force sur le dos des autres — ils les paient très cher pour ce qu'ils valent. Le secteur public est un poids lourd administratif, détestable dans la gestion de son personnel, et inefficace dans sa manière d'utiliser les équipements et la technique. Il y a 'toutes les chances pour que le service uniforme que la plupart des gens reçoivent de l'Etat leur coûte personnellement plus cher qu'un équivalent dans le secteur privé, qui aurait en plus la variété et le souci de s'adapter à leurs besoins et exigences particulières. Tout cela est vrai, cent fois vrai ; mais la réalité qu'il faut voir en face, c'est que les gens ne perçoivent pas les choses ainsi. L'illusion accompagne le gaspillage à tous les niveaux. C'est une conséquence nécessaire du fonctionnement des marchés politiques.
Le micropoliticien doit accepter ces réactions comme des données de fait. Alors qu'il sera éventuellement possible de les faire évoluer dans le long terme, elles s'imposent à la réalité actuelle, et on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. Il est théoriquement possible que l'on finisse par modifier ces attitudes, et qu'un programme d'éducation civique à long terme puisse persuader les gens de les abandonner, et de se lancer joyeusement sur les terres inexplorées de la liberté des choix. Personne ne sait si un tel projet réussirait ni combien de temps il prendrait. En revanche, nous sommes payés pour savoir quelle est la force d'un intérêt, comparée à celle d'un principe.
Ayant compris que les institutions entretiennent des illusions invincibles, le micropoliticien se propose de les amender de manière telle que les gens soient d'eux-mêmes amenés à ouvrir les yeux
Une fois de plus à rebours de la pensée conventionnelle, l'analyse micropolitique affirme qu' il sera plus facile de modifier les attitudes une fois que la politique aura changé. Elle prend en compte le fait que les avantages du libre choix et de la diversité sont difficiles à enseigner par la démonstration théorique. Les gens sont bien plus portés à voir les avantages pratiques qui existent, que de les imaginer alors qu'ils n'existent pas. Pour qu'ils les perçoivent, la micropolitique se propose donc de ménager des éléments de choix et de diversité au sein même du système uniforme de la production publique. S'ils peuvent être introduits sans menacer la sécurité tant vantée dans la fourniture étatisée, il n'y aura aucun rejet massif à craindre des usagers du service.
Au contraire, on obtiendra l'appui de tous ceux qui sont disposés à profiter des choix qui s'offrent à eux, et comme personne ne touche à la fourniture publique existante pour ceux qui y sont attachés, on ne suscite aucune opposition de la part de ces derniers. A mesure qu'un nombre croissant de personnes exerce sa liberté de choix et profite des avantages d'un service plus varié et attentif à ses besoins, l'exemple pratique permet de saisir bien plus directement ces avantages que l'argument théorique ne l'aurait jamais fait. Ayant expérimenté pour eux-mêmes les avantages qu'apporte le Droit de choisir dans certains domaines, les gens seront plus disposés à les accepter ailleurs.
Les services seront personnalisés par leurs utilisateurs eux-mêmes
Ainsi la personnalisation des "services publics" standardisés sera-t-elle obtenue, non par une conversion complète aux idéaux du marché libre, mais par une démarche qui créera progressivement des exceptions à l'uniformité, ainsi que des occasions pour les gens d'obtenir directement ce qu'ils veulent. Tout ceci doit être fait sans compromettre la "sécurité" que les gens semblent tellement apprécier dans l'offre publique.
On dira que cette progression au coup par coup ne fait que retarder le jour du jugement, où il faudra s'attaquer de front au service d'Etat, en même temps qu'à cette impression de sécurité dont les gens sont devenus si dépendants. A ce moment-là, pourrait-on dire, il faudra bien couper le cordon ombilical et laisser les gens se débrouiller tous seuls.
La fin du "service public" n'a besoin de gêner personne
Ce raisonnement est défectueux, et à deux titres. Tout d'abord, si un tel jour devait arriver, les gens le redouteraient beaucoup moins si un grand nombre d'entre eux s'étaient habitués à faire leurs propres choix, ayant pris leurs dispositions pour se procurer eux-mêmes le service, indépendamment des hommes de l'Etat. Deuxièmement, la fin du "service public", si elle a lieu, peut aussi bien être accompagnée d'un haussement d'épaules que d'une explosion. Si les gens décidés à recourir à d'autres fournisseurs sont suffisamment nombreux, rien n'empêche la production d'Etat de se retrouver finalement avec une part infime du marché, sans impact sur la vie de la plupart des gens.
A bien des égards, c'est le meilleur destin possible pour un "service public" : passer d'une fourniture presque universelle avec un produit uniforme, à un système mixte dans lequel l'élément public est suffisamment minime pour être sans conséquence, et où ce sont les individus qui choisissent et déterminent eux-mêmes la gamme des produits.
La part supérieure des régimes de retraite de l'Etat en Grande-Bretagne semble prendre ce chemin. La disposition suivant laquelle les gens sont autorisés à sortir du système public des retraites complémentaires [4] est renforcée par des avantages fiscaux pour ceux qui le quittent. Le choix d'abandonner le système public ne peut être fait que par ceux qui adoptent un régime privé à la place, mais les dégrèvements d'impôts rendent ces régimes plus intéressants pour la plupart des gens. De ce fait, plus de la moitié ont déjà abandonné le régime d'Etat pour choisir, parmi les divers régimes privés, celui qui correspondait le mieux à leurs besoins individuels. Le régime de retraite devient donc de plus en plus personnalisé, par le simple exercice des choix individuels.
Un déclin inexorable mais tranquille
En outre, l'accroissement irréversible des effectifs dans les régimes de retraite privés renforce le pouvoir du groupe d'intérêts qui les soutient, et diminue celui du lobby qui défend le système d'Etat. Le résultat est qu'il devient possible de modifier encore un peu plus l'équilibre. Le gouvernement a progressé pas à pas, s'assurant qu'aucun groupe dont les avantages sembleraient menacés n'aurait de griefs à lui opposer. Les changements proposés ne toucheront pas les créances déjà acquises, et n'affecteront pas les salariés atteignant l'âge de la retraite avant la fin du siècle. Mais cela aura pour conséquence d'accélérer légèrement le taux de désertion dans le système d'Etat, rapprochant d'autant le jour non pas du jugement, mais celui où il sera réduit à un résidu insignifiant.
Interdire l'entrée dans les systèmes redistributifs, tout en garantissant les "droits" de ceux qui y sont déjà
Cette manière élégante de régler leur compte aux retraites d'Etat illustre à merveille une technique essentielle, à utiliser dans tout processus de personnalisation des services d'Etat. Elle consiste à s'efforcer de bloquer toute entrée future, tout en garantissant les avantages de ceux qui en font déjà partie. En arrêtant tout influx pour l'avenir, le gouvernement met en branle un processus de changement à long terme. Il s'écoulera peut-être plus d'une génération avant que les derniers bénéficiaires du régime politisé ne finissent par en sortir, mais l'offre de substitution augmente dans le même temps, et contribue à la formation d'un groupe d'intérêt efficace longtemps avant l'abandon total de la production étatique.
La règle sera d'imposer des obstacles à l'entrée pour empêcher les nouveaux salariés d'adopter le régime public. On les incitera à choisir l'une des solutions privées offertes. S'il s'agit d'un service du genre retraite d'Etat, c'est l'industrie des assurances et autres régimes de retraite privés qui prendra le relais. L'âge de la majorité, la fin des études ou l'entrée dans la vie active sont des points de départ idéaux pour choisir un nouveau régime de retraite. Et si la naissance n'est pas forcément le meilleur moment, c'est parce que les bébés ne prennent généralement pas eux-mêmes les décisions qui les concernent.
L'avantage de l'interdiction d'entrer est qu'elle n'affecte en rien ceux qui dépendent actuellement du système étatisé. Pour eux, éventuellement jusqu'à la fin de leurs jours, ce système sera maintenu disponible. Toutefois, en l'absence de nouvelles arrivées, la proportion de ceux qui s'en servent finira par diminuer. Même si l'offre d'Etat est garantie, ce qui neutralise l'opposition éventuelle des usagers actuels, on mettra en œuvre des mesures d'accompagnement pour que les solutions de remplacement soient bien plus intéressantes, et pour encourager ceux qui y ont encore des droits à se trouver, par leur propre initiative, un moyen de se fournir ailleurs.
Racheter les privilèges en liquide
Outre les divers procédés visant à abaisser le prix des substituts privés, parmi lesquels on trouve les exemptions et les remises d'impôts, on peut aussi accroître le taux de sortie des systèmes d'Etat, en offrant un remboursement en liquide à ceux qui renonceront aux droits acquis sur les prébendes à venir. Nous avons vu par exemple que British Airways, lorsqu'elle se trouvait encore dans l'orbite de l'Etat, avait fait une offre en liquide pour faire accepter le passage des super-retraites indexées à des régimes plus ordinaires. L'offre était suffisamment élevée pour convaincre les salariés de changer de régime. Le même principe pourrait être utilisé pour inciter à quitter plus rapidement d'autres systèmes d'Etat lorsque les solutions de remplacement sont parfaitement viables.
Les droits acquis sur les retraites et les assurances "sociales" seraient probablement trop coûteux à racheter en liquide si le gouvernement devait rembourser immédiatement tous les engagements à venir du système actuel. Il ne pourrait se permettre qu'un rythme progressif d'abandon si on devait se servir d'espèces pour rembourser tous ceux qui voudraient opter pour le système privé. En revanche, rien n'empêche en l'espèce d'offrir des bons du Trésor, remboursables à la date de la retraite, à quiconque passerait du système d'Etat au système privé. Cela ne fait que modifier la forme des engagements de l'Etat sans lui créer de charges nouvelles (même si cela peut avoir l'inconvénient politique d'exposer plus crûment l'ampleur de son endettement), et la liquidité de la créance est aussi bonne que celle de n'importe quel titre d'Etat.
La possibilité de liquider ses droits sur un système d'Etat pousse à la personnalisation
Cette politique visant à rendre les retraites "portables" fait partie d'une stratégie générale de personnalisation. Si les droits à la retraite deviennent la propriété d'une personne, susceptibles d'être retirés à volonté, alors on peut offrir des plans de retraite taillés sur mesure pour les besoins de cette personne et non pour la tranquillité de ceux qui fournissent le service.
Réformer le "service public" lui-même
Toutefois, aussi utiles que soient les diverses méthodes pour encourager à sortir des systèmes d'Etat, et aussi avantageuses que soient les mesures qui y interdisent toute nouvelle entrée, elles ne représentent qu'une partie de la tâche. L'énorme portion de la population qui ne voit aucun moyen viable de se passer du secteur d'Etat, aussi mal fondée qu'elle soit à voir les choses ainsi, constitue un groupe essentiel, toujours dépendant de produits soumis au bon vouloir des fournisseurs et condamné à recevoir le même brouet rudimentaire et standardisé. Il faut donc aussi trouver des moyens d'introduire dans le système d'Etat lui-même des procédures qui favoriseront le développement de la diversité et du libre choix. La personnalisation n'a plus à être confinée au secteur privé si un arrangement astucieux permet de découvrir les moyens d'adapter les produits de l'Etat aux besoins individuels.
Faire prendre un autre chemin au financement public
Cette ambition implique évidemment de réaligner les contraintes qui dirigent la production. On a vu que, dans le secteur public, elles viennent généralement des seuls producteurs, ne laissant les consommateurs exercer aucune influence effective. Voilà un état de choses, comment le modifier ? Un type de technique possible consiste à faire prendre un autre chemin au financement public.
La procédure la plus ordinaire pour entretenir les activités du secteur d'Etat est la suivante : l'argent est confisqué par les hommes de l'Etat, versé au Trésor, attribué au ministère "responsable", puis transféré aux services qui les administrent. Dans certains cas, comme le transport ferroviaire ou la fourniture d'électricité, une partie de l'argent provient des tarifs payés par les usagers mais, pour la plupart d'entre eux, il n'existe pas d'autres fournisseurs de trains ou d'électricité.
Cette façon de faire perpétue la domination par les producteurs. L'argent venant de l'administration qui fournit le service, il est naturellement utilisé pour produire ce qu'a décidé l'organisme en question. Celui-ci peut se donner des airs de demander au public ce qu'il souhaite, mais rien ne l'oblige à s'abaisser davantage dans ce sens. Quand on peut se le permettre, il est tellement plus confortable d'imposer un service uniforme au lieu de s'astreindre à servir le public, à lui offrir la gamme et la diversité des services sur mesure dont il pourrait avoir envie! Or, justement, il n'y a pas de sanction possible. Comme on lui interdit de choisir ailleurs, le public est bien obligé de se contenter du produit qu'on lui offre.
S'il a la chance d'entretenir directement une partie du service, en payant les tarifs publics, il a au moins l'option limitée de réduire sa consommation ou de se tourner vers d'autres produits qui lui font concurrence. On n'a peut-être pas le choix quand il s'agit de trains ou d'électricité, mais on peut au moins prendre davantage la route ou consommer plus de gaz. En revanche, lorsque l'on paie l'intégralité du service par le biais de l'impôt, comme c'est le cas pour l'enseignement ou la plupart des assurances sociales, on n'a même pas ce choix, à moins d'être assez riche pour se payer le service deux fois.
Le choix du consommateur doit déterminer effectivement comment l'argent sera réparti
Par conséquent, si l'on veut faire admettre un peu de diversité et de choix personnels dans les services uniformisés par les hommes de l'Etat, il fait absolument faire prendre à l'argent un autre chemin pour donner un pouvoir réel au consommateur. Il n'est pas nécessaire qu'il lui revienne dans les mains en liquide, comme dans les crédits d'impôt, ou par coupon, comme dans les systèmes de bons. Il suffit simplement que le choix du consommateur détermine effectivement comment l'argent sera réparti. Cela vaut mieux, d'ailleurs, étant donné la puissance et la hargne des adversaires du système de bons, et la peur de l'inconnu qu'ils ont réussi à inculquer au public. Le crédit d'impôt est aussi mal vu par les bureaucrates des Finances qui n'aiment pas que l'argent leur échappe, et par ceux qui trouvent subitement à propos d'opposer une chimérique "neutralité" fiscale aux tentatives faites pour faciliter certains choix par des exemptions fiscales.
L'exemple type est la réforme de l'enseignement
Nous avons vu, à propos du débat sur l'enseignement "public", la manière dont on pouvait y comparer la stratégie micropolitique aux propositions plus classiques. Cet exemple peut servir à nouveau pour montrer comment, en général, il devient politiquement possible d'organiser le financement du service pour qu'il se conforme aux choix des consommateurs. Il a suffi, pour donner un pouvoir effectif aux parents, de financer directement chaque année d'enseignement en donnant à chaque établissement une somme fixe chaque fois qu'un élève s'y inscrivait ; à cela, on associait la liberté d'inscription afin de permettre aux parents de choisir librement entre les écoles. Le principe était : le parent choisit l'école, et l'argent suit l'enfant.
Il fallait aussi — c'est un corollaire important — instituer une disposition autorisant la diversité, de manière à ce qu'on puisse vraiment parler d'un choix. Cela ne sert à rien d'introduire la liberté de choix dans le secteur public ni de mettre au point un procédé qui dirige le financement dans le sens de ces choix, s'il n'y a pas d'alternative réelle. Le troisième volet de notre proposition pour l'éducation était donc que les écoles deviennent indépendantes sous la responsabilité de leurs Conseils d'Administration. Si les écoles n'avaient pas pu choisir des objectifs pédagogiques différents, ou suivre leurs conceptions particulières de l'enseignement, les choix faits par les parents auraient été vides de contenu. Pouvoir accéder librement à l'école de leur choix et déterminer effectivement l'emploi des fonds n'aurait eu aucune valeur sans une diversité capable de traduire leurs préférences dans le système. Les trois volets de la proposition étaient donc indissociables : libre accès pour donner le choix, indépendance pour permettre la diversité, et financement per capita pour diriger les ressources vers ce que les usagers auront choisi.
Concurrence et décentralisation
Il est important, par conséquent, que la réorganisation du financement s'accompagne de mesures pour introduire la diversité dans le système d'Etat. Si l'on doit briser son uniformité, il faut y créer des options de rechange et trouver un moyen de s'assurer que ce soit bien la satisfaction des besoins de consommateurs qui préside à la répartition des fonds.
La technique comporte donc plusieurs éléments combinés.
Tout d'abord, il faut retirer les pleins pouvoirs à l'administration de tutelle. Celle-ci doit être remplacée par un système qui répartisse les fonds selon une formule dont l'élément-clé sera la demande des consommateurs.
Deuxièmement, il faut décentraliser le pouvoir de décision, de sorte que chaque unité locale puisse décider de son fonctionnement de façon indépendante, et changer d'avis sous sa responsabilité propre. S'il peut être conseillé de préserver la présence, rassurante, d'un minimum de normes, il faut que ces règles soient lâches. Dans le cas de l'enseignement, par exemple, il convenait de limiter la norme à l'imposition d'un minimum à apprendre par tous, et de mesurer son respect, non pas au montant des moyens qui lui seraient affectés, mais à la conformité des résultats à un contenu explicitement délimité.
Troisièmement, on doit garantir que le choix sera permis entre les divers produits disponibles, au lieu de forcer les gens à s'adresser à l'établissement public le plus proche, pour la plus grande tranquillité des bureaucrates.
La plupart des monopoles d'Etat existants peuvent se traiter de la sorte
On peut appliquer cette technique à un certain nombre de services actuellement monopolisés par les hommes de l'Etat. Il s'agit toujours de décomposer la production uniformisée en une variété de choix concurrents, qui correspondront à ce que veulent les clients. Au cœur du dispositif se trouve la décentralisation du pouvoir, à laquelle certains groupes de producteurs s'opposeront, et qui doit par conséquent être structurée de telle sorte qu'elle recueille le soutien d'un grand nombre d'usagers [5] et d'au moins une partie des producteurs.
La réforme universitaire
Une telle technique serait un moyen viable de mettre fin au caractère uniforme de l'enseignement universitaire en Grande-Bretagne. A l'heure actuelle, il est financé ainsi : les impôts vont au Conseil des Dotations Universitaires, lequel les affecte aux enseignements et institutions qui ont l'heur de lui plaire. Si on devait réorganiser le financement, il faudrait qu'il passe par les étudiants. Dans le système actuel, leur participation se résume à accepter ce qui leur est proposé. Il leur donne peu d'influence, sauf en tant qu'usagers passifs de ce qui se trouve être au menu. Et le menu en question présente une uniformité frappante, quand on songe à la diversité des personnes et des besoins dans l'enseignement supérieur.
Sans toucher à l'enveloppe globale qui va à l'enseignement supérieur en Grande-Bretagne, et sans modifier son financement par le biais de l'impôt, il serait possible de personnaliser le produit uniforme du secteur public, en affectant l'argent là où les étudiants ont décidé d'aller. Si le financement court-circuitait le Conseil, et s'il était alloué aux établissements que les étudiants ont choisis, les universités auraient intérêt à faire ce qu'on leur demande. Cette mesure ne manquerait pas de provoquer des palpitations dans les hautes sphères : à force de se nourrir à la mangeoire de l'Etat, les producteurs ont fini par considérer le public, qu'ils sont censés servir, comme un gêneur. Inévitable certes, mais alors vraiment importun.
Le système pourrait attribuer aux étudiants des certificats à remettre au moment de l'inscription, ou tout simplement s'arranger pour que ce soient les effectifs d'une unité d'enseignement particulière qui déterminent le volume de son financement. De quelque manière que l'on procède, la redistribution exprimerait les choix effectifs des étudiants. Les universités qui sauraient les attirer deviendraient prospères, d'autres s'enfonceraient, à moins bien sûr d'être capables de se réformer. Certains producteurs prétendront peut-être que les étudiants ne connaissent rien à l'enseignement, tout comme d'autres s'alarment de l'"ingérence" des parents dans les écoles. Bien loin de s'inscrire massivement dans des cours faciles "sans valeur éducative", l'exemple des pays européens montre que, dans ce cas, les étudiants choisiraient des cycles d'enseignement plus adaptés aux carrières qu'ils envisagent.
Réformer le "service public" sans remettre en cause ses avantages perçus
Du point de vue de la stratégie politique, la réorganisation du financement a l'avantage de conserver l'aspect le plus apprécié d'un service collectivisé, tout en réussissant à personnaliser une production auparavant uniforme. La place "gratuite" à l'école est toujours là, et la formation universitaire toujours enretenue sur fonds publics. Ceux qui ne cherchent qu'à conserver la sécurité que cela leur apporte ne font face à aucun changement. Même si l'on peut tout à fait affirmer qu'il ne devrait pas y avoir d'école fondée sur le mensonge de la "gratuité", ni de formation universitaire enretenue par la force sur le dos des autres, cet ensemble de propositions essaie au moins de faire que ces institutions se préoccupent de ce que veulent les consommateurs aussi longtemps qu'elles subsistent. Cette technique de redistribution des fonds montre que, même si leur emprise sur le marché politique est suffisamment solide pour leur permettre de faire obstacle aux solutions de liberté, il est encore possible, par des mesures soigneusement mises au point, d'introduire dans les "services publics" certains éléments de responsabilité et de choix.
Une concurrence interne
Ce à quoi l'on parvient, bien sûr, c'est à instituer la concurrence au sein même du système d'Etat. Tout comme on peut utiliser divers moyens pour susciter une concurrence extérieure et donner à un nombre croissant de personnes les moyens de se passer des hommes de l'Etat, il est possible de créer une concurrence interne. En décentralisant le pouvoir et en réaménageant le mécanisme de financement, on peut créer une situation grâce à laquelle l'intérêt des producteurs devient de satisfaire les demandes des consommateurs plutôt que celles de l'Administration.
Un quasi-marché
Les marchés privés se caractérisent par la coïncidence du paiemet avec la présence du consommateur. Si les consommateurs sont attirés, l'argent suit, de sorte que les producteurs rivalisent pour faire venir les clients en leur offrant ce qu'ils veulent. Les procédés utilisés pour introduire une certaine personnalisation dans l'anonymat des services d'Etat impliqueront donc des techniques visant à y établir, entre le paiement et la présence du client, un lien comparable à celui qui existe dans le secteur privé. Une fois ce rapport créé, les contraintes qu'il impose dans le secteur privé auront un effet analogue dans le secteur public. Ce ne sera pas une copie conforme, ni même vraiment ressemblante, mais elle contiendra diversité, concurrence et choix, dirigera les fonds là où la demande est la plus forte et satisfera davantage les besoins individuels que ne le fait le modèle ordinaire du "service public". On aura une sorte de "marché" interne.
Les conditions de la responsabilité
Promouvoir la concurrence, à l'intérieur comme à l'extérieur du secteur d'Etat, est une technique qui fonctionne si les contraintes qu'on y a instituées permettent de l'entretenir. Ce n'est donc pas la peine d'essayer de mettre en concurrence des éléments du secteur public, si cela n'entraîne aucune sanction. Si ceux qui l'emportent dans cette rivalité n'en tirent aucune récompense, ou si ceux qui y échouent ne sont pas pénalisés, alors on n'obtiendra rien du tout. Ce qui fera marcher le service est la politique qui donnera l'argent aux services compétitifs en le retirant à ceux qui ne le sont pas, et rendra le pouvoir de décision aux unités décentralisées, par exemple aux établissements scolaires et universitaires.
On ne peut pas s'en tirer sans adopter cette approche
Si l'on n'adopte pas une approche globale du projet, en faisant en sorte que ses éléments imbriqués se renforcent mutuellement, cet exercice ne sera rien d'autre qu'une tentative de plus, futile et vaine, pour greffer des éléments du privé sur la gestion publique. Si les entreprises privées présentent des traits enviables, ce n'est pas par hasard : ils sont inséparables des contraintes et des forces qui commandent dans le secteur privé. Si l'on souhaite rendre le secteur public plus efficace, plus conscient de ses coûts, ou plus respectueux de ses clients, il faut véritablement créer des forces qui l'y contraindront. Faute de mettre ces forces en mouvement, ce désir ne sera rien d'autre qu'un vœu pieux et n'aura, au mieux, que des résultats partiels autant qu'éphémères.
Si l'on veut personnaliser, c'est naturellement parce que l'on juge possible de créer ces forces à l'intérieur des services d'Etat. Pour rendre ce projet viable aussi bien qu'acceptable, l'ingéniosité à mettre en œuvre est incommensurable ; mais on peut tout de même le faire. Cela signifie qu'à l'image des services privés qui offrent à la fois variété et compétitivité une fois qu'on les a mis en concurrence avec le "service public", il est possible de briser le monolithisme des services d'Etat, en les forçant à démultiplier leur fourniture en un ensemble de services, dont chacun rivalisera avec les autres productions.
Le domaine le plus explosif
Prenons un exemple ultime : tout le monde considère la médecine d'Etat — financement et hôpitaux publics — comme le domaine politiquement le plus délicat pour y tenter des réformes. L'opinion dominante est que celle-ci offrirait une sécurité hautement appréciable, et qu'il faudrait s'opposer à toute tentative pour la remettre en cause. La médecine d'Etat n'en est pas moins, pour notre malheur, typique de sa catégorie. Le service qu'elle offre est standardisé au maximum, et la tendance naturelle y est de traiter le consommateur comme un numéro. L'apparition de files d'attentes de plus en plus problématiques succédant aux surcapacités locales témoigne de l'impossibilité structurelle d'y ajuster les offres aux demandes. Il faut également souligner qu'elle est tristement célèbre pour son incapacité à exercer un contrôle quelconque sur ses prix de revient. S'agissant de coûts, il existe même un grand nombre de services pour lesquels elle n'en a tout simplement aucune idée. C'est donc un véritable défi à relever pour le spécialiste de la micropolitique.
Faciliter les solutions privées
On sait qu'il existe des solutions capables de l'améliorer. Les solutions privées, notamment en matière d'assurance-maladie, se développent parallèlement. En Grande-Bretagne, on a déjà mis en œuvre des mesures visant à encourager et à accélérer cette croissance ainsi que la fourniture privée des soins, et d'autres ne devraient pas tarder.
Comme cela ne menace directement les "droits acquis" de personne, cela ne devrait pas susciter l'hostilité des groupes d'intérêt. Certes, on n'évitera pas les cris des groupes de pression idéologiques, ni ceux des syndicats qui profitent du système ; mais on peut largement désamorcer cette opposition en posant comme principe que toute remise en cause du "service public" sera exclue pour ceux qui croient y trouver leur avantage, et en inventant un moyen de racheter une partie des intérêts qu'on n'aura pas pu neutraliser.
Garantir le maintien des prestations
De toutes façons, dans le grand public, même ceux qui dépendent du monopole d'Etat ne s'opposeront pas vraiment au développement des systèmes privés. Ils croient certes profiter du système, et que s'ils peuvent le faire c'est plus ou moins parce que ce dernier donne à l'"Etat" l'occasion de voler les "riches" (les autres) au profit des "pauvres" (eux-mêmes) : tous les discours officiels sur la "solidarité" sont des variantes de cette fable. Or, il s'agit bien d'une fable, car c'est le contraire qui est vrai : le passage au privé des catégories les plus aisées a généralement pour conséquence d'alléger le fardeau pécuniaire du système d'Etat. Il en est d'autant plus facile de garantir inconditionnellement les distributions dont croient "bénéficier" les gens attachés au système d'Etat, ce qui est en fait la condition essentielle pour éviter une opposition majeure.
Le système sera d'autant moins mauvais que l'irresponsabilité financière y sera moins grande
Le système médical britannique étant un super-monopole centralisé, on peut se demander s'il est possible de trouver un moyen de réaménager son mode de financement pour que les préférences des consommateurs y soient prises en compte. Si c'est faisable, on réussira progressivement à personnaliser une production qui n'est à présent qu'uniformité et indifférence au consommateur. La réponse est que de tels systèmes peuvent parfaitement être mis au point. L'Etat, comme Allah, est peut-être grand, mais la créativité humaine l'est aussi. Avec une méthode appropriée pour la diriger, il y a peu de problèmes d'organisation si énormes qu'elle soit incapable de les résoudre.
En Grande-Bretagne, le principe centraliste de l'"enveloppe globale" et la pseudo-gratuité totale ont conduit à un rationnement de plus en plus pénible des soins pour ceux qui n'ont pas les relations nécessaires. La première étape d'une réforme devrait donc être d'augmenter la dépense totale, non pas en augmentant les impôts, mais en encourageant les gens qui en ont les moyens à apporter leurs propres ressources. D'autres pays avancés parviennent à augmenter le budget de la santé en puisant dans la production générale, car les gens y prennent davantage eux-mêmes l'initiative de la dépense et ressentent par conséquent plus directement ses avantages pour eux-mêmes et leur famille.
Le système français par exemple, respectant mieux la liberté de choix au moment de la prestation des services, est plus supportable ; cependant, ce n'est pas non plus un exemple à suivre parce que, comme aux Etats-Unis mais de façon bien plus massive, l'irresponsabilité qui règne à tous les niveaux dans l'assurance-maladie "publique" infecte l'ensemble du système et risque bien, faute de concurrence dans ce domaine, de dériver vers un système plus proche du système britannique, dont les usagers chercheront à s'échapper par le haut. Les systèmes suisse et allemand, quoiqu'affectés à un degré ou à un autre par les tares qui caractérisent l'intervention politique, sont en fait bien meilleurs, parce que les choix de financement y ressemblent davantage à des décisions responsables.
Réduire au maximum l'emprise des choix imposés
Le fait est que les systèmes d'Etat ont partout les mêmes conséquences et le financement public doit aussi conduire les autres pays, un jour ou l'autre, à une situation de rationnement aigu. Plus tôt les systèmes de financement pourront être privatisés, et plus tôt on pourra éviter cette situation. Il faut donc autoriser et même encourager au maximum la sortie des systèmes d'Etat, de fourniture des soins comme d'assurance-maladie. Des exemptions fiscales peuvent être un moyen d'encouragement, en réduisant le coût de la fourniture privée pour ceux, nombreux, qui ne peuvent se le permettre pour l'instant. Cela a l'avantage de permettre aux dépenses totales de santé d'augmenter conformément aux choix personnels, tout en réduisant la pression sur le système d'Etat. Le Système National de Santé britannique serait en bien plus mauvaise posture sans les 9 % de personnes qui ont déjà adopté la médecine privée, ou les 400 000 opérations chirurgicales libres faites par le privé.
Il est possible de faire des économies
Si l'on veut améliorer la médecine d'Etat elle-même, le meilleur angle d'attaque est peut-être de combler le manque d'équipements intermédiaires entre la médecine de ville et les hôpitaux. Nous avons indiscutablement un système à deux niveaux. Si les prescriptions des médecins ne guérissent pas les malades, on les envoie à l'hôpital. Or, on peut imaginer toute une gamme d'organisations intermédiaires et qui ont déjà fait leurs preuves, telles que les associations de diagnostic et les cliniques de jour. Comme une bonne partie, peut-être la plus grande partie des traitements donnés à grands frais dans les hôpitaux pourrait être assurée plus efficacement à l'extérieur, et comme ce traitement serait davantage à la portée d'un client privé que celui que les grandes institutions peuvent fournir, il existe une ouverture pour des réformes possibles si l'on peut calmer les groupes d'intérêt.
Les Organismes d'Entretien de la Santé : un moyen d'encourager la prise en compte des coûts
On pourrait réorganiser la médecine d'Etat de manière à y introduire des Organismes d'Entretien de la Santé6. Ces organisations fonctionnent dans d'autres pays et assurent une gestion intégrée de la santé de chacun. Elles rassemblent des médecins, des établissements de soins, des spécialistes, des laboratoires et des hôpitaux ; tous travaillent au sein de ces organisations pour garantir un niveau de soins approprié. Leurs honoraires consistent généralement en un forfait annuel par patient, ce qui leur crée un intérêt à maintenir leurs patients en bonne santé au moindre coût. Elles doivent attirer leurs clients par le rapport qualité-prix, sinon par l'exclusivité de certains de leurs équipements.
On pourrait introduire ce principe dans le système public. Les généralistes se feraient embaucher par l'une de ces unités de soins, amenant leur clientèle avec eux. Un patient individuel pourrait toujours changer d'unité de soins en changeant de médecin traitant. Les médecins seraient alors payés à la tâche par l'entreprise, avec des honoraires pour chaque consultation et chaque traitement prescrit.
Lorsque des patients seraient envoyés par des hôpitaux ou des spécialistes, leur unité choisirait un traitement approprié. Les solutions de rechange disponibles les inciteraient à fournir un service rentable. Chaque hôpital devrait connaître le coût de toutes ses activités et les rentabiliser. Sinon, les unités ne feraient pas appel à leurs services.
Le système que produiraient ces changements apporterait enfin une concurrence capable de pousser à la rationalisation des coûts. Il permettrait aux divers niveaux de gestion d'être plus souples et de prendre des décisions indépendantes. Les médecins et leurs patients pourraient s'inscrire aux Organismes de leur choix, lesquels choisiraient entre les services de différents hôpitaux pour y envoyer leurs patients.
Un quasi marché par renouvellements périodiques
Dans le cadre d'un financement public, les unités de soins pourraient être financées par une dotation annuelle pour chaque patient et devraient, pour cette somme, fournir des services selon des normes déterminées au plan national. Si un patient quittait une unité pour une autre, sa subvention annuelle le suivrait. Cela signifierait que l'argent suivrait les choix faits, comme il suivra l'enfant dans un marché interne de l'éducation.
On pourrait perfectionner ce système. Les unités de soins n'auraient pas le droit de refuser des patients, sauf pour des questions de place. Même dans ce cas, elles devraient établir des listes d'attente. La subvention annuelle pourrait varier avec la catégorie du patient ou la zone géographique de résidence, pour refléter les différences dans le coût des soins.
Un changement acceptable
Cette mesure n'est pas de nature à susciter la réprobation générale qui accueillerait une tentative de supprimer le système public. Elle promet au contraire de l'améliorer. Les patients consultent leurs médecins comme avant, et c'est toujours quasiment (pseudo-) gratuit. Ils bénéficient des soins hospitaliers et de l'expertise des spécialistes sans débourser un sou. Le changement est que l'on a accru la diversité et les choix au sein d'un marché interne, et surtout que la responsabilité est rétablie à certains niveaux, ce qui incite à rechercher la rentabilité et le contrôle des coûts.
Cela aurait pour effet de susciter une évolution souhaitable, qui dispenserait d'imposer un rationnement aveugle tout en maintenant un degré de personnalisation du service qui le soumette vraiment aux divers besoins et préférences des consommateurs. Il relèverait toujours du "service public" et conserverait sa fonction de couverture générale, mais les pressions et les forces présentes en son sein concourraient à donner des résultats différents. Les unités de soins dont les consommateurs seraient contents recevraient davantage de subventions, et d'autres seraient encouragées à suivre leur exemple. Les unités rentables pourraient mieux rémunérer leur personnel, si bien que cela favoriserait l'éclosion de nouveaux talents.
Si on peut réformer la médecine d'Etat, alors on pourra tout réformer
Notre exemple de médecine totalement étatisée, problème épineux s'il en est, donne une idée de l'étendue des problèmes auxquels ces principes peuvent être appliqués. Une fois que l'on applique aux marchés politiques des solutions originales qui orientent dans une autre direction les forces qui s'y exercent, il est possible de mener à bien des réformes d'ampleur considérable. Notre Système National de Santé est presque un cas limite ; si ces méthodes marchent là-dedans, alors il se peut bien qu'on soit capable de les appliquer partout.
Autres techniques
D'autres disciplines au service de l'usager
Il est deux autres méthodes qui méritent une attention particulière. L'une d'entre elles s'efforce d'introduire des contraintes dans le secteur public pour le conduire à se conformer, dans une certaine mesure, à la demande du consommateur.
Nous pouvons partir du "service public" "normal", que nous connaissons déjà : le consommateur, privé de la possibilité de s'adresser ailleurs, n'a d'autre choix que de prendre ce qu'on lui donne ; personne n'est incité à faire correspondre cette offre à ce qu'il désire réellement. Les producteurs ayant une plus grande capacité de nuire que lui, leurs préférences l'emportent régulièrement.
Il nous faut maintenant envisager les cas, qui existent sans doute, où il sera impossible de mettre en place la solution complexe qui conduirait à réorienter le financement du "service public" afin d'y encourager la diversité.
L'obligation de résultats sous peine de concurrence effective
Même dans des domaines aussi difficiles, on a découvert des procédés capables d'instituer des contraintes favorables aux usagers. L'un d'entre eux consiste à instituer une obligation formelle de résultats imposée au "service public", associée à une procédure permettant effectivement de se fournir ailleurs si le service n'est pas rendu.
"J'ai tout votre temps"
Par exemple, on a vu que les fournisseurs produisent ce qui les arrange, et font attendre aux clients les services qu'ils ont demandés. Retards et listes d'attente caractérisent la fourniture publique dans tous les domaines, de la sécurité sociale au logement collectivisé. Cette obligation d'attendre est un des traits les plus impopulaires des "services publics". Même les consommateurs qui trouvent à leur goût le service, et la sécurité que leur inspire l'idée d'un financement public, ceux-là n'aiment pas attendre non plus. Toutes choses égales par ailleurs, ils aimeraient mieux que le service leur soit rendu immédiatement et non plus tard.
Un prétexte aux revendications de dépenses
Dans le cas où aucune autre disposition n'existe, cette situation peut fournir un excellent prétexte à ceux qui veulent augmenter les dépenses publiques. Ils peuvent monter en épingle les retards en question et, les attribuant à un "financement insuffisant", manipuler le mécontentement qu'ils ont engendré au service d'une campagne pour l'accroissement des crédits. Comme les professionnels et les producteurs ne peuvent que faire chorus, le ralliement des groupes de pression et des consommateurs eux-mêmes exercera selon toute vraisemblance une pression considérable sur le marché politique. Le gouvernement, même s'il sait pertinemment qu'une augmentation des dépenses n'a aucune chance de raccourcir les délais, sera peut-être obligé d'en passer par là.
La défaillance de l'Etat appelle l'intervention du marché
L'autre solution consiste à écarter d'emblée l'idée que si le secteur public est incapable de faire face, il faut lui en donner davantage, et à se tourner vers le secteur privé pour résoudre le problème. Si la fourniture publique conduit à de longs retards, on a au minimum une bonne raison pour s'adresser ailleurs. Reconnaître qu'il existe un droit de recevoir effectivement un service "public", c'est affirmer un principe bien précis, à savoir que si le secteur public est incapable de le fournir lui-même, alors le consommateur a le Droit de se fournir ailleurs, sur fonds publics.
Ces trois derniers mots pèsent de tout leur poids. En effet, n'importe qui peut éviter les queues et les retards en payant, à ses frais, un service privé. Ce que signifie le droit de recevoir le service "public", c'est tout autre chose : cela veut dire que si le citoyen a payé pour recevoir un service en acquittant ses impôts, il a acquis le droit de l'obtenir effectivement, même si cela doit impliquer qu'il se serve de fonds publics pour l'acheter dans le privé [1].
Réaliser le droit effectif de recevoir un service qu'on a payé
Dans la pratique, cela signifie qu'après une période d'attente jugée tolérable, les gens acquièrent automatiquement le droit de se procurer le service ailleurs, avec l'argent de l'Etat. Pour donner des exemples précis, quand les locataires ont besoin de réparations dans les logements "sociaux", ils sont souvent obligés d'attendre très longtemps une intervention même urgente, comme la réparation de la toiture ou des fenêtres. Il est probable que les services du logement se servent de ces retards comme d'un prétexte pour justifier l'octroi de fonds supplémentaires qui, selon toute vraisemblance, n'y changeraient pas grand chose. Une solution plus imaginative consiste à instituer un délai maximum de réponse pour le "service public", au-delà duquel le locataire aura le droit de faire appel à des fournisseurs privés et d'envoyer la note au "service public" susmentionné.
Bien sûr, il y a des clauses de protection à instituer : le prix du travail fait par l'entreprise privée ne devra pas dépasser ce qu'aurait coûté l'intervention du "service public", et il faudra pouvoir prouver que le "service public" connaissait la nécessité des réparations et n'a pas réagi dans le délai fixé. A en croire la quasi-totalité des enquêtes faites sur le sujet, il y a peu de chances que le coût des entreprises privées dépasse celui des organismes publics dans le domaine du bâtiment.
Une discipline merveilleuse sur le comportement étatique
Instituer ce principe du droit de recevoir le service, droit qui peut être exercé ailleurs si les hommes de l'Etat sont défaillants, exerce une pression sur ces derniers pour qu'ils s'efforcent de fournir le service eux-mêmes. Si le locataire qui ne peut pas faire réaliser la réparation dans un délai raisonnable a la possibilité de s'adresser ailleurs et d'envoyer la facture aux hommes de l'Etat, cela les poussera à s'assurer que le travail nécessaire soit fait en temps utile. S'ils échouent à le faire, une bonne partie de leurs activités sera automatiquement privatisée et ils perdront le financement correspondant' au profit de leurs concurrents du privé. Naturellement, ils feront leur possible pour empêcher cela. Ainsi, le droit d'obtenir le service, une fois reconnu, installe dans le système une pression au profit des consommateurs que la présence d'un marché ordinaire ne suffit pas à exercer sur des monopoles publics.
Ce qui se passe dans la pratique est que les producteurs font de leur mieux pour que seuls un très petit nombre de cas aillent jusqu'à l'intervention d'un fournisseur privé. Ce qu'ils font, c'est qu'ils améliorent la gestion du service, le pressant de réagir plus efficacement et plus vite. Ils gèrent de plus près les demandes de réparation, et commencent à se soucier de savoir depuis combien de temps les clients attendent. A l'approche de la date limite, ils se mettent à entreprendre le travail voulu [2]. L'idée que l'usager a le droit de recevoir le service ne fait qu'imposer au "service public" des contraintes inspirées des conditions de production du marché, et qui suppléent à l'absence des disciplines normales.
Une mesure populaire et facile à étendre
Le droit d'obtenir le service est calculé pour plaire aux consommateurs des "services publics". Officiellement, il ne fait rien pour mettre en cause la fourniture publique. Il permet simplement de forcer les hommes de l'Etat à acheter le service ailleurs pour ceux qui ne parviennent pas à se faire servir dans un délai raisonnable. Le grand public peut imédiatement percevoir l'efficacité de la garantie que lui donne ce droit ; il saisit immédiatement ce qu'il vaut, et le soutient en conséquence.
Les producteurs de "services publics", bien sûr, n'aiment pas que leurs clients puissent acheter le service à d'autres, et leur envoyer la facture en sus. Mais c'est une des rares circonstances où le poids d'un groupe de pression suffit pour l'emporter sur celui d'un autre groupe. Or, les consommateurs qui obtiennent le moyen de sauter par-dessus les retards et les listes d'attente ont plus de poids que les fournisseurs partisans du statu quo. Il y a plus de consommateurs mécontents, ou qui pensent pouvoir l'être, que de producteurs à qui l'idée de devoir leur reconnaître ces Droits est insupportable. D'ailleurs, le principe du "service public" n'est pas menacé à la base. S'il fait ce qu'on attend de lui, il n'est même pas mis en cause du tout [3].
En outre, le principe peut être appliqué dans l'ensemble du secteur public. Dans une étonnante interview lors de la dernière grève du service des eaux, Lord Denning, ancien Lord of the Rolls [4], affirmait que le droit formel d'obtenir un "service public" existait déjà dans la Common Law, et que le public avait de plein droit la possibilité de faire appel à une entreprise privée et d'envoyer la facture aux hommes de l'Etat s'ils manquaient à leurs obligations. L'idée n'a jamais été testée devant un tribunal et on peut toujours penser qu'elle est vraie ou fausse. Que ce droit existe ou non dans le droit coutumier, il est de toutes façons possible de l'instituer par la législation, chaque fois que le service du public semble nécessiter de l'imposer [depuis, des usagers mécontents du Système National de Santé britannique se sont faits opérer en France et ont effectivement obtenu des tribunaux le remboursement de leurs frais].
Raccourcir les listes d'attente dans les hôpitaux
Listes d'attentes et délais de traitement hospitalier ne sont pas les caractéristiques les plus populaires de notre Système National de Santé. Ils sont rituellement invoqués par les producteurs et autres groupes de pression pour réclamer un financement accru. Mais on pourrait tout aussi bien s'en servir pour fonder un droit d'être soigné, tout comme on a celui de faire réparer les logements sociaux. Si le "service public" prend l'argent du contribuable, alors le contribuable a un Droit indiscutable sur ses productions.
Un droit effectif d'être soigné par les hôpitaux publics pourrait impliquer pour ces derniers l'obligation de fournir le traitement dans un délai, disons, de six mois (ce qui en dit long sur l'état de notre système). S'ils se montraient incapables de le faire, ils seraient obligés d'acheter le traitement au secteur privé pour satisfaire le consommateur. Ce qui signifie que le délai d'attente serait automatiquement limité à six mois. Une telle mesure serait sans doute très populaire chez les patients ou futurs patients, même ceux qui n'ont jamais goûté à la médecine étatisée. Elle aurait également la faveur de certains médecins, infirmières et spécialistes, mais serait fort mal vue des administrateurs. Hélas pour eux, ces derniers ne sont qu'un petit groupe, si réelle que soit sa capacité de nuire.
Là encore, dans la pratique, on assisterait à un changement immédiat des attitudes vis-à-vis des listes d'attente. Les responsables se mettraient à les suivre de près, et apprendraient à mieux utiliser les surplus de certains secteurs pour remédier aux défaillances dans les autres. A n'en pas douter, on trouverait des procédures raffinées pour faire admettre les patients dans les centres de soins aussitôt qu'une place aurait été libérée. A l'approche de la date limite, on assisterait à un effort massif pour soigner les malades dans les temps. La conséquence ne serait donc pas un recours plus fréquent aux services privés payés par l'Etat, mais une utilisation plus efficace des fonds publics, et une meilleure prise de conscience des délais de retard.
Tout bénéfice pour le gouvernement
Autre conséquence pratique, et qui n'est pas négligeable : un tel système ferait parfaitement l'affaire du gouvernement, dont il augmenterait la popularité en l'exonérant instantanément de toutes les critiques portant sur les délais de traitement hospitaliers. En effet, même si le malade devait finalement faire appel à un service privé, il ne s'en plaindrait pas pour autant. En outre, le gouvernement n'aurait rien à y perdre financièrement. Cela coûterait certainement moins cher que la dépense supplémentaire qu'il faudrait consentir pour amener le monopole médical au niveau souhaité si cette contrainte nouvelle n'était pas instituée.
Un produit du génie micropolitique
La notion de "droit d'obtenir le service" est une bonne application de l'approche micropolitique. En effet, le service d'Etat est laissé intact. Il garde ses chances de fournir le service en premier. C'est seulement s'il se montre incapable de le faire dans un délai raisonnable que l'on fait appel à la concurrence, et le consommateur en profite directement.
Le dispositif introduit dans les "services publics" un partage des tâches strictement limité. Il donne sa chance au secteur public, et n'ouvre la porte au privé que pour ce que le premier ne peut pas faire. Si les hôpitaux publics sont incapables de traiter leurs patients en moins de six mois, c'est seulement alors que l'on fait appel à la médecine privée. Si les offices d'HLM sont incapables de réparer les toitures et les fenêtres dans des délais raisonnables, c’est seulement ensuite que l'on fait appel à des entrepreneurs privés pour réaliser le travail.
Le dispositif est soigneusement calculé pour offrir aux consommateurs ce qu'ils attendent des services de l'Etat : une réponse à leurs besoins. Le temps interminable que les producteurs mettent pour se décider à fournir le service est abruptement raccourci par la menace — et, le cas échéant, la réalité — de la fourniture privée. Le procédé introduit par conséquent dans le système un moyen de pression au profit des consommateurs, même là où l'on juge indésirable ou impossible de laisser naître des occasions de choisir librement un service diversifié. La pression est créée par la simple possibilité d'un autre choix en cas d'expiration du délai. En utilisant cette technique pour la diriger vers les producteurs, le gouvernement se dégage de la pression qu'il subissait du fait des retards et les listes d'attente. Au lieu d'être forcé par la pression politique à augmenter le budget du "service public", le gouvernement se sert du "privé" pour forcer le "public" à s'améliorer. D'où la merveilleuse efficacité du procédé.
Confier les investissements publics aux décideurs privés
La deuxième méthode qui mérite une attention particulière vise le problème de la dégradation du capital installé dans le secteur public. Le problème de fond, rappelons-le, est que l'investissement est bien peu défendu relativement aux dépenses de fonctionnement. Les dépenses courantes servent à financer les services, ce qui plaît aux consommateurs, et à payer les salaires, ce qui fait l'affaire des producteurs. L'ensemble tire de toutes ses forces vers la dépense courante. S'il n'y a pas assez d'argent pour cette dernière, les producteurs peuvent interrompre le service, et les consommateurs, irrités, iront se plaindre au gouvernement.
La dépense d'investissement n'a pas pour elle tous ces nobles protecteurs. Comme nous l'avons vu, ses principaux bénéficiaires sont les consommateurs à venir, qui n'ont que peu à offrir sur le marché politique d'aujourd'hui. L'investissement en capital est là pour maintenir à niveau l'équipement et les locaux, et pour mettre à jour les techniques afin que les services ne dépendent pas d'un matériel usagé et dépassé. La pression étant beaucoup plus forte du côté des dépenses courantes, le "service public" typique connaît petit à petit une baisse dans la proportion des fonds attribués au capital, et l'on assiste à une chute rapide du ratio de capital par employé. A terme, la décapitalisation finit par attirer l'attention.
Une épine dans le pied des politiques
On ne s'étonnera pas de la mauvaise réputation que leur sous-capitalisation vaut aux "services publics". Ils sont obligés de faire durer un équipement ancien et usé beaucoup plus longtemps qu'on ne le tolérerait dans leurs homologues du privé. Les usagers doivent s'accommoder d'un équipement rafistolé et de locaux ayant dépassé la limite d'âge. Hôpitaux victoriens, écoles archaïques, prisons surpeuplées, matériel antédiluvien ; tous produits d'un système où la pression du côté courant est trop forte, et qui n'est pas capable de maintenir son capital à un niveau satisfaisant.
Les producteurs font d'ordinaire pression pour l'augmentation des dépenses. Tout comme ils la présentent comme la solution miracle au problème des listes d'attente, elle ne saurait manquer, assurent-ils, de résoudre ceux de la sous-capitalisation. En fait, à les en croire, elle serait la panacée pour tous les maux du secteur public. Et l'épuisement du capital pousse bel et bien le gouvernement à faire ce qu'on nomme "réinvestir", et qui n'est en fait qu'une pure et simple augmentation des dépenses. La pression venue des producteurs aussi bien que des consommateurs finit par arriver à un point tel que le gouvernement se sent forcé d'agir.
Accroître les dépenses n'est évidemment pas une solution
Or, nous savons malheureusement qu'augmenter les dépenses n'est pas une manière efficace de traiter la décapitalisation. L'ensemble des contraintes continuant à pousser les dépenses vers le côté courant, les nouveaux financements subissent ce déterminisme tout autant que les anciens. L'afflux d'argent frais affaiblit la résolution des administrateurs à résister aux revendications des employés, et à réduire les services inutiles ou gaspilleurs. L'argent est justement là, à leur disposition. L'effet est d'attirer la plus grande partie des nouveaux financements du côté courant, si fermement qu'on ait résolu de les affecter à la rénovation du capital.
Cette pénurie chronique de capital condamne le secteur public à une production de plus en plus médiocre, problème dont on verra encore à tort la solution dans une dépense supplémentaire de l'argent du contribuable. A moins d'estimer que les services doivent être inadaptés à la demande, interdire la diversité et la liberté du choix, et que le financement doit mépriser les désirs du consommateur, on peut juger cette situation hautement indésirable ; elle enferme la plupart des "services publics" dans un cercle vicieux de dégradation continuelle.
Isoler la dépense d'investissement des pressions de la politique
La technique imaginée par la micropolitique permet d'augmenter l'investissement en capital sans induire une dépense courante supplémentaire, en introduisant dans le secteur public des capitaux privés. Le secret est de donner au capital la forme d'un investissement privé. De l'argent privé, on peut toujours en trouver dès lors que les conditions lui sont favorables. A une époque où la part des investissements publics dans la dépense totale tombait à niveau historiquement bas, les marchés privés ont vu les capitaux affluer pour acheter des actions, de nouvelles émissions, et des parts de sociétés privatisées. L'argent est là ; le problème est de savoir comment l'attirer vers le secteur public.
L'emprunt public direct n'est pas approprié. Il livre aux hommes de l'Etat des sommes qu'ils peuvent dépenser à leur discrétion, ce qui veut dire qu'en pratique, il n'est guère différent d'un surcroît de recettes fiscales. Les contraintes qui pèsent sur l'emprunt public sont celles de son financement, et celle de son remboursement final. En tant que somme à dépenser, il ne subit pas plus de contraintes que l'impôt quant à l'usage qui en est fait. Quand l'autorité publique emprunte davantage, ses dépenses augmentent, et la pression pour contenir les coûts de chaque service diminue. L'une des raisons pour contenir les dépenses publiques est d'ailleurs le souci de limiter l'endettement global.
Un investissement privé, que la collectivité paierait pour mettre à la disposition des usagers
L'investissement direct du capital privé présente des inconvénients techniques. Alors, l'idée est née que l'argent privé devrait aller directement financer des projets publics, plutôt que d'être prêté aux hommes de l'Etat. Ces derniers pourraient alors payer le droit d'utiliser le capital installé, qu'il s'agisse de bâtiments ou d'équipement, ce qui permettrait de rémunérer les investisseurs. Par exemple, un groupe privé pourrait financer la construction d'un pont, avec l'aval des hommes de l'Etat, puis tirer sa rentabilité du loyer que l'Etat paierait pour l'utilisation de ce pont. Ce système pourrait concerner des investissements aussi divers que la construction des musées ou des stations d'épuration. L'avantage est que l'Etat obtient son investissement immédiatement, sans avoir à sortir du liquide tout de suite, tandis que les investisseurs privés reçoivent leur rentabilité sur le capital.
Dans les faits, ce système ressemble à une forme de prêt-bail. Le capital privé sert à réaliser les travaux publics nécessaires, et la collectivité paie un loyer à leurs propriétaires. Le public peut en disposer alors même que leurs propriétaires sont privés, et la collectivité paie pour l'utiliser et non pour le construire. Dans un système de ce genre, on pourrait construire les voies de contournement, les ponts, et les tunnels dont la nécessité est pressante, sans la nécessité d'une énorme dépense en capitaux publics. Ce beau programme présente de nombreux avantages... et comporte une faille gênante.
Transformer une dépense d'investissement en dépense courante
Son principal avantage est qu'il ferait passer la dépense publique du côté capital au côté courant. Reconnaissant que le secteur public engendre un épuisement inéluctable du capital, le procédé commence par appeler son capital de l'extérieur, pour le financer ensuite au titre des dépenses courantes. Au lieu d'attribuer des dotations en capital pour construire les routes et les ponts, la collectivité ne paie qu'à titre "courant", pour les utiliser. Le capital vient du privé qui en a à revendre, et non plus d'un gouvernement tiraillé de partout par des demandes de fonds qu'il cherche à contenir. Le paiement est inscrit dans les dépenses de fonctionnement courantes, et assure la fourniture effective du service au public, qu'il s'agisse d'une station d'épuration ou d'un musée.
Le hic est que la proposition n'est pas compatible avec nos règles de financement public. On l'a essayée, avec succès, dans plusieurs états d'Amérique, mais elle ne peut pas être appliquée en Grande-Bretagne sous la forme que nous venons de décrire. Le problème est que si le paiement est garanti par l'Etat, nos lois de finances traiteront l'investissement comme un emprunt public, l'incluant dans le total. Même si l'argent provient de sources privées, il faudra l'inscrire au compte de l'endettement public global. La doctrine officielle est qu'en l'absence de risque, il ne s'agit pas d'un véritable "investissement", mais d'un "prêt" pur et simple. Si les investisseurs privés s'étaient contentés de prêter de l'argent à l'Etat en échange d'annuités, les conséquences juridiques seraient les mêmes.
Associer l'investisseur privé au risque du projet
Bien que cette législation semble condamner le projet, ce qu'elle exige en fait, c'est un élément de risque suffisant. Le micropoliticien, s'il veut permettre aux capitaux privés de venir à la rescousse d'un secteur public à court de capital, doit alors inventer des systèmes incluant le facteur de risque qui caractérise les investissements privés ordinaires. La chose est plus compliquée, mais aura le mérite de surmonter l'objection suivant laquelle le recours au capital privé ne serait rien d'autre qu'une nouvelle forme d'emprunt, à peine déguisé.
Il existe bel et bien un facteur de risque, dans la mesure où personne ne peut vraiment savoir avec quelle intensité les nouveaux investissements seront utilisés. Par exemple, les hommes de l'Etat peuvent se faire communiquer des informations sur la fréquentation probable d'une nouvelle route, ou le nombre de véhicules par heure que l'on peut prévoir pour un pont ou un tunnel, mais ces chiffres ne sont que des estimations grossières. De même, les chiffres d'entrées prévisibles dans un musée, ou l'affluence dans d'autres grands projets, sont en grande partie des devinettes. Voilà le prétexte d'où l'on peut tirer le risque nécessaire pour satisfaire aux exigences de la législation. Ce qu'il s'agit alors de faire, c'est de tenir une négociation serrée entre une collectivité désireuse d'obtenir un financement aux meilleures conditions, et des investisseurs également soucieux de maximiser la rentabilité de leurs placements.
On pourra donc convenir d'un chiffre de fréquentation qui correspondrait à une opération blanche, par exemple pour utiliser un pont, et en déduire une somme par véhicule que la collectivité paierait aux investisseurs. S'il y a davantage d'utilisateurs que prévu, les investisseurs feront un profit, mais s'il y en a moins, ils subiront une perte. Ce système présente l'avantage de créer un risque véritable, ce qui dispense d'inclure le capital investi dans le total de l'endettement public recensé.
Il a un autre avantage important : dans la mesure où les calculs financiers sont fondés sur l'utilisation effective de l'ouvrage construit, il crée une forte contrainte pour que l'argent aille seulement aux projets dont les investisseurs privés attendent le plus de succès auprès du public.
On peut toujours interpréter une réglementation
Il y a un élément artificiel dans cette notion d'usage attendu et dans le concept d'un taux de rentabilité plus ou moins élevé suivant que l'usage effectif est plus fort ou moindre qu'on ne le prévoyait. Cela tient à ce que les règles elles-mêmes sont plutôt arbitraires, la définition du "risque" étant prise dans la réglementation et non dans la réalité [5]. En fait, comme on l'a vu, toute réglementation comporte une définition arbitraire de ses propres limites. Cet arbitraire, tout comme il peut faire obstacle à certains projets du fait d'une interprétation trop rigide, peut aussi jouer en faveur d'autres propositions, si celles-ci ont été faites sur mesure pour s'y conformer formellement.
Les projets ont de bonnes chances d'être rentables
On devine qu'il faudra donner au capital privé de bonnes raisons pour aller s'investir dans des projets publics. Il y a bien des moyens de faire de l'argent sur un investissement privé, et un projet public, quel qu'il soit, devra au moins supporter la comparaison en termes de rentabilité et de risque s'il veut attirer des fonds. Ce qui signifie que si des accords sont conclus entre les hommes de l'Etat et des investisseurs potentiels, les estimations qui les fondent devront plutôt se tromper au profit des seconds. En somme, les calculs que l'on fera pour juger de l'utilisation probable des installations réalisées sur fonds privés, devront donner aux investisseurs éventuels l'impression qu'il existe une chance raisonnable pour que la cible soit dépassée.
Il existe heureusement une marge de manœuvre qui rend la chose possible. En effet, nous l'avons vu, la gestion publique fait en général de l'argent un usage bien moins efficace que ne le feraient des gestionnaires privés dans une activité comparable. Elle pousse aux sureffectifs, tout comme à la sous-capitalisation, et ceci vaut aussi bien pour l'entretien et pour la mise en œuvre de leurs capitaux matériels que pour la fourniture des services proprement dite. Toutes choses égales par ailleurs, on doit donc s'attendre à ce que les entreprises privées, pour entretenir et gérer des biens de capital, dépensent moins qu'il n'en coûte au secteur public pour faire le même travail. C'est là que se trouve le moyen d'offrir à l'investissement privé la rentabilité supérieure qui l'attirera dans le projet, le secteur public en ayant pour son argent.
Du projet à la réalisation
Un projet affectant des capitaux privés à un usage public prévoira normalement la construction d'un élément de capital, sa supervision au cours des années ainsi que son entretien pendant cette période. Il est rare que le secteur public fasse appel à ses propres bureaux d'études et à sa propre main-d'œuvre ; il est plus fréquent qu'il ait recours à des appels d'offre auprès des entreprises privées. Si un projet public est également financé sur fonds privés, la construction se fera de la même manière, avec peut-être quelque chance de faire des économies supplémentaires en échappant à la routine technologique et à l'application trop stricte des règles bureaucratiques. La véritable économie réside en fait dans l'exécution des tâches de gestion et d'entretien par l'entreprise privée, attributions qui reviennent encore le plus souvent à des fonctionnaires.
Les accords d'investissement privé permettront généralement de faire des propositions intéressantes aux hommes de l'Etat, dans la mesure où elles les conduiront à dépenser moins qu'ils n'auraient dû le faire en se chargeant eux-mêmes de la besogne. La proposition est également intéressante pour les investisseurs, parce qu'elle leur offre un contrat à long terme, avec une certitude raisonnable d'obtenir une bonne rentabilité pour un risque faible.
Quiconque s'imagine que tout cela n'est que de la théorie peut toujours aller voir comment des contrats de ce genre fonctionnent aux Etats-Unis. Il y est devenu courant, dans les divers états, que les entreprises privées offrent leurs services pour construire et gérer des prisons conformément aux normes publiques. Elles ne se bornent pas à construire les bâtiments ; elles offrent aussi aux états une économie substantielle sur le coût journalier d'entretien des prisonniers.
Pour la Grande-Bretagne, il serait donc tout à fait possible d'y ajouter un élément de risque qui paraîtrait suffisant aux fonctionnaires du Trésor — qui connaîtraient par ailleurs le coût du projet s'il était pris en main par les hommes de l'Etat — et semblerait suffisamment faible à des investisseurs privés en position de réaliser les économies de coût que l'on peut obtenir d'une gestion privée. Ainsi peut-on satisfaire à l'obligation d'introduire un élément de risque sans dissuader les investisseurs potentiels. On pourra souligner que cette procédure compliquée ne vise pas à faire apparaître un risque véritable, mais juste ce qu'il faut pour satisfaire aux exigences de la comptabilité publique.
Un avantage pour les finances publiques
On observe également que, si les investisseurs apprécient la rentabilité de leurs investissements en termes financiers, les hommes de l'Etat, de leur côté, font aussi un profit politique. Même si les calculs portent sur les coûts et la fréquentation éventuels, avec un projet mené à bien à l'aide de fonds privés, les hommes de l'Etat se retrouvent rapidement à la tête d'importants investissements pour lesquels ils n'auront pas eu à débourser un liard. Ils ont leur déviation, leur pont, leur tunnel, leur prison, leur musée ou leur station d'épuration, sans avoir dû augmenter les impôts ni l'endettement public. Ils en tirent aussi la gratitude de ceux qui accèdent à ces nouveaux équipements.
Bien sûr, il faudra bien que les hommes de l'Etat paient pour les mettre à leur disposition, mais cela passera beaucoup plus facilement, à bien des égards, que la dépense publique en capital. Les hommes de l'Etat, dans tous les cas de figure, doivent payer l'utilisation de leurs propres réalisations dans la mesure où ils les entretiennent et les gèrent ; ce qu'ils paient aux investisseurs couvre également ces coûts. En outre, les hommes de l'Etat ont l'habitude de dépenser à titre courant. Ils peuvent tout à fait se permettre de consacrer, pour plusieurs années, certaines sommes à la fourniture de certains services. Ce qu'ils ont de la peine à faire, c'est entretenir leur capital de façon suffisante, en échappant à l'attraction de la dépense courante.
Signalons encore que les paiements s'étalent sur plusieurs années, et même de nombreuses années. Les hommes de l'Etat, on le sait, ne sont pas très doués quand il s'agit de dépenser de l'argent aujourd'hui pour assurer une production à venir. Or, employer des capitaux privés pour construire des équipements publics est une réplique parfaite à cette pratique courante des hommes de l'Etat, de donner la prime au présent et de mettre l'avenir à l'encan : les investissements projetés sont construits immédiatement, alors que l'argent sera déboursé sur plusieurs années. Une bonne partie en sera payée par les contribuables à venir, qui n'ont pas grand chose à offrir sur le marché politique aujourd'hui. Ainsi, les électeurs d'aujourd'hui ont leurs équipements, et les électeurs de demain en supporteront une part substantielle. Du point de vue de l'élu en place, ce ne peut pas être une mauvaise affaire.
Une prise en compte réaliste des contraintes
Présenter ainsi les hommes de l'Etat n'est pas très flatteur pour eux ; mais il ne s'agit que de tenir compte des contraintes auxquelles ils sont soumis. En temps normal, l'autorité publique ne peut faire autrement que de rogner sur ses dépenses de capital, parce que la nécessité d'acquérir des bénéfices politiques la force à dépenser davantage du côté courant. La nouvelle proposition est artistiquement conçue de façon à compenser cette tendance au moyen d'un contrepoids institutionnel. Elle crée une situation dans laquelle le décideur public tire avantage d'une dépense immédiate en capital, avec un bénéfice politique instantané, alors que c'est le secteur privé qui l'a financé.
Corriger un défaut de fonctionnement inhérent au secteur public
Chacune des deux méthodes que nous venons d'examiner permet, dans une certaine mesure, de corriger un défaut de fonctionnement inhérent au secteur public. L'idée d'un droit effectif de recevoir le service force le secteur public à prêter aux besoins du consommateur une attention qu'il lui refuserait en son absence. L'idée d'utiliser des capitaux privés pour des projets publics permet à l'investissement public de fournir aux hommes de l'Etat des avantages politiques impossibles à obtenir autrement. Les deux méthodes illustrent une approche commune. L'analyse de la manière dont fonctionne le secteur public identifie le défaut, et la réforme est taillée sur mesure pour le corriger, ou du moins pour en atténuer l'impact.
Une gamme de techniques potentiellement illimitée
La liste de ces méthodes n'est naturellement pas fixe : il n'y a pas de gamme toute prête de techniques qui couvriraient tous les domaines. Un des traits majeurs de cette approche est que seule l'imagination du moment peut borner ses ambitions. Il n'y a pas d'autre limite de principe au nombre des procédés qu'on peut envisager pour pallier les défauts du secteur public. Une fois que l'on a compris le principe du marché politique, il devient possible d'y introduire des dispositifs capables de réorienter les forces qui s'y exercent. C'est là tout ce que la micropolitique se propose de faire.
NOTES
Notes du chapitre treize : approfondissements
- 1 La vente directe au privé, par exemple, tient éminemment compte de la nature et de la situation économique de l'entreprise concernée. Amersham International, entre autres, a été directement vendu par émission d'actions. Pas de campagne publicitaire massive : on a fait appel à des professionnels de la City pour piloter la vente sur le marché, comme ils le font régulièrement pour des sociétés privées. Vente en un bloc, 100% des actions étant mises en vente. Le cours a immédiatement grimpé, avec l'accusation standard d'avoir "bradé" l'entreprise aussitôt portée contre le gouvernement.
- La privatisation de British Petroleum, pour sa part, est passée quasiment inaperçue. C'était la première, soit dit en passant. Le gouvernement n'en possédait guère plus de 50%, la crise de 1976 ayant amené le Fonds Monétaire International à exiger du gouvernement travailliste qu'il vende quelques-unes de ses possessions. Ce qui provoqua la privatisation fut une vente décidée en 1979 qui conduisit le gouvernement à se retrouver avec moins de 50% du capital de la société. Elle était devenue privée suivant les critères du Trésor, comme si de rien n'était. Sa rentabilité s'accrut, l'action prit de la valeur, et le gouvernement fut ensuite en mesure de vendre d'autres tranches à des cours plus élevés.
- Pour Cable and Wireless, la vente initiale de 49,4 % du capital en 1981 fut suivie par une émission prioritaire en 1983 au cours de laquelle, n'exerçant pas son option, le gouvernement ne conserva que 45% des parts. Toutefois, la privatisation par accident ou à la dérobée n'est pas un choix habituel : les circonstances étaient uniques. Comme elles le sont toujours.
- Pour British Aerospace, on vendit un peu plus de la moitié des actions, avec une distribution aux employés, comme dans le cas d' Amersham et, pour empêcher la reprise d'une industrie "stratégique" par des étrangers, l'on utilisa pour la première fois la technique de l'action privilégiée. A l'exception de cette dernière, le gouvernement vendit d'ailleurs par la suite tout le reste de ses actions.
- National Freight Corporation, nous l'avons vu, fut vendue dans son intégralité au consortium formé par la direction et le personnel, avec l'assistance des banques. Les actionnaires étaient tenus de ne pas revendre leurs actions avant cinq ans. On commença par fermer les chantiers navals Redhead, puis on les vendit à un consortium du personnel qui les rouvrit. La chaîne hôtelière, les services de ferry-boats et d'aéroglisseurs de British Rail furent vendus séparément. Ce fut également le cas pour nombre de filiales d'autres entreprises d'Etat.
- La vente des actions de Cable et Wireless en 1981 eut lieu à prix fixe ; la tranche de 1983 se fit par soumission. Pour Britoil, c'était aussi le cas de la première vente en 1982, mais la tranche de 1985 fut vendue à prix fixe. La privatisation d' Enterprise Oil ne fit pas le plein des souscripteurs tandis que, pour les actions Jaguar, les gens se battaient dans les rues pour souscrire à temps. On offrit aux clients de British Telecom le choix entre des réductions sur leurs factures téléphoniques et des actions gratuites s'ils souscrivaient ; les usagers du gaz savaient au contraire qu'ils recevraient des actions privilégiées en plus des actions gratuites.
- 2 Lequel dépend pourtant des rapports de force dans la société politique, dont rien ne garantit qu'il soit pérenne : par exemple, les générations grugées par le système de retraites par répartition sont bien proches du moment où elles seront plus nombreuses dans l'électorat que les générations profiteuses. Que se passera-t-il alors ? A prendre pour argent comptant la "sécurité" que les hommes de l'Etat prétendent assurer, on raisonne comme si la politique ne comportait aucune incertitude ni aucun risque, ce que l'histoire ne confirme guère.
- 3 Cf. à ce sujet F.A. Hayek, Scientisme et sciences sociales, Paris, Agora, 1985.
Notes du chapitre quatorze : le rôle de la liberté du choix
- 1 Rappelons que, tout le monde étant forcé par l'impôt à payer les services pseudo-gratuits fournis par les hommes de l'Etat, ce choix revient à payer deux fois le service.
- 2 Si les hommes de l'Etat avaient monopolisé la fabrication des chaussures, les distribuant à titre pseudo-gratuit en interdisant toute offre privée, il se trouverait certainement une majorité de gens pour dire qu'une production privée de chaussures est impensable (c'est ce que tout le monde dit pour les billets de banque), et une quasi-unanimité pour prétendre que, s'il en allait autrement, "les pauvres iraient pieds nus" (c'est le raisonnement standard pour "justifier" le monopole d'Etat sur l'enseignement).
- 3 Ce qui est faire bon marché du coût principal des études, à savoir la rémunération du travail à laquelle on renonce en choisissant d'étudier à la place (son "coût d'opportunité", pour parler comme un économiste). Par ailleurs, à propos de redistribution "sociale", on peut souligner que la subvention étatique à l'enseignement est proportionnelle à la durée des études. Et qui fait les études les plus longues, sinon les enfants de la classe moyenne et supérieure ?
- 4 Il existe en Grande-Bretagne un système de retraites uniforme indépendant du revenu, complété par un système qui en dépend. C'est ce système complémentaire qui est en voie de privatisation.
- 5 Quand on parle d'"usagers", il ne s'agit évidemment pas des groupes de pression organisés qui prétendent représenter leurs intérêts, mais de classes importantes de consommateurs individuels. Nous avons vu qu'à l'expérience, les prétendus "représentants des usagers" se révèlent être des satellites des producteurs ou les représentants de lobbies idéologiques.
- 6 Les Organismes d'Entretien de la Santé [Health Maintenance Organizations] sont apparus aux Etats-Unis, à la suite d'une initiative spontanée des assureurs privés, pour faire face à une croissance excessive des dépenses de soins.
Notes du chapitre quinze : autres techniques
- 1 C'est le principe affirmé par la "Charte des citoyens" (Citizens' Charter) du gouvernement Major, sur les conseils de l'auteur [F.G.].
- 2 ... toutes ces choses qu'une entreprise privée fait normalement, parce que le marché l'y oblige spontanément. Si une entreprise privée ne les faisait pas, elle perdrait bien vite sa réputation et sa clientèle fondrait comme neige au soleil.
- 3 Cette dernière conclusion dépend évidemment de la raison d'être que l'on attribue au "service public" : si son principe n'est que de forcer les uns à payer le service rendu aux autres, sa fonction n'est pas atteinte ; en revanche, si l'on en attend aussi qu'il assure une vie douillette à ses employés en leur permettant de mépriser le public, alors le principe du "service public" est bel et bien entamé.
- 4 Ce terme poétique désigne ce qu'en France on appellerait le Premier Président de la Cour de Cassation [F.G.].
- 5 Les règles de la propriété ne le sont d'ailleurs pas moins. Quand la part de l'Etat passe de 50,1% à 49,9%, l'entreprise, comme par magie, entre tout-à-coup dans le secteur "privé".