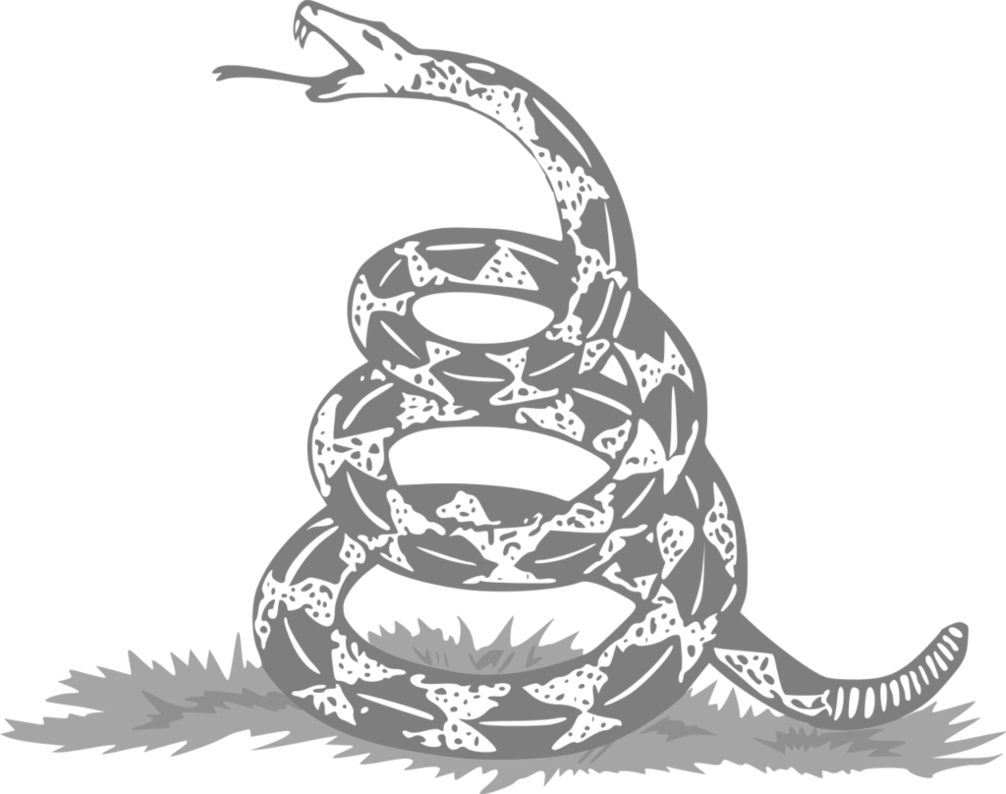Participation obligatoire dans les entreprises
LE PIEGE DE LA PARTICIPATION OBLIGATOIRE DANS LES ENTREPRISES
par Pascal Salin (1984)
Présentation
L'idée que l'Etat devrait organiser les relations à l'intérieur de l'entreprise en imposant la participation des salariés à la gestion possède une façade attrayante (1). La participation semble en effet correspondre à une exigence de respect des capacités de l'homme et à son besoin d'être maître de son sort au lieu de subir des décisions arbitraires qui lui sont imposées d'en-haut. On souligne souvent également qu'il est normal et juste de permettre aux salariés de « participer » à des décisions qui affecteront nécessairement leur situation future.
Malheureusement, ces opinions sont fausses, car elles reposent sur une vision mythique de l'entreprise et du [p. 8] comportement humain. Cela est d'autant plus grave qu'il ne s'agit pas d'un problème mineur : la mise en œuvre de la participation obligatoire introduit un principe dont le développement ultime conduit à la destruction du système de la libre entreprise. Or, c'est à ce système et à lui seul que des masses immenses d'hommes dans le monde doivent leur prospérité. Il ne faut pas s'y tromper, et c'est pourquoi nous croyons nécessaire de souligner ce risque de destruction, en particulier auprès des partis politiques et des chefs d'entreprise qui s'opposent par instinct à un changement de société, mais qui acceptent ou parfois même défendent l'idée de ce mode de participation par esprit de compromis, par mauvaise conscience, par manque de clairvoyance ou, tout simplement, faute d'information. Les ennemis de la libre entreprise sont plus profonds dans l'analyse et plus habiles dans l'action : ils ont compris les conséquences logiques de la participation forcée et ils se servent de ce mot pour les échos positifs qu'il rencontre chez beaucoup de gens. L'argument en faveur du pouvoir des travailleurs et de leurs justes droits à gérer les entreprises sert alors de prétexte, pour la confiscation du pouvoir, à des hommes qui ne peuvent pas satisfaire leurs ambitions par d'autres moyens.
On prendra peut-être conscience de l'importance du débat en comprenant que la participation forcée et organisée par la loi — c'est-à-dire celle qui est imposée par voie législative ou réglementaire — a trois conséquences principales : elle détourne l'entreprise de sa finalité naturelle, elle constitue un système d'exclusion et non de participation effective, elle empêche ceux qui mettent leur patrimoine financier à la disposition des entreprises de remplir une fonction sociale irremplaçable, à savoir la prise de risque. Nous analysons ci-dessous ces trois conséquences.
LA PARTICIPATION OBLIGATOIRE DETOURNE LES ENTREPRISES DE LEUR FINALITE
Une entreprise capitaliste libre est une organisation dont toutes les forces sont mises et doivent être mises au service de ses clients par l'intermédiaire du marché, où s'exprime la demande du consommateur. Elle constitue un ensemble de contrats entre des hommes qui désirent échanger quelque chose, qui se mettent ainsi au service des clients, et qui sont rémunérés en contrepartie de leur apport "de travail ou de capital. Le fait que le salarié reçoive un salaire et le possesseur du capital un revenu qui peut prendre la forme d'un dividende ou d'un gain en capital, ne signifie pas que l'entreprise soit au service des apporteurs de travail ou de capital. Bien au contraire, c'est parce qu'ils sont déjà payés en échange de leurs apports respectifs, conformément à des règles contractuelles, que l'entreprise ne doit pas être au service de ceux qui la constituent. Elle y perdrait toute sa finalité.
Le profit, en particulier, n'est pas le signe que l'entreprise fonctionne au service de l'actionnaire (celui qui permet d'agir, qui actionne) et des propriétaires d'entreprises en général. Il ne signifie pas que le propriétaire, l'actionnaire, qui décide d'affecter le capital, est un maître absolu, mais au contraire qu'il a bien obéi aux désirs de ses clients. Le profit ne représente pas davantage ce que l'entreprise prendrait au reste de la société ; il mesure au contraire la qualité de l'entreprise par ce qu'elle apporte à la société (différence entre la valeur créée et la valeur utilisée par la production). Il indique donc quelle est la valeur sociale effectivement créée et il incite à cette création ; l'actionnaire ne fait un profit que dans la mesure où son entreprise réussit à rendre à ses
[p. 9]clients plus de services qu'elle n'en utilise. S'il contrôle l'entreprise, c'est en contrepartie du fait qu'il est toujours servi en dernier dans la distribution de la valeur des ventes : il est « créancier résiduel », c'est-à-dire qu'il ne peut pas compter sur un revenu garanti par contrat — ce qui est le cas du salarié, par exemple — et qu'il ne peut espérer une rémunération que de ses efforts pour faire apparaître une différence entre la valeur des ventes et les coûts de production.
Il faut signaler que, si un actionnaire peut retirer son profit en capital en vendant ses actions, c'est un autre actionnaire qui le paye en les achetant. Le profit en capital n'est donc jamais retiré à l'entreprise et reste constamment à sa disposition. Le collège des actionnaires donne son argent pour toujours. C'est pourquoi on parle de « capitaux permanents ».
Comment la participation peut-elle alors s'insérer dans un tel schéma ? Les formes que peut prendre la participation sont évidemment très nombreuses et il n'est pas question ici de les discuter toutes. On peut, sans généraliser de manière excessive, distinguer deux grandes catégories de participation :
- la « participation aux fruits de l'entreprise » ;
- la participation aux décisions, stratégiques ou autres, de l'entreprise, que l'on peut appeler « cogestion ».
La « participation aux fruits de l'entreprise » peut être volontaire ou obligatoire.
a) Elle est volontaire lorsque, par exemple, elle résulte d'un contrat, le contrat de travail entre l'entreprise et le salarié incluant une disposition qui lie une par[p. 11]tie de la rémunération au profit de l'entreprise. Dans ce cas, l'entrepreneur estime par exemple que la possibilité de participer aux bénéfices constitue une motivation pour les salariés qui vaut plus pour lui qu'elle ne lui coûte. De même, la participation est volontaire si des salariés achètent des titres de leur entreprise. C'est alors en tant que capitalistes et non en tant que salariés qu'ils « participent » à l'entreprise. Il est d'ailleurs frappant de constater que rien ne s'oppose en Droit à ces formes de participation (partage contractuel du profit ou achat volontaire de titres par les salariés). Or, ces situations sont assez peu répandues. Faut-il comprendre qu'elles sont mieux adaptées à certaines entreprises qu'à d'autres ? La « participation obligatoire » impose donc aux propriétaires d'entreprises et aux salariés des arrangements qu'ils ne recherchent pas de façon habituelle.
Il est bien évident que toutes les expériences de participation sont bienvenues. Leur valeur vient précisément de ce qu'elles sont volontaires. C'est alors le rôle du marché que d'éliminer les formes de participation les moins efficaces.
b) Contrairement aux cas de « participation volontaire aux fruits de l'entreprise », les systèmes obligatoires de participation au profit sont critiquables. Ils peuvent imposer une distribution d'actions (dont la revente est contrôlée) de l'entreprise à ses salariés, ce qui signifie en fait qu'une partie du salaire est autoritairement affectée à un emploi déterminé. Cette « participation » obligatoire. inspire deux remarques.
Ce n'est pas l'intérêt des salariés que d'avoir « tous leurs leurs œufs dans le même panier », c'est-à-dire et leurs économies et leur emploi dans la même entreprise. C'est [p. 12] d'ailleurs pour cette raison qu'en l'absence de dispositions obligatoires les salariés achètent rarement des actions de leur entreprise. On peut même souligner que rien n'empêche en principe les salariés d'aller jusqu'à prendre le contrôle de leur entreprise en rachetant ses actions. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne le souhaitent pas : ils ont décidé d'être salariés et non entrepreneurs.
Par ailleurs, la gratuité d'un bien n'est jamais le meilleur moyen d'inciter à une bonne utilisation des ressources (2).
Dans le cas de la législation française, même si la distribution d'actions se traduit pour l'entreprise par une diminution d'impôts, une partie de l'achat obligatoire d'actions par les salariés est en fait financée par les propriétaires des entreprises. Certains capitalistes sont donc obligés de payer pour certains salariés, ceux à qui s'applique la législation sur la « participation ». Ce transfert n'a évidemment aucune justification logique, puisqu'on voit mal pourquoi le fait de travailler dans une grande entreprise donnerait le droit de recevoir de l'argent pris aux autres par la force.
Dans tous les cas de participation aux bénéfices, on peut se demander pourquoi il n'y a pas, par ailleurs, participation aux pertes. En effet, le profit est la rémunération du risque d'entreprise. En ce sens, la participation aux fruits de l'entreprise rencontre une critique semblable à celle que nous développons ci-après au sujet de la participation aux décisions : elle méconnaît la nature de l'entreprise et la nature du profit.
Sans revenir sur le problème des modalités de la participation, nous supposerons donc maintenant que, d'une[p. 13] manière ou d'une autre — participation obligatoire et importante au capital, représentation de délégués au conseil d'administration, etc. — les salariés « participent » aux décisions stratégiques de l'entreprise par l'intermédiaire de leurs représentants. Il en découle naturellement que cette participation affecte d'une manière ou d'une autre la répartition de la valeur produite par l'entreprise entre les différents acteurs concernés.
Imaginons donc le cas d'une entreprise traditionnelle quelconque, dans laquelle la participation des salariés aux décisions est un jour introduite. En supposant que les salariés soient tous d'accord sur les décisions à prendre (ce qui est loin d'être évident), quel peut être le comportement de leurs représentants, et dans quel sens vont-ils essayer de faire pencher les choix de l'entreprise ? On pourrait imaginer que l'intérêt des salariés et l'intérêt des capitalistes convergent ; en effet, plus l'entreprise est performante, plus les profits futurs et les salaires futurs ont de chances d'être élevés.
En fait, il n'en est rien car la « catégorie » des salariés n'est pas homogène et, en particulier, les salariés d'aujourd'hui ne sont pas obligatoirement les salariés de demain. Autrement dit, un salarié a nécessairement intérêt à obtenir aujourd'hui une part maximum des ressources existantes puisqu'il ne peut pas être certain qu'il restera dans l'entreprise. Il aurait bien tort de sacrifier des gains actuels certains pour obtenir des gains futurs incertains. S'il désire épargner aujourd'hui en renonçant à une consommation actuelle pour obtenir un gain futur, il a tout intérêt à tirer le maximum de l'entreprise et à placer une partie des ressources ainsi obtenues à l'extérieur de l'entreprise, en devenant propriétaire de biens réels — par exemple sa maison — ou d'actifs divers. C'est ce qui [p. 14] explique également le fait, déjà signalé, que les salariés décident rarement d'acheter des actions de leur propre entreprise. En poussant le raisonnement, on s'aperçoit que le salarié peut avoir intérêt à s'approprier non seulement une partie aussi grande que possible des ressources produites par l'entreprise dans le présent, mais aussi à consommer une partie du capital accumulé dans le passé par d'autres que lui-même. Il suffit pour cela d'empêcher le renouvellement intégral du capital. Ce choix sera évidemment encouragé si les salariés peuvent bénéficier de transferts publics sous forme de subventions destinées à « sauver » l'entreprise ainsi mise en difficulté et à maintenir l'emploi, ou s'ils peuvent bénéficier d'allocations-chômage en attendant de trouver un autre travail. Ce comportement est comparable à une activité de pillage organisé, mais il est tout à fait compréhensible et impuni aussi longtemps qu'il est légal. On pourrait le considérer comme un cas-limite mais il ne l'est pas, dans la mesure où la participation risque d'être prise en charge par des syndicats politisés, qui visent précisément à détruire le système de la libre entreprise.
Les propriétaires de l'entreprise, pour leur part, sont dans une autre situation. Le détenteur du capital a intérêt à la rentabilité future de l'entreprise parce que le but même de son investissement est d'obtenir un rendement dans l'avenir. Il en va de même qu'il laisse son capital dans l'entreprise ou qu'il le vende, puisque la valeur actuelle de ce capital dépend totalement de sa rentabilité future.
Autrement dit, la valeur de la force de travail d'un salarié (3) ne dépend pas nécessairement de la rentabilité future de l'entreprise où il se trouve à un moment donné.
[p. 15] Il peut librement transférer ce capital vers une autre entreprise sans dévalorisation, et il peut même espérer trouver un rendement supérieur dans une autre entreprise, c'est-à-dire une valorisation de son capital humain. Il n'en va pas de même pour le capital financier qui se trouve en quelque sorte « piégé » dans l'entreprise où il est investi. La valeur des capitaux placés dans une entreprise dépend des rendements futurs de cette entreprise et .un propriétaire ne peut pas protéger la valeur de son patrimoine en le transférant : la mise en cause de la rentabilité future de l'entreprise diminue la valeur actuelle du patrimoine transférable.
Il faut donc éviter que les salariés, c'est-à-dire des gens qui ont un intérêt à s'approprier immédiatement les ressources de l'entreprise, puissent imposer leurs vues à ceux dont la fonction est précisément d'en maintenir ou d'en accroître la valeur. C'est justement pourquoi l'organisation traditionnelle de l'entreprise, qui distingue soigneusement le rôle du détenteur du capital et le rôle du salarié, est un instrument incomparable de croissance économique, qui profite à tous. Par contraste, un système de cogestion est un système qui incite chaque salarié à sacrifier l'avenir au présent, de telle sorte que le résultat collectif de toutes les actions individuelles se traduit par une moins grande création de richesses. Tous y perdent, y compris les salariés. Ainsi la défense de la participation obligatoire, aussi compréhensible qu'elle puisse apparaître à première vue, repose sur une conception statique de l'organisation 'humaine (caractéristique au demeurant de la pensée socialiste) : il 'existerait comme par miracle une quantité donnée de ressources et il serait donc juste et même. efficace d'en organiser l'utilisation conformément aux vœux du plus grand nombre. Mais c'est l'existence même de ces richesses et leur création qui [p. 16] est alors mise en péril. Il n'y a pas un gâteau à partager, qui existerait en toutes circonstances : la participation diminue le rôle de ceux qui ont précisément pour fonction de faire augmenter la taille du gâteau. C'est pourquoi ceux qui critiquent l'ingérence de l'Etat en la matière ne le font pas parce qu'ils auraient un quelconque intérêt à défendre les actionnaires, les obligataires et les prêteurs contre les salariés, mais parce qu'ils ont le souci de défendre l'institution qui, par excellence, est créatrice de richesses pour le profit de tous, à savoir l'entreprise capitaliste. Il serait d'ailleurs plus exact de dire que l'entreprise est non pas une institution, mais un nœud de contrats. Et c'est pourquoi la participation forcée est étrangère à la nature même de l'entreprise : elle introduit une procédure imposée, nécessairement incompatible avec le caractère contractuel et donc volontaire de l'entreprise capitaliste. La participation obligatoire « institutionnalise » l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle substitue un statut de Droit publie au statut de Droit privé. Il n'est donc pas étonnant que son introduction dans un système d'économie de marché conduise à la collectivisation de ce système, ainsi que nous le verrons ultérieurement.
La participation freine la croissance des entreprises à un autre point de vue. La stratégie d'une entreprise est en effet nécessairement secrète face à la concurrence et même à l'espionnage industriel — en effet, la divulgation de ses plans stratégiques, du fait de la présence des représentants des salariés dans les conseils, représente un risque. D'autre part, on est moins incité à élaborer une bonne stratégie si l'on sait qu'elle sera connue de tous et qu'on ne pourra pas en obtenir tous les fruits qu'on pouvait en attendre. Pour les produits de haute technologie vers lesquels on s'oriente de plus en plus, le secret des recherches et des lancements sur le marché est évidem[p. 17]ment capital. Les producteurs que la participation oblige à révéler des informations sont désavantagés par rapport aux autres qui ne subissent pas les mêmes contraintes. Un pays où les entreprises sont gênées de la sorte est désavantagé par rapport aux autres.
En définitive, l'entreprise n'est pas et ne peut pas être une démocratie, tout au moins au sens très restrictif auquel on entend ce terme généralement. Il en est ainsi, fondamentalement, parce que l'entreprise est un ensemble de contrats et non une institution. Or, cela n'a pas de sens de gérer « démocratiquement » un contrat.
Par ailleurs, c'est la survie même de l'entreprise qui dépend de ceux qui la contrôlent : elle disparaît si elle cesse d'être au service de ses clients. L'Etat, lui, survit parfaitement, même lorsqu'il mécontente la grande majorité des citoyens dans l'exercice de telle ou telle activité. Le parallèle entre l'organisation de l'Etat et celle de l'entreprise est donc totalement fallacieux. Si la démocratie est nécessaire dans l'Etat, c'est parce que la nature de son action est de décider à la place des autres : le rôle de la règle majoritaire est — ou devrait être (4) — de permettre aux citoyens de mieux contrôler les dirigeants..
Mais, sur un marché libre, le contrôle des clients sur la marche de l'entreprise existe, d'emblée, le plus complètement possible.
La démocratie est donc nécessairement une forme moins parfaite et moins efficace de l'exercice de la liberté que ne l'est le marché : on n'est pas plus libre par la démocratie que par le marché, bien au contraire.
[p. 18] L'entreprise capitaliste est nécessairement au service de ses clients, mais elle tient compte de tous leurs choix, de leur intensité et de leur importance, alors que la règle majoritaire viole au moins les préférences de la minorité et parfois même celles du plus grand nombre.
On comprendra donc que la comparaison de la démocratie et du marché ne peut tourner qu'à l'avantage de ce dernier. En fait, si on définit la démocratie comme le pouvoir de décision du plus grand nombre, c'est le marché qui est la forme d'organisation la plus démocratique, puisque chaque acte d'achat permet au « peuple », la clientèle, de voter. Celui qui donne son sens à l'activité de l'entreprise, c'est le client (c'est-à-dire celui que l'on veut voir revenir librement). La participation obligatoire ne constitue donc pas un système d'organisation sociale plus « démocratique », puisqu'elle consiste à confisquer une partie des droits du « peuple » au profit d'une oligarchie singulièrement restrictive et fort imparfaitement associée aux buts de l'entreprise.
Par conséquent, s'il est vrai qu'en matière politique la démocratie représentative que nous connaissons est préférable à la dictature, parce qu'elle permet un contrôle, certes insuffisant, mais indéniable, d'une majorité de la population sur les titulaires du pouvoir (ce qui peut apporter des limites à l'exercice arbitraire de ce pouvoir), c'est à tort qu'on en tire la conclusion implicite que la règle majoritaire d'une démocratie représentative est la forme d'organisation sociale la meilleure, quelle que soit l'organisation concernée. Pour les entreprises, le contrôle extérieur assuré par les clients est incomparablement supérieur à celui que des électeurs peuvent assurer sur les pouvoirs publics, car il est continu et diversifié ; il ne s'agit pas d'un mandat en blanc, global, donné une fois [p. 19] pour plusieurs années, en vue de la fourniture de quantités incertaines de biens à des prix incertains (5). Par conséquent, si la règle majoritaire est meilleure que la dictature, l'introduire à la place du marché constitue une formidable régression de la liberté.
En outre, la façon dont le contrôle extérieur s'exerce n'a rien à voir avec l'organisation intérieure. Leur confusion est une véritable imposture intellectuelle, qui cherche à s'insinuer dans le secteur public comme dans l'entreprise : ainsi, la cogestion constitue une déviation semblable à celle qui conduit le « service public » à servir ses bureaucrates et ses politiciens plutôt que ses usagers. Elle aboutit à sacrifier le contrôle extérieur « démocratique » des clients pour mettre l'entreprise au service de ses salariés, en violant d'ailleurs les contrats qui constituent l'entreprise.
En effet, quand on insiste sur la cogestion dans l'entreprise au nom de la « démocratie », c'est par ignorance du véritable rôle de celle-ci dans l'organisation de l'Etat : les élections constituent un mode de contrôle extérieur des pouvoirs publics et non une modalité d'organisation interne de ces pouvoirs (6). Cela est si vrai que l'organisation de tout Etat repose sur le principe hiérarchique : le Premier ministre, le directeur de ministère ou le chef de bureau ne sont pas élus par les membres de leur administration. Les électeurs souhaitent que leurs élus poursuivent certains buts, mais en leur laissant pour cela lé choix des moyens. C'est un fait d'observation que [p. 20] le principe hiérarchique est toujours apparu comme le seul principe efficace d'organisation des pouvoirs publics. Il faut se méfier des bons apôtres qui proposent de prendre le pouvoir dans l'entreprise en prétendant l'exercer au nom du bien commun. C'est le marché libre qui met les entreprises au service du peuple. Et, sur le marché libre, c'est le rôle des consommateurs que d'exercer leur libre choix, c'est-à-dire d'éviter les gaspillages et les entraves à leur propre épanouissement. De la même manière, c'est le rôle des entreprises que de répondre par la diversité des produits et leurs qualités à l'exercice de ce libre choix.
LA PARTICIPATION EST UN SYSTEME D'EXCLUSION
[p. 21] Nous avons raisonné jusqu'à présent comme si les salariés d'une entreprise à un moment donné constituaient une catégorie homogène. En fait, il n'en est rien. C'est pourquoi la défense de la cogestion surestime les vertus d'un système représentatif et repose sur une conception irréaliste des relations internes dans l'entreprise. Il en résulte que la participation organisée ou réglementaire est en réalité un obstacle à la véritable participation.
Si l'entreprise était organisée autour d'un groupe de gardes-chiourme commandant des esclaves avec des pouvoirs absolus (7), on pourrait certes souhaiter une plus grande participation des esclaves et la suppression de l'esclavage. Ce n'est pas le cas. D'autant moins que l'efficacité de l'entreprise est liée à sa capacité à utiliser au mieux les aptitudes des individus aux différents échelons, mais surtout leur sens des responsabilités et leur imagination, c'est-à-dire leur aptitude à participer effectivement à la vie de l'entreprise. Une entreprise fondée sur un principe de commandement absolu et de non- participation est nécessairement condamnée dans une économie vraiment concurrentielle, contrairement d'ailleurs à ce qui se passe quand l'Etat réprime la concurrence et, en particulier, dans une société totalitaire ; son manque d'efficacité la rend peu compétitive et elle éprouve les plus grandes difficultés à recruter des salariés. L'entreprise est un lieu de coopération, plus ou moins parfait bien sûr, mais en tout cas bien réel. Et c'est la concurrence qui impose un système de participation extrêmement raffiné, où chacun a tendance à trouver sa place en fonction de son niveau de compétence et de sa personnalité et où il est incité à amé[p. 22] liorer sa position. Ceux qui apportent une aide réelle à la décision sont toujours écoutés dans une entreprise qui fonctionne bien.
Par rapport à ce système très subtil et organique de participation, la participation réglementaire s'inspire d'une vision technocratique dont la conséquence majeure est de tuer la participation effective en imposant une structure de décision parallèle.
Dans une entreprise soumise à la double discipline de la concurrence et du profit, les dirigeants sont obligés de chercher à faire participer chacun de façon adaptée à sa compétence et à ses responsabilités. Un système de participation réglementaire conduit, au contraire, à donner un pouvoir de décision aux moins productifs et aux moins responsables. En effet, ceux dont la position est la plus menacée dans l'entreprise, du fait de la mauvaise qualité de leur travail, de leur manque de compétence ou de leur moindre utilité pour l'entreprise, sont souvent ceux qui ont le plus intérêt à se faire élire et à consacrer du temps et des forces pour obtenir, au moyen de l'exercice du pouvoir, ce qu'ils ne peuvent pas nécessairement obtenir par leur travail et leurs capacités. Ils accroissent ainsi leurs chances d'obtenir des promotions, ils bénéficient d'un droit d'expression particulier ou diminuent leur risque d'être licenciés. La participation obligatoire aboutit non pas à la défense de l'intérêt général de l'entreprise, mais au contraire à la défense de quelques privilèges particuliers, de ceux dont la contribution est la moins utile à la collectivité. Cela peut expliquer l'attachement que lui vouent certains.
Ainsi, la participation réglementaire compromettra un effort de participation généralisée des salariés à la vie de l'entreprise, pour lui substituer une situation où quelques individus, les « représentants », obtiendront le [p. 23] monopole de la participation. Nous disposons de ce point de vue d'une expérience peut-être trop mal connue, mais qui illustre parfaitement la situation présentée ci-dessus, à savoir celle de l'Université française (8) : la loi d'orientation de 1968 y a précisément introduit des structures de décision où la démocratie représentative est censée avoir permis la participation. Malheureusement, les résultats en sont souvent désastreux : la vie intellectuelle est affectée par la constitution de clans et de stratégies électorales et par des préoccupations qui n'ont rien d'universitaire ; les décisions et les informations sont souvent monopolisées par les spécialistes de la prise du pouvoir, qui sont plus motivés par cet intérêt immédiat et personnel que par la pérennité et la qualité de l'Université ; la recherche de l'excellence au service des étudiants et de la connaissance y est bloquée par le maintien des situations acquises et des privilèges.
Il serait temps de reconnaître que le modèle de la démocratie représentative ne constitue pas le type le plus perfectionné de l'organisation humaine, contrairement au principe de liberté contractuelle, et qu'il constitue souvent le moyen de défendre certains intérêts particuliers et de court terme, au détriment des intérêts généraux et de long terme. Il aboutit à exclure ceux qui participaient à la prise de décision pour donner ce pouvoir de « participation » à quelques minorités. La « participation » dans les entreprises ne signifie pas que les responsabilités et le pouvoir de décision des salariés sont accrus, mais que les dirigeants syndicaux, en particulier, reçoivent sans contrepartie les pouvoirs de décision détenus par les proprié[p. 24]] taires de l'entreprise et mettent en péril les procédures de coopération qui existaient entre tous les membres de l'entreprise.
Les syndicats n'étant pas dépendants de l'entreprise, il faut se poser deux questions : quelles sanctions encourent-ils ? Devant qui sont-ils responsables ? Si la réponse à ces deux questions est facile pour les vrais partenaires de l'entreprise, elle ne l'est pas pour les syndicats. Elle le sera d'autant moins dans l'avenir, si l'extension de leurs privilèges les dispense d'avoir à rendre de vrais services aux salariés pour maintenir leur influence.
LA PARTICIPATION SUPPRIME LA FONCTION SOCIALE DU CAPITALISTE
[p. 25] L'organisation traditionnelle de l'entreprise, où la participation est adaptée aux fins de l'entreprise et non à un modèle préfabriqué, a permis la croissance fantastique des économies occidentales, et elle est le seul espoir des pays pauvres. Elle constitue en effet un moyen puissant — probablement le seul — de surmonter deux difficultés considérables de toute organisation sociale :
1. L'imputation de la valeur : la divergence apparente des intérêts entre les hommes conduit certains à proposer de résoudre cette difficulté par la recherche d'un consensus sur le partage des ressources entre différentes parties prenantes. En fait, seule la reconnaissance précise des droits de propriété nés de la production et leur transférabilité par l'échange libre fait disparaître les divergences' d'intérêt qui apparaissent nécessairement lorsque la définition de ces droits de propriété est insuffisante. La recherche d'un consensus sur la répartition des richesses (et non pas seulement sur les règles du jeu de la société) apparaît sans objet car elle est illégitime, dès lors que l'origine des droits de propriété est reconnue et que ceux-ci sont clairement définis et défendus (9).
En outre, l'entreprise a pour rôle non pas de répartir les richesses existantes, mais de créer de nouvelles richesses. Ceci implique que des hommes soient incités à produire ces richesses, du fait que les nouveaux droits de propriété issus de la production auront été reconnus et protégés le plus précisément possible.
[p. 26] 2. Le partage du risque : les inévitables incertitudes au sujet du futur ont pour conséquence qu'on ne peut pas garantir à tous un montant précis de ressources futures. C'est pourquoi, dans l'organisation traditionnelle des entreprises, le détenteur d'un capital peut choisir entre un emploi risqué (propriété d'un capital à risque) et un emploi non risqué (prêts, obligations) (10). De la même manière, le possesseur d'une compétence particulière peut choisir entre une fonction sans risque (le salariat) et une fonction risquée (un statut d'entrepreneur, par exemple d'industriel, de commerçant ou de membre d'une profession libérale).
La création d'une entreprise sous forme de société résulte ainsi d'un contrat par lequel différentes personnes mettent leur patrimoine en commun pour servir un marché, et proposent aux salariés des contrats par lesquels ils pourront offrir leurs compétences en échange d'une rémunération définie à l'avance.
Le principe de spécialisation — caractéristique des sociétés humaines — s'applique ici ; on obtient la plus grande valeur pour un produit en permettant à chacun de se spécialiser dans le type d'activité pour lequel il est relativement le plus apte : les fonctions du capitaliste et celles des salariés sont de nature différente. La participation réglementaire, pour sa part, mélange les genres.
Un salarié peut perdre son emploi, mais le paiement de son salaire-lui est en principe garanti aussi longtemps que l'emploi subsiste. De la même manière, un prêteur obligataire, dont le capital est censé être moins soumis au risque, subit tout de même, par exemple, le risque de [p. 27] défaillance de la part de son emprunteur. Mais le Droit a prévu de minimiser le risque — sans pouvoir évidemment le supprimer complètement — pour les salariés, en les plaçant parmi les premiers bénéficiaire de la répartition des actifs sociaux, et en accordant une priorité aux propriétaires de capital non risqué par rapport aux propriétaires de capital à risque.
Or, le développement économique implique nécessairement des paris sur le futur, et quelqu'un doit bien accepter le risque correspondant. On peut déplacer le poids du risque, on ne peut pas le supprimer. L'entreprise ne peut marcher que dans la mesure où il existe, une certaine répartition, décidée à l'avance, de la part de risque supportée par chacun. Une tâche et une rémunération librement acceptées à l'avance sont le lot de chacun et dépendent de la part de risque qu'il a prise.
Au salarié, l'employeur promet un certain nombre de choses précises dans le cadre d'un contrat de travail : un salaire, des conditions de travail et même des garanties d'emploi. De même promet-il une rémunération précise, à des dates déterminées, au porteur d'obligations ou au prêteur bancaire. D'autres apporteurs de capitaux acceptent de supporter le risque. C'est leur fonction, leur spécialité, et cette spécialisation des tâches n'est en rien différente de celle que l'on rencontre entre celui qui sait bâtir un mur et celui qui sait taper à la machine. Le maçon apporte sa compétence pour effectuer une tâche précise à des conditions précises. L'apporteur de capital à risque apporte son capital pour courir des risques précis à des conditions précises. L'un et l'autre refuseront leur concours si les conditions acceptées au départ sont violées par les uns ou par les autres et si on donne aux uns la tâche qui revient aux autres.
[p. 28] On considérerait comme anormale, inefficace et même immorale une situation où la loi autoriserait les apporteurs de capital non risqué à modifier à leur convenance le montant de leur rémunération, ou même à participer à un organisme de décision de l'entreprise habilité à accroître leur rémunération de manière discrétionnaire et c'est pourquoi leur rémunération — sans risque — est déterminée par contrat. Agir autrement consisterait à nier le contrat et à substituer une situation de conflit pur, c'est-à-dire de chaos, à une situation de droit. Aucun propriétaire d'entreprise n'emprunterait si l'on pouvait attribuer à volonté au capital non risqué un rendement plus important que le rendement prévu par le contrat. L'accroissement possible du rendement du second impliquerait une augmentation du risque pour le premier.
Il en est de même dans le cas de la participation des salariés aux décisions de l'entreprise. Elle rend plus aléatoire la rémunération du capital à risque. Le propriétaire du capital à risque sait bien qu'il doit faire face aux risques imprévus considérables qui tiennent à la nature même de la vie économique. Il s'y ajoute, dans les sociétés à économie administrative, l'incertitude due au fait que l'Etat peut, discrétionnairement et du jour au lendemain, modifier l'environnement de l'entreprise parce qu'il exerce un pouvoir arbitraire sans être directement responsable des conséquences de ses décisions. L'intervention continue de l'Etat dans le contrat d'entreprise raréfie le capital à risque — d'origine nationale ou étrangère — disposé à s'investir. Ajouter un pouvoir, lui aussi irresponsable, susceptible de modifier de manière imprévue le partage du produit dans l'entreprise, c'est évidemment accroître encore le risque supporté par les détenteurs de capital à risque et donc les décourager. Le risque qu'ils supportent est le fondement de leur responsabilité [p. 29] dans le fonctionnement de l'entreprise. Il est donc incohérent d'accroître encore le risque et de substituer à leur pouvoir responsable des pouvoirs totalement ou partiellement irresponsables puisque, nous l'avons vu, les représentants des salariés dans un système de participation ne sont pas incités à favoriser le rendement du capital et ne sont probablement pas les plus aptes à prendre les décisions favorables à l'entreprise, dont ils court-circuitent et paralysent la hiérarchie naturelle.
Ainsi l'argument déjà cité, selon lequel il serait normal que les salariés participent à la gestion de l'entreprise parce qu'ils sont affectés par les décisions prises, est dépourvu de sens, malgré sa bonne foi apparente. Il ignore en effet que le Droit exprime la nécessaire répartition des fonctions acceptée à l'avance dans toute organisation humaine et dans la société. Ce n'est pas après le départ, même si leur vie dépend de la conduite d'un avion, que les passagers doivent choisir qui pilotera et comment, et il serait absurde de leur part d'élire des représentants chargés de décider du pilotage. La revendication en faveur de la participation dans la conduite de l'entreprise est aussi absurde que le serait la revendication d'un opéré à participer à l'exécution de l'opération (11). C'est au moment de la répartition des risques que se distribuent les rôles. Le changement social et économique n'est possible que dans la mesure où certains sont spécialisés dans la prise de risque, que le risque porte sur leur capital ou sur leur force de travail (cas des industriels, commerçants, membres des professions libérales, etc.).
[p. 30] Leur activité procure aux autres une rémunération sans risque ou à risque plus faible pour leur capital ou pour leur travail. En les dépossédant d'une partie de leur pouvoir de décision, on accroît le risque pour ceux qui sont « preneurs de risque » dans une société. Or, c'est le rôle social des propriétaires ou actionnaires — appelés capitalistes — que de prendre les risques pour les autres. Ceci suppose que ce soit eux qui en subissent les conséquences et qui décident d'affecter les facteurs de production.
Si l'on autorisait par exemple un prêteur (propriétaire de capital non risqué) à décider des prix de vente ou des heures d'ouverture du magasin de l'épicier à qui il a prêté, ce dernier serait dessaisi d'une partie de son rôle d'entrepreneur et il serait découragé de pratiquer son métier. Il en va exactement de même avec la participation des salariés (propriétaires d'une ressource de travail non risquée). La participation ne supprime évidemment pas les risques normaux de l'activité économique ni les risques dus à l'action discrétionnaire de l'Etat ; mais elle fait peser des risques supplémentaires sur le capital à risque, qui se raréfie donc. Les épargnants préfèrent alors épargner moins, placer leur épargne à l'étranger, ou faire des placements non risqués. On en arrive finalement à une économie d'endettement et non plus de capital à risque (12). Il n'y a alors que deux solutions.
1. Ou bien il n'existe plus personne pour prendre en charge les risques du changement économique, et la société s'installe dans la stagnation. La lutte politique pour le partage des richesses — que l'on avait voulu évacuer par la participation — devient alors d'autant plus rude que le produit à partager est plus restreint. La [p. 31]société « de participation » devient une société d'hostilité mutuelle (que l'Etat prétend évidemment arbitrer comme acteur privilégié de la redistribution).
2. Ou bien l'Etat répartit le risque sur les contribuables, donc finance par l'impôt le changement social et économique, et il en résulte une société collectiviste, c'est-à-dire une société où le progrès (13) n'est plus orienté conformément aux désirs de la population : les libertés individuelles sont agressées et les libertés économiques n'existent plus.
il faut bien voir que nous sommes déjà dans ce dernier processus en France. L'accroissement de l'interventionnisme étatique, non seulement par la fiscalité mais aussi par les réglementations, et la pression croissante exercée par ceux qui sont censés représenter les salariés sur les décisions de l'entreprise, nous ont éloignés d'une économie de prise de risque. La faiblesse de l'investissement et le ralentissement de la croissance en sont évidemment le résultat, avec leurs conséquences naturelles sur l'emploi et la prospérité. L'avenir appartient justement aux pays qui sauront donner des structures d'accueil favorables aux capitaux à risque, c'est-à-dire aux capitaux permanents. Les hommes susceptibles de prendre le risque en charge ne sont pas nombreux. Il convient de ne pas les décourager, car c'est d'eux que dépendent le travail et la prospérité des autres. En limitant sans cesse davantage les pouvoirs des détenteurs de capitaux à risque et en augmentant les risques qui pèsent sur eux, les décideurs publics nuisent aux Français (14). La crise éco[p. 32]nomique n'a pas d'autre cause, et le développement de la « Participation des salariés » ne peut que nous enfoncer davantage dans une situation où personne ne peut être gagnant, sinon les hommes qui sont prêts à prendre définitivement en main les destinées individuelles des citoyens, c'est-à-dire ceux qui représentent les forces du totalitarisme.
Notes
1. Une première version de ce texte est parue dans Perspectives (février 1984). Je remercie François Guillaumat pour ses nombreuses et pertinentes remarques, ainsi qu'un groupe d'entrepreneurs qui m'ont fait bénéficier de leur expérience.
2. Cette gratuité n'est évidemment qu'apparente.
3. Ce qui est communément appelé son capital humain.
4. Celle-ci a malheureusement été détournée de son objet dans la plupart des cas : voir F. Hayek, Droit, législation et liberté, 3 vol., P.U.F., coll.. « Libre échange », Paris, 1980, 1982 et 1983.
5. C'est ce qui est admis de la part de l'Etat. Et pourtant, quelle entreprise pourrait prétendre à un monopole dam un pays, en proposant à des clients forcés de payer, de leur fournir des quantités incertaines de biens non spécifiés, en leur cachant combien il leur en coûtera exactement ?
6. Là encore, les discours qui réclament une « démocratisation » du secteur public se servent d'une confusion pour confisquer les pouvoirs de contrôle du peuple sur ses salariés en remettant ce rôle à des gens élus par eux-mêmes...
7. Ce qui serait nier, évidemment, sa nature contractuelle, et donc libre.
8. Il peut sembler contestable de comparer l'entreprise et une organisation bureaucratique (ce qu'est notamment, l'Université en France). En fait, la participation obligatoire tend à transformer l'entreprise en organisation bureaucratique et l'Université française fournit donc un exemple de ce qu'elle peut devenir. A contrario, l'entreprise libre fournit un modèle de ce que pourrait être l'Université si elle était en situation de concurrence.
9. « Toute richesse est produite par quelqu'un et elle appartient à quelqu'un. » Ayn Rand, « What is Capitalism ? », dans Capitalism, the Unknown Ideal, New American Library, New York, 1967.
10. Les variations violentes des taux d'intérêt, dues au caractère désordonné des politiques monétaires étatiques, ont cependant tendu à brouiller cette distinction.
11. Ici se rencontre l'exemple d'une déviation intellectuelle fréquente, celle qui consiste à établir des catégories arbitraires, en ignorant la relation entre les principes en cause, la diversité des hommes et le pluralisme social. Parce qu'on a décidé de diviser une société en « salariés » et « capitalistes », on demande que lu premiers puissent faire en partie le travail des seconds. Si on avait décidé de diviser la société en « maçons » et « non maçons », aurait-on parlé du « droit des non-maçons à participer à la construction des murs ». en partageant les profits éventuels de la construction, mais en laissant les maçons seuls responsables des pertes dues à l'effondrement de murs mal construits ?
12. Ce thème est développé dans « La crise financière mondiale est-elle inévitable 7 », rapport que j'ai présenté à la Conférence régionale de la Société du Mont-Pèlerin, Paris, 29 février — 3 mars 1984.
13. En effet, le fonctionnaire n'est pas incité à prendre les décisions favorables au progrès global, puisqu'il n'en tire aucun profit particulier. Il a plutôt intérêt à orienter à son profit les ressources existantes.
14. Cf. Ludwig von Mises : Politique économique, éd. de l'Institut Economique de Paris, 1983.
L'AUTEUR (1984)
Pascal SALIN a étudié aux Universités de Bordeaux et de Paris. Il a obtenu un doctorat en sciences économiques à Paris en 1965 et il a été reçu à l'agrégation de sciences économiques en 1966. Il a été successivement assistant à l'Université de Paris, maître de conférences à l'Université de Poitiers et à l'Université de Nantes, professeur à l'Université Paris-IX-Dauphine. Il a été professeur invité au Centre de Bologne de l'Université Johns Hopkins, consultant auprès du Fonds Monétaire International et expert auprès des Communautés européennes.
Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages, parmi lesquels Economie internationale (Paris, Armand Colin, 1974), L'unité monétaire européenne : au profit de qui ? (Paris, Economica, 1980, préface de Friedrich A. Hayek), L'ordre monétaire mondial (Paris, PUF, 1982) et, en collaboration avec Emil Claassen, Recent Issues in International Monetary Economics (Amsterdam, North Holland, 1976), L'Occident en désarroi (Paris, Dunod, 1978), Recent Issues in the Theory of Flexible Exchange Rates (Amsterdam, North-Holland, 1983). Il a dirigé la publication de Currency Competition and Monetary Union (La Haye, Martinus Nijhoff, 1984).
Résumé
1. La participation des employés aux décisions appartient à la vie même de l'entreprise. La double discipline de la concurrence et du profit oblige les entrepreneurs à associer tous ceux qui en sontcapables à la prise de décisions.
2. La participation obligatoire, imposée par la force publique, empêche les entreprises de trouver les formes de participation adaptées à leurs modes d'organisation et de production.
3. La participation forcée viole le consentement mutuel, traduit par les contrats qui forment le Droit dans l'entreprise. Loin de « réconcilier » les capitalistes et les travailleurs, elle accentue leurs divergences d'intérêt.
4. La raison d'être d'une entreprise est de servir ses clients qui la contrôlent parfaitement sur un marché libre. Lui imposer une représentation des salariés de type politique est un détournement de sa fonction.
5. Remplacer la coopération volontaire des individus par une organisation politique imposant des décisions collectives est une régression formidable de la liberté.
6. Rien n'empêche les salariés d'acheter la propriété de leurs entreprises. S'ils ne le font pas en général, c'est qu'ils ont mieux à faire de leur argent.
7. Les capitalistes sont les derniers servis dans la distribution des revenus de la production. C'est en échange de cette prise de risque — fonction spécialisée que les salariés ne veulent pas assumer — qu'ils contrôlent les entreprises.
8. La participation forcée l'associe au contrôle des ressources des gens qui n'en supportent pas directement les conséquences et dont les intérêts divergent de ceux de l'entreprise.
9. Elle assure ainsi des postes-de pouvoir à des gens dont l'action est étrangère, voire hostile, aux fins de l'entreprise.
10. La participation forcée introduit l'irresponsabilité qui gaspille les ressources. En collectivisant les entreprises, elle décourage l'accumulation du capital. Cette violation du Droit est donc nuisible à tous.