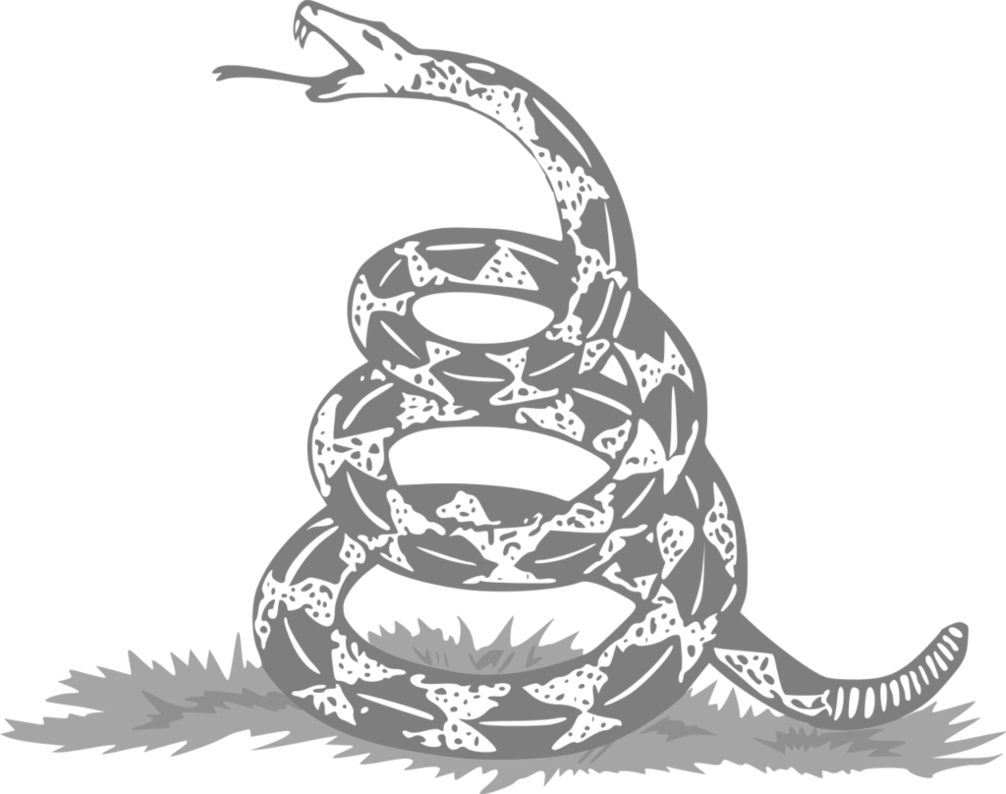Des droits individuels
(Note V de l’édition de 1818 des Réflexions sur les constitutions. Texte issu des Écrits politiques, Gallimard, Paris, 1997. Version PDF.)
Un écrivain très recommandable par la profondeur, la justesse et la nouveauté de ses pensées, Jérémie Bentham, s’est élevé récemment contre l’idée des droits et surtout contre celle de droits naturels, inaltérables ou imprescriptibles ; il a prétendu que cette notion n’était propre qu’à nous égarer, et qu’il fallait mettre à sa place celle de l’utilité, qui lui paraît plus simple et plus intelligible.
Comme la route qu’il a préférée l’a conduit à des résultats parfaitement semblables aux miens, je voudrais ne pas discuter contre sa terminologie. Je suis pourtant forcé de la combattre ; car le principe d’utilité, tel que Bentham nous le présente, me semble avoir les inconvénients communs à toutes les locutions vagues ; et il a de plus son danger particulier.
Nul doute qu’en définissant convenablement le mot d’utilité, l’on ne parvienne à tirer de cette notion précisément les mêmes conséquences que celles qui découlent du droit naturel et de la justice. En examinant avec attention toutes les questions qui paraissent mettre en opposition ce qui est utile et ce qui est juste, on trouve toujours que ce qui n’est pas juste n’est jamais utile. Mais il n’en est pas moins vrai que le mot d’utilité, suivant l’acceptation vulgaire, rappelle une notion différente de celle de la justice ou du droit. Or, lorsque l’usage et la raison commune attachent à ce mot une signification déterminée, il est dangereux de changer cette signification. On explique vainement ensuite ce qu’on a voulu dire ; le mot reste, et la signification s’oublie.
« On ne peut, dit Bentham, raisonner avec des fanatiques armés d’un droit naturel, que chacun entend comme il lui plaît, et applique comme il lui convient1. » Mais, de son aveu même, le principe d’utilité est susceptible de tout autant d’interprétations et d’applications contradictoires. « L’utilité, dit-il, a été souvent mal appliquée ; entendue dans un sens étroit, elle a prêté son nom à des crimes. Mais on ne doit pas rejeter sur le principe les fautes qui lui sont contraires, et que lui seul peut servir à rectifier2. » Comment cette apologie s’appliquerait-elle à l’utilité, et ne s’appliquerait-elle pas au droit naturel ? Le principe de l’utilité a ce danger de plus que celui du droit, qu’il réveille dans l’esprit des hommes l’espoir d’un profit et non le sentiment d’un devoir. Or, l’évaluation d’un profit est arbitraire : c’est l’imagination qui en décide. Mais ni ses erreurs, ni ses caprices ne sauraient changer la notion du devoir. Les actions ne peuvent pas être plus ou moins justes, mais elles peuvent être plus ou moins utiles. En nuisant à mes semblables, je viole leurs droits ; c’est une vérité incontestable : mais si je ne juge cette violation que par son utilité, je puis me tromper dans ce calcul, et trouver de l’utilité dans cette violation. Le principe de l’utilité est par conséquent bien plus vague que celui du droit normal. Loin d’adopter la terminologie de Bentham, je voudrais, le plus possible, séparer l’idée du droit de la notion de l’utilité. Ce n’est, comme je l’ai déjà dit, qu’une différence de rédaction ; mais elle est plus importante qu’on ne pense.
Le droit est un principe, l’utilité n’est qu’un résultat. Le droit est une cause, l’utilité n’est qu’un effet. Vouloir soumettre le droit à l’utilité, c’est vouloir soumettre les règles éternelles de l’arithmétique à nos intérêts de chaque jour.
Sans doute il est utile, pour les transactions des hommes entre eux, qu’il existe entre les nombres des rapports immuables : mais si l’on prétendait que ces rapports n’existent que parce qu’il est utile que cela soit ainsi, l’on ne manquerait pas d’occasions où l’on prouverait qu’il serait infiniment plus utile de faire plier ces rapports. L’on oublierait que leur utilité constante vient de leur immuabilité ; et, cessant d’être immuables, ils cesseraient d’être utiles. Ainsi l’utilité, pour avoir été trop favorablement traitée en apparence, et transformée en cause, au lieu qu’elle doit rester effet, disparaîtrait bientôt totalement elle-même. Il en est ainsi de la morale et du droit. Vous détruisez l’utilité par cela seul que vous la placez au premier rang. Ce n’est que lorsque la règle est démontrée, qu’il est bon de faire ressortir l’utilité qu’elle peut avoir.
Je le demande à l’auteur même que je réfute. Les expressions qu’il veut nous interdire ne rappellent-elles pas des idées plus fixes et plus précises que celles qu’il prétend leur substituer ? Dites à un homme : « Vous avez le droit de n’être pas mis à mort ou dépouillé arbitrairement » ; vous lui donnez un bien autre sentiment de sécurité et de garantie que si vous lui dites : « Il n’est pas utile que vous soyez mis à mort, ou dépouillé arbitrairement. » On peut démontrer, et je l’ai déjà reconnu, qu’en effet cela n’est jamais utile. Mais en parlant du droit, vous présentez une idée indépendante de tout calcul. En parlant de l’utilité, vous semblez inviter à remettre la chose en question en la soumettant à une vérification nouvelle.
« Quoi de plus absurde, s’écrie l’ingénieux et savant collaborateur de Bentham, M. Dumont de Genève3, que des droits inaliénables qui ont toujours été aliénés, des droits imprescriptibles qui ont toujours été prescrits ! » Mais en disant que ces droits sont inaliénables ou imprescriptibles, on dit simplement qu’ils ne doivent pas être aliénés, qu’ils ne doivent pas être prescrits. On parle de ce qui doit être, non de ce qui est. Bentham, en réduisant tout au principe de l’utilité, s’est condamné à une évaluation forcée de ce qui résulte de toutes les actions humaines, évaluation qui contrarie les notions les plus simples et les plus habituelles. Quand il parle de la fraude, du vol, etc., il est obligé de convenir que, s’il y a perte d’un côté, il y a gain de l’autre ; et alors son principe, pour repousser des actions pareilles, c’est que bien de gain n’est pas équivalent à mal de perte. Mais le bien et le mal étant séparés, l’homme qui commet le vol trouvera que son gain lui importe plus que la perte d’autrui. Toute idée de justice étant mise hors de la question, il ne calculera plus que le gain qu’il fait ; il dira : « Gain pour moi est plus qu’équivalent à perte d’autrui. » Il ne sera donc retenu que par la crainte d’être découvert. Tout motif moral est anéanti par ce système.
En repoussant le premier principe de Bentham, je suis loin de méconnaître le mérite de cet écrivain : son ouvrage est plein d’idées neuves et de vues profondes : toutes les conséquences qu’il tire de son principe sont des vérités précieuses en elles-mêmes. C’est que ce principe n’est faux que par sa terminologie : dès que l’auteur parvient à s’en dégager, il réunit dans un ordre admirable les notions les plus saines sur l’économie politique, sur les précautions que doit prendre le gouvernement pour n’intervenir dans les affaires des individus que lorsque cela est indispensable, sur la population, sur la religion, sur le commerce, sur les lois pénales, sur la proportion des châtiments aux délits ; mais il lui est arrivé, comme à beaucoup d’auteurs estimables, de prendre une rédaction pour une découverte, et de tout sacrifier à cette rédaction.
Je suis donc resté fidèle à la manière de parler usitée, parce qu’au fond je crois qu’elle est plus exacte, et aussi parce que je crois qu’elle est plus intelligible.
J’établis que les individus ont des droits, et que ces droits sont indépendants de l’autorité sociale, qui ne peut leur porter atteinte sans se rendre coupable d’usurpation.
Il en est de l’autorité comme de l’impôt ; chaque individu consent à sacrifier une partie de sa fortune pour subvenir aux dépenses publiques, dont le but est de lui assurer la jouissance paisible de ce qu’il conserve ; mais si l’État exigeait de chacun la totalité de sa fortune, la garantie qu’il offrirait serait illusoire, puisque cette garantie n’aurait plus d’application. De même chaque individu consent à sacrifier une partie de sa liberté pour assurer le reste ; mais si l’autorité envahissait toute sa liberté, le sacrifice serait sans but.
Cependant, quand elle envahit, que faut-il faire ? Nous arrivons à la question de l’obéissance à la loi, l’une des plus difficiles qui puisse attirer l’attention des hommes. Quelque décision que l’on hasarde sur cette matière, on s’expose à des difficultés insolubles. Dira-t-on qu’on ne doit obéir aux lois qu’autant qu’elles sont justes ? On autorisera les résistances les plus insensées ou les plus coupables ; l’anarchie sera partout. Dira-t-on qu’il faut obéir à la loi, en tant que loi, indépendamment de son contenu et de sa source ? On se condamnera à obéir aux décrets les plus atroces et aux autorités les plus illégales.
De très beaux génies, des raisons très fortes, ont échoué dans leurs tentatives pour résoudre ce problème.
Pascal4 et le chancelier Bacon ont cru qu’ils en donnaient la solution, quand ils affirmaient qu’il fallait obéir à la loi sans examen. « C’est affaiblir la puissance des lois, dit le dernier, qu’en rechercher les motifs5. » Approfondissons le sens rigoureux de cette assertion.
Le nom de loi suffira-t-il toujours pour obliger l’homme à l’obéissance ? Mais si un nombre d’hommes ou même un seul homme sans mission (et pour embarrasser ceux que je vois d’ici s’apprêter à me combattre, je personnaliserai la chose, et je leur dirai : soit le Comité de salut public, soit Robespierre), intitulaient loi l’expression de leur volonté particulière, les autres membres de la société seront-ils tenus de s’y conformer ? L’affirmative est absurde ; mais la négative implique que le titre de loi n’impose pas seul le devoir d’obéir, et que ce devoir suppose une recherche antérieure de la source d’où part cette loi.
Voudra-t-on que l’examen soit permis, lorsqu’il s’agira de constater si ce qui nous est présenté comme une loi part d’une autorité légitime ; mais que, ce point éclairci, l’examen n’ait plus lieu sur le contenu même de la loi ?
Que gagnera-t-on ? Une autorité n’est légitime que dans ses bornes ; une municipalité, un juge de paix sont des autorités légitimes, tant qu’elles ne sortent pas de leur compétence. Elles cesseraient néanmoins de l’être, si elles s’arrogeaient le droit de faire des lois. Il faudra donc, dans tous les systèmes, accorder que les individus peuvent faire usage de leur raison, non seulement pour connaître le caractère des autorités, mais pour juger leurs actes ; de là résulte la nécessité d’examiner le contenu aussi bien que la source de la loi.
Remarquez que ceux même qui déclarent l’obéissance implicite aux lois quelles qu’elles soient, de devoir rigoureux et absolu, exceptent toujours de cette règle la chose qui les intéresse. Pascal en exceptait la religion ; il ne se soumettait point à l’autorité de la loi civile en matière religieuse, et il brava la persécution par sa désobéissance à cet égard.
L’auteur anglais, que j’ai cité ci-dessus, a établi que la loi seule créait des délits, et que toute action prohibée par la loi devenait un crime. « Un délit, dit-il, est un acte dont il résulte du mal ; or, en attachant une peine à une action, la loi fait qu’il en résulte du mal6. » À ce compte, la loi peut attacher une peine à ce que je sauve la vie de mon père, à ce que je le livre au bourreau. En sera-ce assez pour faire un délit de la piété filiale ? Et cet exemple, tout horrible qu’il est, n’est pas une vaine hypothèse. N’a-t-on pas vu condamner, au nom de la loi, des pères pour avoir sauvé leurs enfants, des enfants pour avoir secouru leurs pères ?
Bentham se réfute lui-même lorsqu’il parle des délits imaginaires. Si la loi suffisait pour créer les délits, aucun des délits créés par la loi ne serait imaginaire. Tout ce qu’elle aurait déclaré délit serait tel.
L’auteur anglais se sert d’une comparaison très propre à éclaircir la question. « Certains actes innocents par eux-mêmes, dit-il, sont rangés parmi les délits, comme chez certains peuples des aliments sains sont considérés comme des poisons7. » Ne s’ensuit-il pas que, de même que l’erreur de ces peuples ne convertît pas en poison ces aliments salubres, l’erreur de la loi ne convertit pas en délits les actions innocentes ? Il arrive sans cesse que, lorsqu’on parle de la loi abstraitement, on la suppose ce qu’elle doit être; et quand on s’occupe de ce qu’elle est, on la rencontre tout autre : de là des contradictions perpétuelles dans les systèmes et les expansions.
Bentham a été entraîné dans des contradictions de ce genre par son principe d’utilité, que je crois avoir réfuté plus haut.
Il a voulu faire entièrement abstraction de la nature dans son système de législation et il n’a pas vu qu’il ôtait aux lois tout à la fois leur sanction, leur base et leur limite. Il a été jusqu’à dire que toute action, quelque indifférente qu’elle fût, pouvait être prohibée par la loi, c’était à la loi que nous devions la liberté de nous asseoir ou de nous tenir debout, d’entrer ou de sortir, de manger ou de ne pas manger, parce que la loi pourrait nous l’interdire. Nous devons cette liberté à la loi, comme le vizir, qui rendait chaque jour grâces à Sa Hautesse d’avoir encore sa tête sur les épaules, devait au sultan de n’être pas décapité ; mais la loi qui aurait prononcé sur ces actions indifférentes, n’aurait pas été une loi, mais un despote.
Le mot de loi est aussi vague que celui de nature ; en abusant de celui-ci, l’on renverse la société ; en abusant de l’autre, on la tyrannise. S’il fallait choisir entre les deux, je dirais que le mot de nature réveille au moins une idée à peu près la même chez tous les hommes, tandis que celui de loi peut s’appliquer aux idées les plus opposées.
Quand, à d’horribles époques, on nous a commandé le meurtre, la délation, l’espionnage, on ne nous les a pas commandés au nom de la nature, tout le monde aurait senti qu’il y avait contradiction dans les termes. On nous les a commandés au nom de la loi, et il n’y a plus eu de contradiction.
L’obéissance à la loi est un devoir : mais, comme tous les devoirs, il n’est pas absolu, il est relatif ; il repose sur la supposition que la loi part d’une source légitime, et se renferme dans de justes bornes. Ce devoir ne cesse pas, lorsque la loi ne s’écarte de cette règle qu’à quelques égards. Nous devons au repos public beaucoup de sacrifices ; nous nous rendrions coupables aux yeux de la morale, si, par un attachement trop inflexible à nos droits, nous troublions la tranquillité, dès qu’on nous semble, au nom de la loi, leur porter atteinte. Mais aucun devoir ne nous lie envers des lois telles que celles que l’on faisait, par exemple, en 1793, ou même plus tard, et dont l’influence corruptrice menace les plus nobles parties de notre existence. Aucun devoir ne nous lierait envers des lois qui, non seulement restreindraient nos libertés légitimes, et s’opposeraient à des actions qu’elles n’auraient pas le droit d’interdire, mais qui nous en commanderaient de contraires aux principes éternels de justice ou de pitié, que l’homme ne peut cesser d’observer sans démentir sa nature.
Le publiciste anglais que j’ai réfuté précédemment convient lui-même à cette vérité. « Si la loi, dit-il, n’est pas ce qu’elle doit être, faut-il lui obéir, faut-il la violer ? Faut-il rester neutre entre la loi qui ordonne le mal et la morale qui le défend ? Il faut examiner si les maux probables de l’obéissance sont moindres que les maux probables de la désobéissance. » Il reconnaît ainsi, dans ce passage, les droits du jugement individuel ; droits qu’il conteste ailleurs.
La doctrine d’obéissance illimitée à la loi a fait sous la tyrannie, et dans les orages des révolutions, plus de maux, peut-être, que toutes les autres erreurs qui ont égaré les hommes. Les passions les plus exécrables se sont retranchées derrière cette forme, en apparence impassible et impartiale, pour se livrer à tous les excès. Voulez-vous rassembler, sous un seul point de vue, les conséquences de cette doctrine ? Rappelez-vous que les empereurs romains ont fait des lois, que Louis XI a fait des lois, que Richard III a fait des lois, que le comité de salut public a fait des lois.
Il est donc nécessaire de bien déterminer quels droits le nom de loi, attaché à certains actes, leur donne sur notre obéissance, et, ce qui est encore différent, quels droits il leur donne à notre concours. Il est nécessaire d’indiquer les caractères qui font qu’une loi n’est pas une loi.
La rétroactivité est le premier de ces caractères. Les hommes n’ont consenti aux entraves des lois que pour attacher à leurs actions des conséquences certaines, d’après lesquelles ils pussent se diriger, et choisir la ligne de conduite qu’ils voulaient suivre. La rétroactivité leur ôte cet avantage. Elle rompt la condition du traité social. Elle dérobe le prix du sacrifice qu’elle a imposé.
Un second caractère d’illégalité dans les lois, c’est de prescrire des actions contraires à la morale. Toute loi qui ordonne la délation, la dénonciation, n’est pas une loi ; toute loi portant atteinte à ce penchant qui commande à l’homme de donner un refuge à quiconque lui demande asile, n’est pas une loi. Le gouvernement est institué pour surveiller ; il a ses instruments pour accuser, pour poursuivre, pour découvrir, pour livrer, pour punir ; il n’a point le droit de faire retomber sur l’individu, qui ne remplit aucune mission, ces devoirs nécessaires, mais pénibles. Il doit respecter dans les citoyens cette générosité qui les porte à plaindre et à secourir, sans examen, le faible frappé par le fort.
C’est pour rendre la pitié individuelle inviolable, que nous avons rendu l’autorité publique imposante. Nous avons voulu conserver en nous les sentiments de la sympathie, en chargeant le pouvoir des fonctions sévères qui auraient pu blesser ou flétrir ces sentiments.
Toute loi qui divise les citoyens en classes, qui les punit de ce qui n’a pas dépendu d’eux, qui les rend responsables d’autres actions que les leurs, toute loi pareille n’est pas une loi. Les lois contre les nobles, contre les prêtres, contre les pères des déserteurs, contre les parents des émigrés, n’étaient pas des lois.
Voilà le principe : mais qu’on n’anticipe pas sur les conséquences que j’en tire. Je ne prétends nullement recommander la désobéissance. Qu’elle soit interdite, non par déférence pour l’autorité qui usurpe, mais par ménagement pour les citoyens que des luttes inconsidérées priveraient des avantages de l’état social. Aussi longtemps qu’une loi, bien que mauvaise, ne tend pas à nous dépraver ; aussi longtemps que l’autorité n’exige de nous que des sacrifices qui ne nous rendent ni vils ni féroces, nous y pouvons souscrire. Nous ne transigeons que pour nous. Mais si la loi nous prescrivait, comme elle l’a fait souvent durant des années de troubles, si elle nous prescrivait, dis-je, de fouler aux pieds et nos affections et nos devoirs ; si, sous le prétexte absurde d’un dévouement gigantesque et factice à ce qu’elle appelle tour à tour république ou monarchie, elle nous interdisait la fidélité à nos amis malheureux ; si elle nous commandait la perfidie envers nos alliés, ou même la persécution envers nos ennemis vaincus : anathème et désobéissance à la rédaction d’injustices et de crimes ainsi décorée du nom de loi !
Un devoir positif, général, sans restriction, toutes les fois qu’une loi paraît injuste, c’est de ne pas s’en rendre l’exécuteur. Cette force d’inertie n’entraîne ni bouleversement, ni révolution, ni désordre ; et c’eût été certes un beau spectacle, si, quand l’iniquité gouvernait, on eût vu des autorités coupables rédiger en vain des lois sanguinaires, des proscriptions en masse, des arrêtés de déportation, et ne trouvant dans le peuple immense et silencieux qui gémissait sous leur puissance, nul exécuteur de leurs injustices, nul complice de leurs forfaits.
Rien n’excuse l’homme qui prête son assistance à la loi qu’il croit inique ; le juge qui siège dans une cour qu’il croit illégale, ou qui prononce une sentence qu’il désapprouve ; le ministre qui fait exécuter un décret contre sa conscience ; le satellite qui arrête l’homme qu’il sait innocent, pour le livrer à ses bourreaux.
La terreur n’est pas une excuse plus valable que les autres passions infâmes. Malheur à ces hommes éternellement comprimés, à ce qu’ils nous disent, agents infatigables de toutes les tyrannies existantes, dénonciateurs posthumes de toutes les tyrannies renversées ! On nous alléguait, à une époque affreuse, qu’on ne se faisait l’agent des lois injustes, que pour en affaiblir la rigueur, et que le pouvoir, dont on consentait à se rendre le dépositaire, aurait causé plus de mal encore s’il eût été remis à des mains moins pures. Transaction mensongère, qui ouvrait à tous les crimes une carrière sans bornes ! Chacun marchandait avec sa conscience, et chaque degré d’injustice trouvait de dignes exécuteurs. Je ne vois pas pourquoi, dans ce système, on ne serait pas le bourreau de l’innocence, sous le prétexte qu’on l’étranglerait plus doucement.
Et même, dans ce qu’ils nous disent, ces hommes nous trompent. Nous en avons eu d’innombrables preuves durant la révolution. Ils ne se relèvent jamais de la flétrissure qu’ils ont acceptée ; jamais leur âme, brisée par la servitude, ne peut reconquérir son indépendance. En vain, par calcul, ou par complaisance, ou par pitié, nous feignons d’écouter les excuses qu’ils nous balbutient ; en vain nous nous montrons convaincus que, par un inexplicable prodige, ils ont retrouvé tout à coup leur courage longtemps disparu : eux-mêmes n’y croient pas. Ils ont perdu la faculté d’espérer d’eux-mêmes ; et leur tête, pliée sous le joug qu’elle a porté, se courbe d’habitude et sans résistance pour recevoir un joug nouveau.
Notes
1 J. Bentham, Traités de législation civile et pénale, précédés de Principes généraux de législation, Paris, an X (1802), 3 vol. « Le principe de l’utilité, dit Bentham, consiste à partir du calcul, ou de la comparaison des peines et des plaisirs dans toutes les opérations du jugement et à n’y faire entrer aucune autre idée. Je suis partisan du principe de l’utilité lorsque je mesure mon approbation ou ma désapprobation d’un acte privé ou public sur sa tendance à produire des peines et des plaisirs ; lorsque j’emploie les termes juste, injuste, moral, immoral, bon, mauvais, comme des termes collectifs qui renferment des idées de certaines peines et de certains plaisirs et qui n’ont aucun autre sens » (op. cit., tome premier, p. 4). Le propos cité par Constant vient des Principes généraux de législation, Traités, op. cit., tome premier, chapitre XIII, p. 136.
2 Principes généraux de législation, dans les Traités de législation, op. cit., tome premier, chapitre v, p. 27.
3 Dumont, ministre protestant genevois, secrétaire de Bentham pendant vingt ans, et son traducteur, présentateur et commentateur en français.
4 Pascal : « La justice est ce qui est établi ; et ainsi toutes nos lois établies seront nécessairement tenues pour justes sans être examinées, puisqu’elles sont établies », Pensées, n° 312 de l’éd. Brunschvicg, Paris, Hachette, 1897, p. 475. Brunschvicg a ramassé dans la section V de son édition les multiples variations de Pascal sur ce thème (op. cit., pp. 464-485).
5 Nous n’avons pu situer exactement la formule dans le livre huitième du traité De la dignité et de l’accroissement des sciences (1623), chapitre III, « Exemple d’un traité sommaire sur la justice universelle, et sur les sources du droit », que Constant avait sans doute en vue (cf. par exemple Œuvres de F. Bacon, traduit par F. Riaux, Paris, 1843, tome premier, pp. 422-444).
6 Vue générale d’un corps complet de législation, dans les Traités de législation civile et pénale, op. cit., tome premier, p. 158.
7 Code pénal, dans les Traités de législation civile et pénale, op. cit., vol. II, pp. 380-384.