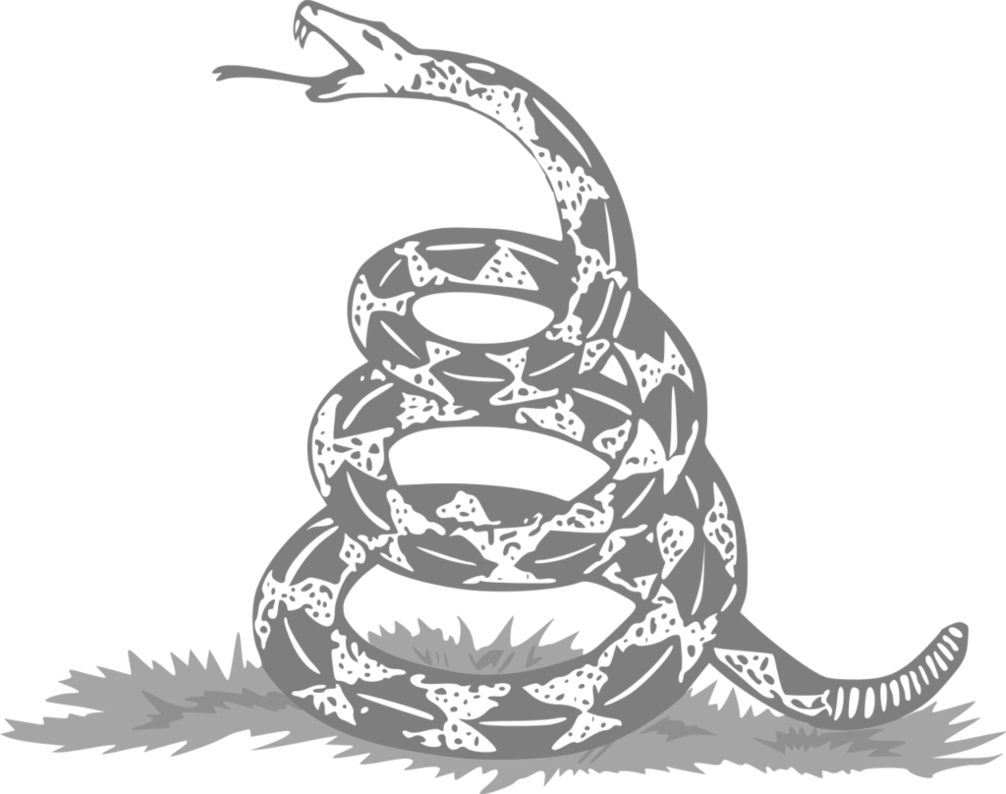L'économie politique contre l'économie mathématique
TEXTE EN TRAVAUX Par Juan Carlos Cachanosky*
- "The greatest claim that can be made for the mathematical method is that it necessarily leads to good economic theory"
- G.J. Stigler
- "[The mathematical method] is an entirely vicious method, starting from false assumptions and leading to fallacious inferences"
- L. von Mises
- ["Il existe un accord tacite entre tous les économistes mathématiciens pour ne pas révéler les nombreuses contradictions que contiennent les postulats sur lesquels ils fondent leurs recherches. Le concept d'une action humaine se référant à un avenir qui ne serait en rien inconnu est inconcevable/ La vie de gens pour qui l'avenir ne contiendrait rien d'inconnu est si différente de celle que nous connaissons qu'aucune imagination n'est assez puissante pour s'en faire une idée. Est-ce qu'on pourrait seulement appeler cela une vie au sens où nous l'entendons ? "
- Ludwig von Mises, "Bemerkungen über die mathematische Behandlung nationalökonomischer Probleme", Studium Generale VI N°2, 1953, Springer Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg,
traduit par Helena Ratzka comme : "Comment about the Mathematical Treatment of Economic Problems", Journal of Libertarian Studies, Vol.1 n°2, pp. 97-100, Pergamon Press, 1977. http://www.mises.org/journals/jls/1_2/1_2_2.pdf]
1 INTRODUCTION**
Comme on peut le constater dans les citations de ces deux prestigieux économistes que sont Stigler et Mises, la différence d'opinion quant à l'usage de la mathématique en économie n'est pas précisément une question de nuance. Quoique le débat ait déjà plus d'une centaine d'années, ces deux positions diffèrent, pour le dire en termes mathématiques, de 180 degrés. Si les théorèmes économiques pouvaient se déduire indifféremment en utilisant les mathématiques ou le langage ordinaire, la question ne serait pas si importante ; chacun choisirait ce qu'il trouverait le plus commode. Cependant, le problème est bien plus profond : certains économistes mathématiciens ont soutenu qu'il existe des théorèmes économiques qu'on ne peut pas déduire sans se servir des mathématiques . Pour leur part, les économistes "littéraires", en particulier ceux de l'école autrichienne, affirment que la mathématique ne peut pas rendre compte des problèmes de l'ajustement sur le marché []. Ainsi, le débat est important parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas une pondération de la rigueur déductive de la mathématique respectivement à celle de la logique verbale : c'est la possibilité, en science économique, de faire usage de l'une ou l'autre méthode.
Dans cet article, j'essaierai de démontrer que l'emploi de la méthode mathématique est impossible en économie, si ce que l'économiste cherche à faire est de développer des théories applicables à la réalité. Naturellement, n'importe qui est libre de faire de la gymnastique intellectuelle en inventant des modèles mathématiques détachés du réel, mais cette activité ne devrait pas être incluse dans la théorie économique, n'étant que de la mathématique pure. Malgré l'affirmation de Stigler suivant laquelle l'économie mathématique "conduit nécessairement à de la bonne théorie économique", il existe un grand nombre de modèles mathématiques qui conduisent à des résultats divergents ; il n'est que de se référer aux collections d'Econometrica. Si nous suivions Stigler, nous devrions conclure que tous sont "nécessairement" bons ; une étude spécifique de ces modèles nécessiterait d'écrire un traité, peut-être en plusieurs volumes, et non un petit article.
Le problème est en fait semblable à celui de la planification économique. On peut dire qu'il existe autant de "plans" que de planificateurs. Pour démontrer les erreurs de la planification, on n'a pas besoin de critiquer l'une après l'autre chacune de leurs propositions. Il peut, et pourra toujours exister, le planificateur qui dira que son plan à lui est vraiment différent des autres. La critique, pour être efficace, doit porter sur l'essence de la planification, c'est à dire sur ce qu'il y a de commun à l'ensemble de ces plans. De même, de l'économie mathématique : nous ne gagnerions rien à critiquer tel ou tel modèle. En conséquence, c'est à l'essence de l'entreprise que nous entendons nous adresser.
L'article est divisé en trois grands thèmes :
- le premier comprend une brève description historique de l'économie mathématique ; elle vise à montrer comment, depuis une centaine d'années, les économistes mathématiciens eux-mêmes se montrent incertains quant à l'applicabilité pratique de leurs modèles.
- Le second traite de l'impossibilité d'appliquer la même méthode aux sciences naturelles et aux sciences sociales. Il soutient que la construction de modèles économiques mathématiques équivaut à appliquer la méthode hypothético-déductive qui est viable dans les sciences naturelles, mais ne l'est pas dans les sciences de l'action humaine.
- Le troisième, enfin, se propose de montrer quelles différences existent entre une déduction verbale et une déduction mathématique, et leurs conséquences pour la théorie économique.
2 L'EVOLUTION DE L'ECONOMIE MATHEMATIQUE
Depuis la naissance de l'économie politique (que l'on considère que son fondateur est Adam Smith, Richard Cantillon, ou bien Xénophon), jusqu'au dernier quart du XIX° siècle, les économistes déduisaient leurs principes en utilisant la logique verbale. Très peu se servaient des mathématiques. Mais depuis la fin du siècle dernier et jusqu'à nos jours, l'économie mathématique a commencé à gagner du terrain et aujourd'hui nous pouvons dire que rares sont les livres d'économie qui n'utilisent pas un peu de mathématiques.
Dans The Theory of Political Economy de William Stanley Jevons, il y a deux appendices (le V et le VI) avec une liste des économistes mathématiciens qui embrasse la période 1711-1888, à savoir l'époque où elle était peu populaire. Cette liste n'est pas complète et par-dessus le marché elle inclut des noms d'économistes qui s'opposaient explicitement à l'utilisation des mathématiques comme John Stuart Mill et Carl Menger []. Malgré la longue liste de Jevons, les précurseurs de l'économie mathématique sont fort peu nombreux à être bien connus. Parmi eux on trouve Daniel Bernoulli (1700-1782), mathématicien suisse qui développa les concepts d'utilité marginale décroissante avec des dérivées dans un article paru en 1730. Thomas Perronet Thompson (1783-1868) publia en 1826 un article dans la Westminster Review — dont il était l'un des fondateurs, appliquant le calcul différentiel pour calculer le profit maximum. En Allemagne, le mathématicien Johann Heinrich von Thünen (1783-1850 [inventeur présumé de la différence entre "risque" (assurable) et "incertitude" (portant sur des événements uniques, donc non assurable) utilise aussi des concepts du calcul infinitésimal dans son oeuvre Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirthschaft und National Ökonomie ("L'Etat isolé en relation avec l'agriculture et l'économie politique"). En France les deux précurseurs les plus remarquables furent Antoine-Augustin Cournot (1801-1877) et Jules Dupuit (1804-1866). En 1838, Cournot publie son livre Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses, où il fait un assez grand usage de formules et de graphiques et, de même que ses prédécesseurs, met l'accent sur le calcul infinitésimal. De son côté, Dupuit développe le concept de courbe de demande de manière apparemment indépendante de Cournot. Son livre De l'utilité et de sa mesure (1853) ne contient pas autant d'équations que celui de Cournot, mais suffisamment pour en faire un précurseur de l'économie mathématique. La citation suivante de Cournot traduit le peu de cas que l’on faisait à cette époque de l’emploi de la mathématique en économie :
- "[...] le titre de cet ouvrage n'annonce pas que des recherches théoriques ; il indique aussi que j'ai l'intention d'appliquer à celles-ci les formules et les symboles de l'analyse mathématique. Ce dessein, je l'avoue, doit m'attirer immédiatement la réprobation des théoriciens accrédités. Tous se sont manifestés, comme d'un commun accord, contre l'emploi de formules mathématiques et il serait sans aucun doute difficile actuellement de vaincre un préjugé que de grands talents, comme Smith et d'autres écrivains plus modernes, ont contribué à réaffirmer ."
Il ne fait pas de doute que les économistes de plus grand renom de cette époque s'étaient rendu compte des objections à faire à l'usage de la mathématique en économie. Par exemple, Jean-Baptiste Say faisait ce commentaire dans son Traité d'économie politique (1803) quant à ceux qui utilisaient les mathématiques en économie :
- "Ces personnes [...] n'ont pu énoncer ces problèmes en langage analytique sans les dépouiller de leur complexité naturelle, au moyen de simplifications et de suppressions arbitraires, avec les conséquences, insuffisamment appréciées, qu'ils changeaient toujours la condition du problème et viciaient toutes ses résultats ; cela fait qu'on ne peut déduire de tels calculs aucune autre inférence que celles qui se dégagent de la formule arbitrairement supposée ".
Des opinions semblables, nous pouvons en trouver chez Nassau W. Senior [], J. S. Mill et J. E. Cairnes . Sans doute, l'usage des mathématiques n'était pas le thème épistémologique central de ces économistes. Ce qu'ils cherchaient à démontrer était que la méthode utilisée pour les sciences de la nature n'était pas appropriée aux sciences de la société []. L'utilisation de la mathématique en économie politique était plutôt un sous-produit. A en croire Cournot, l'opposition à la méthode mathématique était due en partie
- "à l'idée fausse que se sont faits de cette analyse des esprits judicieux et versés dans l'économie politique, mais presque ignorants des sciences mathématiques" [].
Cette critique n'est pas trop juste. En tous cas, on pourait [aussi bien] conclure le contraire : que ses "esprits judicieux et versés", par leur formation, avaient des sciences de la nature et de la mathématique une connaissance bien meilleure que les économistes mathématiciens n'en avaient de l'économie. Après tout, nous ne devons pas oublier qu'Adam Smith, par exemple, a écrit des traités d'astronomie de physique, de logique et de métaphysique. Ces économistes avaient assez de connaissances pour ne pas confondre la méthode des sciences de la nature et celles de la société . Avec toutes les erreurs qu'on voudra bien leur trouver, les économistes classiques ont fait des contributions majeures à la science économique et cela, en se servant uniquement de la logique verbale. Au cours de la décennie 1870, les économistes mathématiciens commencèrent à gagner du terrain mais, comme nous le verrons, ils ne réussirent guère à en dire plus que les économistes classiques ne l'avaient fait, et cela, en des termes plus rigoureux . En 1871, Jevons publia son livre The Theory of Political Economy, faisant un assez large usage, pour l'époque, du raisonnement mathématique. Dans son introduction, il défend le caractère mathématique de la science économique. Dans la préface à la seconde édition (1879), il affirme que
- "Tous ceux qui écrivent en économie doivent le faire en forme mathématique s'ils veulent être scientifiques, parce qu'ils parlent de quantités et de relations entre ces quantités, et toutes les quantités et les relations entre les quantités sont du domaine de la mathématique" [].
Cette affirmation révèle que Jevons n'avait pas une idée claire de ce qu'est l'objet de l'étude de la science économique. Il croyait que l'objectif de l'économie était
"de maximiser le bonheur à travers l'échange, pour ainsi dire, de faire plaisir pour le sacrifice le plus faible" [].
Quoique Jevons reconnût qu'il était difficile ou presque impossible de mesurer directement le bien-être ou l'utilité d'une personne, il croyait qu'il était possible de la mesurer par ses effets quantitatifs que, selon lui, les prix constituaient []. Cette erreur, de penser que les prix seraient une "mesure" de l'utilité est intéressante, parce qu'il fut conduit à cette conclusion pour s’être servi de l'analyse mathématique. Jevons arrive à la conclusion que le prix relatif des biens est égal au rapport inverse de leurs utilités marginales . Les économistes "littéraires" de l'école autrichienne arrivent à une tout autre conclusion : le prix ne peut jamais refléter l'utilité marginale des parties qui échangent, car le prix n'existe que parce qu'il y a des différences entre les utilités. Si l'utilité marginale du bien que chaque personne abandonne était égale à celle du bien qu'il reçoit, alors il n'y aurait pas de raison pour échanger, et par conséquent pas de prix []. Il n'est pas superflu de rappeler que Jevons n'avait pas de bonne formation mathématique, comme lui-même le reconnaissait. Ses connaissances n'allaient pas au-delà du calcul différentiel élémentaire. Aussi bien Alfred Marshall que J. E. Cairnes ont signalé les problèmes que Jevons avait avec cette limitation []. Cette réserve ne prétend pas nier le mérite de Jevons, qui a bien gagné sa place dans l'histoire de la pensée économique. Nous cherchons seulement à montrer que les précurseurs de l'économie mathématique n'étaient pas d'excellents mathématiciens mais au contraire des gens qui avaient de la chose une connaissance superficielle []. Le livre de Jevons ne connut pas la popularité, en partie parce qu'il défiait les économistes classiques, à qui John Stuart Mill valait à l'époque une grande réputation, et en partie à cause de son emploi des mathématiques qui, comme nous l'avons vu, n'était pas bien vu dans la profession.
Alfred Marshall avait une formation mathématique bien plus poussée que celle de Jevons, puisqu'on le cite comme l'un des meilleurs mathématiciens de sa génération. Lui n'est certes pas aussi catégorique que Jevons quant à l'utilisation de la mathématique en économie. Dans une lettre à A. L. Bowley, datée du 27 février 1906, il affirmait :
- "Il est très improbable qu'un bon théorème mathématique qui s'occupe d'hypothèses économiques soit de la bonne théorie économique ; je me suis de plus en plus contraint à suivre les règles suivantes :
- 1° Utiliser les mathématiques bien plus comme un langage tachygraphique (un code d'abréviation) que comme un instrument de recherche ;
- 2° les conserver jusqu'à obtention des résultats ;
- 3° traduire tout cela en anglais ;
- 4° les éclairer par plusieurs exemples de la vie réelle ;
- 5° brûler les maths ;
- 6° S'il n'est pas possible d'obtenir le 4°, brûler aussi le 3°. Cette dernière règle, je l'ai suivie plus d'une fois ".
Les Principles of Economics de Marshall connurent un grand succès. Dans les dernières années du XIX° siècle, et dans les premières du XX°, ses Principles étaient la Bible. "L'économie, c'était Marshall ". Malheureusement, il commit certaines erreurs théoriques graves qui marquent encore leurs traces dans les manuels de microéconomie et dans un certain sens, il finit par régresser jusqu'à défendre la théorie de la valeur de David Ricardo . Mais le plus important est que Marshall avait aplani le terrain pour que les auteurs qui suivirent développent avec enthousiasme l'échafaudage mathématique tout en abandonnant la prudence marshallienne. Les Principles donnèrent lieu à ce qu'on connaît aujourd'hui comme la théorie de l'équilibre partiel, parce qu'elles mettaient l'accent sur l'analyse du comportement des "unités" économiques, c'est-à-dire le consommateur et l'entreprise. Les continuateurs les plus importants de la pensée de Marshall furent Edward H. Chamberlin, Joan Robinson et l'italien Piero Sraffa. Ce courant de pensée est connu comme l'école de Cambridge parce que Marshall et ses disciples enseignaient dans cette ville anglaise.
La renommée de l'école de Cambridge éclipsa presque totalement l'autre courant de pensée anglais qui se développait à Londres avec Edwin Cannan, qui maintint l'explosition dans la logique verbale et poursuivit le type d'analyse développé par les économistes classiques, à savoir l'explication de la manière dont opèrent les forces du marché pour atteindre un ordre "spontané". Les continuateurs les plus importants de cette ligne de pensée sont Lionel Robbins et William H. Hutt. Dans les années 30, s'y joint Friedrich August Hayek, qui fait pénétrer la pensée de l'école autrichienne à la London School of Economics. Comme nous le verrons plus loin, Hayek eut une grande influence sur la pensée de l'un des économistes mathématiciens les plus distingués, John R. Hicks.
Le promoteur le plus important de l'économie mathématique semble avoir été Léon Walras, par l'intermédiaire de ce que l'on connaît comme la théorie de l'équilibre général. Cette promotion ne semble pas tant être due au succès de son livre Eléments d'économie politique pure (1874), qui ne fut pas bien reçu (ce qui arriva aussi aux livres de Jevons et de Carl Menger), qu'au repêchage qu'en firent les penseurs postérieurs. Walras se livre à une défense de l'emploi des mathématiques en économie dans la préface des Eléments, et s’en prend à ceux qui y sont opposés :
- "Quant aux économistes qui ne connaissent rien à la mathématique, et même qui ne savent pas ce que mathématique veut dire et qui en dépit de cela ont pris la position que la mathématique ne peut servir à rien pour élucider les principes économiques, nous les laisserons sur leur chemin à dire que
- 'la liberté humaine ne se laissera jamais enfermer dans des équations',
- ou que la mathématique ignore les frictions qui sont tout dans les sciences sociales, et autres phrases également vigoureuses et fleuries, Ils ne pourront pas empêcher que la théorie de la détermination des prix en libre concurrence se convertisse en une théorie mathématique" .
Dans cette citation, Walras ne soutient pas seulement que l'économie est une science exacte []. Comme Cournot, il critique aussi ceux qui s'opposent à cette idée comme ignorants des mathématiques. Le problème n'en semble pas moins être davantage celui de Walras que celui des économistes littéraires : pas plus que Jevons, il n'avait de formation mathématique suffisante. Il essaya à deux reprises d'entrer à la fameuse Ecole Polytechnique mais échoua pour cause de connaissances insuffisantes dans ce domaine []. Il avait fini par entrer à l'Ecole des Mines comme élève-ingénieur, mais la chose lui déplaisait, ce qui le conduisit à abandonner au bout de peu de temps pour se consacrer à la litérature. Son père, Antoine-Auguste, qui était économiste, préoccupé par le tempérament bohème de son fils, le convainquit finalement de se consacrer à l'étude de l'économie. Sa formation d'économiste ne fut guère différente de celle qu'il avait reçue en mathématique. En théorie économique, il n'eut jamais qu'un professeur : son père. Pour ce qui est du reste, c'était un autodidacte presque complet . De même que, sans être bien formé en mathématique, il croyait en savoir davantage sur la question que les économistes littéraires, il croyait aussi que ses connaissances en économie l'emportaient sur celles des autres :
- "Je ne suis pas un économiste. Je suis un architecte. Mais je connais plus d'économie politique que les économistes" [].
La théorie de l'équilibre général consiste en un système d'équations linéaires où les inconnues sont les prix, les quantités de biens produits, les prix et les quantités des services productifs et les quantités de services productifs nécessaires à la production d’une unité de chaque bien, ou "coefficients techniques de production ." Walras montra que le nombre des équations indépendantes était égal à celui des inconnues, mais ni lui ni aucun de ses disciples ne fournirent, du point de vue mathématique, une démonstration rigoureuse de leurs idées. Ils croyaient — à tort — que le système avait une solution du fait que le nombre des équations était égal à celui des inconnues. En réalité, l'égalité entre le nombre des équations et celui des inconnues n'est une condition ni nécessaire, ni suffisante pour que le système soit en équilibre.
L'ambition de Walras ne se heurtait pas seulement à ce problème de manque de rigueur mathématique, mais à des problèmes supplémentaires de la théorie économique. Les suppositions de son modèle sont ceux d'une "concurrence parfaite" : on suppose une atomisation des marchés, une parfaite divisibilité et une parfaite mobilité des biens et des services productifs, il n'y a pas de temps (tout se produit instantanément), les produits sont homogènes et il existe une connaissance parfaite de la part des agents économiques. En résumé, les hypothèses sont irréelles et par conséquent les conclusions le sont aussi . Il semble que Walras était conscient de ces problèmes. Dans une lettre au mathématicien d'Ocagne, il dit :
- "(..) je considère mon travail, tant du point de vue économique que celui des mathématiques, comme une ébauche simple et incomplète. J'espère que dans un avenir proche il sera dépassé par un travail plus complet et mieux fait" .
Jusqu'aux années 30, les économistes de l'école de Lausanne n'introduisirent pas de grandes modifications. Ils continuèrent à compter les équations et les inconnues et maintinrent les hypothèses irréalistes de la "concurrence parfaite". Bien plus, à certains égards, il y eut une franche régression théorique. Au moins Walras avait utilisé la théorie de l'utilité marginale pour déduire les équations de demande ; Gustav Cassel, en revanche, omet cette étape, qui est d'une grande importance. Cependant, aucun des deux ne réussit à obtenir des conclusions différentes de celles des économistes classiques. Si nous tenons compte de ce que le but d'une théorie est de permettre de comprendre comment fonctionne une certaine partie de la réalité, alors les classiques, en dépit de tous leurs défauts et incohérences, furent supérieurs à Walras et à ses disciples. Les classiques avaient mis l'accent sur l'explication du processus d'ajustement sur le marché. L'école de Lausanne, au contraire, à cause de ses hypothèses irréelles, s'en tenait à l'analyse de l'équilibre. La théorie des tâtonnements de Walras ne fait que reprendre ce qu'Adam Smith avait dit de façon beaucoup plus claire et réaliste [].
Dans la décennie 1930, la théorie de l'équilibre général commence à être perfectionnée du point de vue de la rigueur mathématique, mais elle ne fait pas de progrès quant à son réalisme. Ce perfectionnement s'obtient à travers deux courants, dont l'un naît en Autriche et le second en Angleterre. Le premier se préoccupe de prouver l'existence et l'unicité du système d'équilibre établi par Walras. Le deuxième a étudié le problème de la stabilité et de la statique comparative. En Autriche, tout commença avec trois études dont les auteurs étaient F. Zeuthen [], H. Neier [], et H. von Stackelberg [] qui, de manière indépendante, signalèrent que la détermination de l'équilibre nécessitait davantage que l'égalité entre le nombre d'équations et celui des inconnues. Ce fut cependant Karl Schlesinger, lequel faisait partie du séminaire privé de Ludwig von Mises, qui se rendit compte de la complexité mathématique d'un traitement rigoureux du problème . Pourtant, ses connaissances en mathématique étaient insuffisantes pour résoudre le problème. Oskar Morgenstern, autre membre du séminaire privé de von Mises, le mit en contact avec Karl Menger [], mathématicien célèbre [et fils de Carl,] qui dirigeait un Colloque de mathématique à Vienne, avec Abraham Wald, son élève. Schlesinger avait modifié le système d'équations de Walras et Cassel en supposant que certains facteurs étaient superflus, ce qui, mathématiquement, transformait en inéquations certaines équations du système de Walras-Cassel. Ainsi, l'argument comme quoi le système possédait autant d'équations que d'inconnues se compliquait. Ce fut Wald qui démontra, dans différents articles, l'existence de l'équilibre pour d'autres systèmes []. La démonstration de Wald marqua une nouvelle ère en économie mathématique. D'après K. Menger :
- "(..)avec le travail de Wald se termine la période dans laquelle les économistes se bornaient à formuler les équations, sans se préoccuper de l'existence ou de l'unicité de leurs solutions ou, dans le meilleur des cas, ils s'assuraient que le mombre d'équations et d'inconnues était égal. (chose qui n'est ni nécessaire, ni suffisante pour avoir la solution et l'unicité). A l'avenir, quand les économistes formuleront des équations et s'intéresseront à leur solution (comme les physiciens le font depuis quelque temps), ils auront tendance à traiter les questions profondes de l'existence et de l'unicité" .
L'avance de Wald se limitait à la rigueur mathématique du modèle de l'équilibre général, mais l'irréalisme du modèle continuait à être présent. Les deux postulats principaux sont :
- a) Que soit satisfait l'axiome des préférences révélées ; et
- b), que tous les biens soient substituables.
Ces deux suppositions sont suffisantes pour invalider quant au réalisme et le réduire à un bon exercice mental de mathématique pure.
Une démonstration concurrente de celle de Wald fut apportée par John von Neumann ; Ce fameux mathématicien utilisa les instruments mathématiques de la théorie des jeux, qu'il avait développés en 1928 et, avec Morgenstern en 1944 [], étendus à la théorie de l'équilibre général dans un article sur le développement économique équilibré . La démonstration de von Neumann se fondait sur une généralisation du théorème du point fixe de Brouwer . Quelques années plus tard, un autre mathématicien, S. Kakutani, réussit à simplifier le théorème de von Neumann et en 1950, John F. Nash, mathématicien de Princeton, généralisa la théorie des jeux de von Neumann-Morgenstern à n persones et n stratégies. La généralisation utilisait le théorème du point fixe de Kakutani pour démontrer qu'un jeu à n personnes avait un équilibre []. Parallèlement au développement de la théorie des jeux, commençaient à se développer les modèles de programmation linéaire qui finiraient par jouer un rôle important dans le problème de l'existence de l'équilibre. Au milieu de 1949, se tint à Chicago une conférence sur le thème de la "Programmation linéaire". Les travaux présentés dans cette conférence furent publiés par Tjalling Koopmans en 1951 dans le fameux livre Activity Analysis of Production and Allocation. Comme la théorie des jeux est équivalente à un problème de programmation linéaire, les deux points de vue se complétèrent heureusement.
Sur ces bases, on réussit à élaborer des démonstrations sur l'existence de l'équilibre qui étaient beaucoup plus simples et générales. Leurs auteurs furent L.W. McKenzie , Keneth J. Arrow , Gérard Debreu et H. Nikaido Dans le monde anglo-américain, se développa de manière indépendante une autre lignée de travaux sur la théorie de l'équilibre général. On considère John R. Hicks comme le fondateur de ce courant à travers son livre Value and Capital (1939). A la manière d'Alfred Marshall, Hicks avait relégué dans un appendice la partie mathématique. Le livre eut un grand succès, pour avoir été écrit dans la "prose" intelligible des économistes d'Oxford [].
Ceci donna à Hicks un grand avantage sur les travaux issus du colloque de Karl Menger, qui en plus d'avoir été écrits en Allemand, avaient beaucoup moins du langage ordinaire et beaucoup plus de formalisation mathématique. Le problème de la "communication" joua un rôle important. En avril 1941, Paul A. Samuelson réalise une nouvelle contribution avec un article sur la stabilité de l'équilibre , et quelques années plus tard, il publia son livre Foundations of Economic Analysis (1947). Ni l'article ni le livre ne font mention du problème de l' existence de l'équilibre qui avait concentré l'attention du groupe de Vienne. Cette ligne de recherche fut poursuivie par Jacob L. Mosak , Lloyd A. Metzler , Takashi Negishi , Frank Hahn et Hirotemi Uzawa [].
Néanmoins, le groupe de Vienne, formé en grande partie de mathématiciens et non d'économistes, considérait le groupe d'Amérique du Nord avec réprobation pour sa manière d'employer les mathématiques, ce que reflète ce commentaire de von Neumann à Morgenstern :
- "Tu sais, Oskar, si on déterrait ces livres au bout de quelques centaines d'années, les gens ne croiraient pas qu'ils datent de notre époque. On penserait plutôt qu'ils ont été écrits par quelque contemporain de Newton, tant leurs mathématiques sont primitives. L'économie se trouve à des millions de kilomètres de la situation dans laquelle se trouve une science avancée comme la physique" [].
Nous pourrions cependant conserver de même quelques réserves sur la minceur ou le caractère "primitif" des connaissances économiques des mathématiciens de Vienne, dont les "modèles", comme nous l'avons déjà dit, impliquent une régression par rapport aux économistes classiques. Les hypothèses sur lesquelles ils se fondent les privent de la validité pratique que doit avoir toute théorie. En particulier, le postulat de "connaissance parfaite" change la nature de l'objet de l'étude. C'est ce point-là que les économistes de l'école autrichienne signalèrent avec insistance.
- "Toute approche, dit Hayek, comme celle d'une bonne partie de l'économie mathématique avec ses équations simultanées, qui part en fait de l'hypothèse suivant laquelle l'information dont les gens disposent correspond aux faits objectifs de la situation, laisse systématiquement de côté ce qu'il est notre premier devoir d'expliquer" [].
Tjalling Koopmans reconnut ce problème de la théorie de l'équilibre général :
- "Que je sache, on n'a développé aucun modèle formel d'allocation des ressources au moyen de marchés concurrentiels qui prenne en compte l'ignorance des décideurs sur leurs actions à venir, sur leurs préférences ou leurs connaissances techniques comme cause principale de leur incertitude, et qui reconnaisse simultanément que les marchés à terme, sur lesquels les attentes et les intentions desdits agents peuvent se confronter et s'ajuster, n'existent pas avec suffisamment de variété ni avec une période de prévision suffisante pour que la théorie actuelle sur l'efficacité des marchés concurrentiels soit applicable.
- Si ce jugement est correct, notre connaissance en économie n'est pas encore parvenue au point de pouvoir jeter une lumière suffisante sur le problème central de l'organisation économique de la société : comment affronter et traiter l'incertitude. En particulier, la profession des économistes est bien loin de pouvoir se manifester avec une autorité scientifique sur les aspects économiques de la polémique qui divise l'humanité à notre époque pour choisir entre l'entreprise individuelle ou collective (c'est moi qui souligne) []."
Cette affirmation fut faite en 1957 ; c'est-à-dire que depuis que Walras a écrit ses Eléments en 1874, il s'éait passé quatre-vingt quatre années pendant lesquelles les économistes mathématiciens s'étaient souciés d'étudier l'existence, l'unicité et la stabilité d'un modèle qui ne servait à rien. Si, comme on le déduit de la dernière phrase de la citation, Koopmans croit que l'opposition "entre l'entreprise individuelle et collective" sera éclairée par des modèles d'équilibre général, il a fait fausse de route. Comme Hayek le dit en 1948 :
- "Les avantages de la concurrence ne dépendent pas des conditions qui prévaudraient si celle-ci était parfaite" [].
Une fois terminée l'étape de la recherche quant à l'existence, l'unicité et la stabilité de l'équilibre, commença une seconde étape au cours de laquelle on essaya d'adopter des hypothèses plus réalistes en introduisant le problème de l'incertitude. L'article d'E. Grunberg et Franco Modigliani "The Predictability of Social Events", joua un rôle important . En général, ces modèles essaient d'expliquer la formation des anticipations à partir d'extrapolations de données du passé. Un autre point de vue fut donné par l'hypothèse des anticipations rationnelles [], qui suppose que les attentes des agents se forment en tenant compte des relations entre les variables de quelque théorie économique appropriée. La théorie des anticipations rationnelles part de suppositions aussi irréalistes que celles de l'équilibre général :
- 1) que tous les agents sont d'une intelligence surnaturelle et
- 2) que les marchés sont continuellement en équilibre [].
En tous cas, ces deux postulats laissent justement de côté le point à expliquer : l'allocation des ressources sur un marché où l'information est limitée [].
Les théoriciens de l'équilibre général ont essayé d'introduire l'incertitude dans leurs modèles. La recherche commença avec Gérard Debreu en 1959, soit deux années après l'avertissement de Koopmans que nous avons cité . Douze ans révolus après la publication du livre de Debreu, Kenneth J. Arrow et Frank H. Hahn publient General Competitive Analysis, où ils se voient obligés de reconnaître à plusieurs occasions qu'ils n'introduisent pas l'incertitude dans les divers modèles qu'ils analysent []. En 1981, Frank Hahn semble être arrivé à la même conclusion que Koopmans en 1957 :
- "La théorie de l'équilibre général est une réponse abstraite à une question abstraite et importante : une économie peut-elle être ordonnée si elle se fie aux seuls signaux des prix pour son information sur le marché ? La réponse de la théorie de l'équilibre général est claire et définitive : oui, on peut décrire une économie qui aurait ces propriétés. Mais cela, naturellement, ne signifie pas que nous ayions décrit une économie réelle. Elle a répondu à une question théorique importante et intéressante et en première instance, c'est tout ce qu'elle a fait. C'est là un succès intellectuel considérable, mais il est évident que, pour la pratique, on a besoin de beaucoup plus d'argumentation."
De son côté, Morgenstern a réalisé une critique de la théorie économique contemporaine qui, parce qu'elle provient d'un membre du colloque mathématique de Karl Menger et du séminaire privé de Mises, acquiert une importance spéciale. Les treize points qu'analyse Morgenstern sont suffisants pour mettre en cause la validité théorique de tous les modèles mathématiques de la théorie économique.
Ainsi, nous voyons que les théoriciens de l'équilibre général eux-mêmes mettent en doute la validité pratique de leurs modèles, et si nous nous rappelons que le propos de toute théorie est d'expliquer la réalité, alors ce qu'ils mettent en cause est en fait leur validité théorique. En d'autres termes, la cohérence et la rigueur logique du modèle n'impliquent pas qu'il soit théoriquement valable.
Les économistes autrichiens Ludwig von Mises et Friedrich A. Hayek, depuis plusieurs décennies, ont analysé "verbalement" les implications logiques du comportement humain dans des conditions réelles, dont on pourrait dire qu'elles sont opposées à celles du modèle de l'équilibre général. Cette méthode leur a permis d'arriver à une théorie d'une haute valeur explicative. Nous n'allons pas faire ici une apologie de la théorie autrichienne de l'économie , mais il est intéressant de citer un paragraphe de l'un des théoriciens de l'équilibre général, John Richard Hicks, qui se rétracte de sa position antérieure et reconnaît la supériorité des économistes de l'école autrichienne :
- "Dans le sous-titre, et dans le texte du chapitre I, j'ai manifesté la filiation 'autrichienne' de mes idées ; l'aveu de reconnaissance envers Böhm-Bawerk et ses successeurs est un tribut que je suis fier de payer. J'appartiens à sa lignée ; bien plus, je l'ai vérifié pendant mes recherches, c'est une tradition plus étendue et développée qu'il ne semblait au départ. Les 'autrichiens' n'ont pas été une secte particulière, en marge du courant principal ; ils étaient au centre. C'étaient les autres qui étaient à l'écart" [].
Comme on peut le voir, nombreux et importants sont les économistes théoriciens de l'équilibre général qui ont eu des états d'âme quant à la validité de leurs modèles mathématiques. Evidemment, cela ne doit pas être tenu pour une "preuve" que l'économie mathématique ne sert à rien. La conclusion que nous pouvons tirer de cette première partie est que, durant l'histoire de l'économie mathématique parmi les penseurs qui connaissaient mal les mathématiques, certains se sont opposés à son utilisation en science économique, comme Carl Menger et David Novick , et d'autres l'ont défendue, comme nous l'avons vu, William Stanley Jevons et Léon Walras. D'un autre côté, il y a eu des penseurs avec une bonne formation mathématique qui ont défendu son utilisation en économie, comme Tjalling C. Koopmans et Paul A. Samuelson et d'autres qui s'y opposaient, comme John M. Keynes et Eugenio Frola []. Nous pourrions y inclure des mathématiciens du niveau de René Thom qui ont manifesté leur scepticisme sur l'économie mathématique :
- "En physiologie, en éthologie, en psychologie et dans les sciences sociales, les mathématiques n'apparaissent pratiquement pas si ce n'est sous la forme de recettes statistiques dont la légitimité propre semble douteuse ; il n'y a qu'une exception : l'économie mathématique, avec le modèle des économies d'échange Walras-Pareto, qui arrive à poser des problèmes théoriques intéressants, mais dont l'applicabilité à l'économie réelle est plus que suspecte" [].
Nous voyons donc qu'il y a aussi bien des experts que des "inexperts" en mathématique qui s'opposent à l'utilisation des mathématiques en économie ou qui la soutiennent. Mais les doutes qu'ont exprimés certains économistes mathématiciens quant à la validité pratique de leurs modèles les quittent à force d'argumenter en faveur de la supériorité de la méthode mathématique sur la déduction logique. Pourtant, l'économie mathématique a popularisé nombre de théories grossièrement erronées ; pour n'en citer que quelques-unes, nous avons :
- a) le multiplicateur d'investissement,
- b) le principe d'accélération,
- c) le théorème de l'autoroute,
- d) la théorie suivant laquelle la concurrence parfaite serait plus efficace que le monopole à égalité de coûts
- e) les courbes d'indifférence
- f) la théorie de la préférence révélée, etc*.
Le problème semble plus grave quand au lieu d'engendrer de 'nouvelles' fausses théories, ce qu'elle fait est de ressusciter des erreurs vieilles de plus de cent ans, comme c'est le cas de Samuelson et Georgescu-Roegen, qui arrivent à la conclusion que dans certains cas, la technologie détermine les prix relatifs des biens produits avec une totale indépendance vis-à-vis de la demande [], ce qui implique non seulement de revenir à la théorie classique de la valeur d'échange mais par-dessus le marché n'avoir pas compris exactement la théorie de l'utilité marginale. A. Chiang a vraiment trouvé la formule quand il a dit que :
- "l'économiste de formation mathématique est exposé à deux tentations :
- 1) se limiter aux problèmes qui peuvent être résolus, et
- 2) adopter des hypothèses économiques inappropriées au nom de la convenance mathématique ".
Il semble que la seconde tentation ait vaincu la résistance des économistes mathématiciens, à tel point que toute ressemblance entre leurs modèles et la réalité est désormais de pur hasard. Ils ont fini par chercher un objet d'étude adapté à l'usage des mathématiques plutôt que de chercher la méthode appropriée à l'objet de la science économique.
3 LA METHODE DE L'ECONOMIE POLITIQUE
La majorité des économistes sont persuadés que la science économique doit employer la même méthode que les sciences de la nature. Par exemple Samuelson soutient que :
- "Dans les sciences sociales, le scientifique ne rencontre aucun problème méthodologiques différent de ceux que rencontre n'importe quel autre savant"
et Friedman pense que, quoique l'économiste ne puisse pas faire d'expériences de laboratoire,
- "cela ne représente pas une différence essentielle entre les sciences sociales et les sciences physiques" [].
C'est là une erreur importante que nous essaierons de traiter ici. L'élaboration d'une théorie consiste dans un arrangement mental des faits, les mettant en relation entre eux d'une certaine manière, à partir de laquelle on pourra inférer certains événements à partir des autres. Une théorie est bonne quand les événements se produisent conformément aux relations qu'elle a établies. Au contraire, la théorie est mauvaise quand elle perd en caractère explicatif, c'est-à-dire quand les événements se produisent d'une façon différente de celle que la théorie a prévue.
L'élaboration d'une théorie commence quand nous sommes confrontés à un fait dont nous ne savons pas pourquoi il est apparu. Pour l'expliquer, nous essayons de le mettre en relation avec un autre, auquel on donne généralement le nom de "cause" [], d'une forme telle que le second soit toujours présent quand le premier est là. Pour rechercher la relation, il faut commencer à suggérer un certain type de lien entre les faits. Ces suggestions sont appelées hypothèses, et ne sont pas davantage que des tentatives d'explication. En proposant une hypothèse, le savant doit choisir certains faits qu'il considère comme pertinents et en rejeter d'autres qu'il juge non-pertinents, par exemple la couleur de mon bureau n'a pas l'air d'être significative pour expliquer la vitesse de chute d'un corps. Dans la formulation d'une hypothèse, il n'y a pas de règle fixe pour rechercher les faits pertinents ; l'expérience passée et l'analogie peuvent jouer un rôle important, mais, par-dessus tout, ce qui compte est l'originalité du savant pour mettre en relation des faits qu'il n'était venu à l'idée de personne de relier jusqu'à présent. L'élaboration d'une hypothèse implique un pprocessus de raisonnement : l'esprit n'est pas une table rase sur laquelle la réalité imprimerait des connaissances comme le croyaient les empiristes anglais. Nous approchons toujours la réalité avec une "théorie" préconçue quelconque, c'est-à-dire avec une hypothèse. Même ceux qui se considèrent comme des "praticiens" ont une conception théorique définie de ce qu'ils font. Y compris John Stuart Mill qui disait :
- "(...) ceux qui rejettent la théorie ne peuvent pas faire un pas sans théoriser" .
Le paragraphe suivant de Morris R. Cohen synthétise clairement cette idée :
- "l'observation qui n'est pas éclairée par un raisonnement théorique est stérile. En fait, sans une attente ou une hypothèse bien raisonnée de ce que nous attendons, il n'y a pas d'objet défini à observer, et aucun indice pour déterminer ce qui est pertinent pour notre recherche. Le savoir ne vient pas à ceux qui regardent la nature avec la bouche ouverte et la tête vide. L'observation féconde ne dépend pas, comme le pensait Bacon, de l'absence de préjugés ou d'idées préconçues mais, au contraire, d'une multiplication systématique de ces derniers, de sorte qu'en ayant beaucoup de possibilités à l'esprit, nous soyions mieux préparés pour diriger notre attention vers ce que les autres n'avaient jamais pensé pouvoir faire partie du domaine des possibilités" [].
Ce point de vue est à l'opposé de celui qui prédominait dans la philosophie des sciences au milieu du XIX° siècle. A cette époque, on croyait que les recherches scientifiques commençaient par une observation sans préjugé de la réalité []. A partir de cette observation, on devait obtenir des inférences inductives qui permettraient de déduire des lois universelles. Karl Popper a insisté sur l'erreur de cette position inductiviste []. Il est impossible de faire des généralisations inductives sans un préjugé ; à partir du moment même où on choisit certaines variables pour en rejeter d'autres, on introduit un "préjugé" ; on est en train de suggérer que les variables choisies puissent être la cause du phénomène à expliquer. Il est extraordinaire (ou peut-être pas tellement) qu'en 1956, Samuelson ait encore pu soutenir l'idée primaire que
- "toute science est fermement basée sur l'induction : sur l'observation de faits empiriques" [].
Une fois qu'un chercheur fait une suggestion quant à la cause d'un événement, c'est-à-dire formule une hypothèse, la seconde étape consiste à la confronter à l'expérience. La fonction que remplit le test empirique est de voir si l'hypothèse est réfutée par les faits. Les relations possibles sont au nombre de quatre :
- 1) Chaque fois que le facteur A est présent, le facteur B l'est aussi, sous une forme abrégée (AB).
- 2) Chaque fois que le facteur A est présent, le facteur B est absent (AB).
- 3) Chaque fois que le facteur A est présent, le facteur B est absent (AB), et
- 4) Chaque fois que le facteur A est absent, le facteur B l'est aussi (AB).
Si, par exemple, on cherche à démontrer que A est la cause de B, alors, en termes de preuves empiriques ou expérimentales, on doit trouver les résultats 1 et 4, et ne pas trouver 2 et 3. S'il n'y a pas de moyen de confronter une hypothèse à la réalité, alors elle ne peut pas être scientifique Au cours de la décennie 1930, il était déjà assez clair que les expériences empiriques ne peuvent servir qu'à réfuter des hypothèses et non à les "prouver" . Cela est dû à ce que, d'un point de vue strictement logique, on ne peut pas affirmer qu'une hypothèse est vraie parce que ses conclusions concordent avec l'expérience ; si on le faisait, on commettrait une faute de logique.
Prenons, par exemple, le syllogisme suivant :
- "si A est vrai, alors B est vrai.
- A est vrai, alors B est vrai".
Pour pouvoir conclure que B est vrai, il faut pouvoir affirmer que A est vrai (modus ponendo ponens) ; la conclusion sera logiquement valide. Mais que se passe-t-il si nous modifions le syllogisme de la manière suivante? :
- "Si A est vrai, alors B est vrai.
- B est vrai, donc A est vrai".
Au lieu d'affirmer l'antécédent A pour pouvoir affirmer le conséquent B, nous procédons à l'inverse, prétendant que l'antécédent est vrai à partir d'une affirmation du conséquent.
Or, ce raisonnement-là n'est pas logiquement valide. Prenons, par exemple, le cas suivant :
- "Si un liquide est du sang alors il est rouge ;
- ce liquide est du sang donc il est rouge".
Affirmant l'antécédent : "c'est du sang", nous pouvons affirmer avec une nécessité logique qu'il est rouge. En revanche, le syllogisme suivant n'est pas valide :
- "Si ce liquide est du sang, alors il est rouge :
- il est rouge, donc c'est du sang".
Là, nous affirmons le conséquent, mais il n'y a pas de nécessité logique. Nous ne pouvons pas conclure qu'un liquide est du sang parce qu'il est de couleur rouge. Ce que l'on peut bel et bien faire avec une nécessité logique, c'est 'nier l'antécédent à partir de la négation du conséquent (modus tollendo tollens) ; Ainsi, le raisonnement suivant est logiquement valide : "Si A est vrai, alors B est vrai : B n'est pas vrai donc A ne l'est pas". Dans notre exemple :
- "Si un liquide est du sang, alors il est rouge ;
- celui-ci n'est pas rouge, donc ce n'est pas du sang".
De cette manière on peut conclure que si nous trouvons un liquide qui n'est pas rouge, nous pourrons réfuter l'idée que c'est du sang, mais s'il est rouge, nous ne pourrons conclure que le fait qu'il y a une possibilité que ce soit du sang. En résumé, nous pouvons dire qu'il y a une nécessité logique dans la réfutation mais pas dans la vérification.
Quand les savants avancent une hypothèse et en déduisent des conclusions avec le propos d'expliquer un phénomène déterminé, ils font un syllogisme du type : "Si A alors B". L'antécédent A est l'hypothèse et le conséquent B est la conclusion. Dans les sciences de la nature en général les hypothèses ne sont pas directement testables, de telle sorte que le savant ne peut pas affirmer l'antécédent. Par exemple, l'atome, les électrons, les ondes ne sont pas directement observables ; les hypothèses des lois de Newton ou de la théorie de la relativité d'Einstein ne sont pas directement testables . Le test des hypothèses se fait indirectement, c'est-à-dire en observant si leurs conclusions sont ou non vérifiées dans la réalité. Cependant, comme je viens de le dire, si les conclusions concordent avec la réalité, l'hypothèse n'est pas "vérifiée" ou "prouvée", puisqu'on ne peut pas affirmer le précédent (hypothèse) à partir de l'affirmation du conséquent (conclusion). En revanche, si les conclusions ne sont pas vérifiées dans la réalité, l'hypothèse (c'est-à-dire l'antécédent) peut être niée et réfutée avec une nécessité logique, en invoquant le modus tollendo tollens. Le savant ne peut pas prouver ses hypothèses, il ne peut que les rejeter. Une hypothèse en remplace une autre lorsqu'elle est plus générale, c'est-à-dire quand elle explique un plus grand nombre de cas. Les sciences de la nature avancent lorsqu'on trouve des faits qui réfutent l'hypothèse établie []. Lorsque cela arrive, les savants se voient obligés de remplacer l'hypothèse ou de la perfectionner. La nouvelle hypothèse doit pouvoir expliquer les phénomènes antérieurs plus les nouveaux, et pour cela elle est plus générale. L'histoire de la physique permet d'assister à une reformulation constante des hypothèses. Ainsi, les exemples les plus révolutionnaires sont la théorie de la relativité et la mécanique quantique qu'inaugura Max Planck []. Le fait que deux hypothèses ou plus soient logiquement possibles explique qu'aucune ne peut être rejetée par le moyen de la raison. C'est pourquoi l'expérience ou l'observation sont d'une importance cruciale pour réfuter une hypothèse. Sans expérimentation ni observation, une science de la nature serait impossible, car il n'y aurait pas de moyen de départager des hypothèses concurrentes. Comme le dit M. Cohen :
- "(...) Quoique aucun nombre, quel qu'il soit, d'expériences individuelles ne puisse prouver qu'une hypothèse est vraie, elles sont nécessaires pour décider quelle hypothèse est la meilleure et montre une plus grande correspondance avec l'ordre de l'existence" [].
John Stuart Mill a formulé cinq méthodes d'expérimentation : il croyait qu'elles étaient utiles pour découvrir et prouver les liens de cause à effet. Cependant, comme nous l'avons dit, l'observation seule ne permet pas de découvrir des relations ; le chercheur observe toujours la réalité avec une hypothèse à l'esprit ; nous avons aussi vu que cette dernière ne peut pas être confirmée, mais seulement réfutée. De sorte que les méthodes de Mill ne sont pas utiles pour les objectifs qu'il se proposait de poursuivre, alors qu'ils le sont pour départager des hypothèses concurrentes. Ces méthodes sont les suivantes :
- 1) celle de la concordance,
- 2) celle de la différence,
- 3) la méthode conjointe de la concordance associée à la différence,
- 4) celle des résidus et
- 5) celle de la variation concomitante [].
Un bref examen de ces cinq méthodes d'expérimentation aidera à mieux comprendre pourquoi il n'est possible que de réfuter et non de vérifier les hypothèses, mais elle mettra aussi en relief l'importance d'isoler les variables quand on observe ou expérimente.
1) La méthode de la concordance : si deux instances ou plus de l'événement que l'on examine n'ont qu'un seul facteur en commun, ce facteur est la cause (ou l'effet) de l'événement. Schématiquement : __________________________________________________________________ Expériences Evénements Facteurs présents
1 e A C D
2 e A B D E
3 e A B D
4 e B C D E
5 e A C D
Dans cet exemple, la cause de l'événement e peut être le facteur D. L'hypothèse pourra être acceptée jusqu'à ce qu'apparaisse un cas où on observe l'événement e sans que D soit présent. Si cela se produit, l'hypothèse se trouvera réfutée et le chercheur devra trouver un facteur "caché" qui soit présent dans chacun de ces cas. S'il le trouve, nous serons en présence d'une nouvelle hypothèse qui sera valide jusqu'à ce qu'elle soit réfutée par un nouvel événement qui oblige à chercher un autre facteur. Dans cette méthode, il est clair que le chercheur a le pouvoir de contrôler l'expérience pour isoler le facteur qu'il est en train d'étudier, ou au moins, quand il n'y a pas de possibilité de contrôle, il poit pouvoir étudier l'événement avec un seul facteur en commun. Si dans plusieurs cas observés il existe deux ou plusieurs facteurs en commun sans qu'il soit possible de les observer l'un et l'autre séparément, la méthode de la concordance perd de son utilité, puisqu'il n'y a pas de moyen de savoir lequel de ces facteurs communs est la cause.
2) La méthode de la différence : S'il existe deux cas, et si dans le premier apparaît l'événement étudié alors que dans le second il n'apparaît pas, en observant que tous les facteurs à l'exception d'un seul sont communs, le facteur non-commun est la cause (ou l'effet) de l'événement. Schématiquement : __________________________________________________________________ Expériences Evénements Facteurs présents
1 e A B C D E
2 A C D E
Ici, la cause possible de l'événement e est le facteur B. L'hypothèse pourra être acceptée jusqu'à ce que se produise un cas où e se produira en l'absence de B, ce qui conduira à la recherche de la variable cachée. Comme pour la première méthode, le chercheur doit pouvoir isoler ou observer le facteur étudié agissant seul, c'est-à-dire étant le seul présent puis absent lorsque l'événement se produit puis manque à se produire. Si cet isolement n'est pas possible et s'il se présente ou s'il disparaît plusieurs facteurs en même temps, la méthode cesse d'être utile.
3) La méthode conjointe de la concordance associée à la différence : elle consiste à utiliser en même temps les deux méthodes précédentes et se révèle utile lorsque aucune des deux ne peut à elle seule isoler le facteur étudié. Schématiquement, _________________________________________________________________ Expériences Méthode de la concordance : Méthode de la différence : Evénements Facteurs présents Evénements Facteurs présents 1 e A B C D e A B C D 2 e A C B C Dans cet exemple, la méthode de la concordance permet à elle seule d'éliminer les facteurs B et D mais ne permet pas de décider entre A et C. Avec la méthode de la différence, on peut éliminer B et C, mais on ne peut pas départager A et D. Cependant, les deux méthodes conjointes permettent de conclure que la cause possible est A. La méthode conjointe, à l'évidence nécessite aussi que l'on puisse contrôler ou observer séparément les phénomènes, de telle manière que l'on puisse éliminer tous les facteurs sauf un.
4) La méthode des résidus : S'il reste d'un certain événement une partie que l'on sait être causée par certains facteurs, alors le résidu de l'événement est l'effet des facteurs restants.
Schématiquement : __________________________________________________________________ Evénements Facteurs présents e = a + b + c A, B, C Si l'on sait que l'événement e est composé de a, de b et de c et si par ailleurs on sait que B est la cause de b et C la cause de c, alors A est la cause de a. Cette méthode se différencie de celles qui précèdent en ce qu'elle ne nécessite pas l'observation de deux ou plusieurs instances, et qu'une seule suffit. Comme pour les méthodes antérieures, il existe le risque qu'une variable cachée demeure et aussi, lorsque après la soustraction de la partie connue le résidu est composé de plus d'un facteur, la méthode est inutilisable.
Ces quatre méthodes sont toutes qualitatives, en ce qu'elles se limitent à observer la présence ou l'absence conjointe d'événements et de facteurs de cause. Il faut en outre tenir compte de ce que les exemples donnés supposent que l'hypothèse, à savoir la cause, est observable. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, les hypothèses les plus importantes de la science naturelle, et particulièrement de la physique, ne le sont pas, observables. Un des exemples les plus cités est la prédiction d'Einstein suivant laquelle la lumière d'une étoile sera déviée par la force de gravitation du soleil ; il avait même calculé la déviation maximale. Dans ce cas, il n'y a pas de moyen de contrôler les variables et de plus, l'hypothèse selon laquelle le soleil a une force de gravitation n'est pas observable en elle-même, mais par ses effets (ou conséquences logiques). Cependant, quoiqu'on ne puisse pas contrôler les variables, on a pu soumettre la prédiction d'Einstein à la preuve empirique pendant une éclipse de soleil, depuis certains endroits de la terre où elle était totale. L'observation put être réalisée durant une éclipse survenue le 29 mars 1919, et elle put confirmer la prédiction du physicien allemand. Dans ce cas, on dit que l'hypothèse est bonne, quoiqu'on ne puisse pas l'observer directement, parce que les conséquences logiques qui s'en déduisent ont été confrontées avec succès à la réalité. Il vaut la peine de répéter que l'hypothèse n'a pas été prouvée, mais qu'elle est devenue probable. Cet exemple est aussi intéressant pour montrer qu'il n'est pas nécessaire que le chercheur puisse contrôler l'expérience pour tester l'hypothèse. Ce qui compte, c'est que l'observation réunisse les conditions minimales que nécessite la confrontation. Il n'y a que dans le cas où ces conditions ne sont pas réunies qu'il est nécessaire de pouvoir contrôler l'expérience, et dans le cas contraire, l'hypothèse n'est pas testable.
5) La méthode de la variation concomitante : Quand un événement varie, dans un sens positif ou négatif, chaque fois qu'un facteur déterminé varie, alors il existe entre les deux une relation de cause à effet. Schématiquement : __________________________________________________________________ Relation directe Relation indirecte Facteur Evénement Facteur Evénement A E A E A + AA E + AE A - AA E + AE A - AA E - AE A + AA E - AE A la différence des méthodes précédentes, celle-ci est quantitative, et pour autant plus dangereuse quant à l'éventualité d'associer de façon causale des variables qui n'ont en fait aucune relation causale entre elles. N'importe quel statisticien sait qu'avec un peu de patience, on peut toujours trouver des variables qui présentent un haut degré de corrélation entre elles. Comme le dit M. J. Moroney : "Le meilleur conseil que nous puissions donner à un homme qui trouve une corrélation et commence à dire : "bon sang, mais c'est bien sûr...", c'est : "réfléchis encore une fois. Dix contre un qu'il y a un piège" . Même quand on obtiendrait une corrélation de 100%, cela n'est pas une preuve qu'il existe une relation causale entre les variables observées. Par-dessus le marché, ladite corrélation ne peut rien garantir au-delà de l'intervalle ou de la période examinée. Une règle de variation peut cesser d'être valide au-delà de certaines bornes. Le meilleur exemple est la théorie de la relativité d'Einstein, qui révéla que la physique de Newton est un cas particulier au sein d'un problème plus général et qu'ainsi, au-delà de certaines conditions , ses corrélations entre vitesse, masse, temps et espace cessent d'être valides. Autre exemple cité par Cohen et Nagel : "La période d'un pendule est proportionnelle à la racine carrée de sa longueur si l'amplitude de l'oscillation est petite ; en augmentant la longueur, la période conserve (quoique théoriquement et approximativement) la relation en question avec cette longueur, mais alors, il faut tenir compte d'un autre facteur, la résistance de l'air, de sorte qu'il n'est pas possible d'obtenir une période exacte au moyen d'une formule simple" . De la même façon que les méthodes précitées, la valeur de celle-ci réside dans sa capacité à écarter des hypothèses, mais le danger est beaucoup plus grand d'imaginer de fausses représentations de cause à effet, tant il est possible de trouver des mouvements de n'importe quelle variable qui ont lieu dans la même direction ou dans des directions différentes. Si cette méthode ne s'accompagne pas de méthodes qualitatives dans lesquelles on pourrait isoler les variables étudiées, elle peut devenir totalement arbitraire. Supposons que quelqu'un trouve un coefficient de corrélation inverse élevé entre la vente de glaces à Buenos Aires et la température à New York, à savoir que quand la température augmente dans la cité nord-américaine, la vente des glaces baisse en Argentine, alors qu'une autre personne trouve une corrélation élevée mais en sens direct entre la vente de glaces à Buenos Aires et la température qui règne dans cette ville. Pour démontrer que la seconde corrélation est plus probable que la première, nous devrons avoir recours à des explications ou à des expériences d'un autre type. La manière de terminer la discussion serait de contrôler les variables. Si nous pouvions maintenir constante la température de New York et faire varier celle de Buenos Aires, on pourrait démontrer empiriquement l'erreur de la première hypothèse. Les méthodes qualitatives sont plus concluantes ; les corrélations statistiques ne sont pas une preuve absolue en matière de causalité et, s'il est vrai que les méthodes qualitatives ne fournissent pas non plus de preuve définitive des hypothèses, elles rendent moins probable la construction de modèles faux . Etant donné que les hypothèses ne sont pas des propositions nécessaires mais seulement vraisemblables, les méthodes de confrontation deviennent indispensables, aussi bien pour choisir entre des hypothèses concurrentes que pour faire avancer la science en réfutant des hypothèses déjà établies. Sans test empirique, la méthode hypothético-déductive des sciences de la nature serait impossible. Cependant, il vient une question : pourquoi donc est-il possible de tester des hypothèses? La réponse est la suivante : les phénomènes de la nature présentent une régularité, c'est-à-dire une relation entre les variables qui a un caractère déterministe. Le chercheur peut faire des expériences parce que, quand on maintient égales les conditions pertinentes, devant des stimuli ou des changements déterminés, les choses se comportent de la même manière. En somme, elles réagissent avec régularité. Sans régularité, non seulement l'expérimentation serait impossible, mais l'action de tout le monde le serait aussi. Il n'y aurait aucun moyen de connaître les relations entre les différents événements ; les hommes ne pourraient élaborer aucun plan d'action, et ne sauraient pas à quels moyens recourir pour atteindre leurs fins . Si dans les mêmes circonstances la même cause ne produisait pas les mêmes effets, la vérification empirique serait impossible. La régularité est essentielle pour tester les hypothèses dans les sciences de la nature. On peut facilement voir comment, en l'absence de régularité, les méthodes d'expérimentation devienent vaines : il serait impossible d'arriver à des conclusions à partir d'une observation comme celle-ci : _________________________________________________________________ Cas Evénement Facteurs présents 1 e A B C D E 2 e F G H I J 3 K L M N O 4 e P Q R S T 5 ne U V W X Y Le déterminisme des sciences naturelles a été mis en doute au début de ce siècle avec l'émergence de la physique moderne, à savoir la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Certains physiciens importants, comme Werner Heisenberg et Niels Bohr, en conclurent qu'il existe une indétermination dans la physique subatomique . Pourtant, cela n'est pas certain. Une proposition causale peut avoir trois formes : 1) proposition nulle, à savoir qu'on ne sait rien de la cause du phénomène, 2) proposition complète, qui nous permet de dire : "étant donné certaines conditions, A produit B" et 3) proposition incomplète, qui nous permet seulement d'affirmer : "étant donné certaines conditions, A produit B dans x% des cas". Dans ce dernier cas, le chercheur ne connaît qu'une partie des facteurs qui déterminent un événement, et ignore l'autre partie. Ce n'est que lorsqu'on connaît la totalité des phénomènes qu'on est en position d'énoncer des propositions complètes. Le fait qu'il existe dans la physique subatomique des relations entre les objets observé et l'observateur sans qu'il soit possible de les isoler n'implique pas l'indéterminisme, mais l'ignorance. Elle se trouve à un niveau de la connaissance où on ne sait pas comment observer sans affecter le résultat de l'expérience, et on ne sait pas non plus dans quelle mesure elle affecte l'observateur . Si on ne conclut pas que le caractère probabiliste d'un événement est dû à cequ'il existe d'autres facteurs que nous ne connaissons pas et qui ont une incidence sur le résultat, alors on en est réduit à une seule conclusion : que l'objet observé, à savoir un électron, a la capacité de décider, comme un être humain, de son propre comportement. Le déterminisme et le comportement délibéré sont des concepts mutuellement exclusifs, il n'y a pas de moyen terme entre les deux. Or, conclure que les objets de la nature ont un comportement délibéré impliquerait une régression à l'animisme primitif. D'une certaine manière, quand un événement réfute une hypothèse largement établie, il la transforme en proposition causale incomplète. A partir de ce moment, l'hypothèse n'explique plus cent pour cent des cas, ce qui oblige les savants à chercher l'erreur, et à trouver une hypothèse de caractère plus général, c'est-à-dire qui puisse donner une explication complète. C'est justement sur ce point, du déterminisme contre l'indéterminisme, qu'apparaît la différence de nature entre les sciences naturelles et les sciences sociales : alors qu'il est présent dans les sciences de la nature, il ne l'est pas dans les sciences sociales. La découverte de la théorie "subjective" de la valeur siginifiait "bien plus que la substitution d'une théorie plus satisfaisante du marché à une autre qui l'était moins ". Avec la révolution marginaliste, il n'est pas seulement apparu que les phénomènes du marché sont les conséquences logiques de jugements de valeur personnels, mais en plus, ont été révélés les problèmes épistémologiques différents rencontrés par les sciences naturelles et sociales. Les idées épistémologiques de J. B. Say, N. W. Senior, et J. S. Mill y gagnèrent un nouvel élan et une nouvelle solidité.
Le point-clé est que les évaluations subjectives, qui sont la base fondamentale de la théorie économique, ne sont pas déterminées par des facteurs extérieurs à l'esprit. L'homme, à la différence des choses et des animaux, peut décider de son propre comportement. Libre arbitre signifie que les idées qui sont engendrées dans l'esprit de l'homme ne sont pas déterminées de la manière dont les sont les phénomènes de la nature. La présence ou l'absence d'un certain facteur peut affecter de manières différentes les évaluations de chacune des personnes à des moments différents. A l'évidence, cela ne veut pas dire que les facteurs externes n'aient pas d'influence sur la pensée et notamment les jugements de valeur, ni sur les actions des individus ; ils le font sans l'ombre d'un doute. Ce que l'on veut dire par "indéterminisme de la pensée" est que ces facteurs externes n'influencent pas de manière singulière le résultat des idées et des jugements de valeur .
Ainsi, nous pouvons conclure que, alors que les phénomènes des sciences de la nature sont caractérisés par la causalité, ceux des sciences de la société sont téléologiques , c'est-à-dire que ce ne sont pas des causes (passées) mais des objectifs ou des finalités (l'avenir) qui guident les choix humains . Les "causes" qui font que les objectifs seront x ou z sont indéterminées, elles dépendent du libre choix des personnes. C'est donc de manière indéterminée que les conditions qui règnent à un moment et dans un lieu déterminé infuencent la conduite des hommes . Les faits de la société sont alors le résultat de phénomènes complexes . Ils reflètent seulement les événements uniques qui répondent à un instant déterminé, à un endroit déterminé, à des circonstances et des jugements de valeur jamais reproductibles. La Révolution Française, la bolchevique, la crise de 1929, etc. sont des événements singuliers qui ne peuvent pas se répéter. Le fait que les événements sociaux sont des phénomènes complexes et singuliers rend impossible la confrontation empirique des hypothèses à la réalité. Supposons que quelqu'un soutienne que le développement industriel des Etats-Unis est dû à un certain degré de protectionnisme. La seule chose que l'on puisse faire pour combattre cet argument est de démontrer rationnellement, c'est-à-dire sans recourir à l'expérience, que l'industrie américaine s'est développée en dépit du protectionnisme et que s'il n'y avait pas eu de protection il y aurait une industrie différente et plus efficace. Mais il n'y a pas de moyen pour refaire l'histoire pour démontrer l'erreur de la thèse protectionniste. On peut encore moins démontrer cette erreur en prenant l'exemple d'un pays plus protectionniste que les Etats-Unis et de moindre potentiel industriel, comme par exepmple l'Argentine. Le protectionniste pourrait faire valoir que les conditions n'étaient pas les mêmes, parce que l'Argentine avait d'autres facteurs qui ont fait plus que compenser les effets de la protection. D'un autre côté, un pays totalement libéral pourrait avoir un volume de production inférieur à un autre qui serait protectionniste si les valeurs qui prédominent chez les personnes de la société libre favorisaient l'oisiveté et la contemplation plutôt que la production de biens et de services "matériels". En résumé, sans une observation ceteris paribus, c'est-à-dire avec des variables contrôlées, il est impossible de réfuter et encore moins de prouver des propositions. A son tour, cela permet qu'apparaissent et se maintiennent des théories fausses avec la plus grande facilité. Le développement de théories qui incorporent le sophisme post hoc, ergo propter hoc, est fort commun. Ainsi, par exemple, nous avons le cas de la théorie qui soutient que dans certains cas, l'inflation est causée par l'augmentation des salaires, du prix des combustibles ou des coûts en général. Sans contrôle de ces variables, il est impossible de démontrer empiriquement l'erreur de la théorie de l'inflation par les coûts. C'est pour ces raisons que l'histoire reste sujette à de multiples interprétations. Chaque historien ou économiste explique les événements d'une certaine période sur la base de relations différentes de cause à effet. Par exemple, John Maynard Keynes, Milton Friedman et Benjamin M. Anderson attribuent des causes différentes à la crise des années trente, et plus de cinquante ans passés après ces événements, il continue à y avoir une divergence dans les interprétations. Ces divergences seraient terminées s'il était possible de contrôler les variables et si le comportement des individus était déterminé, ou s'il y avait une régularité dans la relation stimulus-réponse. Ces deux conditions étant données, il suffirait de reproduire certaines périodes historiques, changer les variables désirées, contrôler le reste, et étudier les conséquences. Alors, si l'expérience et l'observation des faits sociaux ne permettent pas de prouver ni de réfuter les théories économiques, nous devons poser la question : l'économie est-elle une science? Comment est-il possible de savoir quelle théorie est vraie et laquelle est fausse? La réponse est que les sciences sociales, et donc l'économie, sont des sciences, mais qu'à la différence des sciences de la nature, ce ne sont pas des sciences hypothético-déductives mais aprioristiques . En effet, comme nous l'avons vu, dans les sciences naturelles le savant part d'hypothèses, c'est-à-dire de prémisses probables, pour expliquer un certain événement. Comme une hypothèse est l'une parmi d'autres explications possibles d'un événement, la confrontation empirique, comme nous l'avons vu, devient essentielle. En économie, les prémisses à partir desquelles on commence à faire des déductions ne sont pas probables, mais ce sont des propositions a priori, c'est-à-dire nécessairement certaines. Une proposition a priori est celle dont la négation est impensable : elle apparaît comme absurde à l'esprit de l'homme. Par exemple, il est impossible que la partie soit plus grande que le tout, ou que A puisse être en même temps non-A. L'observation ne peut prouver ni réfuter une proposition a priori car ce sont des catégories mentales évidentes en elles-même. M. R. Cohen expose cette idée de la manière suivante : "[L'a priori] dénote des propositions qui doivent être absolument et inconditionnellement vraies et ne jamais pouvoir être réfutées par aucune chose qui puisse être arrivée ou devoir arriver où que ce soit et quand que ce soit ". Les théorèmes déduits de propositions a priori, s'il n'y a pas d'erreurs dans la chaîne du raisonnement, sont nécessairement vrais et ne sont pas sujets à confrontation ni réfutation empirique. Toute différence entre la conclusion des théorèmes et l'observation empirique doit être attribuée à une erreur d'observation. Par exemple, si un homme sait qu'il a sept pommes et sait aussi qu'on lui en a donné cinq de plus, il n'est pas nécessaire qu'il compte les pommes pour savoir que maintenant il en a douze. Mais s'il les compte et n'en trouve pas douze, personne ne prendra cela pour une preuve que 5 + 7 ne font pas 12, et il faudra nécessairement recourir à une autre forme d'explication pour justifier la différence. Quoique J.B. Say, N.W. Senior, J.S. Mill, J.E. Cairnes et C. Menger eussent déjà signalé le caractère a priori de la science économique, sa base la plus systématique et la plus concise fut donnée par L. von Mises . Cet économiste a démontré que l'économie fait partie d'une science plus vaste : la praxéologie, et que tous les théorèmes praxéologiques sont impliqués par la catégorie de l'action humaine. La première étape est de les extraire et de les déduire, exposer leurs implications et définir les conditions universelles de l'action en tant que telle . Mais comme le propos de toute théorie est de connaître la réalité, la seconde étape consiste à restreindre la recherche à l'étude de l'action dans les conditions que la réalité impose à l'homme. Par exemple : "La désutilité du travail n'est pas une réalité catégorique et aprioristique. Nous pouvons, sans contradiction, penser à un monde dans lequel le travail ne cause qucunde peine, et nous pouvons décrire la situation qui prévaudrait dans ce monde-là. Seulement, les théorèmes fondés sur la supposition que le travail est une source de peine sont applicables pour la compréhension de ce qui se passe dans ce monde ". Ce recours à l'expérience ne change pas le caractère a priori de la science économique. Sa fonction est seulement de restreindre le domaine de l'étude de l'action humaine à ceux des problèmes que l'on considère comme importants pour des raisons pratiques. Si les théorèmes économiques ne pouvaient pas être réduits à des principes ultimes, c'est-à-dire à des propositions a priori, alors la théorie économique serait impossible, car l'absence de régularité et de contrôle des variables rend impossible sa confrontation empirique. Les modèles de l'économie mathématique non seulement partent de suppositions ou de prémisses qui ne sont pas aprioristiques, mais en plus sont irréalistes. Si le modèle part de prémisses réalistes mais probables, de sorte qu'il puisse y avoir d'autres prémisses également réalistes qui donnent naissance à d'autres modèles, alors on aura besoin du test empirique pour décider entre des modèles concurrents, mais comme nous l'avons vu, cela est impossible d ans les sciences sociales. Ainsi, les modèles de l'économie mathématique ne laissent pas d'être des hypothèses impossibles à tester ; jamais on ne peut décider entre un modèle ou un autre. Il vaut la peine de répéter quem même quand on obtient un degré élevé de corrélation statistique entre les variables du modèle, cela n'est pas une preuve que ces relations causalesólö soient les bonnes. Pour réussir à contruire un modèle économique réaliste et vrai en même temps, les prémisses dont on part doivent être nécessairement vraies, c'est-à-dire a priori. Certes, l'économiste mathématicien, en formulant son modèle, se voit forcé d'introduire des suppositions irréalistes qu'exige l'utilisation même des outils mathématiques. Cela est dû à ce que les propositions verbales ne sont pas toujours traduisibles en termes mathématiques à moins qu'on ne change la signification et la nature de la proposition. Il y a des économistes pour qui l'introduction de suppositions irréalistes n'est pas un problème si celles-ci permettent de développer des théorèmes capables de prédire . Il ne semble pas y avoir beaucoup de différence entre les explications théoriques que cette position épistémologique prétend avancer et ceux qui consultent une gitane pour qu'elle leur prédise l'avenir en leur tirant les cartes ou en leur lisant les lignes de la main ; ou avec l'astrologie qui pronostique l'avenir des gens en étudiant la situation et l'aspect des planètes. L'objectif de la science est d'étudier des relations "réelles" des phénomènes et non de faire des prédictions. A l'évidence, dans la mesure où on connaît les causes d'un événement, il sera possible, quoique pas dans tous les cas, de faire des prédictions. Pour dire que l'important est de bien prédire sans se soucier du moyen qu'on utilise, même si celui-ci est illusoire, implique de réduire la théorie au niveau du mythe. A cet égard, il vaut la peine de citer M. J. Moroney : "Les modes ne changent pas moins en fait d'absurdités et de superstitions qu'en matière de chapeaux pour dames. Il fut un temps où les papes et les rois avaient des astrologues à la cour pour les aider à planifier l'avenir. Aujourd'hui, les directions de l'Etat ont des statisticiens pour le même usage. Un beau jour, ils seront relégués aux journaux du dimanche pour chasser les astrologues de leur dernier refuge. Je peux comprendre le culte des astrologues de cour. Après tout, l'astrologue était un astronome, et si un homme a réussi à prédire des éclipses en regardant les étoiles, pourquoi n'aurait-il pas le même succès en prédisant le cours d'événements plus terrestres en prenant connaissance de la disposition des corps célestes? Mais pour la plus grande partie des travaux statistiques des services de l'Etat, je ne peux trouver que bien peu d'excuses" . La perte de prestige qui a atteint les prédictions économiques au moyen de modèles économétriques est aujourd'hui assez grande et a été admise par les partisans mêmes de la prévision. Ainsi, Martin Feldstein, de Harvard, qui fut Président du Council of Economic Advisers de Reagan, a dit : "Une des grandes erreurs de la politique économique des trente dernières années a été une confiance excessive dans la capacité de prédire" . Le même Milton Friedman concède : "nous avons prétendu faire plus que nous ne pouvions faire" . Un autre économiste important, Wassily Leontief, se plaint de ce que : "les revues d'économie sont pleines de formules mathématiques qui conduisent le lecteur d'un ensemble de présupposés plus ou moins plausibles mais complètement arbitraires à des conclusions théoriques sans intérêt mais précisément exposées" . Lawrence R. Klein, coauteur avec R. M. Young du livre An Introduction to Econometric Forecasting and Forecasting Models, se met sur la défensive en écrivant : "Au moins, les modèles économétriques peuvent fournir une réponse immédiate à n'importe quel grand événement comme un embargo ou un changement de la politique budgétaire ou monétaire" . Il devrait être suffisamment clair que pour prédire de grands changements, on n'a pas besoin d'un modèle économétrique. Par exemple, les grands changements de la politique monétaire ou budgétaire répondent aux actions concrètes de ceux qui règlementent ces variables et la seule manière de les prédire est de connaître ou d'essayer de deviner ce que la bureaucrate de service pense de la question ou quelles chances il y a que le parlement approuve les réformes fiscales. Un modèle économétrique a peu de chose à dire, ou rien du tout, sur ces questions. De son côté, R. E. Lucas, représentant connu de l'école des anticipations rationelles, a dit que les grands modèles économétriques utilisés pour faire des simulations "[...] ne peuvent pas donner d'informations utiles quant aux conséquences réelles de politques économiques concurrentes" . Cette reconnaissance de l'échec des prédictions n'est pas due, comme le pense George J. Stigler, à ce que "l'économie est encore une science primitive comparée à l'avancement des sciences de la nature" [...]. L'impossibilité de la prévision est due à ce que les événements sociaux sont un effet de l'action des individus, et que ces actions, comme nous l'avons déjà dit, sont indéterminées, elles ne sont "fonction mathématique" de rien du tout. La bonne prévision consiste à prévoir les actions des gens, mais la théorie économique n'a rien à nous en dire ; ce qu'elle nous permet de connaître , ce sont les conséquences de ces actions. La théorie économique nous dit que si l'action est A, les conséquences seront A1, A2, A3... An, et que si l'action est B, les conséquences seront B1, B2 ; B3...Bn, etc. Le problème crucial est de savoir quelle sera l'action concrète et comment, pour leur part, les conséquences de cette action influenceront les choix à venir des autres personnes. Nous devons nous rappeler que plus une société est grande, plus complexe sera le phénomène résultant puisqu'il y a, disons à l'instant 1, des millions d'actions indéterminées dont les conséquences influenceront aussi de façon indéterminée des millions d'actions à l'instant 2, et ainsi de suite. L'activité entrepreneuriale consiste justement à essayer de prévoir et d'évaluer les actions personelles qui se traduisent par des prix. Cependant, cette activité est un art, car elle se fonde sur des jugements subjectifs de pertinence . Le caractère indéterminé des actions est ce qui rend impossible une modélisation rationnelle des attentes, et par conséquent des actions. Toute modélisation des anticipations est nécessairement arbitraire, se fonde sur des appréciations subjectives qui reçoivent le nom de "compréhension" . Nous pouvons [donc] regrouper les erreurs de prévision économique en deux catégories : 1) les erreurs de "compréhension" et 2) les erreur de théorie. Dans le premier cas, l'erreur de la prédiction est due à ce que les jugements subjectifs du prédicteur étaient faux, par exemple, il pensait que les personnes concernées allaient poursuivre l'action A alors qu'elles ont choisi l'action B. Les conséquences logiques (ou aussi bien théoriques) dans chacun des cas étaient différentes, et c'est pourquoi la prédiction s'est trompée. Dans le second cas, le jugement subjectif peut être correct mais on aura pu se faire une idée erronée des conséquences de l'action. Le premier type d'erreur, qui est essentiel aux sciences sociales, introduit un problème suplémentaire de testabilité puisqu'une prédiction fausse peut être due à des jugements subjectifs erronés et non pas à ce que la théorie était mauvaise. Cependant, cela implique aussi qu'on ne peut pas décider avec une nécessité logique si c'est des jugements subjectifs, ou de la théorie, que provient l'erreur. Si on ne contrôle pas les variables, et s'il n'est pas possible de s'assurer des jugements de valeur ni des choix personnels, alors il n'existe aucun moyen de trancher : n'importe laquelle des explications est logiquement admissible. Cela fait que la prédiction n'est pas un moyen approprié pour décider entre des théories concurrentes : il est impossible d'appliquer la méthode hypothético-déductive dans les sciences sociales, et par conséquent en économie. Il est important d'ajouter qu'en plus de ce problème de nature, il existe une série de problèmes pratiques qui sont liés à l'authenticité et à l'exactitude des statistiques sociales et économiques . La manière d'élaborer les indices de prix, les séries de produits bruts, etc., ne répond pas aux exigences minimum de la théorie de la mesure. "Il devrait être clair a priori, dit Morgenstern, que la majorité des statistiques économiques ne doivent pas être exprimées de la manière dont on le fait normalement, prétendant à une exactitude qui peut en fait être complètement hors d'atteinte et qui n'est pas exigée pour la majorité d'entre eux [...]. "Les chiffres de chômage pour plusieurs millions se donnent jusqu'au dernier mille (soit un dix-millième de pourcent!) alors qu'en réalité, ce sont les centaines de milliers, voire dans certains cas les millions qui sont problématiques ." Le mensonge aussi joue un rôle pertinent ; ainsi, nous rappelle Morgenstern :
- "Quand on a mis en place le plan Marshall, l'un des premiers personnages chargés de son administration (dont nous tairons le nom) me dit :
- 'Nous fabriquerons toute statistique dont nous pensons qu'elle pourra nous aider à soutirer aux Etats-Unis autant d'argent que nous le pouvons. Les statistiques que nous n'avons pas, mais dont nous avons besoin pour justifier nos demandes, nous les inventerons, tout simplement'."
- "Ces statistiques qui 'prouvaient' la nécessité de certaines classes d'aide seraient incluses dans les compte-rendus historiques de la période comme des descriptions économiques véridiques de cette époque".
- Il se peut même qu'on vienne à s'en servir dans le travail économétrique!" [].
M. J. Moroney semble avoir mis dans le mille quand il disait du calcul statistique :
- "Les prévisions économiques, comme les prévisions du climat en Angleterre, ne sont valides que pour les six heures à venir environ. Au-delà, c'est de la pure pifométrie" .
Pour éviter la confusion il est important de distinguer clairement entre la théorie et les faits économiques. La théorie économique est un ensemble de théorèmes qui partent de prémisses nécessairement certaines, et par conséquent, s'il n'y a pas d'erreur dans les syllogismes, ces théorèmes ne sont pas seulemement vrais mais par-dessus le marché ils sont exacts. Le fait que les théorèmes économiques sont exacts n'implique pas une capacité de prédiction, parce que ces théorèmes nous expliquent les conséquences logiques de différents types d'actions, mais ne nous disent rien (et ne peuvent pas nous le dire) quant à savoir quelles actions seront menées à bien par les individus, ni comment ces conséquences se répercuteront sur le comportement des autres individus. Ces théorèmes ne nous disent rien non plus de l'ampleur de ces conséquences.
L'utilité des théories économiques est très limitée pour des fins de prévision, mais elle est d'une grande importance pour savoir à quels moyens il faut avoir recours pour obtenir une allocation efficace des ressources. Gr^éce aux théorèmes économiques, on peut savoir, par exemple qu'une politique protectionniste, les impôts progressifs ou le contrôle des prix produisent une allocation inefficace des ressources. Le caractère a priori de la science économique nous permet de conclure qu'il en est nécessairement ainsi, alors même qu'on ne pourrait pas le démontrer de façon empirique. Nous pourrions résumer ce qui précède de la manière suivante :
- 1) quand une science part de prémisses plausible elle est hypothético-déductive ;
- 2) dans la mesure où la prémisse est plausible c'est à dire non nécessaire, le test empirique devient un facteur indispensable pour mettre l'hypothèse à l'épreuve.
- 3) l'hypothèse ne peut jamais être prouvée, seulement réfutée ; dans ce sens, il faut affirmer que, même lorsque l'hypothèse a résisté à de nombreuses épreuves empiriques elle n'est pas pour autant définitivement établie ;
- 4) Le test empirique est possible dans les sciences de la nature parce que les relations entre ses éléments sont déterminées, c'est-à-dire que dans des circonstances identiques, un même stimulus provoque toujours la même réponse, car dans les sciences naturelles il y a régularité.
- 5) Comme l'homme est capable de choisir sa conduite, dans les sciences sociales il n'y a pas de déterminisme et par conséquent il n'y a pas de régularité non plus ;
- 6) L'absence de régularité rend impossible de tester empiriquement les hypothèses, car les faits sociaux sont caractérisés par ce qu'ils sont uniques et non répétables ;
- 7) les modèles de l'économie mathématique partent de prémisses non nécessaires, et dans la majorité des cas irréalistes, et ne sont donc que des hypothèses ;
- 8) l'impossibilité de tester empiriquement les hypothèses en sciences sociales fait que les modèles mathématiques sont par voie de conséquence impossibles à tester.
- 9) Quand une hypothèse n'est pas testable, elle n'est pas scientifique.
- 10) L'économie peut néanmoins être une science parce que ses théorèmes peuvent être réduits à une prémisse qui est de caractère nécessaire et non de caractère probable. En ce sens, l'économie, comme la mathématique et la logique, est une science a priori. Par conséquent, les théorèmes économiques sont nécessairement vrais et n'ont aucun besoin de vérification empirique.
4 LOGIQUE VERBALE ET MATHEMATIQUE : LA CLARTE
Les arguments qui ont été avancés en faveur de la supériorité de l'utilisation de la mathématique face à l'usage de la logique verbale pour l'analyse économique sont divers, mais on peut les résumer comme quoi l'utilisation des mathématiques rendrait l'économiste "plus rigoureux" dans la position des hypothèses et dans le raisonnement déductif. Voyons, à titre d'exemple, les citations suivantes :
1) L. R. Klein :
- "les contributions non mathématiques à l'analyse économique ont souvent tendance à être grossières, brouillonnes et vagues"
et
- "la clarté de la pensée est ce qui caractérise l'économie mathématique" [].
2) William J. Baumol :
- "Un des avantages des méthodes mathématiques est que leur utilisation nécessite l'énumération explicite de toutes les prémisses employées dans l'analyse. Les règles du jeu nous interdisent d'introduire des hypothèses au milieu de l'argumentation ou d'employer une prémisse qui n'aurait pas été énoncée et peut-être même pas reconnue par nous au moment de l'utiliser [t'as qu'à croire !]. Il faut admettre que c'est là la racine d'une faiblesse importante de l'analyse littéraire, dans laquelle il est souvent facile de glisser de nouvelles hypothèses quand elles sont commodes, pour arriver avec leur aide à toutes les conclusions que l'on veut" ;
et 3) George J. Stigler :
- "[...] l'économiste formé en mathématiques expose ses conclusions, en moyenne, de façon plus claire que l'économiste non mathématicien" .
Citons donc un paragraphe du célèbre économiste mathématicien Gérard Debreu pour illustrer la clarté que Klein et Stigler attribuent à l'exposition mathématique de problèmes économiques ; voici donc Debreu :
- "L'économie de propriété privée Ó = ((Xi,Û), (Yj), ( i), (Èij))
i
- possède un équilibre si :
- pour tout i
- (a) Xi est fermé, convexe et possède une cote inférieure pour Û,
- (b-1) il n'y a pas de consommation saturée en Xi (b-2) Pour tout x'ien Xi, les ensembles {xiÓ Xi| xiÚ x'i} et { xiÓ Xi| xiÛ x'i},
i i sont fermés en Xi,
- (b-3) Si x1iet x2i sont deux points de Xi, et si t est un nombre réel en ]0,1[, alors x2i> x1i implique tx2i+(1-t)x1i> x1i,
i i
- (c) Il existe un x0ien Xi tel que X0iÆ i
Pour tout j (d-1) 0 Ó Yj ;
- (d-2) Y est fermé et convexe
- (d-3) Y Ô (-Y)c{0}
- (d-4) Y (-Í) ."
Si je ne me trompe, pour la grande majorité des lecteurs, la seule chose qui ait été claire est :
- "L'économie de propriété privée possède un équilibre si :".
Pour un autre groupe, plus petit, familiarisé avec la théorie des ensembles, la citation sera un peu plus claire, parce qu'il comprendra la "signification" de mots comme "fermé", "convexe", "cote inférieure", etc. dans le contexte où ils ont été écrits. Mais seuls ceux qui auraient compris ce que Debreu veut "dire" par Ó, Xi, Yj , i ,Èij, etc., pourraient comprendre toute la citation. La clarté de ce qu'on cherche à communiquer dépend de :
- 1) La quantité de personnes qui comprennent la signification des symboles employés pour transmettre la pensée, et
- 2) le degré d'ambiguïté des symboles employés.
Nous allons voir chacune de ces conditions. Si j'écris "pytaquí", il sera difficile à quiconque de comprendre ce que je veux dire, et si je l'emploie dans une adresse comme "cette nuit, j'ai contemplé pendant trois heures les contours de pytaquí", cela peut donner lieu à des milliers d'interprétations. Cela est un cas extrême, où je suis le seul à connaître la signification du symbole "pytaquí". A moins que je n'échange ce symbole contre un autre que le reste des gens puisse comprendre, il sera impossible de transmettre mon message. Si je remplace le symbole "pytaquí" par "Uranus", la clarté de ce que je veux communiquer augmente notablement du fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui comprennent ce qu'on veut dire quand on écrit "Uranus".
Un exemple moins extrême est celui des langues. Il en est certaines dont les mots, c'est-à-dire les symboles, sont connus avec une plus grande universalité que ceux des autres, par exemple, un livre écrit en Anglais sera compréhensible pour beaucoup plus de monde qu'un livre écrit en Japonais. L'utilisation des mathématiques nécessite, pour faciliter les règles de l'inférence, l'utilisation de symboles, généralement des lettres, qui représentent des variables et des constantes. Mais les lettres isolées, en général, n'ont pas de signification. Par exemple, on peut écrire : "CT = CV + CF", dont la signification est moins claire que d'écrire : "le coût total est égal au coût variable plus le coût fixe". Une fois qu'on connaît le sens de "CT", "CV", et "CF", les deux manières d'écrire cette proposition sont équivalentes. Cependant, pour que les deux formes aient une capacité égale à transmettre à d'autres personnes ce qu'elle veut dire il faudrait que les symboles "CT", "CV" et "CF" soient compris par la même quantité de personnes qu'il y en a pour comprendre les symboles "coût total", "coût variable" et "coût fixe". Mais si cela arrive, alors "CT", "CV" et "CF" se convertiraient en mots, par exemple "CT" serait synomyme de "coût total".
En dernière instance, les mots sont des symboles que les gens associent avec des concepts ; sans cette association, la communication serait impossible. Il est par conséquent contradictoire d'affirmer que l'utilisation de symboles en soi privés de signification permettrait "en moyenne" (?) d'exprimer plus clairement les concepts et les idées que l'on cherche à transmettre, comme le croient Stigler et Klein []. Naturellement, une partie (voire une grande partie) du problème de la communication n'est pas seulement dû à ce que les symboles utilisés en mathématiques n'ont pas de sens pour le lecteur . Cependant, que le problème ait une cause ou une autre, la conclusion devrait être l'opposée de celle de Stigler :
- "en général, l'économiste mathématicien tend à exposer ses concepts sous une forme moins claire que l'économiste non mathématicien".
Le second facteur dont nous avons mentionné le lien avec la clarté de l'exposition est celui de l'ambiguïté des termes . Il arrive souvent qu'un mot puisse avoir plus d'une signification, c'est-à-dire qu'un symbole peut être associé à plus d'un concept. Quand cela arrive, le message ou la proposition de celui quui écrit peut donner lieu à des interprétations divergentes, de sorte que le lecteur comprendra quelque chose de différent de ce qu'il voulait dire, ou bien s'il se rend compte de l'ambiguïté, il ne pourra pas savoir avec précision ce que la personne qui écrit voulait transmettre. L'exemple classique pour illustrer le cas de l'ambiguïté est celui de Crésus, roi de Lydie, qui, avant de partir en guerre contre la Perse, s'en fut consulter l'oracle de Delphes, pour être sûr que la victoire serait sienne. La réponse de la Pythie fut la suivante :
- "Si Crésus commence la guerre contre la Perse, il détruira un puissant royaume".
Crésus, enthousiasmé par la réponse, déclara la guerre et fut mis en déroute par les Perses. Devant la plainte de Crésus, les prêtres de Delphes répondirent que la prédiction avait été correcte : Crésus avait détruit un puissant royaume : le sien !
L'exemple que donne J. M. Copi est aussi une bonne illustration : c'est la définition que l'on donne de l'anthropologie en Anglais : The science of man embracing woman []. Dans ces deux exemples, les symboles "un puissant royaume" et "embracing" sont ambigus, on peut les associer à plus d'un concept. A l'évidence, l'utilisation de la logique verbale pour faire des déductions peut donner lieu à des impressions et à des conclusions fausses si on utilise des mots à double sens, mais ce problème ne se résout pas en utilisant les mathématiques. Comme le dit H. R. Seager,
- "il n'y a pas de vertu souveraine dans les modalités de la pensée mathématique"
qui protège l'économiste mathématicien de l'erreur ; bien plus, comme nous le verrons, c'est le contraire qui se passe. La seule manière d'éviter les erreurs d'ambiguïté auxquelles peuvent conduire certains mots est de préciser leur définition. C'est dire a fortiori que nous ne pouvons pas définir quelque chose en utilisant des symboles privés de signification ; il n'y a qu'avec des mots que nous pouvons donner des définitions qui puissent éliminer les ambiguïtés. Bien souvent, le contexte dans lequel on écrit une idée suffit à éliminer les ambiguïtés, même lorsque le texte peut avoir des interprétations littéralement ambiguès. Si, par exemple, on lit : "les salariés ont adopté l'échelle mobile", personne ne doute de la "nature" de l'échelle en question. On ne pensera pas spontanément à des salariés se promenant avec une échelle sur l'épaule. De la même façon, on comprend une affirmation du genre : "je prends le soleil", il y aura peu de gens, ou pas du tout, pour en conclure que je me "saisisse" du soleil, quoique le symbole "prends" puisse être interprété dans ce dernier sens. Il existe d'autres cas, en revanche, dans lesquels l'ensemble des symboles est clairement ambigu. Si nous disions simplement : "les osselets de la petite se sont cassés", on pourait l'interpréter comme si elle s'était cassé l'articulation du poignet ou si elle avait cassé son jeu. Ce sont des cas qui demandent plus d'information, c'est-à-dire plus de symboles significatifs, pour éviter le double sens. Celui qui rédige doit rester sur ses gardes pour éviter des indéterminations de ce type. Il y a lieu de faire la même remarque à propos de la ponctuation ; si par exemple nous écrivons :
- "Les économistes(,) qui croient que l'utilisation des mathématiques rend la théorie plus rigoureuse, se trompent."
Selon que nous mettons ou non la virgule, le sens de la phrase change beaucoup. L'absence de virgule donne à entendre que l'on ne parle que de certains économistes, alors que la présence de la virgule donne à penser que l'on parle de tous les économistes. Ce type d'ambiguïtés et d'imprécisions peut évidemment exister lorsqu'on utilise la logique verbale pour déduire des théorèmes, mais cela n'implique en rien que l'usage des mathématiques résolve le problème ou le réduise. Il est donc opportun que l'économiste, avant d'être un expert en mathématique et en statistique, se repose sur les notions fondamentales de la logique pour éviter les erreurs dans ses raisonnements et apprenne à rédiger correctement pour transmettre ses idées sous la forme la plus claire possible. Dans ses conférences de Glasgow, Adam Smith insistait avec grande éloquence sur le fait que la précision est le moyen d'améliorer son utilisation du langage. Le perfectionnement du style, disait Smith,
- "consiste à exprimer la pensée de l'auteur de manière plus concise, appropriée et précise, et le faire d'une manière qui transmette mieux le sentiment, la passion ou l'émotion qui l'affecte (ou celle dont il croit être touché), et qu'il a décidé de transmettre au lecteur. Cela, direz-vous, n'est rien d'autre que le sens commun : et c'est bien en effet le cas" [].
Affirmer que l'exposition en symboles mathématiques est en moyenne plus claire que l'exposition en langage ordinaire ne semble pas avoir le moindre fondement logique et ne peut pas être tenu pour davantage qu'un slogan émotif.
5 LOGIQUE VERBALE ET MATHEMATIQUE. VOUS AVEZ DIT : "RIGUEUR" ?
Paul Samuelson a dit :
- "En principe, la mathématique ne peut pas être plus mauvaise que la logique verbale en théorie économique ; en principe, elle ne peut certainement pas être meilleure qu'elle, puisqu'en dernière instance, -sans tenir compte des problèmes de tactique et de pédagogie- les deux moyens sont strictement identiques".
Cela ressemble à ce que disait Irving Fisher :
- "Il n'y a pas d'endroit où vous puissiez aller en train où vous ne puissiez aussi aller à pied ".
Les idées de Fisher et Samuelson sont vraies, quoique de manière grossière. Car si toute formulation mathématique est traduisible en paroles, tout ce qui se dit avec des mots ne peut pas se traduire en langage mathématique. La symbolique mathématique telle que nous la connaissons à notre époque est le résultat d'une évolution très lente au cours de l'histoire. Les symboles furent introduits petit à petit par commodité pour la mécanique du calcul. Par exemple, il serait possible de multiplier "quatre mille cinq cent vingt-trois" par "trente mille quatre cent cinquante-deux" en n'utilisant que des mots, mais à l'évidence le calcul est beaucoup moins embarrassant lorsque nous "traduisons" les mots en symboles numériques. Non seulement la "visualisation", mais aussi la mécanique du calcul sont énormément facilités.
La meilleure preuve de cela est l'algèbre, dont le nom dérive d'un livre perse appelé Al-Jabr w'al nuqâbalah, et dont l'auteur était al-Khowârizmî . Dans ce livre, qui d'après ce que l'on croit fut publié aux environs de l'année 800 av. J.-C., al-Khowârizmî développa deux méthodes pour résoudre les équations quadratiques de la forme x2 + px = q sans introduire un seul symbole mathématique. L'algèbre conserva sa forme verbale pendant plus de 500 ans. Juste aux alentours de 275 av. J.-C., un fameux mathématicien grec, Diophante d'Alexandrie, aurait introduit pour la première fois "un symbole algébrique qui mérite cette appellation" .
Le signe égale (=) ne fut introduit qu'en 1557 par le mathématicien anglais Robert Recorde et le signe (x) de la multiplication est des alentours de 1600 []. Comme le lecteur peut l'imaginer, avant qu'on introduisît ces symboles, les gens faisaient tout autant de multiplications et d'égalités . La symbolique mathématique n'est rien d'autre qu'une manière de traduire les mots dans le but de faciliter le calcul et les déductions de certains concepts. La symbolique mathématique n'est pas plus ni moins rigoureuse que son équivalent en prose. Les mots "égal", "moins", "par", "divisé", par exemple, ne sont ni plus ni moins rigoureux que les symboles "=", "+", "-", "x", "÷" ; et les mots "deux", "trois", et "quatre", non plus ne sont ni plus ni moins rigoureux que les symboles "2", "3", et "4" ; bien plus, nous pourrions dire qu'ils sont synonymes car "=", "+", "2", et "3" ont une signification.
Karl Menger lui-même (mathématicien distingué et fils du fondateur de l'Ecole Autrichienne d'économie) et qui fut comme nous l'avons vu un des promoteurs les plus importants de l'économie mathématique à Vienne, a signalé que :
- "L'affirmation :
- (1) "n'importe quel nombre réel augmenté de un est égal à un augmenté de ce nombre"
- est parfaitement équivalente à l'affirmation :
- (1') x + 1 = 1 + x pour tout x réel "
Aussi bien sont "parfaitement équivalentes" les expressions "deux plus deux égale quatre" et "2 + 2 = 4". La différence est que la seconde expression économise l'espace et permet de lire plus rapidement et dans le cas d'expressions algébriques plus longues et plus compliquées l'utilisation de symboles mathématiques est beaucoup plus commode et concise.
Ecrire avec des mots une expression comme y = x2 + 83x - 24 z + 8,81 w est fort peu commode. Cependant, la différence entre les deux formes d'écriture n'est qu'une différence de "place" ; la lecture des mots prendrait beaucoup plus de temps, mais elle ne serait en aucune manière moins exacte ou rigoureuse. L'utilisation de la symbolique mathématique à la place des mots devient beaucup plus pratique au moment de faire des calculs. Une somme de polynomes, par exemple, serait ennuyeuse à l'extrême si nous avions les polynomes écrits avec des mots ; la résolution nous prendrait beaucoup plus de temps mais, encore une fois, ce n'est pas pour autant qu'elle serait moins exacte ni rigoureuse. Maintenant, ces exemples maintiennent une équivalence parfaite entre leur forme verbale et symbolique parce que la nature de ce que l'on dit permet de les exprimer indifférement sous l'une ou l'autre forme. La nature du problème est telle qu'elle se réfère à des quantités et à des relations entre des quantités ou, si l'on préfère, à des variables susceptibles d'être quantifiées. Comme le dit Keynes :
- "Dire que la production nette d'aujourd'hui est plus grande que celle d'il y a dix ans, ou un an, mais le niveau de prix inférieur, est une affirmation similaire à dire que la reine Victoria était une meilleure reine mais pas une femme plus heureuse que la reine Isabelle (assertion qui n'est pas dépourvue de signification ni d'intérêt, mais qui est inappropriée comme matériel pour le calcul différentiel). Notre précision serait burlesque si nous essayions d'utiliser de telles expressions, partiellement vagues et des concepts non quantitatifs comme bases d'une analyse quantitative" [].
La grande erreur des économistes mathématiciens est de vouloir traduire des expressions verbales en équations sans se soucier de savoir si ce que l'on dit par une telle traduction équivaut exactement à ce qu'on a dit avec des mots. Le point est crucial, parce que s'il n'existe pas une équivalence parfaite, la formulation mathématique pourrait conduire à une quantité d'implications logiques plus grande ou plus petite que ne le permettrait l'emploi de la langue naturelle []. Voyons quelques exemples en commençant à nouveau par une citation de Karl Menger (fils) :
- "En ce qui concerne la précision, considérons, par exemple, les propositions suivantes :
- - (2) A un prix plus élevé pour un bien correspondra une moindre demande (ou pour le moins une demande qui n'est pas plus grande) ;
- - (2') Si p signifie le prix, et y la demande d'un bien, alors q = f (p) et dq/dp = f'(p) < 0.
- Ceux qui considèrent la formule (2') comme plus précise ou "plus mathématique" que la phrase (2) sont complètement dans l'erreur...
- La seule différence entre (2) et (2') est la suivante : alors que (2') se limite à des fonctions qui sont différentiables et dont les représentations graphiques ont par conséquent une tangente (qui d'un point de vue économique, ne sont pas plus raisonnables qu'une courbure), la phrase (2) est plus générale, mais cela ne veut pas dire moins précise ; elle a la même précision mathématique que (2') .
Comme le dit bien Karl Menger (fils), la formulation (2') "se limite à des fonctions qui sont différenciables". Pourtant, la généralité des cas démontre que les fonctions de demande ne sont pas continues. Même si on peut penser au prix comme à une variable continue, il est plus difficile d'accepter cette supposition de continuité en ce qui concerne la variable "quantité". La majorité des produits ne sont pas fongibles (les voitures, les vêtements, les bureaux, les chevaux, etc.). Et quand ils le seraient, les gens ne prennent pas de décisions sur des quantités infinitésimales []. Alors, si la formule (2') fait référence à quelques cas (peut-être si peu nombreux qu'ils sont des cas marginaux), cela en fait une expression moins générale que la phrase (2) ; les deux formulations ne sont pas "exactement" équivalentes. Ainsi, traduire la phrase (2) dans l'expression (2') affaiblit la rigueur de ce que l'on veut dire. Observons que si on traduisait l'expression (2') avec des mots reflétant exactement ce qu'elle veut dire, nous n'obtiendrons pas (2) mais quelque chose comme : "la quantité demandée (q) est fonction du prix (p), la dérivée de q par rapport à p étant non positive". Evidemment, on pourrait se passer de la supposition de continuité, mais je la cite à cause de la popularité dont elle jouit dans la théorie économique dominante de nos jours (pour vérifier la popularité en question, il suffit d'ouvrir n'importe quel texte de microéconomie).
Un autre exemple est le cas, largement généralisé, de l'optimum du consommateur. Comme l'enseigne l'économie mathématique, un consommateur qui doit choisir entre deux biens x et y maximise son bien-être quand la condition est satisfaite que le taux marginal de substitution entre x et y est égal au rapport des prix de x sur le prix de y. Le taux marginal de substitution de x par rapport à y se définit comme le nombre d'unités de y qu'il faut sacrifier au profit d'une unité de x de telle façon que soit maintenu un niveau constant de satisfaction. Cela équivaut à dire que le taux marginal de substitution est égal au quotient des utilités marginales de x et de y []. Il se trouve que cette manière d'exprimer l'optimum du consommateur implique que les utilités marginales seraient mesurables (on appelle généralement "util" cette unité de mesure), pour que les quantités puissent par conséquent être additionnées, soustraites, multipliées et divisées (comme dans ce cas), alors que tout cela est faux.
Les économistes autrichiens, en utilisant la logique verbale, sont arrivés à une formulation et à une conclusion bien différentes. En toute rigueur, le consommateur ne maximise pas son bien-être quand l'utilité marginale du dernier franc dépensé est égale à l'utilité marginale du dernier bien acheté, mais quand il achète jusqu'à ce que l'utilité marginale (décroissante) du bien qu'il achète cesse de dépasser l'utilité marginale (croissante) de celui qu'il vend (par exemple, l'argent). La différence paraît claire quand la formulation du problème se fait à partir d'un "ordonnancement" des utilités" et non d'une [pseudo-]mesure (comme le suppose une courbe d'indifférence). Nous allons voir l'exemple suivant : Supposons que l'échelle des valeurs initiale de l'individu soit donnée par la colonne 1 de la table suivante : 1 2 3
- 1 Première vache Première vache Première vache
- 2 Premier cheval Premier cheval Premier cheval
- 3 Deuxième vache Deuxième vache Deuxième vache
- 4 Deuxième cheval Deuxième cheval Deuxième cheval
- 5 Troisième vache Troisième vache Troisième vache
- 6 Troisième cheval Troisième cheval Troisième cheval
- 7 Quatrième vache Quatrième vache Quatrième vache
- 8 Quatrième cheval Quatrième cheval Quatrième cheval
En encadré, les produits dont l'utilité est l'utilité marginale, c'est-à-dire l'utilité à comparer pour une action d'échange éventuelle. L'utilité marginale des chevaux donnés en échange (en double encadré) est clairement croissante à mesure que diminue le nombre possédé, et celle des vaches achetées (en simple encadré) est décroissante à mesure qu'augmente leur nombre* [F.G.]. L'échelle de valeurs est un "classement", dans lequel nous plaçons dans la partie supérieure de la colonne le bien qui a la plus grande utilité marginale pour la personne et nous poursuivons en ordre décroissant. Ainsi, dans notre exemple, l'utilité marginale de la première vache est plus grande que celle du premier cheval ; l'utilité marginale du premier cheval est plus grande que celle de la seconde vache ; etc. Etant donné la situation initiale (colonne 1), l'individu pourra améliorer sa situation s'il arrivait à échanger un cheval contre une vache, car l'utilité marginale du quatrième cheval est inférieure à celui de la première vache. L'échange le mettrait dans la situation de la colonne 2 ; au lieu d'avoir quatre chevaux et aucune vache, il a trois chevaux et une vache ce qui, étant donné son échelle de valeurs, est une meilleure combinaison que la première. A son tour, la situation de la colonne 2 peut être améliorée si la personne réussit à échanger un autre cheval contre une autre vache, car l'utilité (marginale) du cheval auquel il renonce est moindre que celle de la vache qu'il acquiert. Cela la conduirait à la situation de la colonne 3. Dans les échanges successifs, l'utilité marginale des vaches baisse, alors que celle des chevaux augmente. Une fois dans la situation de la colonne 3, l'individu ne peut plus réaliser d'échange qui implique une augmentation de son bien-être, il a donc maximisé celui-ci. Et on ne peut pas pour autant prétendre qu'il aurait "égalisé" l'utilité marginale du dernier bien acheté avec celle du dernier bien vendu. Bien plus, comme que l'analyse se fait sur la base d'une échelle de valeurs rangée de manière "ordinale", les utilités marginales ne pourront jamais être égalisées au cours de l'échange. Cela devrait être évident, étant donné que les échanges se font lorsque chacune des personnes donne plus de valeur à ce qu'il reçoit qu'à ce qu'il donne, et qu'ils ne se feraient jamais si les évaluations étaient égales. Dans l'exemple donné, la deuxième vache achetée est la dernière dont l'utilité marginale décroissante dépasse l'utilité marginale croissante du bien abandonné (dans ce cas le deuxième cheval). Acheter une troisième vache impliquerait de renoncer à un cheval dont l'utilité (à la marge) est supérieure.
- Traiter le thème en termes de fonctions continues et de leurs dérivées ne rend absolument pas l'analyse plus rigoureuse : c'est le contraire.
Même s'il est vrai que les utilités marginales ont tendance à s'égaliser et que les dérivées expliquent les cas limites, cela ne change rien à ce que la conclusion suivant laquelle
- "le consommateur maximise son bien-être lorsque les utilités marginales des biens échangés sont égales"
est moins exacte que la conclusion logique à laquelle arrivent les autrichiens. Et cette moindre rigueur est précisément due au fait d'avoir employé l'analyse mathématique là où elle n'est pas appropriée [].
La prétendue rigueur de l'économie mathématique semble par ailleurs faire eau dans l'une des théories les plus répandues : la situation "suboptimale" à laquelle arriverait un marché "monopolistique" comparé à un marché de "concurrence parfaite"*. Et ce qui est intéressant, c'est l'incohérence de la conclusion alors que le problème a été posé en termes de graphiques et de dérivées.
Comme on dit, une entreprise opérant sur un marché de "concurrence parfaite"* ne peut pas modifier le prix du marché en développant ou en réduisant la production ; cela implique que le prix devient une donnée pour l'entreprise ; elle est "preneuse" de prix. Pour mettre cela dans les termes d'un économiste réputé, citons G. J. Stigler :
- "la courbe de demande d'une entreprise concurrentielle est une ligne horizontale : sa production est trop petite pour affecter le prix du marché" .
On tire de cela que pour une entreprise concurrentielle, le prix est égal à la recette marginale, c'est-à-dire que pour toute unité supplémentaire vendue par la firme, sa recette est égale au prix de vente. L'entreprise maximise ses bénéfices quand le prix (ou recette marginale) est égal au coût marginal . On en conclut que toutes les entreprises "concurrentielles"* d'une "industrie"* produisent de concert alors que "le prix est tel qu'il est égal au coût marginal" . Le "monopoliste"*, en revanche, n'est pas "preneur de prix". Quand il modifie la production, il affecte le prix ; la courbe de demande qu'il rencontre est celle de l'ensemble du marché qui, naturellement, a une pente négative. Alors, quand la courbe de demande n'est pas "parfaitement" élastique, il cesse d'être certain que le prix de vente soit égal au "coût"* marginal ; il se passe que la courbe de recette marginale a une pente plus grande que la courbe de demande. Le "monopoleur"* aura intérêt à augmenter la production aussi ongtemps que la recette marginale sera supérieure au "coût"* marginal ; elle obtiendra le bénéfice maximum quand la recette marginale (et non le prix) sera égal au "coût"* marginal, ce qui implique une situation sous-optimale vis-à-vis de la situation de "concurrence parfaite"*. Graphiquement, la situation se présente ainsi :
Sur un marché de "concurrence parfaite"*, l'ensemble des entreprises produiraient la quantité q2 au prix p2. A ce point, le prix est égal au coût marginal (Cmg). Sur un marché de "pur monopole"*, le "monopoleur"* produira la quantité q1 (qui est moindre que q2) au prix p1 (qui est plus élevé que p2). En conséquence, à égalité de coûts, un marché de "monopole"* pur est "moins optimal" qu'un marché de "concurrence parfaite"*, puisqu'il produit une moindre quantité à un moindre coût. Le triangle curviligne ABC mesure la quantité de la production qu'on pourrait obtenir si la production se faisait au niveau "concurrentiel" *. Cette conclusion quant à la supériorité du marché "concurrentiel"* sur le "monopole"* a été très convaincante puisque, comme le dit Stigler,
- "[...] les lois antitrust ont été mises en forme pour s'approcher de la concurrence [...]. []"
Or, quoi qu'il en soit, tous ces graphiques, équations, et dérivées semblent bien avoir conduit à une conclusion erronée.
En effet, une des grandes différences entre le "monopoleur"* et une entreprise de "concurrence parfaite"*, est que le premier fait face à la demande totale du marché, alors que le second n'en connnaît qu'une toute petite partie. Mais ce qui ne paraît pas cohérent, c'est dire que la courbe de demande à laquelle le "monopoleur"* fait face est décroissante alors que celle à laquelle l'entreprise "concurrentielle"* est confrontée serait "horizontale" ou "parfaitement élastique". S'agissant d'un même marché (produit), c'est tout simplement impossible mathématiquement : si chacune des entreprises "concurrentielles"* fait face à une demande "parfaitement" élastique, alors la demande totale du marché ne peut pas être "une courbe conventionnelle de pente négative" , car la pente d'une fonction composée de plusieurs fonctions est égale à la somme des pentes des fonctions qui la composent. Ainsi, il n'est pas possible d'obtenir une fonction de demande agrégée du produit dont la pente soit négative à partir de la somme des demandes qui, à la quantité q font correspondre le même p, et qui ont par conséquent une pente égale à zéro. La somme des demandes de pente zéro donne comme résultat une demande totale qui a aussi zéro pour pente, soit une hozizontale parallèle à l'axe des q.
De deux choses l'une : si la demande agrégée n'est pas moins horizontale que celle à laquelle chaque entreprise fait face, alors rien ne permet de prouver qu'à égalité de coûts un "monopole pur" produise moins que l'ensemble des entreprises concurrentielles, puisque le "monopoleur" lui aussi est confronté à une courbe de demande horizontale. En revanche, si la courbe de demande totale est la courbe conventionnelle, à savoir de pente négative, on ne peut pas conclure que sur un marché atomisé, chaque entreprise n'aurait "aucune" influence sur les prix. En toute rigueur, les courbes de demande individuelles doivent avoir une pente infiniment petite. La pente "tend" vers zéro, mais elle n'"est" pas zéro. Mais si une entreprise en "concurrence parfaite" n'a pas une courbe de demande horizontale mais de pente infinitésimale, alors il n'est plus prouvé que, pour ce type d'entreprises, le prix soit "égal" à la recette marginal ; il y aura une différence infinitésimale entre les deux. Avec quoi l'entreprise de "concurrence parfaite" maximisera ses profits au point où la recette marginale est "égale" au coût marginal, mais le prix sera supérieur. En faisant la somme des comportements individuels de chacune des entreprises, le résultat agrégé doit être le même que celui qu'on obtiendrait dans le cas d'un "monopole" pur (évidemment à égalité de conditions de coût). En réalité, il n'y a aucune raison de supposer qu'un "monopole" en tant que tel soit une "imperfection" du marché. Le marché ne fait pas que fixer les prix et les quantités mais aussi la taille et le nombre des entreprises. En l'absence de barrières légales contre l'entrée de quiconque, l'apparition d'un "monopole"* ne signifie rien d'autre que la supériorité de cette entreprise sur celles qui sont en concurrence avec elle . Les exemples cités ont été choisis parce qu'en général, presque tous les économistes mathématiciens sont d'accord avec cette conclusion que le consommateur maximise ses bénéfices quand il "égalise" les utilités marginales du bien qu'il donne et de celui qu'il reçoit, et qu'à égalité de coûts, la "concurrence parfaite"* produit une plus grande quantité, et à moindre prix que le "monopole"*. Ainsi, je crois qu'il y a là, pour parler en langage statistique, de bons "échantillons représentatifs" des erreurs et des incohérences internes auxquelles conduit l'utilisation de la mathématique en économie. Naturellement, cela n'implique pas que l'utilisation de la logique verbale garantisse l'économiste contre toute erreur et incohérence ; après tout, les économistes littéraires de l'école classique ont commis force erreurs et sont arrivés à nombre d'incohérences logiques. Mais en dépit de cela, la logique a permis aux économistes d'arriver à des conclusions beaucoup plus fécondes pour comprendre la mécanique du marché que l'utilisation de modèles mathématiques. Cela est dû, me paraît-il, à deux facteurs : premièrement, l'utilisation de la logique n'oblige pas l'économiste à faire des hypothèses irréalistes, et deuxièmement, en "forçant" la traduction dans une expression mathématique, soit on ouvre les portes à des implications logiquement fausses que l'utilisation de la logique ne permettrait pas d'obtenir, comme l'égalisation des utilités marginales dans l'optimum du consommateur, soit on s'interdit de trouver des conclusions auxquelles la logique permet d'aboutir, comme la fonction de l'entrepreneur sur le marché, fonction qui ne peut pas être expliquée dans un modèle comme celui de Walras. Comme règle générale, nous devrions nous méfier de n'importe quelle traduction verbale dans une expression mathémétique qui ne dit pas "exactement" la même chose que ce qui s'est dit avec des mots. Passons maintenant à une autre argumentation des économistes mathématiciens d'après laquelle on suppose que dans l'analyse littéraire on incorpore continuellement des suppositions arbitraires pour des raisons de pure convenance. Au début de cete partie-ci j'avais cité Baumol disant que : "Il faut admettre que c'est là la racine d'une faiblesse importante de l'analyse littéraire, dans laquelle il est souvent facile de glisser de nouvelles hypothèses quand elles sont commodes, pour arriver avec leur aide à toutes les conclusions que l'on veut". Malheureusement, Baumol ne donne aucun exemple de ce qu'il veut dire. L'introduction d'hypothèses additionnelles n'est pas toujours incorrecte, ce qui est important, c'est que l'hypothèse additionnelle ne fasse pas perdre leur validité aux conclusions. Les mêmes économistes mathématiciens introduisent constamment des suppositions qui sont des théorèmes mathématiques et qui les aident à arriver aux conclusions qu'ils désirent. C'est justement ici que nous pourrions contre-argumenter. Qui, sinon les économistes mathématiciens, a introduit des hypothèses arbitraires au point de rendre, à la limite, le modèle totalement irréel ? Et ceci, pour des raisons de pure convenance. Est-ce que par hasard ce ne seraient pas les économistes mathématiciens qui ont inventé un monde qu'il serait possible de mettre en équations? Pour quelle raison supposer la continuité des fonctions? Ne s'agit-il pas d'une hypothèse de pure convenance, pour pouvoir faire des dérivations? Est-ce que l'hypothèse de continuité dans le théorème du point fixe n'est pas de pure convenance pour démontrer l'existence de l'équilibre walrasien? Ainsi, par exemple, Dorfman, Samuelson et Solow, dans ce qu'ils appellent la démonstration rigoureuse de l'existence des solutions, disent : "[...] nous suivons Wald en exigeant que nos fonctions de demande soient continues. Ceci constitue une hypothèse minimale de régularité mathématique dont il est difficile de se dispenser, puisque sans elle on aurait de la peine à démontrer l'existence d'un équilibre concurrentiel [...] ". Comme dans la réalité, les courbes de demande ne peuvent pas être continues, le théorème ne peut être autre chose un exercice mental intéressant mais qui n'a aucune validité pratique, ni scientifique. Dans la science, il n'est pas suffisant qu'un théorème soit logiquement rigoureux ; en plus de cela, il doit expliquer les faits tels qu'ils sont reliés entre eux dans la réalité. L'observation de Baumol, pouvons-nous dire, met le doigt avec une grande précision sur ce que font les économistes mathématiciens : accommoder le monde à expliquer à la convenance de leur méthode. Un autre type d'argumentation en faveur de l'utilisation de la mathématique est celui selon lequel la formalisation permettrait d'avancer plus vite. Par exemple, Irving Fisher a signalé qu'utiliser la symbologie mathématique est comme traverser les Etats-Unis en train, alors que les formulations verbales représenteraient une marche transcontinentale. Cette position se retrouve chez A. Whitehead quand il affirme : "[...] avec l'aide du symbolisme, nous pouvons effectuer d'un coup d'oeil et de manière quasi-mécanique des transitions dans le raisonnement qui exigeraient , sans lui, l'utilisation de facultés supérieures du cerveau" . Ceci est un argument secondaire puisqu'on parle de "vitesses" et non de degrés de précision ou d'ambiguïté. Mais dans ce domaine aussi, il vaut la peine de signaler que l'avance de l'économie "littéraire" a été plus rapide que celle de l'économie mathématique. Bien plus, on pourrait dire que cette dernière consiste à dire ce que les économistes littéraires avaient déjà dit auparavant. Le cas le plus clair est celui de 'incorporation des anticipations et de l'information imparfaite, que les économistes mathématiciens ont commencé à introduire dans leurs modèles presque vingt ans après les économistes littéraires de l'école Autrichienne.
La raison pour laquelle l'analyse verbale est toujours en avance sur l'analyse mathématique (du moins en économie), me semble avoir été bien expliquée dans la citation suivante de Ludwig von Mises :
"Les réflexions qui se terminent par la formulation d'une équation sont nécessairement de nature non-mathématique. La formulation d'une équation est la consommation de notre connaissance. Elle ne l'augmente pas directement. Certes, en mécanique, l'équation peut apporter des services pratiques très importants. Comme il existe des relations constantes entre les différents éléments mécaniques, et comme ces relations peuvent être découvertes au moyen d'expérimentations, il est possible d'employer des équations pour résoudre des problèmes technologiques définis. Notre civilisation moderne est principalement un produit de cette utilisation d'équations différentielles en physique. Cependant, il n'existe pas de telles relations constantes entre les éléments économiques. Les équations formulées par l'économie mathématique sont toujours un exercice inutile de gymnastique mentale et le resteraient même si elles pouvaient en dire beaucoup plus qu'elles ne le font en réalité" (C'est moi qui souligne). En effet, la formulation d'une équation n'est en principe rien d'autre qu'une hypothèse issue d'un raisonnement non mathématique antérieur. Un économiste qui dit que la quantité demandée d'un bien "x" dépend de son prix, du revenu disponible et du prix d'un bien "z" ne gagne rien à écrire Dx=f (Px, Y, Pz). Pour "avancer" dans la connaissance, il faudrait pouvoir trouver quelle est la manière dont ces variables sont concrètement li2es, chose qui en économie est impossible pour les raisons exposées dans le point 3 de la première partie de cet article. En général, les économistes mathématiques se bornent à poser des modèles d'équations linéaires pour des raisons de convenance. Mais comme en plus il n'est pas possible de tester l'hypothèse que "Dx" dépend de Px, y et Pz, alors pour les raisons mentionnées dans ledit point 3, le modèle est bel et bien une hypothèse non vérifiable sur les relations entre les variables. Pour paraphraser Henry Hazlitt, nous pourrions dire qu'il est possible de formuler des fonctions mathématiques hypothétiques et d'en déduire des relations hypothétiques qui nous permettent d'arriver à des conclusions hypothétiques. "En résumé, nous pourrons affirmer qu'une relation générale hypothétique implique certaines relations spécifiques hypothétiques ." Aucune d'entre elles n'est empiriquement testable, comme nous l'avons vu dans la partie 3. En conclusion de ce point, nous pouvons dire que peu de gens douteraient de la rigueur logique des modèles mathématiques pour tirer certaines conclusions à partir de certaines prémisses et hypothèses (quoique, comme nous l'avons vu dans le cas du monopole, il puisse y avoir des exceptions à cette cohérence interne supposée). Cependant, j'ai comme l'idée que chez les économistes mathématiciens prédomine l'idée suivant laquelle "scientifiquement rigoureux" est synonyme de théorème parfaitement démontré du point de vue logique. Bien plus, il paraîtrait que certains d'entre eux sont persuadés que si un théorème ne se met pas en forme mathématique, il est moins scientifique. Cependant, le degré de fécondité de la théorie pour expliquer le monde réel semble être passé au second plan, alors que le savant doit formuler des théorèmes logiquement cohérents qui expliquent comment les variables sont reliées entre elles dans la réalité. Aussi bien le manque de réalisme que le manque de rigueur logique sont suffisants pour invalider une théorie du point de vue scientifique. Dans ce sens, l'obsession de formuler la théorie économique en termes mathématiques a conduit à ce que la théorie en question possède un très bas degré de réalisme qui, comme nous l'avons vu dans la première partie, a été avouée par les économistes mathématiciens eux-mêmes. Comme l'indiquera Mises : "Jusqu'à maintenant, l'utilisation de formules mathématiques en économie a fait plus de mal que de bien" , puisqu'elle a conduit la théorie économique sur des chemins qui l'ont éloignée de son objectif final, qui est d'expliquer comment fonctionne le marché réel.
6 LOGIQUE, MATHEMATIQUE ET COHERENCE
L'économiste "littéraire" a recours aux règles de la logique pour tirer des conclusions valides à partir de ses prémisses. L'économiste mathématicien traduit les mots en équations et applique les règles mathématiques pour tirer ses conclusions. Les règles de la logique sont-elles différentes de celles de la mathématique? En quoi consiste la différence dans le mécanisme d'inférence ? Pour cela, nous devons commencer par nous demander quel est l'objet d'étude de la logique et quel est celui de la mathématique, et si par hasard ce serait la même chose.
En général, il semble y avoir un accord sur le fait que l'objet d'étude de la logique consiste dans les méthodes et principes qui permettent de distinguer un raisonnement correct d'un raisonnement incorrect . La logique ne se soucie pas de savoir si les prémisses sont vraies ou fausses, mais si les conclusions découlent nécessairement des prémisses*.
La définition de l'objet d'étude de la mathématique est devenue moins claire à partir du développement des géométries non euclidiennes. En principe, l'objet d'étude de la mathématique est clair : la mathématique est la science de la quantité. Aujourd'hui, néanmoins, les mêmes mathématiciens ne semblent pas se mettre d'accord sur ce qu'ils étudient, quoique sur ce terrain, ils ne soient pas seuls puisque les économistes ont le même problème. Comme nous le verrons, il y a un groupe de mathématiciens qui, après avoir distingué entre la mathématique pure et appliquée, sont arrivés à cette conclusion que la première est identique à la logique ; ainsi, la logique et la mathématique se confondraient dans une même science. Par exemple, B. Peirce soutient que "la mathématique est la science qui infère les conclusions nécessaires" ; A. Whitehead affirme : "La mathématique au sens large est le développement de tous les types de raisonnement déductif formellement nécessaires" ; Bertrand Russell, pour sa part : "La mathématique pure est la classe de toutes les propositions de la forme : "p implique q", où p et q sont des propositions qui contiennent une variable ou plus, les mêmes dans les deux propositions, et ni p ni q ne contiennent aucune constante qui ne fasse partie des constantes logiques" . De la même manière, E. Nagel et J. R. Newman pensent que :
"[...] la seule question à laquelle le mathématicien pur soit confronté (en ce qu'il se différencie du savant qui fait usage de la mathématique dans l'examen d'un sujet de recherche particulier) n'est pas de savoir si les postulats d'où il part ou si les conclusions qui s'en déduisent sont vraies, mais si les conclusions obtenues sont réellement les conséquences logiques nécessaires des hypothèses initiales" .
Cette présentation crée un problème sémantique, puisque si elle est vraie, la logique [pure] et la mathématique se transforment en une seule et même chose. Quand les économistes "littéraires" disent que l'utilisation de la mathématique est inappropriée à l'explication de phénomènes de marché, à quelle mathématique font-ils donc référence? Sans être un expert sur ce thème, j'essaierai d'exposer brièvement comment est née cette identification entre logique et mathématique, ce que pensent les autres courants ou écoles sur les fondements de la mathématique , et quelles implications cela peut avoir pour l'économie mathématique. Comme on le sait, Euclide est connu pour avoir réduit les théorèmes de la géométrie à cinq postulats de base. Quoique ce qu'il fit en réalité fut de réunir le travail d'autres penseurs en un tout systématique . Pendant les deux mille ans qui suivirent, les cinq postulats furent acceptés comme vrais, parce qu'ils étaient évidents en eux-mêmes, à l'exception du cinquième. Ces postulats sont : 1) Par deux points différents il passe une seule droite. 2) Un segment de droite peut être indéfiniment prolongé. 3) Il n'y a qu'une circonférence avec un centre et un diamètre donnés. 4) Tous les angles droits sont égaux. 5) Si une sécante coupe deux droites en formant d'un côté des angles intérieurs dont la somme est moindre que deux angles droits, ces deux droites se coupent de ce même côté si on les prolonge suffisamment. Le cinquième postulat se réfère indirectement aux parallèles ; elle équivaut à dire que d'un point extérieur à une droite, qui se trouve sur le même plan que le point, on ne peut tracer qu'une parallèle à cette droite. Cela se passe quand la somme des angles internes est égale à 180°. Etant donnée la manière dont était énoncé le cinquième postulat, il ne semblait pas aussi évident que les quatre autres. Certains mathématiciens pensèrent qu'on pouvait le déduire des quatre premiers. Ce ne fut qu'au XIX° siècle que fut démontrée l'indépendance du cinquième postulat avec la naissance de la géométrie non euclidienne, dont les précurseurs furent N. I. Lobachevsky, G. F. B. Riemann et J. Bolyai. En 1826, Lobachevsky développa une géométrie qui changeait le cinquième postulat d'Euclide et supposait qu'on pouvait tracer plus d'une parallèle à une droite par un point externe se trouvant sur le même plan, ce qui conduit à ce que la somme des angles d'un triangle soit moindre que 180°. Lobachevsky appela sa géométrie "géométrie imaginaire". A peu près à la même époque, J. Bolyai arriva à des résultats similaires à ceux de Lobachevsky. En 1854, Riemann développa un autre type de géométrie non euclidienne, dans laquelle il suppose que par un point extérieur à une droite, sur le même plan, il ne passe aucune parallèle. De cette manière furent créés deux types de géométrie non euclidienne : 1) Celle de Lobachevsky-Bolyai, ou géométrie hyperbolique et 2) celle de Riemann, ou géométrie elliptique . La naissance de la géométrie non euclidienne révolutionna les fondements de la mathématique, parce qu'on semblait avoir démontré que l'on pouvait développer un ensemble de théorèmes cohérents à partir d'axiomes qui contredisaient l'évidence de nos sens. Cette découverte donna aussi naissance à l'idée suivant laquelle le travail du mathématicien pur est de déduire des théorèmes à partir d'axiomes arbitraires, et qu'en tant que mathématicien, il n'a pas à se soucier de savoir si les axiomes sont vrais ou non dans le monde réel. Cependant, cette nouvelle idée entraînait avec soi un problème qu'on avait jusqu'alors ignoré : les axiomes arbitraires sont-ils cohérents ou peuvent-ils conduire à des théorèmes contradictoires? On acceptait comme vrais les axiomes de la géométrie euclidienne parce qu'ils se vérifiaient dans le monde où l'homme se déplace. Auparavant, personne n'avait pensé à l'éventualité que l'on puisse arriver à des théorèmes contradictoires à partir des postulats d'Euclide. Le cas de la géométrie non euclidienne était différent, ses axiomes étant considérés comme faux en ce qui concerne notre monde réel, et cela faisait surgir des doutes sur leur cohérence. Le fait que les théorèmes développés jusqu'à ce moment n'étaient pas contradictoires les uns avec les autres n'était pas une solution au problème, puisqu'un théorème à venir pouvait faire apparaître la contradiction envisagée. Jusqu'à ce que ce problème fût résolu, on ne pouvait pas conclure que la géométrie non-euclidienne fût une concurrente valable de la géométrie euclidienne. Les fondements de la mathématique étaient à repenser. En 1968, E. Beltyrami réussit à trouver une signification à la géométrie hyperbolique de Lobachevsky, et le fit sur un modèle euclidien. Les lignes et courbes de Lobachevsky pouvaient être représentées sur une surface non euclidienne ayant la forme d'une selle. Une autre interprétation fut donnée par le fameux mathématicien Henri Poincaré, également sur la base de la géométrie euclidienne, dans ce cas un cercle. Dans le cas de la géométrie elliptique de Riemann, les lignes et les courbes peuvent aussi se représenter sur une surface euclidienne qui est la surface d'une sphère . La cohérence des deux géométries non euclidiennes était ainsi démontrée. Pourtant, la démonstration avait un problème, car la cohérence des nouvelles géométries reposait sur celle de la vieille géométrie euclidienne. En d'autres termes, si la géométrie non euclidienne était cohérente c'est parce que la géométrie euclidienne l'était. Peu satisfaits de cela, les mathématiciens et les philosophes continuèrent à chercher une démonstration absolue . Cette crise dans les fondements de géométrie et de la mathématique entière donna lieu à l'émergence de trois écoles épistémologiques : 1) la formaliste ; 2) la logisticienne et 3) l'intuitionniste. Le fondateur de l'école formaliste fut D. Hilbert. Il essaya de construire des démonstrations "absolues", par lesquelles il distinguerait la mathématique de la métamathématique. Il soutint que les systèmes formels que les mathématiciens construisent à partir d'axiomes donnés tombent dans le domaine de la mathématique. En revanche, les spéculations théoriques au sujet de ces systèmes appartiennent à la métamathématique. Avec cette distinction entre mathématique et métamathématique, Hilbert croyait que l'on pouvait examiner les caractéristiques structurelles d'un système mathématique en forme exhaustive et démontrer qu'il ne pouvait pas conduire à des conclusions contradictoires . Plus loin, nous verrons comment Kurt Gödel invalida cette proposition de Hilbert. Pour le moment, nous pouvons ajouter que la méthode de Hilbert n'est applicable que dans le cas où les possibilités à examiner seraient finies ; d'une autre manière, une analyse exhaustive des alternatives serait impossible. Par-dessus le marché, il reste implicite que la mathématique se réduit à une espèce de jeu dans lequel le mathématicien écrit les règles et les postulats du système, et où le métamathématicien étudie sa cohérence. L'école logisticienne fut lancée par G. Frege et continuée par J. Peano, A. Whitehead et B. Russell. Ces penseurs soutenaient que tous les concepts mathématiques peuvent être définis en termes d'idées strictement logiques et que tous les axiomes de la mathématique peuvent se déduire d'un petit nombre de propositions vérifiables en tant que vérités strictement logiques. À son époque, le livre de Russell et Whitehead, Principia Mathematica, parut être la solution finale du problème de la cohérence des axiomes mathématiques, et en particulier de l'arithmétique. Le logicisme paraît être aussi une preuve relative, puisque la cohérence des axiomes mathématiques s'appuie sur la cohérence des axiomes logiques.
Russell et Whitehead commencent leur livre comme s'il s'agissait d'un traité de logique et avancent des déductions jusqu'à arriver à tous les éléments fondamentaux de la mathématique. Ils arrivent à la conclusion qu'il est impossible de tracer une ligne de séparation claire entre la logique et la mathématique : une telle démarcation serait totalement arbitraire. Ainsi, pour mener à bien la réduction des concepts mathématiques à des propositions logiques, Russell et Whitehead doivent donner pour vrais trois axiomes dont l'un, dit de réductibilité, leur permet de franchir certaines étapes du raisonnement qu'ils ne pourraient pas franchir autrement, ou les conduiraient à d'autres conclusions. Ce qui affaiblit beaucoup la logistique fut que cet axiome était très difficile à justifier. Les auteurs mêmes se virent obligés d'admettre (dans la seconde édition) des Principia Mathematica que :
"Un point sur lequel une amélioration est évidemment désirable est l'axiome de réductibilité. La justification de cet axiome est purement pragmatique : elle conduit aux résultats désirés et non à d'autres. Cependant, il est clair que ce n'est pas le genre d'axiome dont nous puissions être satisfaits. Sur ce point, cependant, on ne peut pas dire que jusqu'à présent on puisse obtenir une solution satisfaisante" . Les deux autres axiomes aussi conduisirent les auteurs à certaines déconvenues. Tout cela conduisit le mathématicien H. Weyl à faire ce commentaire que dans les Principia "on ne peut pas encore dire que les mathématiques soient fondées sur la logique, sinon dans une espèce de paradis des logiciens" . Kurt Gödel aussi, peut-être le logicien et mathématicien le plus important du XX° siècle, soutient que : "il est dommage que cette première présentation, large et détaillée d'une logique mathématique et la dérivation des mathématiques à partir de là présente un défaut de précision formelle si grand dans ses fondements ( dans le §1 et le §2 des Principia) qu'il représente un pas en arrière en comparaison avec Frege" . L'école intuitionniste fut lancée par L. E. J. Brouwer, ses successeurs étant L. Kronecker, J. H. Poincaré, E. Bore, H. Weyl et S. C. Kleene. Les intuitionnistes se rapprochent d'une position plus kantienne ; ils soutiennent que la mathématique est un certain type de construction mentale. Le mathématicien intuitionniste considère que le point de départ de la mathématique est la compréhension intuitive des nombres naturels. Ceux-ci ne se déduisent pas logiquement, comme le soutiennent les logisticiens, "mais ils se construisent immédiatement dans l'esprit du mathématicien et leur valeur objective ou leur véracité se fonde directement sur l'évidence de l'intuition" . Avec cette école on retrouve la position que nous avons vue au début : les fondements de la géométrie et de la mathématique sont évidents en eux-mêmes.
Résumant ce que nous avons dit jusqu'à présent, nous avons que pour les formalistes, la mathématique étudie les implications logiques de n'importe quels axiomes ; pour les logisticiens, la mathématique est une branche de la logique, et pour les intuitionnistes elle est l'étude des implications logiques du concept intuitif de nombre naturel, avec lequel on semble retrouver la définition de la mathématique comme science de la quantité. En 1931, le logicien autrichien Kurt Gödel publia un fameux article qui est peut-être le plus important dans l'histoire de la logique. Il y démontrait l'impossibilité de mener à bien le programme de Hilbert et de Russell-Whitehead. Pour reprendre Gödel lui-même,
"[...] on peut prouver rigoureusement que, dans tout système formel cohérent qui contient une portion de théorie finie de nombres, il y a des énoncés arithmétiques indécidables et qu'en plus, la cohérence de n'importe lequel de ces systèmes ne peut pas être prouvée à l'intérieur du système lui-même ." En d'autres termes, le problème qu'avaient fait apparaître les géométries non euclidiennes, de prouver la cohérence d'axiomes contraires aux sens (et aussi de ceux qui ne sont pas contraires aux sens) est impossible à résoudre au sein du système lui-même. En appeler à un autre système formel (métamathématique) ne fait que transférer le problème à une étape ultérieure. D'après Hayek : "Il semblerait que le théorème de Gödel soit un cas spécial d'un principe plus général applicable à tous les processus conscients et en particulier à ceux qui sont rationnels, spécialement le principe suivant lequel il doit toujours exister parmi leurs déterminants certaines règles qui ne peuvent pas être exprimées ni même perçues. Au moins, tout ce que nous pouvons dire et probablement tout ce que nos pouvons penser consciemment présuppose l'existence d'un cadre qui détermine sa signification, c'est-à-dire un système que nous mettons en oeuvre mais que nous ne pouvons ni exposer ni nous représenter et que nous ne pouvons qu'évoquer chez les autres quand et où ils le possèdent" . L'essentiel pour notre thème est que les modèles de l'économie mathématique se retrouvent, d'une certaine manière, plongés dans le problème de la cohérence de la mathématique en général. Dans la première partie, nous avions vu qu'il est impossible de tester empiriquement les théories économiques parce que les faits sociaux sont des événements complexes singuliers, c'est-à-dire non répétables ; certains promoteurs même de l'économie mathématique ont signalé que le propos de leurs équations était analytique et qu'ils ne prétendaient pas trouver les paramètres concrets de leurs équations. Cependant, si les modèles mathématiques de l'économie ne sont pas susceptibles d'être testés, ou si ce n'est pas leur propos que de trouver les vrais paramètres, alors ces modèles semblent bien davantage trouver leur place dans le domaine de la mathématique pure que de la mathématique appliquée. La seule chose que l'on étudie, ce sont les implications logiques des prémisses du modèle, sans se soucier de son réalisme. Alors, puisque les modèles de l'économie mathématique se caractérisent par le manque de réalisme de leurs prémisses et hypothèses, ils semblent se trouver dans la même situation que la géométrie non euclidienne : rien ne garantit la cohérence interne du modèle et, en vertu du théorème de Gödel, nous pouvons conclure que ladite cohérence ne peut pas être démontrée à l'intérieur des mathématiques et encore moins à l'intérieur du modèle. Il semble donc que le grand paradoxe de cette économie mathématique si rigoureuse est qu'elle ne peut pas être certaine de sa cohérence interne . Il faut signaler que l'affirmation de Cohen suivant laquelle la mathématique "facilite la découverte de nouvelles vérités" se limite aux sciences naturelles, puisque dans une autre partie de son livre il soutient que : "en général, les situations sociales sont un réseau dans lequel on ne peut pas changer un facteur sans en affecter beaucoup d'autres. Il est, par conséquent, difficile de déterminer les effets spécifiques d'un facteur individuel quelconque. Qui plus est, les éléments sociaux se prêtent rarement à une simple addition. Le comportement des mêmes individus dans un grand groupe ne sera pas, en général, le même que dans des petits groupes. Cela rend difficile l'utilisation des méthodes mathématiques qui se sont révélées si utiles dans les sciences de la nature. En effet, ces méthodes mathématiques dépendent de la possibilité de passer d'un petit nombre d'éléments à un nombre indéfiniment grand par un processus de sommation ou d'intégration "
7 CONCLUSION
On ne saurait manquer de donner raison à Tjalling C. Koopmans, quand il dit que : "[...] la justification de l'économie mathématique dépend simplement de la question de savoir si les chaînes de raisonnement logique entre les prémisses de base que les économistes ont postulées et nombre de leurs implications observables ou bien intéressantes, peuvent être établies plus efficacement à travers un raisonnement mathématique ou un raisonnement verbal" . Le problème est que Koopmans ne semble pas avoir compris quel est l'objet d'étude de l'économie, puisqu'il ajoute ensuite : "[...] je ne peux manquer d'ajouter que cela ne fait que peu de temps qu'on a démontré complètement le caractère non contradictoire des prémisses de la théorie de l'équilibre général concurrentiel, et que cela fut fait au cours d'une série d'études utilisant l'outillage topologique qui jusqu'à ce moment n'avait pas été utilisé en économie. Existe-t-il un thème plus fondamental dans la théorie économique contemporaine? existe-t-il une technique moins familière, tant aux économistes mathématiciens qu'aux économistes littéraires ? " (c'est moi qui souligne). En premier lieu il faut signaler à nouveau que ce qu'on a réussi à démontrer était l'existence et l'unicité de l'équilibre, mais non le "caractère non contradictoire des prémisses". Comme nous l'avons vu précédemment, Arrow et Hahn ont reconnu les "difficultés logiques" de la théorie de la concurrence parfaite. D'un autre côté, la démonstration en question fut réalisée avec tant des suppositions irréelles introduite par pure convenance (comme dirait Baumol) mathématique (en d'autres termes pour qu'elle donne le résultat désiré), que cette théorie ne peut être qu'un bon exercice intellectuel mais sans aucune capacité d'expliquer le fonctionnement réel du marché.
En second lieu, et combien plus important, il existe bel et bien des thèmes plus fondamentaux. L'objet de l'étude des économistes est le "processus" du marché et non l'"équilibre" ; ce dernier occupe une place totalement secondaire. Il n'est pas inutile de reproduire, en dépit de leur extension, les réflexions suivantes de von Mises :
"Autant les économistes logiciens que les mathématiciens affirment qu'en dernière instance l'action humaine vise à l'établissement d'un état d'équilibre, et qu'elle atteindrait celui-ci si cessaient tous les changements futurs dans les conditions. Mais l'économiste logicien en sait beaucoup plus que cela : il montre comment les activités des entrepreneurs, les promoteurs et spéculateurs, avides de profiter des disparités dans la structure des prix, tendent à éradiquer ces différences et à supprimer les sources de profit et de perte entrepreneuriales. Il montre comment ce processus conduirait finalement à l'établissement d'une économie en rotation uniforme. Voilà le travail de la théorie économique. La description mathématique de divers états d'équilibre n'est qu'un jeu. Le problème est d'analyser le processus de marché [...]. Les problèmes de l'analyse des processus du marché, les seuls problèmes économiques qui soient importants, défient tout traitement mathématique. L'introduction du temps comme paramètre dans les modèles n'est pas une solution. Cela est bien loin de pallier les défauts fondamentaux de la méthode mathématique. Affirmer que tout changement nécessite du temps et que le changement est toujours inhérent à la séquence temporelle n'est rien d'autre qu'une manière d'exposer le fait que lorsqu'il y a rigidité et absence de changement, il n'y a pas de temps. La principale déficience de l'économie mathématique ne se trouve pas dans le fait qu'elle ignore la séquence temporelle, mais de ce qu'elle fait comme si le processus de marché n'existait pas" . Comme on peut l'observer, la citation de Mises tranche notablement avec celle de Koopmans (que l'on peut considérer comme représentatif des économistes mathématiciens). Ce qui, pour Koopmans, est "fondamental" (l'équilibre général) est pour Mises un "simple jeu". En analysant le processus de marché, nous analysons l'action humaine et ses implications logiques, et cela ne peut pas être traduit par des équations mathématiques mais doit nécessairement être expliqué par des mots, c'est-à-dire avec des symboles qui ont un sens. Comme nous l'avons vu dans la première partie, aucun facteur extérieur ne détermine l'action humaine. Evidemment, les facteurs externes influencent la conduite des hommes mais ils ne le font pas pas d'une manière qui serait mécanique ou déterministe. Ainsi, l'action humaine n'est en fonction mathématique de rien, pas plus que ne le sont les conséquences logiques des actes en question. Quand Baumol affirme que : "les clichés à deux sous comme quoi 'l'économie n'est pas une science exacte' ou 'la nature humaine ne peut pas être fourrée dans des équations' ne méritent guère qu'on les prenne en considération" , il occulte justement la clé du problème, parce qu'il est parfaitement vrai que "l'action humaine ne peut pas être fourrée dans une équation", et que prétendre le faire est tout à fait incorrect du point de vue scientifique. Par exemple, expliquer les choix du consommateurs au moyen de "courbes d'indifférence" est et aura été l'une des plus grandes absurdités produites par l'économie mathématique. Le développement et la diffusion de l'économie mathématique a créé le mythe suivant lequel l'exposition verbale serait une "charlatanerie" de doctrinaires, alors que l'approche mathématique serait "scientifique". Ce mythe-là n'est rien d'autre qu'une superstition, même si elle est réservée aux "évolués". Le succès qu'a obtenu l'utilisation des mathématiques dans les sciences de la nature n'implique pas que l'on doive appliquer la même méthode dans les sciences sociales pour atteindre le niveau scientifique. Au contraire, l'utilisation de formules mathématiques en économie a retardé son avance. À cet égard, Hayek a proposé le terme de "scientisme" et de"scientiste" pour décrire l'imitation de la méthode des sciences naturelles de la part des "scientifiques" sociaux : "[...] dans le sens où nous utilisons ces termes, ils décrivent évidemment une attitude qui est décidément a-scientifique dans le vrai sens du terme, puisqu'elle implique une application mécanique et non-critique d'habitudes de pensée à des domaines différents de ceux pour lesquels elles ont été créées. Le point de vue scientiste, envisagé à l'aune de l'approche vue scientifique n'est pas une démarche sans de préjugés : elle en surabonde, puisqu'avant de considérer quel est l'objet de son étude, elle prétend savoir quelle est la manière la plus appropriée de l'explorer" . Cette déformation de la profession est très influencée par l'enseignement que l'on donne aux étudiants en économie dans les universités, qui n'a pas seulement des effets épistémologiques, mais aussi, directement, en politique économique. Dès leurs premiers pas dans la discipline, on expose les étudiants à l'économie mathématique. De là, on les soumet à une lecture intensive de livres et d'articles qui exposent différents modèles mathématiques, suivant les courants à la mode et les "avances" obtenues dans leur perfectionnement. À la fin de son parcours, l'étudiant s'est converti en un "modèle" d'économiste dirigiste. Ceux qui arrivent à occuper un poste public approprié essaieront d'appliquer à la réalité l'un de ces modèles mathématiques irréalistes (les plus malins inventant des modèles à eux). Ils commencent donc à manipuler des taux d'intérêt, des taux de change, des tarifs douaniers, des comptes bancaires, des prix, des salaires, etc., à la lumière de ce que leurs modèles leur annoncent qu'il se produira (avec un certain écart-type). Le degré de dirigisme peut être variable, depuis ceux qui croient qu'il faut manipuler toutes les variables à ceux qui croient qu'il ne faut en manipuler qu'une (par exemple, l'offre de monnaie d'après une certaine "règle" que le modèle recommande). Aussi bien, dans le même degré de dirigisme, le "type" d'intervention peut varier : certains pensent qu'il faut contrôler les variables A, B et C et d'autres les variables W, Y et Z. La combinaison de tous les degrés et types de dirigisme fournit une grande quantité d'"expériences" possibles à mettre en pratique. Quand chacune de ces expériences conduit à son échec inévitable, les technocrates cherchent la solution au mauvais endroit ; au lieu de penser que l'erreur tient au fait même d'imposer sa volonté, ils pensent que ce qu'ils doivent faire, c'est "raffiner" le modèle, et travaillent avec empressement à inventer une autre chimère. L'éducation reçue à l'université les empêche pratiquement de penser à une autre éventualité : l'économie mathématique les a éloignés du problème que tout économiste devrait connaître : comment le marché fonctionne dans la réalité. Ils sont bien peu nombreux, les économistes qui prennent une minute pour penser à ce qu'ils sont en train de faire ; l’emploi des mathématiques est une "donnée" qu'on ne met pratiquement jamais en cause. Cependant, comme toute erreur, il est condamné à disparaître avec le temps.