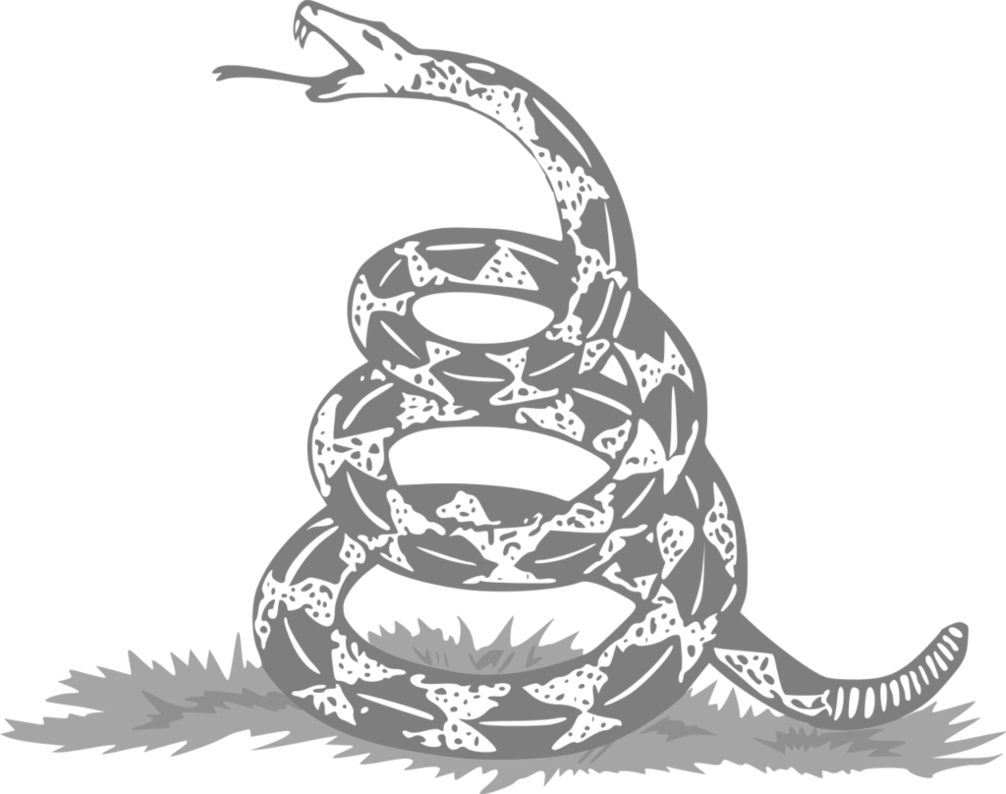La Micropolitique : deuxième partie
La Micropolitique
PREMIERE PARTIE : LE ROLE DES IDEES
DEUXIEME PARTIE : LE SECTEUR PUBLIC
La théorie des choix publics
L'école de Virginie
En 1986, le prix Nobel d'économie fut décerné à l'américain James Buchanan. Depuis des années, avec le professeur Gordon Tullock et bien d'autres [1], le Professeur Buchanan travaillait à mettre sur pied la théorie des "choix publics". D'abord installés au Virginia Polytechnic Institute puis, plus récemment, à l'Université George Mason en Virginie, ces théoriciens du secteur public ont publié une masse impressionnante de monographies, d'articles de recherche et d'articles dans des revues d'économie. Le thème constant commun à tous leurs travaux était que, dans la vie politique, les hommes ne se conduisent pas très différemment de la vie économique.
La nouvelle économie politique
Les années soixante-dix ont permis d'assister à la montée en puissance de plusieurs écoles de théorie économique, non sans rapport les unes avec les autres, et qui réfutaient les thèmes centraux du système keynésien, lequel commençait d'ailleurs à être sérieusement discrédité par la pratique.
Il y avait, tout d'abord, un retour à la respectabilité pour l'économie de marché en général, et une renaissance des idées néo-classiques. La montée de l'école "monétariste" de Chicago avec Milton Friedman, se poursuivit imperturbablement pendant une décennie, mettant l'accent sur la relation qui existe entre la hausse des prix et la création de monnaie par les hommes de l'Etat. Friedman, lui-même prix Nobel en 1976, était un critique précis et éloquent de l'interventionnisme économique d'Etat.
Moins spectaculaire fut l'émergence progressive de l'Ecole "autrichienne" d'économie [2], dont le représentant moderne le plus connu, Friedrich A. Hayek, avait reçu le prix Nobel en 1974. Cette école mettait l'accent sur l'économie non plus en tant que succession d' équilibres, mais en tant que processus, principalement menés par les pensées et les actes de personnes singulières. Un des traits caractéristiques de l'économie autrichienne est son rejet de la macro-économie et sa concentration sur le fait que la réalité économique consiste toujours en des actions particulières et localisées.
D'autres écoles, et leurs rejetons, ont introduit de nouveaux concepts dans l'analyse économique. Les "anticipations rationnelles" [3} furent un temps à la mode ; entre-temps, la sacro-sainte "courbe de Phillips" sombrait dans les marécages de la "stagflation", à mesure que les différents pays s'arrangeaient pour cumuler chômage et inflation élevés, alors que d'après cette courbe, on n'avait jamais à choisir qu'entre l'un et l'autre.
Une révolution scientifique
Cette époque était, et elle est peut-être encore, caractéristique d'une révolution scientifique à la Kuhn. Le paradigme dominant s'était effondré sous le poids de ses anomalies et contradictions, et les intellectuels cherchaient quelque chose pour remplacer le consensus keynésien. Pour Kuhn, ces périodes sont les plus favorables à la créativité. Ce fut certainement le cas en économie politique.
"Science économique" et économie politique
Dans ce bouillonnement intellectuel, l'école des choix publics montait lentement en puissance, à mesure que la qualité de ses travaux et la cohérence de sa pensée venaient à être reconnues. Ceux-ci ne furent jamais vraiment populaires et, avec tout le respect qu'ils inspiraient, on les tenait pour marginaux par rapport aux autres progrès de la discipline. Il y a une raison à cela : c'est que la théorie des choix publics n'est pas fondamentalement une théorie de l' économie, mais de la politique. Elle serait tout à fait à sa place dans les études d'"économie politique" à l'ancienne, mais elle est mal à l'aise dans des classes de "sciences économiques" modernes. Elle applique la théorie économique aux décisions dites "publiques" et montre comment on peut se servir de certains principes économiques pour expliquer et interpréter les choix faits dans l'arène politique.
La politique et l'économie sont officiellement distinctes. C'est-à-dire que, pour la plupart des chercheurs, les deux disciplines sont censées concerner des domaines d'activité essentiellement différents. Quand on fait de l'économie, on fait une chose. Quand on fait de la politique, on est censé en faire une autre. Or, les théoriciens des choix publics ont su rappeler que ces deux activités ont bien davantage de points communs, et notamment que les gens, en politique, ne sont pas autres qu'ils ne sont dans l'économie.
Dans l'"économie", les gens agissent au service de leurs objectifs propres. Conformément à leur propre échelle de valeurs, ils renoncent à certains avantages pour en obtenir d'autres. Ils peuvent par exemple échanger du temps de loisir, qui a de la valeur pour eux, contre un revenu supplémentaire, auquel ils donnent une plus grande valeur à cette occasion. Ils achètent et vendent sur les marchés. Les entrepreneurs s'affairent sur la scène, qui établissent le contact entre investisseurs et producteurs, acheteurs et vendeurs. L'information a son prix : on l'achète et on la vend. La rareté augmente la valeur, de même que la proximité de temps et de lieu. Quand un grand nombre de personnes veulent des marchandises dont la quantité est limitée, les prix grimpent en conséquence.
Cet univers est familier ; il a donné naissance à d'innombrables travaux qui s'efforçaient d'expliquer ses régularités apparentes, et de parvenir à une construction intellectuelle capable d'apporter une cohérence à ce qui paraissait au départ être un chaos aléatoire. Pour ce qui est de la politique, elle relevait d'un autre type de recherche, les penseurs la tenant pour une activité totalement différente. Dans sa version moderne, elle repose sur le postulat que les "décideurs publics" agissent dans un cadre "collectif", devant rivaliser entre eux pour obtenir l'assentiment de "la majorité". Les décisions sont prises périodiquement à l'occasion des élections, et les minorités s'inclinent devant la volonté majoritaire, sauf dans les domaines protégés par la Constitution.
L'action humaine présente partout les mêmes traits fondamentaux
Un des apports fondamentaux l'école des choix publics a justement été de faire comprendre qu'en réalité, l'action politique a beaucoup de traits communs avec l'activité économique. Là aussi, les gens cherchent à réaliser leurs propres projets, en quoi qu'ils puissent consister. Ils n'y subordonnent pas moins leurs décisions aux objectifs qu'ils ont choisis, et n'y sont pas moins forcés de faire des arbitrages. Plutôt que des décisions majoritaires prises par intermittence à chaque élection, ce que nous avons en réalité, c'est une succession incessante de soutiens accordés ou retirés, c'est-à-dire de décisions personnelles, faites par des gens qui intriguent pour influencer le processus politique.
Il y a un marché dès lors que les personnes choisissent de coopérer
Les théoriciens des choix publics ont établi qu'il existe une sorte de marché pour les suffrages, avec des lois assez comparables : quand les suffrages se font plus rares, ils comptent davantage et se vendent plus cher. Quand certains ont vraiment beaucoup plus de valeur que les autres, eh bien ils s'achètent vraiment beaucoup plus cher. Bref, le soutien politique a une valeur économique variable, et s'échange comme tel. Il est pratiquement inopérant de se borner à dire que "la majorité domine la minorité". Dans la réalité, il n'y a au départ que des minorités, et toutes négocient leur soutien en échange d'une contrepartie acceptable. Peut-être ne s'en rendent-ils pas compte, mais en soutenant qui leur a fait certaines promesses, les gens "vendent" en quelque sorte leur suffrage en échange d'autre chose et celui-ci a donc, nécessairement et qu'on le veuille ou non, une valeur économique. Et s'ils le font, cela veut dire que pour eux, ce qu'ils ont reçu en échange vaut encore davantage. Il y a donc réellement un marché des influences politiques et, du point de vue de la valeur et de l'échange, rien n'empêche d'utiliser les mêmes outils d'analyse que pour le marché de la production.
Une description réaliste de la décision politique
Tout ceci vous paraît peut-être encore bien abstrait, voire tiré par les cheveux. Cela ressemble davantage à une interprétation particulière du comportement politique qu'à une véritable contribution à l'analyse des faits. Et pourtant, l'expérience a justifié cette approche, car elle peut prédire le comportement des groupes dans le processus politique bien plus exactement que n'importe lequel des modèles conventionnels. Nous allons voir que si l'on tient pour acquis que les principes économiques décrivent des lois universelles de l'action humaine et s'appliquent donc également à l'activité politique, on peut obtenir une image bien plus réaliste de la vie politique qu'en y plaquant l'image traditionnelle d'une suite de décisions prises "en commun".
La dictature des groupes de pression
Loin que ce soient les minorités qui cèdent toujours à la volonté majoritaire, la théorie des choix publics nous explique pourquoi, le plus souvent, c'est bien le contraire qui se produit, les minorités dans leur ensemble obtenant ce qu'elles veulent aux dépens des majorités. La fermeture d'une usine en difficulté a beau ne mettre en jeu qu'un petit nombre de suffrages, pour ces électeurs-là, l'enjeu est primordial. Leurs représentants sont prêts à payer très cher pour obtenir une aide dans des circonstances aussi graves. Ils donneront alors leur soutien pour obtenir en échange celui des autres. C'est ainsi que l'on réunit des coalitions, qui s'arrangent pour donner gain de cause à l'ensemble des groupes de pression minoritaires sur les sujets qui leur tiennent à cœur, même si tout cela se fait au détriment du bien de tous.
Aider ou subventionner une minorité lui rapporte beaucoup, mais coûte peu aux autres. Pour chaque enjeu, par conséquent, les bénéficiaires potentiels sont prêts, pour défendre leur cause, à payer un prix plus élevé que ceux qui finiront par en supporter la charge : la chose a bien plus d'importance pour les premiers que pour les seconds. La réalité politique ne se fonde donc pas sur les bonnes ou mauvaises raisons de faire ceci ou cela, mais sur l'addition des suffrages négociés. Les gens agissent pour optimiser les avantages qu'ils retirent du système, exactement comme dans les échanges productifs. La récompense n'est d'ailleurs pas nécessairement matérielle ; il suffit qu'elle consiste en quelque chose d'important pour eux.
De quoi est faite une "majorité"
Appliquant cette conclusion fondamentale à l'étude des faits, la théorie des choix publics redécompose en leurs éléments constitutifs les coalitions majoritaires que nous voyons à l'œuvre. Elle montre comment elles ont été formées à partir des groupes, qui renoncent à ce qui leur importe le moins pour obtenir ce qui compte davantage à leurs yeux. Elle montre comment, sur un sujet donné, les minorités échangent leurs suffrages avec les autres dans un réseau de contrats à plus ou moins long terme qui, à bien des égards, ont le goût et la couleur du marché et de l'entreprise.
On constate que certains termes, d'ailleurs familiers des connaisseurs du Congrès des Etats-Unis, tels que le marchandage, l'"échange de bons procédés" ou le "renvoi d'ascenseur", s'appliquent également aux groupements politiques, tout comme aux élus. Chaque élection offre des "paquets" de mesures, des ensembles de décisions politiques à prendre en bloc ou à laisser ; une bonne partie de l'activité politique consiste à définir ces "paquets", dont on rendra les avantages les plus voyants possibles pour le plus grand nombre des électeurs, et dont on occultera les inconvénients. Notons que cette activité ne cesse nullement en-dehors des périodes électorales.
Même entre deux élections, les groupes échangent le suffrage les uns des autres, soutenant certains projets, s'abstenant pour d'autres, en combattant certains. Parfois, l'opposition est suffisamment puissante pour valoir la peine d'être achetée. Ces marchandages sont présentés comme une part importante de la réalité politique, ce qui permet de la comprendre bien mieux que si l'on se contentait des interprétations plus simples, qui mentionnent plus volontiers la "rationalité publique" que des échanges quasi-marchands.
Les vrais intérêts au pouvoir
La théorie des choix publics, et nous en verrons maints exemples, s'est avérée un outil extraordinairement efficace pour prévoir le comportement des différents groupes d'acteurs du secteur public, ainsi que les résultats de leur interaction. Elle envisage notamment toujours les fonctionnaires, non comme de purs esprits qui appliqueraient impartialement les décisions des élus, mais comme une ou plusieurs associations de personnes bien concrètes, et qui ont pour ou contre ces mesures des intérêts puissants et identifiables.
On se rend bien compte que les gens en place dans les entreprises nationalisées ou les "services publics" forment des groupes suffisamment bien placés pour influencer fortement la quantité et la qualité des productions, et qu'ils se soucient énormément du niveau de leur financement. Ceux qui gèrent les services administratifs trouvent un enjeu considérable dans la taille de l'organisation, ses effectifs et l'étendue de ses activités.
Même les parlementaires cessent de n'être que des représentants élus au service du public. Ils sont, eux aussi, un groupe d'intérêts particulier, avec ses priorités propres et ses avantages à conquérir. Les activités qui apportent aux parlementaires une popularité visible auprès de groupes d'électeurs, par exemple, sont plus intéressantes pour eux que des actions qui ne leur rapportent rien, quand bien même ces dernières seraient plus méritoires.
L'intérêt des chefs syndicalistes du secteur public n'a rien à voir avec la production du meilleur "service public" possible au coût le plus bas. Il est d'obtenir le plus d'influence possible, ce qui implique généralement de maximiser le nombre de leurs adhérents. C'est bien ainsi qu'il faut interpréter la "défense du service public" qu'ils ont sans cesse à la bouche, alors qu'il est évident que le service du public en pâtira plus souvent qu'à son tour.
Les incitations perverses de la décision publique
En conséquence, une fois l'électorat décomposé en groupes d'intérêts dont chacun poursuit des objectifs propres, on s'explique bien mieux certaines caractéristiques de la fourniture des "services publics" dans les sociétés démocratiques, qu'il s'agisse de produire des objets ou des services. Dans un tel cadre, entre autres, chacun a normalement intérêt à développer au maximum sa propre consommation des produits financés collectivement. Des électeurs peuvent faire pression sur le système politique pour accroître la quantité des services rendus, les bénéficiaires constituant un groupe de pression bien plus visible et plus puissant que la masse des contribuables qui paiera la facture. La tendance des sociétés démocratiques à développer les financements "publics" en excès peut alors se comprendre à partir des rapports de forces internes au système.
Le "piège du financement public"
Un exemple de ce piège du financement "public" : imaginons que dans un village, il y ait dix personnes qui veulent que la route qui passe devant chez elles soit mieux entretenue. Dix personnes, ce n'est pas un groupe politique bien puissant, mais il doit en exister d'autres qui aimeraient bien, elles aussi, avoir de meilleures chaussées dans leur propre quartier. Elles constituent donc un bon point de départ pour coaliser ceux qui voudraient un meilleur entretien de leur route et sont prêts pour cela à réclamer un financement accru des voies publiques en général. Les politiciens peuvent alors négocier l'appui de ce groupe s'ils s'engagent à améliorer la voirie. Même ceux dont les routes n'ont besoin d'aucune amélioration ne s'opposeront pas très fortement au principe des travaux, car les coûts tels qu'ils les perçoivent ne leur paraîtront généralement pas assez élevés pour qu'ils s'y opposent effectivement. L'effet cumulatif de cette agitation pourra bien être un niveau d'investissement routier plus élevé qu'il n'est réellement nécessaire, et sans aucun doute plus coûteux que ce que les gens débourseraient si le paiement était direct et non collectivisé.
Entrepreneurs et projets politiques
Le principe général de la théorie des choix publics est d'étudier l'activité politique comme une activité économique, y reconnaissant les mêmes lois. Dans un tel contexte, il est très fécond d'envisager les groupements politiques comme des entreprises, travaillant dans un milieu économique. Si l'on tient pour acquis que chacun s'efforce de maximiser son propre avantage (de quoi qu'il puisse s'agir) dans le cadre des règles en vigueur, on dispose d'un outil de prédiction extrêmement efficace. Comme des entrepreneurs, ces groupes guettent les occasions, essaient de pousser leurs avantages, rivalisent pour des parts de marché, et cherchent toujours à réduire les efforts et sacrifices nécessaires pour obtenir un résultat donné.
Tout comme les sociétés commerciales luttent entre elles pour conquérir leurs parts de marché, les bureaucrates des différents ministères sont en concurrence pour l'attribution des crédits. De même, les jeux de pouvoir auxquels on assiste au sein des entreprises, où l'on voit les cadres supérieurs se battre pour leur avancement et leur prestige, ne sont que le pendant ce que l'on peut observer dans les administrations, où les chefs et sous-chefs de service intriguent pour obtenir de l'avancement. Une étude des administrations publiques qui ne se soucierait que des objectifs politiques proclamés et des opinions affichées à leur égard, passerait à côté d'un facteur essentiel, l'implication personnelle dans les décisions de personnes dont la vie et la carrière en dépendent de fait.
Si la manière dont les entreprises poursuivent leurs objectifs exerce un impact capital sur les résultats généraux de l'économie, le comportement des entrepreneurs politiques ne le leur cède en rien : son rôle est véritablement déterminant sur les résultats observés. Les fonctionnaires peuvent favoriser ou freiner l'action du gouvernement. Ils peuvent même la saboter, pour peu qu'elle menace l'un ou l'autre de leurs intérêts vitaux. Les agents du secteur public peuvent menacer de grève ceux qui font la loi — ou la faire — pour faire pression sur eux. Or, la complainte d'une population privée de services essentiels est une des élégies auxquelles les politiciens sont les plus sensibles, car la popularité est leur fonds de commerce.
Les chefs syndicalistes peuvent brandir la menace de l'hostilité de leurs membres pour obtenir le plus possible d'emplois et les meilleures conditions de travail pour leurs affiliés. Certaines fractions de la population, lorsqu'elles cherchent à obtenir des avantages particuliers précis, peuvent organiser des protestations pour peser sur les décisions législatives, et manifester pour entraîner les médias à leur suite.
On ne peut se permettre d'ignorer ces contraintes
Les dirigeants politiques qui veulent se faire réélire doivent guetter tous les signes indiquant que leur action, ou leur inaction, face à certains problèmes, attirera sur eux la colère de l'électorat. A leur tour, ils feront pression sur l'exécutif, et influenceront sa résolution à poursuivre ou abandonner certains éléments de son programme, ou encore à entreprendre de nouvelles initiatives.
Toutes ces pressions sur le système politique sont parfaitement réelles. La volonté des gouvernements, quant à elle, n'est qu'un frêle roseau. Le gouvernement annoncera un programme dans sa plate-forme électorale et entreprendra de le réaliser, mais il n'a pas le choix de tenir compte ou non des pressions qui s'exerceront sur lui. Une bonne partie de l'art de gouverner consiste peut-être justement à savoir ce qu'il est possible de faire, et à percevoir les moments où la résistance est trop forte pour que l'entreprise réussisse. Après tout, n'a-t-on pas dit que la politique est l'"art du possible" [4] ?
Un excellent moyen d'explication
L'idée que la politique est un lieu d'échanges est donc un excellent outil de recherche. Comme bien des théories économiques explicatives, elle donne les meilleurs résultats lorsqu'on s'en sert pour interpréter les événements passés. Grâce à elle, nombre d'événements trouvent bientôt leur explication. Nous pouvons commencer à comprendre pourquoi certains programmes politiques ont échoué, alors que d'autres réussissaient. Bien souvent, cela se résume au fait que les groupes qui devaient en profiter n'y voyaient pas un grand avantage, alors que les perdants potentiels risquaient de perdre gros, ce qui les disposait à sacrifier beaucoup pour leur faire barrage [5].
Entre autres, la théorie des choix publics nous permet de comprendre ce qui, autrement, ne serait qu'un fait étrange, un mystère irrésolu : que ce sont les minorités qui l'emportent sur les majorités. Dans le paradigme politique conventionnel, on s'attendrait au contraire à ce que la majorité impose ses intérêts propres, aux dépens des minorités. Or, avec le modèle des choix publics, on se rend compte que, pour donner un privilège à une majorité, il faut prendre bien davantage à la minorité. En termes plus crus, si l'on veut donner un franc à tous les membres de la majorité, il faut prendre bien plus d'un franc à chacun des membres de la minorité. Et ladite minorité en couinera d'autant plus fort. A l'inverse, pour favoriser la minorité, il n'est pas nécessaire de prendre autant à la majorité. Quand le grand nombre entretient le petit, le petit nombre reçoit beaucoup alors que le grand ne donne que peu chacun. Les reproches de la majorité sont faibles, forte est la reconnaissance de la minorité.
Ce processus explique pourquoi, alors que depuis un siècle la proportion des agriculteurs dans la population a considérablement diminué, les hommes de l'Etat leur distribuent des monceaux de subventions. Dans tous les pays avancés, les agriculteurs sont aujourd'hui une petite minorité, et ils reçoivent de gigantesques subsides aux frais des contribuables citadins, lesquels sont bien plus nombreux [6]. En revanche, dans les économies moins avancées où l'agriculture emploie encore une majorité de la population, il est caractéristique que ce soient les agriculteurs qui sont taxés, ou forcés de vendre leurs produits à des prix artificiellement bas, pour permettre aux minorités citadines de vivre sur leur dos. A mesure que le nombre des agriculteurs baisse, leur capacité à pétitionner augmente de façon manifeste.
Ce cas illustre bien cette conclusion générale de la théorie des choix publics, qu'il est plus facile de satisfaire des minorités que des majorités. Cela coûte moins cher, et les minorités donnent assez de valeur à ce privilège pour que les législateurs y trouvent leur avantage.
Ce qui donne du poids à une minorité
Cependant, toutes les minorités ne pèsent pas du même poids, et ce n'est pas non plus le nombre de leurs membres qui constitue leur élément le plus important. Logiquement, pour la théorie des choix publics, la valeur qu'elles attribuent à un avantage les dispose à payer à due concurrence pour l'obtenir. Un groupe, même d'effectif réduit, peut donner tellement d'importance à ses objectifs qu'il sera prêt à payer cher pour les atteindre ; c'est-à-dire qu'il peut être prêt à offrir un soutien puissant aux alliés potentiels qui l'aideront à obtenir satisfaction.
Pour être efficace, une minorité doit être visible. Dans certains cas, une minorité a énormément à tirer d'une certaine décision, mais elle est incapable de l'influencer parce qu'elle ne constitue pas un groupe suffisamment spectaculaire pour pouvoir offrir en échange un soutien appréciable. Par exemple, si une école est menacée de fermeture, les parents d'élèves constitueront un groupe très visible. Ils pourront se réunir, protester, écrire à leur député, organiser des manifestations de rue, passer à la télévision. En revanche, lorsqu'il s'agit d'ouvrir une nouvelle école, le groupe des futurs parents d'élèves qui pourraient vouloir qu'elle ouvre sera moins spectaculaire et aura moins de poids politique, parce que son soutien est plus difficile à échanger.
Un autre facteur qui donne de l'importance aux groupes minoritaires est leur capacité de nuire. Peut-être y a-t-il plus d'assistantes sociales que de techniciens EDF, je ne sais ; mais ce qui est certain, c'est qu'une perturbation éventuelle dans l'assistance sociale fera moins de dégâts que l'interruption des fournitures d'électricité. Ce qui veut dire que les agents d'EDF ont bien davantage de poids, sans commune mesure avec la valeur objective de leurs contributions personnelles à la société, en comparaison avec les travailleurs sociaux.
Si elle veut bien s'en tirer sur le marché politique, une minorité doit acquérir la conscience politique d'elle-même. Elle doit pouvoir reconnaître les intérêts que ses membres ont en commun, ainsi que sa position de minorité en mesure d'utiliser le système pour en tirer un avantage particulier. Les "défenseurs de l'environnement" qui essaient de bloquer la construction d'un nouveau lotissement dans leur quartier forment une minorité claire et identifiable. Ils savent qui ils sont, et où se trouve leur intérêt7. Ils peuvent faire savoir ce qu'ils veulent aux élus, faire parler d'eux, et causer bien des ennuis à beaucoup de gens.
Les minorités latentes sont défavorisées
Ceux qui pourraient bénéficier de la construction d'une nouvelle résidence sont peut-être plus nombreux, mais ils n'ont aucune conscience de l'être. Ils ne savent même pas qui ils sont. Peut-être sont-ils, au moment présent, dispersés dans l'ensemble du pays, sans pouvoir apprécier l'avantage direct qu'ils pourraient tirer de cette construction. La théorie des choix publics nous annonce que le premier groupe, conscient de sa position comme de ce qu'il a à perdre et à gagner sera, à cet égard, plus efficace que le second pour ce qui est de négocier sur le marché politique.
Un modèle américain ?
Rétrospectivement, il est facile de distinguer ce qui, dans la vie politique américaine, donnait à la théorie des choix publics de meilleures chances d'émerger là-bas plutôt qu'en Europe. La société américaine est plus fragmentée ; bien davantage que chez nous, elle est composée de gens qui considèrent eux-mêmes appartenir à des sous-groupes de la société. Cela ne signifie pas que la théorie des choix publics ne soit pas applicable en Europe8, ni que sa capacité explicative y soit moindre : simplement, et notamment en Grande-Bretagne, ses racines y sont moins visibles. Dans ce pays, c'est plutôt d'après d'origine professionnelle que se rassemblent les acteurs de la politique [9]. Toujours est-il que cette analyse donne une image beaucoup plus précise que l'ancienne conception, suivant laquelle les minorités soutiennent les partis et les candidats parce qu'elles pensent qu'ils sont leurs "représentants".
La théorie des choix publics est la seule à pouvoir traiter certaines questions
Elle fournit aussi une classification bien plus efficace, car elle ne considère pas seulement les groupes traditionnellement permanents, ceux dont tout le monde parle. Même si on ne peut cesser d'être "noir" ou "hispano-américain", on peut dans le même temps appartenir à plusieurs minorités à la fois, qui varieront suivant les enjeux. Selon son lieu de résidence, on pourra faire partie d'un groupe qui réclame une subvention pour l'entretien du réseau routier, ou la construction d'un nouveau pont. Selon sa profession, on pourra faire partie d'un groupe partisan d'octroyer des subventions à tel ou tel type d'industrie, par exemple contre la concurrence étrangère. Tel locataire fera partie d'une association pour le contrôle des loyers et tel propriétaire, d'un groupe pour la réduction des impôts fonciers. Entre dans le domaine d'étude de la théorie des choix publics tout ce qui concerne les choix faits par ces groupes changeants et versatiles à l'occasion des transformations politiques. Il en est de même des élus à tous les niveaux de l'Etat lorsqu'ils réagissent aux pressions, et marchandent avec les groupes suffrages et influence.
Autre avantage : certains des effets des sociétés politiques démocratiques nuisent tellement à la population qu'ils paraissent totalement irrationnels et incompréhensibles quand on essaye de les expliquer à l'aide du modèle politique traditionnel. Les analystes qui s'en tiennent à ce cadre de référence restent encore bien souvent perplexes face à l'apparente impuissance de ces sociétés à corriger ce qui, à l'évidence, ne fonctionne pas. Or, l'approche des choix publics, et c'est une de ses plus grandes vertus, nous fournit un mode d'analyse dans lequel ces comportements trouvent tout naturellement leur place, une fois que l'on a appris à les interpréter en termes de commerce des influences politiques. Ses meilleures recherches nous ont valu des découvertes essentielles sur la structure et le mode de fonctionnement du domaine économique qui relève directement du pouvoir des hommes de l'Etat.
Le secteur public
La théorie des choix publics est indispensable pour comprendre le secteur public
La théorie des choix publics explique particulièrement bien les caractéristiques du domaine économique où les biens et services sont financés par l'impôt et produits sous la domination directe des hommes de l'Etat. Par ailleurs, certains aspects de ce secteur semblent quasiment impossibles à comprendre ou à expliquer si l'on s'en tient aux modèles conventionnels de la politique.
La tendance à la surproduction
Il y a, par exemple, la tendance à surproduire qui subsiste dans le secteur public. Quand c'est par une procédure collective que les gens financent leurs biens et leurs services, ils consomment davantage que si chacun devait payer ce qu'il a reçu. La théorie des choix publics nous donne le fin mot de l'affaire : c'est que, dans ces conditions, il subsistera toujours une demande pour un accroissement du service.
S'il n'existe aucune contrainte, les gens vont préférer que l'autocar passe deux fois par jour plutôt qu'une, que l'éclairage public soit amélioré, qu'il y ait davantage de routes, et mieux entretenues. En l'absence de contraintes, cette demande s'exprime sans égard pour ce qui est consommé ; elle est donc potentiellement infinie. Dans les cas extrêmes, on pourrait imaginer que les gens ne soient pas opposés à ce que des autocars vides passent toutes les demi-minutes, pour le cas où il leur prendrait l'envie d'en attraper un. Quand il n'y a pas de limites, une telle préférence est parfaitement naturelle.
Or, au risque d'avoir à contester un des mythes fondateurs du "service public", il faut rappeler que la "gratuité" n'existe pas et ne peut jamais exister. Il faut donc nécessairement qu'il y ait des contraintes, et les plus évidentes sont celles qu'imposent les prix de revient. Quand les gens paient directement leurs marchandises et leurs services, ils sont obligés de tenir compte de ce qu'ils dépensent, et de limiter en conséquence les quantités demandées. Dans le secteur public de l'économie, ces contraintes sont moins efficaces parce qu'elles sont moins fortement ressenties, et qu'elles sont liées de façon moins évidente à la fourniture des produits.
Supposons que, dans un domaine donné, une minorité réclame une amélioration des services. Elle peut s'être rendue compte elle-même de leurs insuffisances, ou alors quelque candidat à une élection lui aura fait miroiter les avantages d'une amélioration. Ces derniers sont donc bien mis en valeur, alors que leur coût supplémentaire est de moindre conséquence pour chacun. Ce peut être un petit groupe, mais ses desiderata peuvent rejoindre ceux d'autres groupes qui ont aussi leurs fournitures à faire améliorer. Ainsi peut naître une demande générale pour un développement du service, sans qu'il y ait beaucoup de pression pour le limiter. La coalition de ces groupes finit par représenter un potentiel politique bien réel, à échanger contre des produits sur le marché politique, alors qu'aucun soutien équivalent n'aura pu être constitué par ceux qui sont hostiles à cet accroissement des dépenses.
C'est ainsi que l'on peut observer ce phénomène étrange : les biens et services "publics" sont en fait produits en plus grande quantité que les citoyens ne l'auraient voulu si la décision leur avait été laissée à titre individuel. Cela n'implique en rien, bien au contraire, que ces produits soient de plus grande qualité, ni qu'ils répondent mieux aux exigences et aux besoins des consommateurs. Cela signifie seulement que l'irresponsabilité automatiquement induite par la procédure politique conduit les gens, collectivement, à dépenser davantage qu'ils ne le feraient de leur propre chef. S'ils doivent payer directement le service, ils en demandent moins que lorsqu'il leur est fourni par le secteur public. Le secteur public est donc, par sa seule existence, la cause d'une mauvaise allocation des ressources ; phénomène qui échappera toujours à la compréhension de quiconque méconnaît le point de vue adopté par la théorie des choix publics.
Tout le monde est poussé par son intérêt vers ce résultat indésirable
Il n'y a pas que les consommateurs qui soient poussés à la surproduction des biens et des services dans le secteur public. De leur côté, c'est bien naturel, ceux qui gèrent cette production en tirent un pouvoir et un prestige proportionnels à l'importance du service. Les employés, quant à eux, y trouvent des occasions de monter en grade et de se faire augmenter. Ceux qui font la loi gagnent eux-mêmes le soutien des groupes qui reçoivent les services produits en excès, sans pour autant perdre celui des contribuables dans leur ensemble, qui financent toutes ces belles dépenses. Le résultat est un soutien massif et unilatéral à tout projet de développer le service, avec une opposition pratiquement inopérante.
Réduit au statut d'usager, le consommateur perd tout pouvoir de décision
Le service, même produit en plus grande quantité que des clients individuels n'accepteraient d'en financer sur un marché privé, ne répond par ailleurs en rien à leurs besoins particuliers ni à leurs exigences spécifiques. Bien au contraire, c'est aux pressions du processus politique qu'il obéit. Sur un marché privé, le consommateur peut choisir son fournisseur. Par ailleurs il lui suffit, pour en borner la quantité, de limiter sa dépense, dont il a la maîtrise directe. En somme, l'offre est contrainte parce que le client choisit son fournisseur, la somme qu'il est disposé à payer (ou peut se permettre de payer). Dans le secteur public, rien de tout cela : le consommateur ne contrôle ni le choix de son fournisseur ni la quantité produite, et pas davantage ce que tout cela va lui coûter (dût-il se passer du nécessaire pour entretenir ces excès).
Naturellement, dans le privé, le client peut aussi choisir les biens et services particuliers qui correspondent à ses exigences, et refuser ceux qui ne lui servent à rien. C'est ainsi qu'en assez peu de temps, les biens et les services finissent par se conformer aux préférences des consommateurs. Les producteurs qui s'en moquent font faillite lorsque leurs clients vont chercher ailleurs.
C'est à des influences totalement différentes que le secteur public est soumis. Les consommateurs n'ont pas le choix : ils sont bien obligés de payer ce que le secteur public produit. Car cette production est, pour sa plus grande part, financée par l'impôt. Les consommateurs n'ont aucun autre choix possible, d'abord parce que le "service public" est le plus souvent un monopole (ne serait-ce que parce que le financement public, reposant sur l'usage de la force, est en lui-même une forme de concurrence déloyale), ensuite parce que, étant généralement obligés de financer sa production, rares sont ceux qui peuvent se permettre, en plus, de se payer un fournisseur privé. Cela signifie que les consommateurs n'ont aucune possibilité d'imposer leur rationalité propre au secteur public. La procédure politique leur permet épisodiquement de formuler un vœu, mais — nous en avons vu un exemple — celle-ci ne traduit pas leurs véritables préférences, et ils sont de toutes façons soumis à la "carte forcée" : on ne leur donne à choisir (sans garantie aucune d'obtenir celui qu'ils veulent) qu'entre des "lots" composites extrêmement vastes, dans lesquels une dépense particulière pour tel bien ou telle marchandise fournie par le secteur public est totalement noyée dans la masse.
La surproduction s'entend à qualité du service égale
Cet écart entre produit désiré et produit fourni peut d'ailleurs conduire à cette situation paradoxale : en dépit de la tendance inhérente à la surproduction dans le secteur public, il arrive souvent que pour le même type de service, la population soit prête à payer beaucoup plus lorsque les producteurs sont privés. C'est notamment ce qu'on observe en matière de santé, où les Américains, avec leur médecine encore largement privée, dépensent davantage par habitant que les Britanniques assujettis au monopole pseudo-gratuit du Service National de Santé, ou en matière d'enseignement, où les Japonais dépensent plus que les autres, parce qu'une part substantielle de leurs dépenses en la matière va à des écoles de préparation privées.
Un statisticien imprudent — ou malhonnête — en conclurait même que l'observation réfute la théorie des choix publics, puisque, en contradiction apparente avec ses prédictions, une même activité conduit à moins de dépenses dans un pays où elle est collectivisée, que dans un autre où elle ne l'est pas autant. C'est là qu'il faut se rappeler que la tendance à la surproduction existe nécessairement, dès lors qu'un financement public a institué l'irresponsabilité financière pour ceux qui décident de la production du service.
Ce qui se passe, c'est que le service pseudo-gratuit, financé par les hommes de l'Etat, perd tellement de valeur aux yeux de la population qu'elle en vient à en demander moins que s'il était normalement financé, en dépit du déterminisme qui conduit par ailleurs chacun à pousser à une dépense inconsidérée. L'observation ne réfute donc pas la théorie des choix publics : elle traduit en fait la combinaison de deux des effets qu'elle décrit. D'une part, la tendance à dépenser trop, d'autre part l'effondrement de la valeur du service, tous deux imputables à des formes de financement et de gestion par nature irresponsables.
La domination par les producteurs
Ainsi, l'observation montre bien à quel point les consommateurs sont impuissants à influencer la production des biens et services du secteur public. Le système politique favorise la surproduction et se moque du consommateur-contribuable, ce cochon de payant. Les producteurs, en revanche, voilà qui peut exercer sur le service une influence considérable. Or, ceux qui le gèrent au niveau de la direction, et les employés qui participent directement à sa production, ont pour leur part un fort intérêt personnel dans la nature du service, et dans la manière dont il est produit.
L'administration d'un "service public" place son intérêt dans un service qui soit facile à gérer, et maximise les perspectives de carrière des administrateurs et des gestionnaires. Le personnel, pour sa part, a intérêt à ce que le service lui donne le moins de travail possible et le dérange encore moins, tout ceci avec la meilleure garantie d'emploi et les meilleures rémunérations possibles. Quant à la position de ces deux groupes pour influencer le système, elle est excellente. Contrairement aux usagers qui n'ont pas le choix, et sont obligés de prendre ce qu'on leur donne, eux ont un pouvoir à monnayer. Car l'un et l'autre peuvent rendre la vie vraiment difficile aux élus.
La bureaucratie peut entraver, ralentir, et faire échouer tout changement susceptible de menacer son statut et sa position. Le personnel peut interrompre le service, ou menacer de le faire, et livrer ainsi les élus à la vindicte du public. Le résultat, inéluctable, est que les "services publics" tendent tous à être "capturés" par les producteurs. Cela signifie que ces services, au bout d'un certain temps, sont bien davantage au service des producteurs qu'à celui des consommateurs. Ce sont les producteurs qui ont le vrai pouvoir à l'intérieur du système, les consommateurs n'en ayant aucun. C'est, tout simplement, que les premiers ont davantage de poids politique à faire valoir que les seconds.
Seule la théorie des choix publics rend compte de la confiscation du pouvoir par la bureaucratie
Avec les années, progressivement, le service cesse de servir les besoins et les demandes du public, et ne produit plus que pour satisfaire les préférences du petit groupe des producteurs. Cette "capture par les producteurs", la théorie des choix publics lui donne tout naturellement son explication, n'étant même pas loin de la juger inéluctable [1] ; mais elle aussi serait bien difficilement explicable par les représentations traditionnelles de la politique. Pourquoi les citoyens, majoritaires et réputés rationnels, choisiraient-ils d'instituer un service pour qu'il échappe à leur contrôle en aspirant leurs ressources, dans le seul but de satisfaire le groupe des gens qui y seront employés ? Cela semblera inconcevable, faute des outils intellectuels permettant de comprendre comment les règles de procédure en question donnentun pouvoir de négociation exceptionnel à certaines personnes aux dépens du public dans son ensemble.
Les résultats de la capture par les producteurs sont bien visibles dans tous les domaines du secteur public. Les services, qui sont en principe là pour servir le public, sont de plus en plus asservis aux convenances de ceux qui sont payés pour les produire. La Poste est un modèle parfaitement typique : le deuxième passage du facteur le samedi disparaît ; il n'y a plus de levée le dimanche. Les bureaux de poste ferment le samedi après-midi ; le service des pneumatiques a été supprimé. De tous ces changements, aucun n'est la réponse à un vœu des consommateurs ; bien au contraire, on peut supposer qu'ils souhaiteraient exactement l'inverse. En revanche, ceux qui produisent le service ont la vie plus facile s'ils ne sont pas obligés de travailler le week-end.
Un processus constant de dégradation
Dans l'ensemble du secteur public par conséquent, la tendance est à ce que les besoins et les convenances des producteurs aient résolument le pas sur ceux du consommateur. En réalité, rien de tout cela ne se produit immédiatement. C'est un scénario qui se déroule au fil des années, à mesure que jouent les déterminismes et apparaissent leurs effets. par exemple, en Grande-Bretagne, les éboueurs passent tôt le matin et réveillent tout le monde avec le bruit qu'ils font. Les accords qu'ils ont réussi à négocier spécifient qu'ils doivent être payés pour un travail défini, le nombre de tâches correspondant à une journée de travail "normal" n'étant calculé qu'ensuite. Le calcul est remis en cause et débattu chaque année, jusqu'à ce qu'il soit tel que le personnel commence tôt le matin, et termine sa "journée" de travail... à midi. Cette particularité serait virtuellement impossible dans le secteur privé, parce que l'entreprise verrait ses prix refléter ses coûts, et que le public s'adresserait à des concurrents moins chers. Cependant, le secteur "public" accorde rarement au public le luxe de choix concurrents, et on ne peut même pas espérer qu'il fasse faillite comme il devrait normalement le faire avec une gestion pareille. Le résultat est que, année après année, on constate que les négociations remettent de plus en plus le soin de définir le service aux mains de ceux qui le produisent. Encore un mystère élucidé : les conventions collectives, dont un bon nombre de clauses seront incompréhensibles pour qui n'a pas analysé les pressions qui s'exercent dans le système. Les accords qui caractérisent le secteur public ne trouvent aucun équivalent dans le secteur privé, sauf peut-être dans la production des journaux ou des programmes de télévision [2].
Il serait inconcevable qu'une clinique privée réveille ses malades avant six heures du matin, simplement parce que le personnel trouve plus commode de faire le ménage à l'aube. Il ne serait pas davantage plausible qu'on y fasse attendre des malades plusieurs heures dans les couloirs pour une radiographie ou d'autres examens, pour les faire encore lanterner avant de les ramener à leur chambre, tout cela parce que les brancardiers ont imposé certaines règles pour se faciliter le travail. Et pourtant, ces pratiques sont monnaie courante dans nos hôpitaux publics. La différence ne vient pas du fait que les cliniques privées auraient davantage d'argent. Elle vient de ce qu'elles n'ont pas été capturées par les producteurs, et donnent par conséquent la priorité à la satisfaction des désirs et besoins de leurs clients.
La tendance aux sureffectifs
Si le pas donné aux employés est une caractéristique du secteur public, la tendance aux sureffectifs en est une autre. Car l'organisation publique est bien souvent moins efficace que son homologue privée, et nécessite davantage de ressources pour obtenir le même produit. Cette différence est mesurable par comparaison ; rien n'empêche de mettre les prix de revient unitaires de la fourniture publique en regard de ceux d'entreprises ou de services équivalents dans le secteur privé. Il est parfois possible de les comparer à ce qu'ils étaient avant que le service en question ne soit absorbé par le secteur public. On peut aussi mettre en contraste la production publique dans un pays et son homologue privé dans un autre.
La comparaison montre un coût plus élevé pour un résultat équivalent, chaque fois que les biens et services sont produits par le secteur dit "public". Toutes choses égales par ailleurs, il faut davantage de personnel au secteur public pour produire des soins médicaux, de l'acier ou des transports, qu'il n'en faut dans le secteur privé. La théorie des choix publics nous explique pourquoi.
Personne, dans un "service public", n'a intérêt à économiser les postes de travail
Que la main-d'œuvre soit employée de façon économique est normalement dans l'intérêt des producteurs, comme dans celui des consommateurs. Sur un marché concurrentiel, les producteurs s'efforcent de maintenir des coûts à un niveau raisonnable en utilisant plus efficacement la main-d’œuvre. Ils peuvent ainsi augmenter directement leurs bénéfices, ou bien maintenir des prix avantageux pour attirer la pratique et accroître leurs parts de marché. Quant au consommateur, il profite de prix plus bas. Or, le secteur public fonctionne forcément dans un contexte moins concurrentiel, puisqu’il est assis sur des impositions — fiscales et réglementaires — qui privent automatiquement ses clients d’une partie de leur liberté de choix. Les incitations normales, qui conduisent à une utilisation rationnelle de la main-d'œuvre, sont absentes, et d'autres valeurs prédominent donc.
C'est l'intérêt des dirigeants que d'avoir un personnel plus nombreux sous leurs ordres. La responsabilité supplémentaire que cela leur impose leur apportera des rémunérations plus élevées. Le personnel, pour sa part, voit son intérêt dans un excès d'embauche. Cela semble vouloir dire : "moins de travail pour chaque employé, davantage de postes disponibles, et ainsi une plus grande sécurité de l'emploi". Pour ceux qui négocient en leur nom, cette perception est aussi une réalité. Il n'est pas dans l'intérêt des militants syndicalistes d'accepter des baisses de personnel, même si cela devait aboutir à une affectation plus efficace du travail fourni. Moins de personnel, c'est automatiquement moins d'adhérents. Dans le secteur public, les négociations sont caractérisées par une répugnance certaine de la part des syndicats à accepter les nouveaux équipements ou les nouvelles méthodes de travail, s'ils doivent conduire à des réductions de postes.
Même s'il existe dans le gouvernement et l'administration du secteur public un désir authentique d'efficacité, il faut en général prendre des mesures draconiennes pour l'obtenir. Combien plus facile est de céder aux exigences de ceux qui ont le pouvoir, et de sacrifier ceux qui n'en n'ont pas ! Ce qui veut dire, dans le secteur public, donner toujours plus aux producteurs, aux dépens des consommateurs. Lors de la conférence annuelle de l'Association Nationale Américaine des Entreprises de Traitement des Déchets, un responsable fit savoir qu'à Londres, la véritable curiosité touristique n'était pas la famille royale ni les monuments historiques, mais la vision de cinq hommes accrochés derrière une benne à ordures, ramassant les sacs à la main et les y lançant. Ce spectacle-là, il le trouvait pour sa part plus "historique" que les monuments du même nom.
Un pur gaspillage, quasiment palpable
On peut mesurer le degré de sureffectifs et les pertes qu'ils imposent au public des consommateurs au moment où un contrat est passé avec une entreprise privée pour la charger d'une tâche auparavant remplie par un "service public". L'entreprise privée s'acquitte de la même tâche à meilleur marché, et avec moins de monde. Et elle n'impose pas un travail plus dur à son personnel ; elle se contente de mieux l'utiliser. Cela peut passer par un nouvel équipement ou, plus souvent, par de meilleures méthodes de gestion.
Si l'entreprise privée est capable d'obtenir ces conditions de travail, c'est parce qu'elle est en concurrence avec d'autres entreprises, et qu'elle risque la faillite si elle perd sa part de marché. Le personnel accepte ces conditions dans le secteur privé, parce que son emploi en dépend. Un aspect intéressant du passage d'un statut public à un statut privé est que le personnel qui passe à la nouvelle entreprise privée y est en général plus satisfait de son travail que dans le secteur d'Etat, pourtant dominé par les producteurs. Même si son travail est affecté et géré plus rigoureusement, et si la main-d'œuvre est moins nombreuse, il a la possibilité, qu'il n'avait pas auparavant, de gagner des primes en travaillant davantage, et de nouvelles chances d’être promu à des postes plus importants, avec de plus grandes responsabilités.
La décapitalisation chronique
Un autre trait essentiel de la fourniture publique des biens et des services qui ne peut être ni prévue ni expliquée par la théorie politique conventionnelle, est aussi sa décapitalisation chronique. En effet, il n'y a apparemment aucune raison pour que les citoyens de la théorie officielle, toujours aussi rationnels et majoritaires, aient envie de se faire fournir des services par des organisations dépourvues du capital nécessaire pour ce faire. Etant donné que l'allocation donnée à chacun des services ne représente qu'une petite somme pour le contribuable, il est a priori difficile de comprendre pourquoi ils sont sous-capitalisés à ce point. On a déjà observé une nette tendance à la surproduction ; pourquoi n'existe-t-il pas, de la même façon, une tendance à la surcapitalisation?
La myopie de l'Etat
La réponse nous apparaît une fois que nous avons examiné les pressions qui s'exercent respectivement sur les dépenses courantes et les dépenses de capital. Le financement de chaque service est limité par ce que les législateurs sentent que les contribuables peuvent tolérer. Même si tout bénéficiaire d'un service lui donne plus de valeur qu'à la somme marginale qu'on lui fait payer en échange, il existe un intérêt diffus mais certain au sein du public pour maintenir le niveau d'imposition à l'étiage où la pression de ce service l'a fait monter.
Or, au sein de l'enveloppe globale, il existe une pression plus forte du côté des dépenses courantes. Les dépenses courantes financent la fourniture de services aujourd'hui, et paient les personnes en cause aujourd'hui. A l'inverse, les dépenses de capital préservent la capacité de produire les services dans l'avenir. Alors, ce qui tire l'argent vers les dépenses courantes, ce sont d'une part la population, qui protestera si on réduit les services aujourd'hui, et de l'autre le personnel, qui interrompra le service si ses exigences ne sont pas suffisamment prises en compte. La même pression n'existe pas du côté du capital, parce que les bénéficiaires futurs du service ne sont pas là, aujourd'hui, pour l'exercer de la même façon. Ils constituent un groupe diffus et impossible à identifier, qui ne ressent pas directement sa perte lorsque l'investissement est sacrifié.
Pour illustrer la dispersion et l'impuissance relative de ce que Mancur Olson appelle des groupes d'intérêt latents [3], nous avions pris l'exemple d’une l'école existante contre une école en projet. Une de ses conséquences est que, en l'absence d'un groupe de pression constitué, personne ne défend l'avenir face à ceux qui privilégient le présent : les parents d'élèves d'une école existante menacée de fermeture peuvent exercer une pression échangeable sur le marché politique, alors que les parents à venir, qui pourraient profiter d'une dépense faite aujourd'hui pour construire une nouvelle école, ne le peuvent pas. Pour la plupart, ils ne se connaissent même pas, et ne perçoivent pas non plus le rapport qui existe entre la dépense d'investissement faite aujourd'hui et l'avantage qu'ils pourraient en tirer demain.
Etant donné le déséquilibre des forces qui s'exercent sur le financement global, il est toujours plus facile pour les élus et les gestionnaires de faire des économies sur l'entretien ou les investissements, plutôt que de réduire les dépenses courantes. Politiquement, il en coûte moins de retarder l'achat d'équipements nouveaux ou la construction de nouveaux locaux, que d'opposer un refus à des revendications salariales ou d'imposer des réductions dans la fourniture des services. Au fil des ans, cette pression inégale conduit à un déclin constant de la part du financement consacrée aux dépenses de capital dans le secteur public.
"Richesse du privé, misère du public" ?
On peut voir les effets de ce déterminisme dans la tendance qu'ont les "services publics" à posséder un équipement typiquement démodé et sous-entretenu4. Les industries privées ne peuvent pas se permettre de se laisser distancer dans la course à la modernisation et à l'emploi du matériel le plus récent. Les entreprises qui s'y refusent se feront battre sur le marché. Sur le marché politique, en revanche, on peut gagner à réduire les dépenses de capital, qui ont peu de bénéficiaires conscients de l'être, pour financer les dépenses courantes, lesquelles en ont beaucoup.
L'expression "richesse du privé, misère du public" a été inventée par Galbraith, pour se plaindre de ce que les biens et des services privés trouvaient toujours suffisamment d'argent, alors que, prétendait-il, il n'y en avait jamais assez pour les biens et services "publics". Nous avons vu pourquoi sa conclusion est passablement sophistique en ce qui concerne les dépenses, mais l'expression reste tout à fait applicable à l'état de l' équipement, car le secteur public a toujours tendance à la décapitalisation, quel que soit le niveau global de son financement. Même si, pour une raison ou pour une autre, il devenait tout à coup politiquement possible de justifier et d'abonder un vaste financement supplémentaire pour des dépenses d'investissement, ces sommes n'atteindraient vraisemblablement pas non plus leur cible affichée. On pourrait s'attendre à ce que la plus grande part aille aux dépenses courantes, à mesure que s'exerceraient les mêmes pressions qui s'étaient faites sentir sur les financements précédents.
Une conséquence de cet état de fait est que nous pouvons tous contempler un secteur privé moderne et pimpant, à côté d'un secteur public souvent miteux et démodé. Dans les "services publics", les équipements servent plus longtemps qu'ils ne le devraient. Les nouveaux achats sont sans cesse repoussés, et les consommateurs doivent se contenter de services qui semblent avoir des années de retard sur la technique et l'équipement du jour. On serait bien en peine de rendre compte de ce fait à l'aide des théories politiques traditionnelles. En revanche, tout devient lumineux dès lors qu'on étudie l'arène politique sous l'angle économique : les dépenses courantes y ont tout simplement plus de poids politique que les dépenses en capital.
En somme, s'il est un groupe qui n'a rien à marchander sur le forum de la politique, c'est bien la génération qui vient. Elle n'apporte aucun avantage actuel en termes de soutien politique, et ne peut conclure aucun accord. Il existera donc toujours une forte tendance à offrir des avantages à la génération actuelle aux dépens de celle qui suivra. En persuadant les électeurs d'aujourd'hui que leurs avantages seront payés par les contribuables de demain, on s'acquiert leur soutien aujourd'hui, alors que celui de demain ne compte pas.
La faillite programmée des systèmes "sociaux"
Un autre exemple de ce phénomène dans les sociétés démocratiques est la tendance marquée à verser des pensions et prestations "sociales" sans rapport aucun avec les versements des bénéficiaires. Le cas type est celui où une nouvelle échelle de prestations est inaugurée dans sa prodigalité, "justifiée" sur la base de versements plus importants dans l'avenir. Les bénéficiaires immédiats, naturellement, y sont entièrement favorables. Ceux qui doivent payer plus cher l'acceptent dans l'espoir que les bénéfices qu'on leur promet pour l'avenir seront plus élevés encore. Ces derniers seront à leur tour financés par leurs enfants et leurs petits-enfants qui, à l'heure présente, n'ont pas voix au chapitre.
Un calcul démographique élémentaire suffit largement pour montrer que le système ne pourra être conservé, et les promesses tenues, qu'en exerçant une lourde pression sur les contribuables de demain, lesquels ont toutes des chances de la refuser purement et simplement, étant devenus les plus nombreux. La morale est celle de la chaîne de lettres, où ceux qui payent aujourd'hui espèrent qu'après eux on pourra enrôler dans ce jeu un nombre suffisant de gogos supplémentaires pour les payer en retour.
Les exploiteurs des générations à venir
John Maynard Keynes disait : "à long terme, nous sommes tous morts." Il avait raison en ce qui le concerne (il est mort en 1945), mais s'il est une pierre de touche du système public de retraites et d'assurances sociales, c'est bien cette mentalité-là. C'était la conception même de ceux qui ont tiré avantage à le mettre en place et à le développer. Ils ont empoché leurs profits hier sur le marché politique, et aujourd'hui, maintenant que la génération actuelle (qui était hier, pour ainsi dire, la "génération de demain") commence à se rendre compte qu'elle est le dindon de la farce, les hommes de l'Etat du départ sont hors de portée, tranquillement installés dans leur rôle de prétendus "sages". Et pour que la comédie soit complète, il arrive qu'on aille jusqu'à leur demander conseil maintenant qu'il n'est plus possible de camoufler la faillite, qu'ils avaient installée dans le système dès le début.
Par ailleurs, tout homme politique essayant de s'attaquer au problème avant qu'il n'atteigne son point critique se heurtera aux intérêts et aux exigences des prétendus ayants droits ; car la formule consistant à demander aux gens de reconnaître qu'il faut payer davantage maintenant pour percevoir moins plus tard n'a que fort peu de chances de l'emporter sur le marché politique. Les observateurs ont depuis longtemps noté la myopie des élus et leur incapacité à formuler des plans à long terme, même alors que l'on voit nettement se dessiner les tendances. La réponse des théoriciens qui étudient les choix publics est que l'avenir n'y a aucune importance. La seule valeur qu'il puisse avoir aujourd'hui vient du souci que se font les électeurs d'aujourd'hui de laisser un monde au moins tolérable à leurs enfants et petits-enfants ; mais il est bien difficile de bâtir quoi que ce soit sur cette fondation, avec des politiciens tellement décidés à concentrer exclusivement les préoccupations des gens sur les choix à court terme.
Le comportement des administrations
Il est un autre phénomène que la théorie des choix publics sait particulièrement bien expliquer, c'est le comportement de la bureaucratie. Le modèle traditionnel présente l'Administration comme l'instrument du Gouvernement, qui lui-même, d'une manière ou d'une autre, reflète la Volonté du Peuple. Sur ce socle se dresse la noble figure d'un Service Public dévoué et impartial, dont la Fonction est de mettre en œuvre les Politiques conçues par ses Dirigeants, qui sont tous des hommes d'Etat.
Même s'ils est possible que les fonctionnaires soient zélés, et constituent un élément essentiel de l'appareil d'Etat, en aucun cas la théorie des choix publics n'accepte de les considérer comme des machines. Ce sont des êtres humains, mus par des projets et des aspirations semblables à ceux qui font agir les autres personnes. Ils constituent un groupe de pression bien distinct, avec un certain nombre d'actifs à faire valoir sur le marché politique. Si nous les considérons comme des entrepreneurs qui cherchent à pousser leur avantage, nous obtenons une image bien plus fine de leur réaction à certaines situations, et un compte rendu bien plus compréhensible de leur comportement général.
"Je dépense, donc je suis"
Dans la bureaucratie, la rémunération vient pour une part de l'ancienneté, et pour l'autre de l'étendue du pouvoir. Chacun a intérêt, pour sa carrière, à augmenter ses prérogatives et améliorer son statut. Personne ne tire avantage à diriger un service que l'on doit réduire, à moins d'y trouver d'autres satisfactions pour compenser la baisse de pouvoir que cela entraîne.
Au contraire, la bureaucratie proposera plus volontiers la création de nouvelles activités pour ses services, qui impliqueront une expansion tant en budget qu'en personnel. Le financement supplémentaire ne lui coûte évidemment rien et, comme elle fournit généralement ses services à un prix inférieur à celui qui ajusterait la demande à l'offre (quand ils ne sont pas "gratuits"), elle multiplie partout les pénuries artificielles, ce qui lui permet d'y voir autant de "besoins non satisfaits". Nous avons vu que le statut même du "service public" fausse systématiquement la perception de ses coûts et que, dans ces conditions, la demande peut en principe aller jusqu'à être illimitée.
Il peut arriver qu'une mesure donnée soit réellement née de l'initiative d'une fraction donnée du public. Un candidat l'aura peut-être proposé en échange de voix aux élections ; le groupe en question pourra avoir attiré l'attention du gouvernement par les clameurs de ses manifestants, ou bien la question aura été poussée par les médias. A un moment donné, elle aura été reprise par les législateurs, lesquels auront à leur tour fait pression sur le gouvernement pour qu'il remédie au problème.
C'est à ce moment-là que le fonctionnaire entre en scène. On lui demandera d'étudier le problème en question, et de proposer des solutions. Il est tout à fait dans l'intérêt d'un bureaucrate d'ajouter de nouveaux programmes à son domaine d'attributions, et même de se battre avec les autres services pour se les voir attribuer à lui. C'est ainsi que se "construisent les empires" au sein du "service public", processus par lequel les fonctionnaires s'efforcent d'accroître leur champ d'activités, la taille des équipes dont ils sont maîtres et le niveau des salaires auxquels ils ont accès5. Les fonctionnaires peuvent être dévoués et objectifs, mais on décrit plus efficacement leur façon d'agir en faisant l'hypothèse qu'ils se conduisent comme des entrepreneurs, offreurs et demandeurs sur le marché politique, qu'ils ont choisi de préférence à celui de la production.
L'Administration comme groupe d'intérêts
L'apport de la théorie des choix publics est donc qu'elle considère toute administration comme un groupe d'intérêts, et invite à prendre en compte ses raisons d'agir propres. Au lieu de l'imaginer, comme le font les théories traditionnelles, dans le rôle d'un arbitre se tenant au-dessus de la mêlée, exclusivement soucieux d'appliquer les règles d'une manière juste et impartiale, elle la traite comme un joueur à part entière, comme un groupe de plus parmi ceux qui négocient leur influence sur le marché politique. Elle reconnaît les intérêts de ses membres en tant que parties prenantes, tout autant que leur rôle d'administrateurs.
Innombrables sont ceux qui croient bénéficier de la redistribution publique
La tendance constante à l'expansion du secteur public dans les sociétés démocratiques ne s'explique pas seulement par l'intérêt qu'il trouve à étendre ses prérogatives. Il ne suffit pas non plus de dire que les bénéficiaires perçoivent davantage ses avantages que ses coûts. Le "secteur public", c'est bien davantage que l'administration des transferts directs, profitant aussi bien à ses gestionnaires qu'à ses bénéficiaires supposés. En réalité, tous ceux qui dépendent de l'argent "public" pour leurs moyens d'existence font ipso facto partie du secteur dit "public".
La liste comprend automatiquement tous les membres des forces armées et de la Police. Elle comprend tous les employés de la santé et de l'enseignement publics. Elle inclut non seulement ceux qui sont employés par des entreprises nationalisées mines, chemins de fer, fabriques d'automobiles mais aussi tous ceux qui travaillent pour des entreprises dont la prospérité dépend des financements de l'Etat.
La liste ne s'arrête pas là. Il faut aussi y ajouter tous ceux qui sont employés à divers niveaux des collectivités publiques, qu'il s'agisse des Départements ou des municipalités. Du balayeur à l'architecte, du gardien de square à l'avocat, tous les professionnels qui travaillent pour l'Etat au sens large font partie, d'une certaine manière, du secteur public. Tous ont intérêt à ce que les dépenses, dans leur domaine propre, s'accroissent ou du moins se maintiennent. Si tous peuvent trouver à redire à la fiscalité qui leur est imposée parce que l'on augmente d'autres budgets qui ne les concernent pas, tous en revanche auront tendance à se battre plus farouchement pour leur propre secteur qu'ils ne lutteront contre les dépenses dans d'autres domaines. Collectivement, ils constituent une force puissante qui pousse à l'expansion régulière des activités du secteur public.
De rusés politiciens avaient déjà compris, des siècles avant que n'apparaisse la théorie des choix publics, qu'il serait possible de constituer des majorités à partir de tels groupes. Pour un élu, il est très avantageux que plus de la moitié de ses électeurs soient matériellement dépendants de l'Etat. Qu'il s'agisse de fonctionnaires, d'employés ou de bénéficiaires des "services publics", s'ils sont assez nombreux pour constituer une majorité, ils auront tendance à élire des politiciens qui s'engagent à distribuer davantage de privilèges politiques.
La théorie explique comment et pourquoi les systèmes politiques contemporains poussent chacun à agir contre son propre intérêt
Sans doute le processus s'entretient-il de lui-même, peut-être même est-il auto-accéléré, alors même qu'il va probablement contre l'intérêt même de la plupart des parties en présence. Comment qualifier autrement un procédé qui provoque, pour la plupart des services, le maintien d'un niveau de consommation trop élevé, pour un produit qui ne peut pas traduire leurs préférences, en plus des charges supplémentaires imposées à ces services par la domination des producteurs, la décapitalisation et les sureffectifs ? Si l'on ajoute le fardeau du contrôle bureaucratique, il devient évident que lorsque les gens votent, ce procédé leur impose de payer davantage de services que nécessaire, et à un prix outrageusement gonflé. Mais là encore, la perte que chacun peut associer à chaque programme est infime, si on la compare aux énormes gains que son propre privilège lui rapporte. Le système d'incitations propre aux échanges de la politique aboutit donc à ce que les gens, individuellement, y agissent d'une manière contraire à l'intérêt de tous, y compris le leur propre.
Les traits caractéristiques du secteur public de l'économie, qui semblent à la fois incompréhensibles et absurdes à ceux des observateurs qui n'ont à leur disposition que le paradigme conventionnel, se laissent prévoir et expliquer dès lors que le modèle des choix publics vient à leur être appliqué. Le fait que, sans le savoir ni l'avoir voulu, les gens agissent à l'encontre de leur propre intérêt s'explique, parce qu'ils donnent à leurs propres privilèges bien plus de valeur qu'à ceux reçus par les autres. Le fait que les gens, par leur comportement collectif, engendrent une situation qu'ils auraient refusée par leur propre choix, s'explique par la manière dont le marché politique détermine la valeur des suffrages et des influences.
Le modèle des choix publics ne se contente pas de rendre plus clair le système actuel. Il nous offre aussi un schéma de fonctionnement détaillé et limpide qui nous explique pourquoi et comment ce système a pu résister à tant de tentatives faites pour le réformer ou pour l'améliorer.
Réponses de la bureaucratie
Des tares depuis longtemps répertoriées
Cela fait déjà longtemps que l'on connaît les caractéristiques du secteur public qui sont contraires au bien commun. Son médiocre rapport qualité-coût, son inefficacité, et même sa carence fréquente en capital, ont fait l'objet de bien des études. Son incapacité à répondre aux exigences et aux besoins des consommateurs, le temps considérable qu'il lui faut pour réagir, en traînant les pieds et à reculons, ont également été observés, à l'occasion d'anecdotes ou d'études statistiques plus sérieuses.
De même, la tendance de la bureaucratie à adopter certains comportements a été copieusement décrite. La "construction des empires" à laquelle on assiste à l'intérieur des services, la lutte entre ces derniers pour accaparer les attributions, et la pression constante vers l'expansion du secteur d'Etat, sont non seulement connus de la science politique, mais encore mis en scène par l'humour populaire. Yes, Minister1, une des séries les plus appréciées de la télévision britannique, a pour thème le comportement et les tics de la fonction publique, étant bien entendu que le public reconnaît sans faute quelles vérités fondamentales se cachent sous le masque de la caricature.
L'approche naïve des défauts du secteur public
Avant l'analyse des choix publics, on pouvait encore penser que les problèmes constatés dans le secteur public et son administration n'étaient que des accidents, et non des traits essentiels du système. Ainsi, ses aspects indésirables passaient pour être des cas singuliers, où l'élément public de l'économie avait erré, et fait des choses qu'on n'avait jamais voulu lui faire faire. Ce n'était pas littéralement faux, mais supposait que ces phénomènes étaient le résultat de choix contingents, réformables, et non des tares inhérentes au système lui-même.
A première vue, et avec une conception relativement simple de la rationalité, on peut imaginer que ces défauts puissent être identifiés, et réformés par les mesures correctrices appropriées. S'il y a trop de personnel dans le secteur public, alors il faut réduire les effectifs. Si le secteur public utilise des équipements vétustes et délabrés, on peut toujours le rééquiper avec du matériel neuf. S'il est inefficace, avec un médiocre rapport coût-qualité, il suffit, pour l'améliorer, de lui appliquer de nouvelles méthodes de travail et de gestion. S'il ne répond pas de façon satisfaisante aux besoins et aux exigences des consommateurs, il faut instaurer des procédures qui porteront ces défauts à la connaissance des responsables, afin qu'ils puissent y apporter les changements appropriés.
On suppose donc constamment, ce qui est à première vue raisonnable, que s'il y a des défauts, rien n'empêche d'y remédier. Le même raisonnement s'applique à l'appareil d'Etat lui-même. Là encore, il y fort longtemps que l'on identifie les dysfonctionnements, et présume tout naturellement qu'il sera suffisant de mettre en œuvre des mesures correctrices. L'effectif des fonctionnaires a tendance à dépasser celui d'un service privé équivalent ? Alors il faut réduire leur nombre. Il y a évidemment trop de paperasseries et de doubles emplois ? Dans ce cas, instituons de nouveaux types d'organisation afin de les éliminer. Si les bureaucrates ont tendance à se constituer des empires, alors on doit créer un cadre juridique qui le leur interdira. Si un service ne cesse de pousser pour étendre son domaine d'attributions, rien n'empêche, pense-t-on, d'adopter des mesures pour le contrecarrer.
Les remèdes proposés ne marchent pas, parce que l'interprétation est fausse
Ces réactions partent d'un postulat fort louable, à savoir que ce qui va mal peut être amélioré. Pourtant, s'il n'y avait pas une erreur sur le fond, on pourrait s'attendre à ce que le secteur public se porte beaucoup mieux qu'il ne se porte aujourd'hui. Après tout, il y a belle lurette que l'on a identifié les défaillances du secteur public et de la bureaucratie. Maintes études ont été publiées à leur sujet, les décrivant même comme des caractéristiques bien connues du système. Elles prétendaient d'ailleurs souvent y porter remède. On peut alors se demander pourquoi, depuis si longtemps qu'on les étudie et classifie, avec tant de propositions de réforme, ces pratiques malfaisantes continuent imperturbablement de caractériser l'économie du secteur public.
La réponse est tout simplement que ces remèdes ne peuvent pas marcher. Uniquement conçus pour corriger des défauts particuliers, ils y échouent dès lors qu'on les applique. La cause de leur déconfiture est en soi instructive, et c'est pourquoi il vaut vraiment la peine de décrire ce qui leur advient à ce moment-là.
Il ne faut pas être grand clerc pour reconnaître qu'une bonne partie du secteur public emploie trop de personnel. Il suffit de comparer avec des équivalents du secteur privé. Or, que constate-t-on ? Que les tentatives faites pour limiter les effectifs se heurtent à une résistance bien plus forte dans le secteur public. Sur l'entreprise privée plane toujours la menace ultime de la fermeture ; il y a des limites que les travailleurs ne peuvent franchir, sous peine de tout perdre. Les entreprises privées devant rester compétitives, il leur faut de temps à autre procéder à des "dégraissages". Le personnel s'y oppose, mais son intérêt, comme celui de la direction, conduit les uns et les autres à la table des négociations, où les licenciements inévitables finissent par être acceptés.
Rien de tout cela n'est vrai du secteur public. On n'y est en temps normal exposé à aucune fermeture ou faillite, ni à aucune obligation d'être compétitif. Accepter des réductions d'emplois n'est l'intérêt ni des travailleurs ni de la hiérarchie. Les employés apprécient la sécurité de l'emploi du secteur public, d'autant qu'elle est assortie de bénéfices annexes bien plus avantageux que le privé ne peut se permettre d'en offrir. Il n'ont aucune raison d'accepter quelque licenciement que ce soit. Les dirigeants syndicaux cherchent toujours à maintenir le niveau des effectifs, c'est-à-dire des adhérents en puissance, à son maximum. Les directeurs, qui sont rémunérés à proportion des pouvoirs qu'ils exercent, savent ce qu'ils perdraient à devoir diriger un service réduit.
La capacité qu'ont les employés, les chefs syndicalistes et la hiérarchie de bloquer tout effort fait pour supprimer des postes, est à proprement parler phénoménale. Le service, ils en sont les maîtres ; et pour accéder aux médias, il leur suffit de se plaindre et de manifester. Le public sera directement touché et, à travers lui, le législateur s'ils font, ou menacent de faire grève. Dans les faits, le degré de résistance qu'ils opposent aux réductions d'effectifs est si fort que l'on doit en faire énormément pour en obtenir très peu. Ceux qui font la loi apprennent vite à leurs dépens que le coût, en termes politiques, l'emporte le plus souvent sur l'avantage des économies qu'ils pourraient faire.
Leurs efforts pour traiter la dégradation du capital s'en sortent un peu mieux, mais jamais assez pour éliminer le problème. C'est à la structure même des forces en présence que l'on doit cette facilité perverse qu'il y a à piller les budgets d'équipement pour satisfaire les revendications de dépenses courantes, pour fournir les services et payer les salaires immédiatement exigés. Après le temps nécessaire pour que la dégradation devienne bien visible, ce seront de nouvelles alarmes et d'autres appels à "l'investissement". Tout cela, naturellement, vient de ce qu'on prétend aborder le problème comme s'il tombait du ciel, sans considérer qu'il a une cause précise.
On ne peut pas traiter le problème si on refuse d'envisager ses causes
Chercher à résoudre le problème en apportant de nouveaux crédits au compte de capital, c'est vouloir guérir une maladie en ne traitant que ses symptômes. Car, bien entendu, les rallonges budgétaires sont soumises exactement aux mêmes tensions que les allocations qui les ont précédées. A la suite des pressions exercées, la dotation en capital supplémentaire se transmue en augmentations de la masse salariale. A son tour, elle finira par ne plus être qu'une source de financement comme les autres, de l'huile dans les rouages de la négociation. A un moment critique de celle-ci, pour dégager l'argent nécessaire à la sortie de l'impasse, les syndicats proposeront d'eux-mêmes que l'on retarde d'un ou deux ans l'achat du nouvel équipement, ou la construction du nouveau centre.
Pour pallier l'absence totale de pouvoir des usagers, on crée des institutions censées défendre leurs intérêts. Dans l'économie privée, les consommateurs n'ont besoin que d'acheter ou de refuser de le faire pour faire connaître leurs souhaits et leurs exigences. Exigences auxquelles les entreprises se plient, faute de quoi les clients iront trouver un autre fournisseur qui, lui, saura les écouter. Nul besoin, par conséquent, d'institutions particulières pour avertir les industriels de ce que les clients pensent de leurs services. Ils le leur font savoir directement par leurs actes d'achat, après quoi l'entreprise en cause pourra toujours mener ses propres études de marché si elle veut savoir quoi produire.
Dans le secteur public, les consommateurs étant privés du Droit de s'exprimer par leurs achats ou leurs refus d'acheter, on invente des "chiens de garde du consommateur", soi-disant pour "représenter leurs intérêts". Quand la Poste décide d'augmenter le tarif "urgent", l'organisme officiel censé représenter les usagers prétend lui communiquer "ce que le public pense de cette idée". Le véritable public n'a guère l'occasion d'exprimer son opinion, puisqu'on interdit de lui proposer d'autres services de courrier2. Entre-temps, la Poste détermine bien entendu toute seule ce qu'elle décide de penser, ou de ne pas penser, du Comité d'usagers. Ce dernier type d'organisme n'a en fait aucun pouvoir sur les événements. Leurs membres ne sont pas élus par le public, dont ils ne sont certainement pas représentatifs. S'ils l'étaient, ce serait probablement pire, car cela donnerait l'illusion d'un "contrôle démocratique" là où il n'en existe, et ne peut en exister aucun.
Plus grave encore, ces organisations sont elles aussi "capturées" par les entreprises et les services qu'elles sont censées surveiller. Elles suivent l'organisation depuis des années, négocient avec elle, et en viennent à mieux comprendre ses difficultés et ses problèmes que celles des usagers eux-mêmes. Très subtilement donc, leur rôle dérive d'une "représentation" du public auprès des organismes, à celui de porte-parole des organismes en question auprès de ce même public. Après avoir dîné depuis des années à la même table que l'intrus contre lequel il était censé aboyer, le "chien de garde" est devenu un gentil toutou. Or, dans une économie normale, le public réel n'a pas à se soucier, et se moque complètement, des problèmes et autres difficultés d'organisation qu'une entreprise, disons par exemple Honda, pourrait bien rencontrer. Ce n'est pas son affaire. Si Honda ne fournit pas la bonne qualité au prix qu'il faut, eh bien il achètera Hyundai3 à la place. Honda le sait, et ne fait pas tout un cinéma pour l'accepter.
On traite les problèmes de l'Administration de la même façon que ceux des entreprises et des "services publics". Les tentatives faites pour les résoudre souffrent des mêmes insuffisances, c'est à dire qu'on les aborde comme s'il s'agissait de phénomènes contingents : des caractéristiques regrettables qui, pour une raison X, seraient apparues dans le système, et dont il suffirait de le débarrasser. Les règles et les procédures courantes de la bureaucratie ont donné naissance aux pratiques immortalisées par C. Northcote Parkinson dans ses célèbre lois. Mais ces ouvrages ne seraient pas devenus des classiques de l'humour, sans la trame de vérité profonde qui les sous-tend. Il en est de même de la série télévisée que nous évoquions plus haut. En fait, les spectateurs étrangers se demandent souvent si ces œuvres doivent être considérées comme une manifestation d'humour ou comme un genre de documentaire social.
La ronde éternelle des rapports et des propositions
Connaître les pratiques est donc une chose ; les rectifier en est une autre. Même si les procédures des "services publics" sont plus complexes et plus contraignantes que celles de l'activité privée, on pourrait envisager, en guise de solution, d'étudier les procédures du secteur privé et de les appliquer à l'administration de l'Etat. Dans nombre d'économies avancées, la manière dont fonctionnent les administrations du secteur public a fait l'objet d'étude sur étude, et dans le moindre détail. On a appelé en renfort tous les spécialistes du privé possibles, pour évaluer l'efficacité de sa gestion. On a vu des experts en en gestion du temps, voire en ergonomie, se pencher sur ses règles et ses procédures. L'"analyse critique des processus", la "gestion par objectifs", la "rationalisation des choix budgétaires", l'"évaluation (!) des politiques publiques", autant de tartes à la crème qu'on a pu mentionner suivant les caprices de la mode, sans que cesse pour autant la sempiternelle succession des études et des rapports.
Les recommandations sont faites, les déclarations d'intention exprimées. Et les pratiques, de continuer imperturbablement, avec peut-être, dans quelques domaines, une amélioration symbolique et temporaire. On peut bien regrouper certains services, en supprimer d'autres, et transférer leurs fonctions ailleurs. Au bout du compte, on retrouve toujours une bureaucratie où des fiefs se constituent, où les ingérences prolifèrent, et dont le domaine d'intervention s'étend sans arrêt. La réforme de l'Administration ressemble à la marée : elle avance, puis se retire, mais les rochers sont toujours là chaque fois que la marée redescend.
On n'appelle pas un médecin pour soigner une vache
L'erreur fondamentale de cette manière d'observer les défaillances pour essayer de les corriger est qu'elle suppose le secteur public capable de se conduire de la même façon que le privé. C'est en comparant son fonctionnement avec celui du secteur privé que l'on met à jour la plupart de ses pratiques défectueuses. En d'autres termes, l'activité privée est le modèle de référence pour juger les résultats du secteur public. Quand le second est à la traîne de la première, on s'efforce de transplanter les méthodes de l'une dans les procédures de l'autre : on demande à l'organisme public de se comporter plus ou moins comme son homologue concurrentiel.
Or, il n'y a aucune raison de penser qu'il en soit capable. L'animal est complètement différent. L'erreur est là : croire qu'on peut lui faire faire la même chose qu'au privé, sans aucune des forces qui conduisent ce privé-là à se conduire comme il le fait. Le secteur public est soumis à des contraintes, internes et externes, qui n'ont rien à voir avec celles qui s'exercent dans le privé. Et c'est pour cela qu'il se comporte différemment.
La théorie des choix publics étudie spécifiquement les conséquences du statut public sur les décisions personnelles
Une bonne partie des études et des analyses de l'école des choix publics consiste en un examen très précis de ces influences, ainsi que des conséquences qui en découlent. Il se peut fort bien que les raisons qui font agir les gens, aussi bien dans le public que dans le privé, soient les projets et aspirations ordinaires que la plupart des hommes ont en commun. Le désir d'obtenir l'avantage le plus grand et d'améliorer leur situation, leurs conditions de travail, et les récompenses qu'ils peuvent espérer, tout cela peut bien être commun aux deux secteurs ; mais les règles et les conditions qui dominent l'un et l'autre sont tellement opposées, que les mêmes motifs d'action produiront immanquablement des résultats différents.
C'est l'incapacité à tenir compte des différences de structure qui est la source de l'erreur. Si le secteur public est autre, c'est parce que les pressions qui s'y exercent en font quelque chose de différent. Personne ne l'a conçu pour cela ; ce sont les intérêts des groupes et les forces résultantes qui en sont la cause. Le secteur privé non plus n'est pas la création rationnelle d'un seul. Il a évidemment été construit par l'homme, mais pas suivant un plan préparé à l'avance. Ce qu'il fait, et la manière dont il le fait, résulte de l'interaction d'une foule d'actions et de projets personnels. Les caractéristiques qui en ont fait ce qu'il est sont des règles telles que la liberté du choix, la libre concurrence, la possibilité de suivre ses préférences en affectant ses ressources, et de limiter sa consommation à ce que l'on a vraiment décidé de payer.
La logique politique est celle de l'avantage unilatéral
Dans le secteur public, nombre de ces caractéristiques sont soit totalement exclues, soit très amorties dans leurs effets. Le résultat n'y a donc rien à voir avec celui qui émerge de l'économie privée. Les caractéristiques mentionnées ci-dessus jouent un rôle important dans l'organisation du secteur privé, en ce qu'elles limitent la capacité de chaque individu à soumettre le système à son intérêt exclusif. C'est parce que la possibilité de choisir existe que les prix sont contraints. C'est parce que les consommateurs peuvent refuser d'acheter, que l'organisation ne peut pas être exclusivement au service des producteurs. C'est parce que la dépense se limite exactement à la somme dont les gens ont volontairement accepté de se séparer, que la qualité offerte doit être suffisante pour les attirer.
A l'inverse, c'est un aspect caractéristique du secteur dit "public", que les facteurs qui imposent contraintes et limites à la poursuite des avantages unilatéraux n'y sont en rien aussi efficaces. On pouvait donc tout à fait s'attendre à ce que le secteur public se caractérise par la recherche, et l'obtention effective, d'avantages personnels au profit de ses membres, aux dépens de la population dans son ensemble. Si le secteur économique d'Etat se comporte comme il le fait, cela ne tient donc pas à des traits accidentels qui s'y seraient glissés par hasard au cours de sa croissance, mais à des caractéristiques structurelles qui lui sont inhérentes.
L'irresponsabilité qui découle du statut public dispense de produire efficacement
La raison pour laquelle les tentatives faites pour transplanter dans le secteur public certaines procédures du secteur privé ne "prennent" pas, est que les contraintes qui maintiennent ces pratiques en sont tout simplement absentes. Si la production publique des biens et des services contrôle moins bien ses coûts que l'industrie privée, c'est parce que le secteur public n'a pas besoin de le faire. Les pressions qui poussent à ce type d'efficacité sont faibles comparées à celles qui conduisent à la prolifération des postes et aux pratiques restrictives de la production.
Le souci de consacrer davantage de ressources à l'investissement, aux équipements modernes et aux nouvelles installations est bien timide, comparé aux pressions qui aspirent les fonds disponibles vers le côté des dépenses courantes. La vague opinion qu'il faudrait, Dieu sait comment, tenir compte des intérêts des consommateurs et les défendre, ne dépasse guère le stade du vœu pieux dans un système où la plupart des règles conduisent à satisfaire, aux dépens de ces derniers, les désirs et les besoins des producteurs.
Un schéma similaire se répète dans l'administration de l'Etat. A la base se trouve le fait que si une administration publique ne se conforme pas aux normes de la gestion privée et n'atteint pas son niveau d'efficacité, c'est tout simplement parce que son statut même est fait pour l'en dispenser. Elle n'affronte aucune des pénalités qui, dans le secteur privé, sanctionnent l'inefficacité ; en leur lieu et place, elle est confrontée à des règles et des contraintes qui conduisent inéluctablement à multiplier les personnels et à développer les fonctions.
Il est possible que les cadres supérieurs du privé rivalisent de la même manière pour acquérir de l'influence et essayer d'étendre le domaine de leur propre pouvoir. La différence est que, dans le privé, le juge ultime se trouve dans le marché. Si, de toutes ces manœuvres, il résulte que les ventes s'améliorent, ou que la société devient plus compétitive, les choix faits seront maintenus. Sinon, les contraintes à l'œuvre y mettront rapidement fin. Dans l'Administration, il n'existe aucune norme, aucune contrainte d'efficacité approchant ces disciplines propres au marché libre. Le fait est qu'elle n'a jamais été instituée pour cela. Les règles administratives, par nature, sont destinées à contraindre le public et non à le servir.
Les défauts du secteur public sont inhérents à sa nature
Quels enseignements peut-on en tirer ? Les multiples tentatives faites pour améliorer le secteur public et pour éliminer ses aspects nuisibles ont en commun, nous l'avons vu, de s'inspirer des résultats du secteur privé, et de supposer que les défauts du secteur public sont de purs accidents susceptibles d'être éliminés. Or, d'après l'analyse des choix publics, les tentatives inspirées par de telles conceptions n'ont guère de chances de réussir. Tout d'abord, en l'absence des règles qui, dans le privé, entretiennent les caractéristiques recherchées, il n'y a aucune raison pour que celles-ci subsistent dans le secteur public. Deuxièmement, en examinant les groupes de pression et en tirant les conséquences de leurs raisons d'agir, on est forcé de conclure que les principaux inconvénients du secteur public ne sont pas accidentels mais nécessaires, c'est-à-dire qu'ils sont une conséquence presque inévitable de la manière dont le secteur public a été institué, et de son mode de fonctionnement.
Pour reprendre les termes de la théorie des choix publics, les problèmes de la production publique sont un produit secondaire du marché politique. Sur le marché de la production, l'échange des biens et des services conduit à un certain type de résultat. Sur le marché politique, l'influence et les suffrages échangés en assurent un autre, substantiellement différent. On ne trouve pas, sur le marché politique, les traits fondamentaux du marché productif qui mettent automatiquement ce dernier au service des autres. En leur lieu et place, on trouve des caractéristiques garantissant qu'il servira bien les intérêts des groupes de pression minoritaires qui s'y échangent leurs influences aux dépens de tous les autres.
Les règles du secteur public qui permettent aux groupes d'intérêt minoritaires d'y rechercher leur avantage aux dépens du bien commun sont donc celles-là mêmes qui leur permettent également de résister avec succès aux tentatives faites pour enter sur son fonctionnement les méthodes et les procédures du secteur privé. Pour dire les choses plus crûment, il est contraire à leur intérêt de se soumettre à ces procédures et à ces disciplines, et ils ont le pouvoir de faire échec à toute tentative pour les appliquer.
Un scénario type
Là encore, on peut faire appel à un exemple fictif pour repérer les procédés et les pratiques utilisés contre toute tentative faite pour amener le secteur public à plus de ressemblance avec les entreprises privées. Qu'ils soient appliqués consciemment par les acteurs, ou résultent de leur désir inconscient de défendre des positions privilégiées, cela importe peu. Ce qui compte est qu'ils sont bel et bien employés, et qu'ils fonctionnent.
L'exemple pourrait être ce serpent de mer que l'on voit apparaître de temps à autre dans la gestion administrative, une étude qui révèlerait la possibilité de faire des économies pour une production équivalente ou même meilleure, tout en économisant les ressources utilisées. La décision politique de faire des économies substantielles est le signal déclencheur pour une bataille entre les différentes Directions, chacune s'efforçant d'obtenir que les restrictions budgétaires tombent chez le voisin. Même si certaines d'entre elles sont finalement désignées pour supporter l'essentiel des économies de coûts, il se produit encore, entre leurs différents services, une bagarre où chacun s'efforce de faire avaler la pilule à l'autre.
Comme toutes les Directions se battent pour conserver ou augmenter leur dotation budgétaire, les pressions qu'elles exercent sur le gouvernement militent collectivement contre la réalisation d'économies importantes. Les hauts fonctionnaires de chaque service produisent des projections pour dépeindre les conséquences atroces qui résulteraient de coupes budgétaires vraiment significatives. Au sein du gouvernement les Ministres, armés des rapports préparés par leurs subordonnés, se battent à leur tour pour défendre les budgets de leurs ministères. Et comme les autres membres du gouvernement en savent encore moins que le Ministre sur le fonctionnement des autres ministères que le leur, ils sont plutôt mal placés pour juger des chiffres qu'on leur présente.
Ce qui n'était au départ qu'une simple tentative pour réduire les gaspillages s'est désormais transformé en une dispute entre les Ministres au niveau du Conseil, la surenchère résultante ne pouvant déboucher que sur des compromis réduisant l'ampleur de l'économie projetée à l'origine. Le processus se répète à plus petite échelle à l'intérieur de chaque ministère, les Directions consacrant leurs efforts à justifier leur propre attribution budgétaire plutôt qu'à rechercher des occasions de faire des économies. Les bureaucrates savent parfaitement qu'il n'ont aucun intérêt à ce que leur Direction dépense moins d'argent, pas plus qu'à une réduction du budget global de leur ministère.
Deux réformes, également vouées à l'échec
Deux méthodes ont été essayées pour désamorcer le mécanisme qui pousse chaque Direction et chaque ministère à défendre l'intégralité de son budget intact pour faire tomber les réductions sur les autres. L'une est d'imposer des réductions uniformément proportionnelles, en exigeant par exemple que chacun réduise ses dépenses de, disons, cinq pour cent. L'autre consiste à attribuer une enveloppe budgétaire globale à chacune des Directions, en la laissant libre de déterminer comment appliquer ces limites.
Ces deux méthodes tiennent compte du fait que les fonctionnaires vont se démener pour défendre leur propre budget, et pour essayer de trouver un moyen de vider le projet de son contenu. Si tout le monde était forcé d'accepter une réduction uniforme, cela pourrait éliminer la tendance de chaque service à se repasser le bébé, et à vouloir faire porter ailleurs le poids de la restriction. En théorie, cela devrait empêcher les luttes au niveau ministériel, les Ministres n'ayant plus besoin de jouer les porte-voix pour leurs fonctionnaires, ni de s'opposer les uns aux autres pour maintenir leur propre budget.
De même, la limitation globale de l'enveloppe pour chaque Direction est censée confiner les luttes à l'intérieur du ministère. La théorie est que chaque section devra lutter contre les autres pour conserver son budget, le plafond budgétaire global imposé étant le total définitif. Au lieu que l'on voie chaque service défendre sa dotation personnelle, envoyant ensuite le Ministre se battre pour obtenir la somme résultante, la règle de l'enveloppe globale est censée permettre de prédéterminer ce total, en maintenant la bagarre à l'intérieur.
On sous-estime les déterminismes pervers du système
Derrière ces deux stratégies se cache le présupposé selon lequel si les dépenses inutiles et le gaspillage peuvent être identifiés, alors on pourra les éliminer, ou du moins les réduire, pour peu qu'il soit possible d'imposer une certaine discipline. L'idée est que ces deux méthodes imposent un plafond global qui ne peut pas être dépassé, et avec lequel les services devront bien apprendre à vivre. Ainsi, ils seront obligés de réduire les doubles emplois et la paperasse, pour continuer à travailler à moindres frais.
La réalité est bien différente. Dans la réalité, les fonctionnaires découvrent qu' il est plus facile de repousser les limites que de faire des économies sous leur contrainte. Les Ministres réagissent à la proposition de réductions globales en disant que l'idée est bonne en général, mais qu'elle ne saurait être appliquée aux services essentiels de leur propre ministère. On ne peut pas faire de réductions dans ces domaines essentiels que sont par exemple la santé, l'éducation, les retraites ou la sécurité sociale. Ce serait une fausse économie, n'est-ce pas, que d'essayer de réduire le budget de l'environnement. La sécurité serait compromise par des réductions dans le budget de la Défense. Accompagnée d'une grande publicité, la défense des "services publics essentiels" de chaque ministère transforme ce qui devait être une réduction également subie par tout le monde en une image plus familière, celle d'un conflit de priorités au sein du gouvernement. Voilà un scénario qui met le fonctionnaire plus à son aise, sachant parfaitement en tirer les ficelles.
Dans la variante de l'enveloppe budgétaire globale, la réponse est double. Pour commencer, les fonctionnaires s'opposent directement à la limite imposée pour chaque Direction. Ils produisent des chiffres budgétaires "prouvant" l'impossibilité absolue de les respecter. Ensuite, après qu'un certain plafond a été accepté par le gouvernement, les fonctionnaires entreprennent de faire pression pour casser ces limites. A mesure que l'on examine les mérites éminents de chacune des dépenses individuelles, s'accumulent les raisons pour lesquelles la dotation initiale finira par être dépassée.
Imaginons, par exemple, que les plafonds servent à fixer une augmentation salariale inférieure au chiffre que peut accepter un type de personnel indispensable, disons les enseignants. Le conflit qui en résulte fait pression sur le gouvernement, et quand un compromis se présente qui semble acceptable aux fonctionnaires, le Ministre demande au Conseil la permission de dépasser la limite imposée à son ministère pour financer cet accroissement exceptionnel. C'est ainsi qu'il est possible de bousculer les plafonds établis, à l'occasion d'une série d'incidents distincts, dont chacun permet d'invoquer la force majeure. Imaginer que le financement supplémentaire pourrait être obtenu par des économies faites ailleurs au sein du même ministère n'est pas une voie praticable ; cela ne ferait que transférer la pression ailleurs. La seule manière de l'éviter est de piller le budget d'équipement pour financer les accroissements de dépenses courantes.
Même si l'idée qui inspire les réductions budgétaires uniformes et la fixation d'enveloppes globales est de réduire le gaspillage administratif, les pressions sont telles qu'il est plus facile de renoncer au projet que de faire les économies en question. Des exceptions sont faites à la politique globale en faveur de certains ministères ; on attribue un financement supplémentaire à ceux dont les situations les forcent à dépasser les limites budgétaires. L'expérience des bureaucrates est telle qu'ils n'ont aucune peine à fomenter des situations qui obligeront à le faire.
Les économies proposées porteront en priorité sur les services les plus appréciés, dans les domaines où le gouvernement est le plus vulnérable
Si on prenait pour argent comptant la vision théorique des fonctionnaires telle que la présente le modèle politique conventionnel, on pourrait peut-être s'attendre à ce qu'ils cherchent à faire des économies afin de fournir un meilleur rapport qualité/coût. Ainsi, on attendrait d'eux qu'ils économisent l'argent public en adoptant des règles et des méthodes de travail plus rationnelles. On pourrait fermer certains bureaux, leur personnel servant à compenser les défaillances dans d'autres. On pourrait traquer les activités inutiles ou improductives, et les éliminer. Le résultat serait que le ministère continuerait à rendre ses services, mais à moindres frais, ce qui serait une amélioration de l'efficacité.
Lorsqu'on adopte l'analyse des choix publics, et considère les participants comme des marchands d'influence sur le marché politique qui cherchent, comme des entrepreneurs, à s'assurer le plus grand profit personnel, on s'attend à un schéma tout à fait différent, et qui correspond beaucoup mieux à la réalité de l'expérience. Quand les coupes sont imposées, les plans présentés envisagent de les obtenir, non par des économies sur la paperasse, mais par des réductions sur les services. Au lieu que ce soient les bureaux qui subissent l'essentiel des économies, ce sont les bénéficiaires des services qui les subissent de plein fouet. Pire, les réductions proposées vont souvent porter sur des domaines sensibles et perçus comme importants, et dont les cibles sont un type de public particulièrement revendicatif, ayant la langue bien pendue et la visibilité médiatique à l'avenant.
Quand on annonce les réductions envisagées, c'est immédiatement un concert de protestations chez ceux dont les services sont menacés. Les médias suivent naturellement, et le cabinet du Ministre commence à prendre la mesure de ses ennuis. A son tour, le gouvernement ressent une impopularité croissante, et ses membres commencent à se soucier des retombées politiques. Les parlementaires reçoivent des missives hostiles, les sondages montrent quel attachement le public voue aux services menacés. L'économie espérée paraît alors dérisoire par rapport au risque politique. Le gouvernement calcule qu'il ne peut se permettre de perdre qu'un certain niveau de soutien si l'entreprise doit être rentable, et bientôt son enthousiasme pour les économies diminue. Ce qui était bien sûr l'effet escompté par les fonctionnaires qui proposaient les réductions en question.
L'analyse des choix publics suggère donc fortement que c'est dans les services rendus que les réductions seront proposées, et non dans le traitement administratif, et qu'on proposera d'abord de couper dans les services soutenus par les groupes de pression les plus puissants4. Faire des économies dans les services de santé conduira donc sans doute à fermer des hôpitaux, ou à cesser de faire certaines opérations qui sauvent des vies. Couper dans le budget de l'enseignement pourrait porter sur le nombre des professeurs de mathématiques. Des réductions dans le budget de la Marine diminueront le nombre des bateaux.
Le scénario est le même partout, et peut se résumer ainsi : les réductions proposées porteront en priorité sur les services les plus appréciés, et dans les domaines où le gouvernement est le plus vulnérable. C'est pour cela que les campagnes d'économies ont rarement duré très longtemps, et qu'elles n'ont presque jamais engendré des réductions importantes de charges administratives. En termes d'effort et d'impopularité, leur coût se révèle en général plus important que leurs résultats ne le justifient aux yeux de ceux qui s'efforcent de les mener à bien. Une montagne de luttes féroces et épuisantes contre des professionnels de l'obstruction accouche laborieusement d'une souris de dépenses en moins.
Un des épisodes de Yes, Minister, la série télévisée qui décrit les mœurs des fonctionnaires, montrait à quoi avaient mené les réductions budgétaires dans le service de santé [5]. Un hôpital flambant neuf avait un service administratif de cinq cent personnes, parfaitement affairées, mais n'avait pas un seul patient. Aucune réduction de postes administratifs n'avait été possible, alors même que le service était toujours entièrement fermé. Quiconque suppose que les fonctionnaires ne se conduisent ainsi qu'à la télévision peut toujours prendre connaissance de ce qu'a fait le service américain des Douanes et de l'Immigration. A l'annonce d'une réduction de 10% dans son budget, le directeur réagit par la mise à pied de tous les fonctionnaires chargés d'empêcher l'importation de drogue dans les aéroports. On n'avait proposé aucune économie d'administration, mais sacrifié le service le plus apprécié, et celui où le gouvernement était le plus vulnérable. Cela fut quand même considéré comme un abus, et le fonctionnaire en question perdit son poste. Il ne fut pas renvoyé, rassurez-vous : seulement muté à un autre service.
NOTES
Notes du chapitre cinq : la théorie des choix publics
- 1 Geoffrey Brennan, James Tollison, Richard Wagner, etc. Cf. Henri Lepage, Demain le Capitalisme, Paris, Hachette, 1977. James Buchanan est aussi le nom d'un Président des Etats-Unis, le prédécesseur d'Abraham Lincoln.
- 2 Cf. Murray Rothbard, Economistes et charlatans, Ed. des Belles lettres, 1991, et Henri Lepage, Demain le libéralisme, Paris, Hachette, 1982 et La nouvelle économie industrielle, 1989.
- Friedrich Hayek est l'économiste autrichien le plus connu, mais le plus grand était probablement Ludwig von Mises, dont le grand oeuvre, L'action humaine, a été publiée en 1985 aux Presses Universitaires de France.
- 3 Aussi connues sous le nom de "nouvelle école classique".
- 4 Bismarck, dans une conversation avec Meyer von Waldeck (1867) : "Die Politik ist die Lehre vom Möglichen".
- 5 Ce prix élevé n'a pas besoin d'être payé en argent. Il peut l'être en temps ou en efforts, en sacrifices, bref en termes de ce qu'on échange pour obtenir le soutien d'autres groupes. A l'équilibre, ce qu'on paie pour obtenir les avantages de la redistribution politique équivalent au butin reçu : la redistribution politique détruit donc en tendance l'équivalent de ce dont elle s'empare au cours des efforts faits pour obtenir sesbutins.
- 6 En ajoutant les hausses de prix résultant du protectionnisme agricole aux subventions payées par l'impôt, le Wall Street Journal comptait en 1991 que la politique agricole de la CEE (maintenant l'"UE") coûtait 780 milliards de francs par an aux non-agriculteurs européens, soit en moyenne 3 900 F par personne, y compris les enfants en bas âge. Cela fait en moyenne 71 000 F par agriculteur, mais ce résultat ne traduit pas la réalité du privilège ; car la plus grande partie de cette distribution se traduit par une hausse de prix, qui rapporte d'autant plus au producteur qu'il gagne davantage. En outre, l'essentiel de la subvention finit toujours par se retrouver dans les prix des terres. Seuls les propriétaires fonciers déjà en place en profitent donc réellement. C'est donc en fait la minorité d'une minorité de la minorité des agriculteurs, la minorité la plus riche et la plus ancienne, qui empoche l'essentiel du pactole. Ce qui traduit aussi bien l'axiome premier de l'action politique, à savoir qu'elle est faite par et pour les puissants, aux dépens des plus faibles.
- 7 Essentiellement, garder pour eux seuls un emplacement agréable, rejetant ceux qui n'avaient pas encore les moyens de s'y installer au moment où eux-mêmes l'ont fait. Cette restriction peut aussi se traduire par une hausse substantielle de la valeur immobilière pour les propriétaires déjà en place. Comme on le voit, la "défense de l'environnement" est souvent un sport de nantis, qui s'exerce aux dépens de plus pauvres. Nous verrons que c'est aussi le cas de la redistribution "sociale".
- 8 Ce serait d'ailleurs absurde de le supposer. La théorie des choix publics n'est rien d'autre qu'une application aux décisions dites "publiques" de la théorie générale des choix (ou encore, comme Ludwig von Mises se plaisait à le dire, de l' action humaine), théorie qui est universelle parce qu'en elle-même, elle ne préjuge en rien des objectifs visés par l'action. Certes, les théoriciens des choix publics ont accumulé une documentation abondante sur le détail des raisons qui font agir les hommes dans l'arène politique, et ils ont pu constater que les intérêts matériels au sens étroit y ont une large place ; mais cela n'a rien à voir avec un quelconque homo oeconomicus, lequel ne sert plus guère aujourd'hui qu'aux adversaires ignorants de la théorie économique, comme prétexte pour refuser de l'étudier.
- 9 Aux Etats-Unis, il existe une tradition politique séculaire : on "bétonne sa circonscription". Ce qui veut dire qu'on s'arrange pour mériter la reconnaissance d'un nombre suffisant de groupes pour l'emporter à l'avenir dans une élection où tous voteront en même temps. Aux Etats-Unis, il est banal que les majorités soient envisagées comme une coalition de minorités, rassemblées pour les besoins de la cause. Les regroupements qui caractérisent les principaux partis politiques américains peuvent changer, le principe reste de donner satisfaction à un nombre de groupes d'intérêts assez grand pour en faire une véritable majorité.
- Les partis américains lancent des appels soigneusement calculés à des groupes tels "les Juifs", "les Noirs", "les Hispaniques", "les femmes", "les anciens du Viêt-Nam", "les ouvriers syndiqués" et "les agriculteurs". C'est avec ces groupes que se forgent les coalitions ; ces dernières se modifient à mesure que les groupes migrent dans le spectre politique, vers le parti qui leur semble leur offrir le plus d'avantages. Le calcul peut être mauvais : l'une des erreurs classiques de la politique américaine, commise par le Sénateur Mondale lors de l'élection de 1984, fut de rechercher le soutien des dirigeants des minorités au lieu de s'assurer celui de leurs membres. En effet, les chefs ont tendance à se distinguer par leur militantisme et, comme nous le verrons, ne reflètent pas forcément l'opinion générale des groupes qu'ils sont censés représenter.
- Comme toujours après coup, il devient facile de voir comment les tenants de la théorie des choix publics, ayant observé le rôle joué par les minorités aux Etats-Unis, en ont tiré l'idée de considérer leur comportement en politique comme typique d'une activité économique, où les privilèges s'échngent contre les suffrages à la place de l'argent, des marchandises ou des services.
Notes du chapitre six : le secteur public
- 1 Le prix Nobel George Stigler, de l'Université de Chicago, est l'un des pionniers de cette "théorie de la capture", notamment en ce qui concerne la réglementation. Il a montré que celle-ci, ayant principalement pour effet d'attribuer des privilèges de monopole à certaines entreprises en place, passe régulièrement sous le contrôle de ceux qu'elle est censée discipliner.
- 2 Les privilèges de monopole que la réglementation y a institués pour la mettre sous la coupe de la classe politique font des entreprises d'information un quasi-"service public".
- 3 Cf. Mancur Olson, La logique de l'action collective, Paris, PUF, 1978. traduction française de The Logic of Collective Action : Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, 1976.
- 4 La France est un cas particulier, dans la mesure où les ingénieurs, pour des raisons institutionnelles, y forment des lobbies très puissants. Dans ce cas, on peut observer que la technique est un peu plus à jour (comparer le métro de Paris avec celui de Londres ou New York), mais le matériel est là pour faire plaisir aux ingénieurs et non pour obéir au consommateur. Par ailleurs, l'entretien et le renouvellement laissent toujours à désirer.
- 5 On a vu que ce processus n'est pas très différent de la rivalité qui règne entre les cadres supérieurs d'une entreprise privée, qui cherchent à accroître leur influence et à améliorer leur statut au sein de l'entreprise ; tout le monde souhaite faire passer davantage de personnes sous sa coupe. Alors, si l'on trouve normal que, dans le secteur privé, les cadres débordent le cadre de leurs attributions en proposant que leur propre service soit chargé d'attaquer de nouveaux marchés, on ne devrait pas être surpris que les bureaucrates imitent ce comportement.
Notes du chapitre sept : réponses de la bureaucratie
- 1 Yes, Minister! (Bien, Monsieur le Ministre) décrit les démêlés de James Hacker, Ministre des Affaires Administratives, avec ses hauts fonctionnaires, dont le comportement intrigant, intéressé, irresponsable et presque ouvertement méprisant illustre la réalité du contrôle du "peuple souverain" sur "ses" administrations publiques. Cf. Jonathan Lynn & Anthony Jay, The Complete Yes, Minister, The Diaries of a Cabinet Minister by the Right Hon. James Hacker M.P., New York, Perennial Library, Harper & Row, 1988.
- 2 Il n'est même pas certain que le public en question ait seulement pu se faire une idée de ce que le service pourrait être s'il était fourni par d'autres. C'est une des tares essentielles du monopole d'Etat qu'il fausse la démocratie en interdisant par son existence même de faire connaître au public les solutions de remplacement que les entrepreneurs pourraient lui offrir.
- 3 Hyundai, marque coréenne (se prononce : "Hyonndê" en coréen et veut dire "modernité",), était alors interdite en France. Heureux Britanniques, qui pouvaient déjà acheter l'une et l'autre, sans demander la permission à M. Peugeot ou à Mme Renault [F.G.].
- 4 Les groupes puissants étant, on l'a vu, ceux qui perçoivent bien leur avantage, lui donnent beaucoup de valeur, sont connus des médias, et possèdent des porte-paroles efficaces et la capacité de causer des ennuis au gouvernement.
- L'avantage peut être indirect, c'est-à-dire que le groupe de pression peut ne pas être constitué des bénéficiaires supposés, mais de ceux qui gagnent leur vie à les représenter, et qui sont donc des profiteurs importants du programme mis en cause.
- 5 Cf. Lynn & Jay, op. cit., pp. 171-200, "The Compassionate Society".