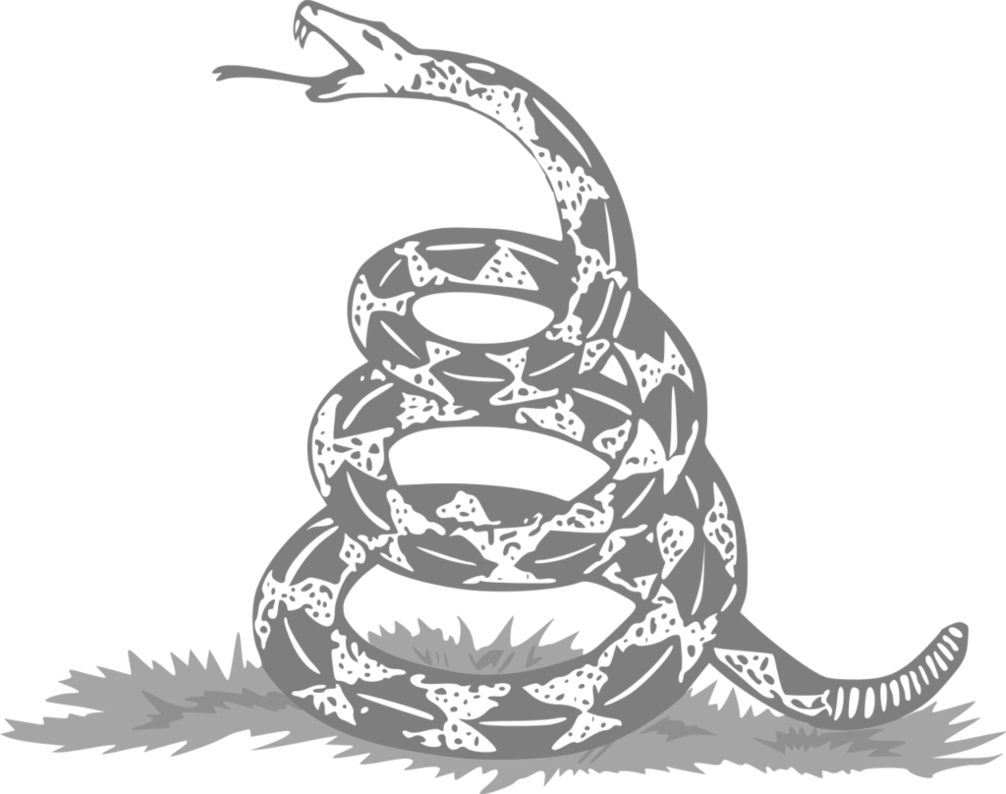Le Risque moral et la régulation des systèmes financiers
Par François Guillaumat, Institut Euro-92 et Georges Lane, Université Paris-IX Dauphine, 2002-2003
Ce texte vise à mettre en forme certaines réflexions sur l'incertitude. Notre expérience nous a convaincus que la praxéologie, réflexion conceptuelle systématique sur l'action humaine, permet d'y résoudre certains problèmes que l'approche scientiste, mathématique et pseudo-expérimentaliste, avait soulevés.
On parle traditionnellement de "risque moral" à propos du marché de l'assurance pour désigner un risque d'entreprise que les assureurs sont censés encourir parce que certains assurés, pour employer un terme cher aux juristes, adopteraient des conduites "pathologiques".
La théorie de l'assurance en déduit que ce "risque moral" compromettrait l'activité des assureurs, voire l'existence même du marché de l'assurance. Certains ont diagnostiqué un problème de stabilité qui lui serait associé, et qui mérite d'être élucidé.
La question se pose alors de savoir si le phénomène est général, et si l'on doit envisager qu'il existe un "risque moral" dans n'importe quelle forme de partage des risques, sur n'importe quel marché incertain. Dans ce cas, ou bien le marché aurait de la peine à émerger alors, ou alors une fois apparu, il serait instable. Dans la mesure où on interpréterait ces phénomènes comme des "échecs du marché", on pourrait y voir une bonne raison pour que les hommes de l'état se chargent de trouver l'origine de ce risque moral, de savoir qui y est exposé, ou qui y échappe, pour mieux le faire disparaître.
Les lignes qui suivent se proposent de montrer que le risque moral ne pose pas de problème propre insurmontable dans un régime de liberté des contrats, qui justifierait une intervention des hommes de l'état. En revanche, elles expliquent qu'il engage ces derniers, désireux malgré tout de "stabiliser" le marché, dans un véritable "parcours du combattant" ou dans une "partie de mistigri" avec ses participants (offreurs et demandeurs), et que son effet principal est, contrairement à leur propos affiché, de créer le risque moral. et de l'aggraver
- 1 De la stabilisation possible et désirable d'un marché libre
- 2 Les moyens de la stabilisation
- 3 Risque moral et instabilité dans le cadre de la liberté des contrats
- 4 Objections résiduelles ; sur le marché libre il est inutile de lutter contre le risque moral.
De la stabilisation possible et desirable d'un marché libre
L'idée de "stabiliser" un système financier, voire la notion d'"instabilité” elle-même, impliquent bien souvent, dans l'esprit de ceux qui s'en servent, plus de présupposés qu'ils n'en exposent formellement. Peut-être pourrait-on éviter des erreurs et des malentendus si on essayait de voir ce que signifient précisément ces notions, plutôt que de s'attacher directement à la fabrication de stabilisateurs supposés.
Avant de prétendre "stabiliser" le système financier, il faut en effet établir d'abord :
Ce qu'on entend par "instabilité"
En matière d'instabilité", on cite généralement la variation des taux de change, celle des taux d'intérêt, et celle des prix en monnaie. Le concept décrit en fait les changements des valeurs observées dans le passé, dont on pense qu'ils ont de fortes chances de se perpétuer à l'avenir. Les financiers parlent de "volatilité", terme emprunté à la physique, qu'ils associent à des grandeurs statistiques, telles que les écarts-types, calculées sur certaines périodes.
Ce qu'est le risque et distinguer en particulier le risque associé à l'instabilité.
Au travers de la notion usuelle de "risque", on juge habituellement la variabilité des valeurs envisagées ; celle-ci implique que les intérêts de quelqu'un soient en jeu : il y a donc un jugement de valeur implicite. Le risque qu'on associe à l'instabilité tient à l'insuffisance de l'information qu'elle est censée engendrer. La variabilité imprévisible des valeurs a pour conséquence que l'on commet des erreurs, et celles ci sont par définition indésirables. Quand on parle de risque d'instabilité, on considère que la variabilité des valeurs qu'on prévoit dépasse ce qu'on jugeait acceptable, et c'est à ce moment là qu'on parle de "danger" ou de "risque".
Les hommes de l'état prétendent augmenter l'information disponible par leurs instances de planification et réduire les risques d'instabilité par leurs règlements.
Pourquoi l'instabilité n'est pas désirée :
C'est essentiellement l'affaire d'une théorie de l'aversion au risque.
L'"aversion au risque" est un terme qui désigne un type particulier d'attitude face au risque, essentiellement une moindre valeur donnée aux objets de l'action risquée, toutes choses égales par ailleurs ; elle a l'inconvénient d'avoir été utilisée par des économistes mathématiciens qui raisonnent en termes de "fonctions d'utilité" et de "courbes d'indifférence", ce qui réduit la description des "états psychologiques" à des primaires irréductibles par l'analyse. Or si l'on accepte de raisonner dans les termes mêmes qu'utilisent ceux qui agissent, on peut y trouver des raisonnements de nature économique qui permettent d'aller plus avant dans cette analyse.
Il semble d'abord que si on admet une fois pour toutes que des propositions nécessairement vraies sont scientifiques (pace Karl Popper), on peut en faire une bonne axiomatique que ne démentirait pas l'expérience du réel. Von Mises l'a fait de la préférence temporelle dans Human Action, mais il l'a aussi fait de l'utilité marginale décroissante de toute action donnée. Or, comme le rappelle de Jasay dans L'État, l'utilité marginale décroissante du revenu équivaut à l'aversion pour le risque relative à ce revenu. (1)
Comment peut-on déduire l'aversion pour le risque de l'utilité marginale décroissante? Logiquement, on accorde plus de valeur à ce qu'on risque de perdre qu'à ce qu'on a des chances de gagner. Ainsi, il vient toujours un moment au cours de l'action où on donne une valeur à ce qui permet d'échapper au risque. Comme quelqu'un qui n'a aucune préférence pour le temps ou dont l'utilité marginale pour une action déterminée n'est pas décroissante, quelqu'un qui n'a aucune aversion pour le risque ne vit pas longtemps pour en parler.
L'analyse en termes de coûts d'adaptation
Il y a d'autres explications possibles, qu'on peut juger concurrentes ou présenter comme les différentes lois de la réalité qui font que l'utilité marginale, justement, est décroissante:
On peut expliquer cela par les coûts d'information : si je gagne, je dois me demander que faire de ce gain. Si je perds, je dois aussi m'accommoder de cette perte. Cela expliquerait ces "anomalies" qui gênent tellement ceux qui veulent à toute force définir des "fonctions d'utilité". Il suffit par exemple que je considère l'argent joué au casino comme une dépense, et que j'aie donc parfaitement pris en compte la perte probable, pour que l'"aversion pour le risque" ne soit plus observable.
L'observation d'Allais (la "prime à la certitude") s'expliquerait de la même façon par le fait qu'on répugne à devoir se soucier d'un aléa, et qu'on est prêt à payer pour avoir la paix.
On peut comparer cela aux résultats de la psychologie expérimentale (Brehm 1966, 1981) selon lesquels une perte est plus fortement ressentie qu'un gain. Il l'a étudié d'une façon compatible avec des explications rationnelles (encore que certains automatismes de la pensée aient des apparences de déterminisme), particulièrement en ce qui concerne la recherche et l'utilisation de l'information (Cialdini, 1987) . (2)
Un autre coût capable d'expliquer l'aversion au risque est lié aux investissements. Il faudrait s'adapter à des pertes éventuelles. En effet certains investissements dépendent de conditions régulières d'exploitation et peuvent perdre de la valeur si elles sont perturbées. Il y a donc une perte éventuelle du fait que les investissements sont spécifiques et qu'on ne peut pas les liquider sans les détourner de l'utilisation qui leur donnait le plus de valeur.
Est-ce là une explication concurrente de celle des coûts d'information? Cette dernière dit tout simplement que lorsqu'une éventualité se réalise, dans un sens ou dans l'autre, il faut apprendre comment y faire face et que cela est coûteux. L'anticipation de ces coûts, voire les dispositions prises pour se préparer aux éventualités, affecte les jugements de valeur. La recherche d'information fait aussi partie des investissements spécifiques qui deviennent caducs si le risque se réalise .
En tous cas, pour notre sujet, cela nous permettra de déduire ce qe l'on considère comme un risque (d'où il vient), pour qui, et ce que l'on gagne à "prendre des risques" du fait que ça coûte quelque chose. Il faut que le risque soit identifiable.
Définir la stabilisation
La stabilisation est une intervention, ou un système d'interventions délibérées, qui vise à réduire la variabilité (ou pour reprendre une métaphore à la physique, la "volatilité"). On pense naturellement, dans notre siècle inflationniste, à une intervention violente des hommes de l'état. Mais il peut s'agir d'entrepreneurs privés qui s'organiseraient pour intervenir sur les marchés. C'est notamment le cas des cartels. Une question essentielle est de savoir si la stabilisation privée n'est pas suffisamment rémunérée pour rendre inutile celle des hommes de l'état (à supposer que cette dernière puisse tenir ses promesses).
Prouver que la stabilisation est désirable :
Sur le marché financier, les hommes de l'état ont cessé d'interdire le recours aux instruments de couverture qui permettent de réaliser un placement sans risque. Chacun y a donc le choix des risques qu'il prend, et de la rémunération qu'il recevra en conséquence (cf. toute la théorie financière actuelle). On peut se demander si vouloir la stabilisation, ce n'est pas demander à la fois le beurre et l'argent du beurre (et à qui), en demandant la rémunération du risque sans le subir.
Prouver que la stabilisation est possible.
Comme l'avenir dépend de l'information qui sera créée demain par les agents et de leurs décisions, les unes et les autres dépendant de leur libre-arbitre, il est très difficile à prévoir (cf. Karl Popper 1955). Si l'avenir est très difficile à prévoir, il n'y a que deux moyens d'y faire face:
S'en accommoder, alors qu'on a renoncé à prévoir, en limitant les risques ou en les subissant contre une prime de risque (ce qui en soi limite la prise des risques), ou les réduire en obtenant par des moyens de droit (on pense à la règlementation, mais le contrat le fait bien mieux) que le comportement des autres soit plus prévisible.
2 LES MOYENS DE LA STABILISATION
La stabilisation étant supposée possible et désirable, il faut étudier les moyens de l'obtenir.
La tradition interventionniste prétend que les hommmes de l'état le font, et sont les seuls à pouvoir le faire. Ils le feraient soit par des prescriptions directes, du genre règlementaire, soit par des interventions sur les marchés, avec l'argent qu'ils ont volé aux contribuables.
Ces deux modes de stabilisation méritent un traitement différent.
2.1 La réglementation :
Les entraves artificielles que la règlementation impose nécessairement à la production et aux échanges (parce que l'intervention de l'état est faite d'actes de violence) appauvrissent tout le monde (cf. l'"immense découverte" de Frédéric Bastiat, qui reste l'article séminal sur l'équivalence économique d'une contrainte artificielle avec une contrainte naturelle).
Par ailleurs, on doit reconnaître que si la règlementation rend plus prévisibles certains actes, elle engendre par ailleurs de nouveaux risques : elle est en effet imposée par des gens politiquement puissants (et ça aussi, c'est encore vrai par définition) et il n'y a pas de raison pour que le rapport de forces qui a conduit à l'imposer ne la modifie pas à l'avenir de façon imprévisible. Parmi ces risques, les plus importants pour nous sont de risque moral : tous les efforts que font les hommes de l'état pour stabiliser le marché, s'ils ont un effet, conduiront à prendre plus de risques par ailleurs.
En effet, à moins d'un pouvoir totalitaire la règlementation ne concerne jamais toutes les formes possibles de prise de risque. Si elle peut réduire la prise de risques dans une forme d'activité ou sur un marché particulier, elle ne peut pas empêcher les gens d'augmenter leur risque dans les domaines qu'elle ne contrôle pas. Le résultat global sur la prise de risques personnels est que les hommes de l'état sont absolument impuissants à contrôler le niveau de risque auquel les gens s'exposent personnellement, et qui est, en dernière analyse, le seul risque dont un économiste ait à se soucier . (3)
Il y a une forme d'intervention de l'état qui pourrait paraître justifiée : ce qu'on observe dans les systèmes bancaires, c'est que la règlementation s'est développée comme une contrepartie à une garantie de liquidité ou de solvabilité "donnée" par les hommes de l'état. Par analogie, on rappelle aussi qu'il est naturel qu'un contrat d'assurance prévoie que l'assureur puisse avoir un droit de regard sur les risques pris par ses clients après la signature du contrat.
Cependant, la question reste de savoir si contrat il y a, si la régulation doit être règlementaire ou contractuelle et s'il est bon ou non qu'une garantie soit donnée par les hommes de l'état.
En effet, les règlementations (imposées) contiennent nécessairement moins d'information pertinente que les modes de régulation contractuels : tout d'abord, ce qui distingue les règlementations publiques des règles de Droit acceptées volontairement par contrat, c'est qu'elles violent nécessairement le consentement de quelqu'un (ceci est vrai par définition).
L'information exclusive de celui dont cette violence étatique oblitère le jugement et nie la rationalité, ne sera pas incorporée dans la décision alors qu'elle le serait si l'unanimité était respectée. Par ailleurs, comme les gens qui agissent ne peuvent pas, du fait de la règlementation, tirer personnellement parti de l'information qu'ils pourraient créer (ceci est aussi vrai des hommes de l'état que de leurs victimes) l'information que les uns et les autres auraient pu produire ne sera pas créée, et les processus de création seront détruits.
La réglementation est donc nécessairement plus pauvre en information que le contrat. (4)
Ensuite, les décisions publiques sont, sous peine d'arbitraire complet (arbitraires, elles le sont déjà assez) soumises à des contraintes qui n'ont rien à voir avec les problèmes à traiter, du genre soumission à des organismes "représentatifs" ou garantie statutaire des personnels administratifs, qui garantissent que des incompétents prendront part aux décisions (voir théories de la bureaucratie . (5)
2.2 La "stabilisation" par l'achat et la vente sur les marchés par les hommes de l'état.
Cette "stabilisation" suppose que les hommes de l'état sachent ce qu'il faut faire, et on peut prouver qu'ils ne peuvent pas le savoir, aussi bien localement que globalement.
Localement, les hommes de l'état interviennent comme s'ils étaient capables de savoir mieux que le marché quelle est la valeur "réelle" des actifs échangés. Quand ils nationalisent, par exemple, pour jouer au Monopoly® avec les richesses des autres, ils prétendent implicitement être mieux à même de prévoir que les personnes privées, c'est-à-dire qu'ils seraient de meilleurs spéculateurs que les capitalistes.
Nous pensons désormais pouvoir prouver que la seule instabilité liée à un risque moral est due à celui que crée l'irresponsabilité institutionnelle inhérente à l'intervention publique, et non à des décisions personnelles dans un cadre de liberté des contrats.
L'intervention violente des hommes de l'état sous couvert de "stabilisation" pourrait réduire l'incertitude à certains égards et dans certains domaines. Cependant, elle ne pourra empêcher personne d'atteindre le niveau de risque qu'il recherche et donc de prendre toujours plus de risques. En revanche, elle crée toujours du risque moral et elle est la seule à faire que ce risque moral conduise à l'instabilité :
Sur un marché libre, l'expérience permet progressivement d'empêcher qu'un décideur qui dispose de l'argent des autres leur fasse subir plus de risques, avec moins de contreparties qu'ils ne peuvent l'accepter.
En revanche, l'action publique est nécessairement, et par définition, dans une certaine mesure institutionnellement irresponsable : elle implique en effet par définition la violation du consentement de quelqu'un, et donc la possibilité pour une personne d'en forcer une autre à subir les conséquences de ses décisions. Cela veut dire qu'il est nécessairement possible à un agent public, agissant ès qualités, de forcer autrui à partager les risques de quelqu'un d'autre sans son consentement, et donc sans contrepartie suffisante. C'est le seul problème de risque moral véritable, puisque dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque le Droit est respecté, la solidarité est disciplinée et limitée par le consentement.
L'intervention des hommes de l'état est donc la condition nécessaire et suffisante de l'existence du problème. Il reste à en trouver l'illustration dans l'histoire économique et la solution dans la théorie monétaire.
Ce problème est bien réel et a conduit à des désordres spectaculaires. La théorie autrichienne des crises documente minutieusement les interventions des hommes de l'état qui ont provoqué les crises financières du passé. (cf Mises, Hayek, Rothbard, Anderson...) Quoique ce ne soit pas le matériau qui manque, on peut toujours en chercher — et en trouver — d'autres. Quant à ce qui se passerait si les hommes de l'état cessaient d'intervenir, on le sait aussi et pas seulement en principe : après tout la banque libre a existé, et a donné un exemple spectaculaire d'une stabilité et d'une prospérité inconnues ailleurs (ça ne nous surprendra pas).
Le problème se trouvera cependant résolu à son tour lorsque l'inventivité des hommes et l'amortissement des investissements faits avant que l'intervention ne devienne une certitude (les investissements qui ne peuvent lui échapper) auront permis d'éviter les risques engendrés par la violence des hommes de l'état. Donc si les hommes de l'état n'étaient pas eux-mêmes actifs et inventifs dans leurs prédations, si on pouvait toujours prévoir parfaitement ce qu'ils vont faire, même par la force, on pourrait prévoir, à terme, la disparition du problème qu'elle cause : c'est une loi générale de l'interventionnisme que les effets de la violence d'Etat tendent à disparaître au cours du temps (6). Cependant, les hommes de l'état ne sont pas en reste et voudront bien entendu réagir en aggravant leurs interventions pour maintenir leurs effets.
Ainsi, chacun essaie de s'affranchir des contraintes que l'inventivité d'autrui crée pour son action, et ces tentatives incessantes pour "se repasser le mistigri", s'interprète comme une instabilité naturelle. Elle ne l'est en fait que dans la mesure où il est "naturel" d'utiliser l'appareil politique pour voler ses semblables.
Il n'y a donc de problème d'instabilité liée au risque moral que du fait de l'intervention de l'état, et les hommes de l'état créent l'instabilité, qu'ils cherchent à stabiliser ou non.
QUEL “RISQUE MORAL” ET “QUELLE INSTABILITE” DANS UN CADRE DE LIBERTE DES CONTRATS ?
L'idée suivant laquelle le risque moral ne pose pas de problème d'instabilité sur un marché libre est une proposition extrêmement contestable. Pour la comprendre, il faut se servir de la théorie des contrats:
Le problème se réduit en effet exclusivement à la question de la responsabilité : le fait de subir les conséquences de ses actes — la solidarité, qui consiste à les faire supporter aux autres, étant par conséquent son contraire.
La solidarité est une bonne relation entre les personnes quand elle ne passe pas par le vol. La mise en commun des risques, le partage de leurs conséquences, est un moyen d'y faire face (les autres moyens étant l'abstention et la prévention).
La solidarité, cependant, ouvre une possibilité au risque moral : lorsqu'on prend des décisions, si on peut faire supporter aux autres une partie des pertes possibles, on peut avoir tendance à prendre davantage de risques.
C'est la théorie de l'assurance qui, sous l'influence des assureurs, a posé les problèmes associés au risque moral, et les a résolus. C'était un cas particulier des problèmes d'agence, où une partie à un contrat peut profiter de l'engagement de l'autre partie pour l'exploiter.
Naturellement, et la théorie en rend compte, ce genre d'exploitation ne peut pas être indéfini ni universel. Alors que les contrats sont en général renouvelables et que les parties potentielles à des contrats d'agence (dont le partage des risques est un cas particulier) acquièrent de l'expérience, les anciens contrats, produits d'une moindre expérience, et qui permettaient l'exploitation d'une partie par une autre, sont naturellement et progressivement éliminés. Dans ce domaine, les hommes de l'état sont intervenus parce qu'ils ne faisaient pas confiance à ce processus de sélection naturelle.
Alors, les contrats d'agence ne seront pas signés, à moins qu'ils ne permettent au mandant de contrôler le mandataire. L'étude empirique des contrats de partage des risques au cours de l'histoire, d'autant plus riche que la liberté des contrats est plus grande, peut donner des idées sur la manière dont les problèmes du risque moral ont été traités dans le passé, et dont on peut les traiter à l'avenir (c'est là, entre autres, qu'il faut faire des recherches et ce, justement, avec l'aide des juristes).
Les gens qui envisagent de partager les risques des autres les acceptent effectivement à quatre conditions :
- i — Que le risque soit acceptable pour eux-mêmes, ce qui devrait les conduire à limiter leur perte éventuelle en tout état de cause ;
- ii — Que "l'assuré" subisse et perçoive pour lui-même un risque issu de son action qui soit suffisant pour l'inciter à la prudence (Arrow, Mossin, Becker, et d'autres ont montré, que l'assurance optimale pour l'"assuré" dans les cas où il considère le risque comme indésirable, et où la perte maximale est limitée au patrimoine physique, est une couverture incomplète au-delà d'une franchise);
- iii — Qu'il paie une prime qui reflète autant que faire se peut le prix de son risque (c'est là qu'on peut discuter de la distinction faite par Frank Knight entre le risque et l'incertitude — dans Risk, Uncertainty and Profit — ou l'affirmation de von Mises — dans Human Action — suivant laquelle le domaine de l'action humaine ne peut pas se traiter de façon probabiliste . (7)
- iv — Dernière condition, l'assureur a le Droit de contrôler et de sanctionner l'action de l'assuré.
Sans ces conditions, les gens sages n'accepteront pas de "couvrir" les risques. Ils refuseront tout simplement de les partager. Naturellement, rien ne prouve qu'ils soient sages. Ils pourront le paraître s'ils disent qu'il y a des risques "excessifs" et d'autres qui ne le sont pas.
L'expérience montre que lors des débuts d'un marché de risques, il peut se produire des troubles spectaculaires : l'appréciation du risque ne repose pas sur assez d'expériences, les contrats n'ont pas prévu toutes les possibilités d'abus, l'arbitrage optimal entre la rivalité et la coopération n'a pas été trouvé (théorie de la firme au sens de la théorie des contrats et aussi cette théorie du cartel optimal, qui reste à faire tant la théorie économique reste marquée par la confusion entre les monopoles institutionnels et les prétendus "monopoles" qui existeraient sur un marché libre), et l'histoire est riche en événements. On peut citer les débuts de la banque libre en Ecosse, les débuts de l'assurance à Londres, les débuts du marché des changes flottants, ceux du Matif à Paris.
Cependant, on n'a pas de raisons de penser que ces erreurs soient inhérentes aux marchés de risques, ni qu'elles continueront à se produire quand le processus de marché aura permis d'accumuler suffisamment d'expérience. On a tout lieu de penser le contraire, surtout si la règlementation n'empêche pas de découvrir les formes de coopération les plus adaptées : Ce serait supposer que les gens sont incapables d'apprendre comment faire face à ces problèmes alors qu'ils en ont le pouvoir et à éviter les désordres humainement évitables : ces suppositions contredisent l'expérience.
L'Histoire nous donne, là encore, une confirmation du fait que tous les gens ne peuvent pas se tromper tout le temps sur les mêmes sujets (il y a les études fébrilement menées par les financiers pour découvrir des biais systématiques dans les évaluations des marchés. Mais il y a aussi la théorie des anticipations rationnelles. Imbus de mesure comme le sont tous ces gens-là, ce ne sont pas les statistiques qui manquent pour le prouver).
La conséquence est que le risque moral dans un régime de liberté des contrats:
- — Ne peut pas créer un système d'irresponsabilité incontrôlée.
- — Ne peut pas conduire indéfiniment à ce qu'une personne expose les autres à des risques dont ils ne seraient pas informés.
- — Ne peut pas provoquer des réactions en chaîne à répétition, parce que chacun a intérêt à contrôler ses risques, et a la possibilité de le faire d'une manière ou d'une autre.
Le phénomène que nous voulons expliquer, l'instabilité (dont les crises financières sont l'illustration la plus spectaculaire), ne peut pas subsister comme conséquence du risque moral dans un système institutionnel où les contrats sont libres et où on les respecte. En effet ce risque moral — conséquence de l'irresponsabilité — y est régulé et limité par le consentement et la bonne foi.
OBJECTIONS RESIDUELLES ; SUR LE MARCHE LIBRE IL EST INUTILE DE LUTTER CONTRE LE “RISQUE MORAL”
Malgré ces développements, l'idée suivant laquelle le risque moral pose un problème d'instabilité restera vive dans l'esprit de certains et activera plusieurs objections. C'est ici l'occasion de les examiner à fond.
L'argument traditionnel de la “carence du marché”
D'après cet argument, l'initiative privée n'utiliserait pas aujourd'hui toutes les possibilités de stabilisation permises par les lois de la nature (on peut donner l'exemple de l'éventail restreint des marchés à terme observables et utilisables).
La première chose à faire serait de prouver que ces possibilités existent, les citer et expliquer pourquoi les entrepreneurs ne pourraient pas les assurer dans le cadre de la liberté des contrats : si on peut les voir alors qu'on ne les utilise pas, il reste à montrer que ce n'est pas dû à une entrave institutionnelle. Si on en croit les résultats de l'étude empirique des marchés financiers, c'est très peu vraisemblable : en effet, le risque a toujours un prix (ce qui découle de notre axiomatique : le risque a une valeur pour la personne, si elle peut l'échanger, il a un prix sur le marché).
Celui qui réussit à réduire un risque qu'il a accepté de prendre au prix courant sur le marché, fait un gain, qui récompense l'exercice suprême de sa faculté conceptuelle, qui produit les richesses.
Par exemple, chaque fois que l'on découvre une possibilité supplémentaire de stabiliser les prix, on y trouve une occasion de profit puisqu'ainsi on subit un risque moindre pour une même rémunération. Et comme une occasion de profit est toujours utilisée une fois qu'on l'a perçue, les entrepreneurs tireront forcément parti de cette possibilité, .
Si quelqu'un connaît un moyen de stabiliser plus avant, qu'il le mette en oeuvre — sous sa propre responsabilité.
L'argument de la "stabilisation, bien public"
Un autre argument, qui méconnaît d'ailleurs son identité avec le premier, c'est celui de la "stabilisation-bien public".
- i — Cet argument implique qu'en l'absence d'intervention de l'état, celui qui rendrait un tel service ne pourrait pas être rémunéré en conséquence. La vraie raison pour laquelle on évoque la nécessité de l'intervention étatique à propos des "biens publics" est en effet que leur producteur ne pourrait pas en faire payer le prix à ses bénéficiaires. Or en ce qui concerne la stabilisation (Pascal Salin a écrit là-dessus en 1986), le seul problème d'exclusion est lié à la responsabilité. Si le spéculateur subit, en bien ou en mal, les conséquences de ses choix, c'est-à-dire par définition s'il est responsable, alors il n'y a pas du tout de problème d'exclusion et par conséquent pas de "bien public". Le service de la stabilisation — à supposer qu'on puisse se spécialiser là-dedans — sera rémunéré (et puni en cas d'échec) autant qu'il est humainement possible.
- C'est dans le cas où celui qui prétend stabiliser n'est pas responsable, qu'apparaît le problème de fond. En témoignent les résultats obtenus par tous ceux qui ne subissent pas la sanction de leurs erreurs de prévision : INSEE, OFCE, BIPE, IPECODE, Direction de la Prévision, Banque de France, Comissariat Général au Plan, le nombre des Français qui font de la prévision dans un cadre d'irresponsabilité totale est impressionnant. Tous ces gens sont payés au mépris du consentement de ceux qui les paient, et ne sont jamais punis pour s'être trompés. On pourrait dire que la difficulté de la chose excuse leurs erreurs mais dans ce cas pourquoi voler l'argent du contribuable pour développer artificiellement une activité si celle-ci est vaine et nuisible?
- Par statut, le "stabilisateur" public n'est pas responsable. le "stabilisateur" privé l'est dans la mesure où d'autres n'ont pas décidé de partager ses risques.
- ii -Il y a aussi les cas où le risque moral empêcherait la conclusion des contrats privés, et où seule une redistribution étatique pourrait faire office d'assurance.====
- Croire cela implique non sulement d'affirmer que la redistribution forcée n'est pas injuste et donc immorale, mais encore prétendre à nouveau que les hommes de l'état sont là pour réduire les coûts d'information et de transaction.
- On peut répéter ce qui a été dit plus haut à ce sujet, et le compléter : l'intervention de l'état empêche toujours au moins une personne de maximiser son utilité (avec ce qui lui appartient, mais si on entre sur le terrain de la philosophie politique, la conclusion est aussi certaine). Pour affirmer que cette intervention améliore l'efficacité productive (augmente l'utilité sociale), il faudrait expliquer comment on est parvenu à mesurer et à comparer les utilités entre les personnes, alors que cela est impossible (Rothbard 1956).
- Si des contrats d'assurance ne peuvent pas être signés, c'est que l'objet est, par nature, non assurable. Il faut bien voir pourquoi il ne l'est pas : parce qu'on ne peut pas décrire le sinistre par des lois statistiques, étant donné que son occurrence dépend trop du libre-arbitre de l'assuré. D'ailleurs, s'il est vrai qu'il existe désormais des contrats d'assurance-vie qui couvrent même le suicide, on est plutôt inquiet que rassuré sur ledit libre-arbitre de l'homme, mais on ne s'en fait pas trop pour l'avenir de la profession.
- Ensuite, il n'y a pas que les assurances explicites ou les contrats financiers qui organisent la solidarité ; il y a toutes les relations interpersonnelles, les "communautés naturelles". Enfin il reste l'autoassurance (l'épargne), la prévention, la diversification des risques)...ou l'abstention.
- Tout ce que les hommes de l'état peuvent faire en imposant une assurance où elle ne résultait pas de la liberté des contrats, c'est, dans le meilleur des cas, substituer un certain mode de partage et de gestion des risques à celui qu'auraient préféré des parties à un contrat, dans le pire des cas à imposer une relation d'assurance là où les problèmes du risque moral empêchaient qu'il y en eût sous cette forme : c'est-à-dire qu'elle fait apparaître un risque moral que le marché aurait éliminé, en subventionnant l'irresponsabilité.
- iii- L'état est là d'une manière générale pour faire respecter les contrats (fonction que l'on confond souvent à tort avec l'idée selon laquelle la stabilisation serait un "bien public").
- C'est en effet le métier des hommes de l'état. Mais supposer qu'ils le font, a fortiori qu'ils ne font que cela, c'est passer à côté d'une part énorme du problème, du moins dans les systèmes financiers contemporains : dans bien des cas, les hommes de l'état y imposent des règles de droit contre la volonté des parties, interdisent la conclusion de certains contrats, refusent de les faire respecter. C'est particulièrement frappant dans l'histoire des banques. L'histoire des systèmes bancaires est une longue litanie de banqueroutes impunies, de monopoles accordés en échange de prêts privilégiés et de garanties offertes — pour être généralement reniées — par les hommes de l'état, au profit de toutes sortes de décisions hasardeuses.
- On voit bien que les hommes de l'état ne cessent de créer de nouvelles obligations à leur égard, refusent de respecter leurs engagements, et que cela entraîne des pertes pour les uns et des profits pour les autres — tant il est vrai que, s'il n'y a pas de profit certain dans l'arène politique, cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait jamais de profit du tout.
- Par ailleurs, il ne suffit pas que les hommes de l'état fassent respecter les contrats et parfois, même, ce n'est pas nécessaire : dans la mesure où il en coûte davantage d'avoir recours à la justice que de se résigner (un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès), les parties aux contrats peuvent, dans certains cas, exploiter leurs partenaires (leur soutirer une quasi-rente" par un choix "opportuniste". Ces rapports sont étudiés par la théorie des contrats).
- Cependant, la théorie de l'agence s'applique à ces questions aussi : et si elle montre que ces problèmes expliquent la forme de certains contrats, ou les raisons pour lesquelles on ne les signera pas, elle ne prédit pas qu'ils devraient entraîner une prise de risques excessive du fait d'un risque moral.
- Il existe toutes sortes de techniques contractuelles qui permettent de se passer de la police des contrats par les hommes de l'état : l'étude des marchés parallèles des marchés de gré à gré, des marchés privés organisés, et aussi des marchés clandestins et autres marchés noirs qui doivent non seulement assurer l'exécution, mais le secret des engagements, est une mine inexploitée d'informations et d'idées à ce sujet.
- Si au contraire on juge qu'ils ne peuvent pas régler ce problème tout seuls, il faut expliquer pourquoi, et essayer de savoir qui pourrait régler le problème (sans supposer a priori que ce serait les hommes de l'état)
L'argument plus récent des coûts d'information et de transaction
D'après cet argument, on peut objecter à la liberté des contrats que l'information n'est pas gratuite, que l'optimum ne peut pas être atteint sans qu'elle le soit et qu'en conséquence les hommes de l'état doivent intervenir pour rapprocher l'état du marché de cette situation idéale en "abaissant le côut de l'information".
Pourtant, ccette définition-là de l'optimum, on n'est pas obligé de la partager . A priori, il est déraisonnable de proposer à la société une norme que les lois de la nature interdisent absolument. C'est pourquoi on ferait bien de distinguer l'"optimum" compatible avec les lois de la nature de celui qui ne l'est pas : le vrai "optimum", c'est le premier et pas le second. Et il existe une définition réaliste de l'optimum, qui a pour elle l'avantage supplémentaire de ne pas pouvoir être contestée : dans cette définition réaliste, l'"optimum" personnel est réalisé à chaque instant par chacun de ceux qui agissent librement sur les choses qu'ils possèdent . (6) Suivant cette définition-là de l'optimum, qui permet de le constater aussi bien que de le réaliser (et cette deuxième condition est nécessaire pour qu'il soit "scientifique"), c'est en jugeant les circonstances de l'action et non en comparant une situation donnée à un idéal irréalisable que l'on peut et doit juger de l'écart éventuel par rapport à un "optimum social".
La production et l'utilisation de l'information n'échappe pas davantage aux lois de l'économie que les autres services. Dans le monde réel, celui où l'information est coûteuse et la transaction incertaine, celui qui réussit à abaisser ces coûts-là fait un gain : produire de l'information et abaisser les coûts de transaction est donc une occasion de profit. "Si quelqu'un connaît un moyen, etc."
L'argument suivant lequel les hommes de l'état pourraient abaisser les coûts
Là encore, c'est une chose que personne ne peut prouver. Les économistes mathématiciens pourront bien s'en défendre, leur refus de définir l'efficacité a priori (sous prétexte que les définitions ne feraient pas partie de la science "positive ") (9) les oblige à multiplier toutes sortes de (pseudo-) "mesures" de l'efficacité productive qui impliquent toutes bel et bien cette fameuse "capacité de comparer et d'additionner les jugements de valeur entre les personnes", dont nous avons vu qu'elle n'existe pas. Or, on ne pourrait comparer les coûts que si cette capacité existait : en effet le coût est la valeur de ce à quoi on renonce au moment de l'action. C'est donc un phénomène de la conscience, au même titre que l'utilité, et pour la même raison . (10) De même qu'on ne peut pas comparer les jugements de valeur entre les personnes, et pour les mêmes raisons, on ne peut pas non plus comparer leurs coûts.
Les "coûts" sur lesquels un économiste peut et doit porter un jugement normatif sont des "utilités" perdues, et ce sont donc des valeurs perçues, des phénomènes de la conscience — et d'une conscience conceptuelle par-dessus le marché. On ne peut donc ni les mesurer, ni les comparer, ni les additionner.
"Les économistes qui s'attribuent quelque capacité innée à définir ce qui est "efficient" indépendamment des actions des participants aux processus du marché lui-même, définition dont on se sert ensuite pour évaluer la performance du marché en tant qu'institution, ces économistes usent d'une arrogance qui n'est tout simplement pas défendable ". (11)
Ce qui est certain en revanche, c'est que les hommes de l'état obligent les uns à payer pour les autres, et cela est clairement un écart par rapport à l'optimum de Pareto (cf. Jasay 1985).
Rien n'empêche un entrepreneur privé de gagner sa vie à réduire les coûts d'information et de transaction : c'est d'ailleurs ce que font les juristes professionnels, et ce pour quoi on les paie. Réduire ainsi les coûts d'information et de transaction ne pose pas de problème d'exclusion qui en ferait une "externalité" ou un "bien public" et c'est donc une malhonnêteté que de mettre en avant un tel prétexte pour pour mettre en oeuvre les rationalisations de l'intervention étatique qu'on y associe ordinairement.
Ce que les hommes de l'état sont seuls à pouvoir faire, et qui leur permet parfois de se donner des airs de réduire les coûts d'organisation, c'est d'empêcher que les prix reflètent l'étendue des charges arbitraires et des entraves artificielles à leurs activités que leurs interventions imposent aux producteurs (les statistiques qui reposent sur ces prix censurés ne sont pas fiables : cf. la prétendue "efficacité" du Système National de Santé britannique).
Autre argument : la spéculation serait déstabilisante, et non pas stabilisante
Cet argument est digne d'intérêt : le problème, c'est qu'on ne gagne de l'argent à spéculer que si l'on achète quand ça va monter, et si l'on vend quand ça va descendre. Cela implique de contribuer à atténuer les fluctuations du marché. Que ce rôle soit rempli par les spéculateurs est garanti par le fait que les mauvais spéculateurs, qui perdent de l'argent, sont privés des moyens de continuer s'ils ne sont pas des hommes de l'état. Sur un marché libre, on ne subsiste comme spéculateur que si on y gagne, et même si on y gagne un revenu au moins égal à celui qu'on gagnerait à faire un autre métier.
L'argument de la "contagion"
On peut aussi mentionner l'argument de la contagion sur les marchés : lorsque tout le monde s'attend à une baisse, les premières ventes massives provoquent une panique, où tout le monde cherche à se débarrasser d'un actif désormais trop risqué, alors que c'est cette ruée qui engendre le risque. On en trouve des exemples dans toutes les entreprises, financières ou non, que l'on peut soupçonner de risquer la cessation de paiements. les paniques bancaires en sont un exemple. Comment condamner une règlementation qui est là pour faire face à une situation que la théorie des jeux désigne comme "stratégique", et qui garantit l'instabilité parce que tout le monde a intérêt à tirer son épingle du jeu avant les autres, alors que c'est cela qui réalisera la perte que l'on craignait ?
C'est un scénario qu'on peut aussi appliquer pour décrire un Krach boursier : tout le monde sait que les titres sont surévalués, certains continuent à acheter, chacun accroît sa protection tout en continuant à profiter de la hausse par des ordres de vente "stop" (vente dès que la baisse a atteint un certain niveau fixé à l'avance et éventuellement exécuté par ordinateur ("program trading").
C'est certainement un des cas où la théorie des jeux peut décrire une situation instable, mais on n'a pas besoin de celle-ci pour la comprendre, et elle n'y trouvera pas forcément de solution. La théorie des contrats décrit aussi bien la chose.
Pour commencer, personne ne peut dire qu'on l'a forcé à prêter à une institution branlante (sauf modification imprévue de la législation des faillites, qui est une violation du Droit si elle s'applique aux contrats existants), ou à conserver des titres risqués à la veille d'un krach. Vouloir la rémunération du risque sans le risque c'est encore une fois demander le beurre et l'argent du beurre.
Ceci n'est évidemment pas une réponse suffisante pour qui se soucie de stabilisation (dans la mesure où on a raison de le faire). Les situations stratégiques décrites par la théorie des jeux peuvent être stabilisées par des changements institutionnels : cela est vrai quand on s'attend à ce que le jeu soit répété et fait en sorte qu'il le soit. Dans ce cas, Axelrod a prouvé que la stratégie la plus payante est celle de la coopération loyale avec représailles et possibilité de pardon des offenses. C'est bien ainsi que dans une communauté financière, entre des gens qui auront à coexister durablement, bien des relations "stratégiques" qui opposeraient des gens dans une relation éphémère n'existent tout simplement pas, parce que la conduite à venir de l'autre peut être une sanction suffisante de la déloyauté.
Notes
- (1) Anthony de Jasay, L'Etat, Paris, les Belles Lettres, 1994, p. 434 n. 43.
- (2) Cf. François Guillaumat :
- 'une approche plus réaliste de la formation des choix permet d'expliquer aussi bien l'"aversion pour le risque" que le 'paradoxe du joueur' — la personne habituellement "averse au risque" qui participe à des jeux d'argent alors que la plupart des jeux d'argent ne sont pas "honnêtes", ce qui impliquerait de sa part une "préférence pour le risque" que ses autres choix, justement, n'affichent pas.
- 'Comme tous les paradoxes, ce paradoxe repose sur un présupposé erroné demeuré inconscient : en l'occurrence, le postulat implicite comme quoi l'attitude face au risque serait une réaction mentale irréductible alors que le contexte du choix s'analyse dans les termes mêmes qui sont ceux du parieur : ceux d'une conscience conceptuelle, productrice et utilisatrice d'information, et qui ne prend elle-même en compte ses propres "goûts" que comme une donnée parmi d'autres : le paradoxe n'existe que pour qui se la représente mécaniquement comme un "goût subjectif" induisant, par une "fonction d'utilité" supposée inhérente et stable, une sorte de réaction automatique en guise de jugement de valeur. Or, c'est à un être pensant et agissant que nous avons affaire, et qui doit tenir compte de ses coûts d'information ainsi que du caractère spécifique de ses investissements, ce qui l'oblige à juger des coûts d'adaptation aux changements de son patrimoine. Et ce sont ces coûts qui expliquent ce qu'on appelle l'"aversion pour le risque" : dans quelque sens que ce changement puisse se produire, on "présentera ce comportement" dès lors qu'au moment du choix l'on tiendra compte du coût à subir pour s'y adapter.
- 'Cependant un coût, comme tout jugement de valeur, n'est pas automatiquement perçu : il suffit aussi de se représenter authentiquement l'appréhension de ce coût pour ce qu'elle est réellement, à savoir un acte de la pensée et non une réaction automatique, pour expliquer le paradoxe : qu'une personne participe à des jeux d'argent, alors que dans d'autres circonstances, ses choix seront ceux de quelqu'un qui évite le risque ; il suffit d'analyser les choix dans les termes mêmes qui sont ceux du parieur, ceux d'une conscience conceptuelle, productrice et utilisatrice d'information (et qui ne prend elle-même en compte ses propres 'goûts' que comme une donnée parmi d'autres). Les questions essentielles à se poser dans ce contexte sont :
- 'à quelle situation finale le parieur est-il prêt à faire face ? Comment conçoit-il ses gains et pertes éventuels, et notamment compte-t-il encore sur la somme qu'il a pariée ?"
- 'Si une personne habituellement "averse au risque" ne compte plus sur la somme pariée, on peut considérer qu'elle n'est pas irrationnelle en pariant, et que ses préférences n'ont pas changé non plus, si on considère qu'elle a tout simplement subi par avance le coût d'adaptation à sa perte ("sunk costs"). Dans ses autres activités, le parieur, n'étant pas pareillement préparé à des pertes (attendues avec incertitude), les prendra toujours en compte dans sa décision d'agir ou de ne pas agir. Le parieur par ailleurs "averse au risque" est donc celui qui a subi par avance le coût d'adaptation à la perte de sa mise, ne compte plus sur la somme pariée, alors qu'il ne se sera pas pareillement préparé à d'autres pertes, attendues avec incertitude. La plupart des parieurs considèrent le jeu comme une dépense, et en échange d'un amusement : on n'a donc aucune raison de mettre en cause l'"hypothèse de rationalité", même si c'était pour la confondre avec la "constance" des préférences. Et quant à la "préférence pour le jeu", c'est une raison d'agir parfaitement authentique, et ce n'est pas une manière de baisser les bras que de l'invoquer comme explication.
- 'Plus généralement, si on considère que l'"aversion pour le risque" s'explique par les coûts d'adaptation au changement, c'est-à-dire au gain comme à la perte éventuels, et notamment par les coûts d'information à subir pour y parer, coûts qui sont présents dans le cas de la perte comme dans celui du gain à moins d'avoir déjà été subis par avance, il suffit qu'une personne rationnelle considère par avance avoir déjà subi sa perte ou empoché son gain pour que ses coûts d'information et d'adaptation appartiennent déjà au passé — et, n'influençant plus les choix, ne soient plus de vrais coûts. Dans ces cas-là, il est rationnel qu'elle participe à une loterie, même si celle-ci n'est pas "honnête", et qu'il manifeste de l'aversion pour le risque dans d'autres cas : le contexte du jeu d'argent est particulièrement propre à cette adaptation, puisque l'ampleur de la perte y est déterminée à l'avance, et sa probabilité subjective aussi peu incertaine que possible."
- Comment l'étude des structures industrielles peut-elle être scientifique ? Thèse de doctorat en sciences économiques, décembre 2001.
- (3) George Stigler en a fourni une illustration avec ses études sur les effets de la règlementation des marchés financiers : l'institution de la SEC (Securities and Exchange Commission) n'a pas du tout rendu les placements plus sûrs en moyenne (et d'ailleurs on peut toujours, individuellement, prendre davantage de risques en empruntant) mais elle a augmenté les frais de transaction. Peut-on ajouter qu'un théoricien moyen de la finance aujourd'hui, (les économistes autrichiens auraient pu le faire il y a vingt ans) est capable d'expliquer pourquoi ces résultats sont nécessaires? (à partir de l'idée qu'il n'y a pas de profit certain : à savoir qu'il n'est pas possible d'obtenir un gain net qui ne soit le produit du hasard ou de l'activité créatrice de l'esprit).
- (4) Hayek a pas mal glosé dans Individualism and Economic Order sur l'information exclusive des agents économiques et l'impossibilité pour les hommes de l'état d'en faire usage s'ils interviennent. Ce qui est moins connu, c'est l'article de Kirzner sur la règlementation de 1983 : The Perils of Regulation : a Market-Process Approach.
- (5) On citera bien sûr Niskanen et il y en a bien d'autres, mais c'est encore une fois von Mises le pionnier de cette discipline avec en plus un ouvrage, La bureaucratie).
- (6) … parce qu'elle ne peut plus en avoir si on l'avait entièrement prévue : les théoriciens des "anticipations rationnelles" n'ont tort que dans la mesure où ils prétendent qu'en moyenne, c'est ce que font toujours les agents économiques.
- (7) Ludwig von Mises était le frère de Richard von Mises, ingénieur aéronautique et grand théoricien de la statistique, qui était d'accord avec lui sur ce point. Seule l'expérience, cependant, permet de distinguer les domaines où l'asurance est possible ou non, et on n'est pas dispensé 'd'explorer la littérature sur cette question. Désormais, il est possible de s'assurer sur la vie même sans visite médicale préalable. bien plus, en cas de suicide, et dès la signature du contrat, l'indemnisation convenue sera versée. Voilà qui limite sérieusement le domaine des risques non assurables.
- (8) C'est l'occasion de citer Rothbard : Vers une reconstruction de la théorie de l'utilité et du bien-être (1956), 1988.
- (9) Cf. entre autres Popper.
- (10) On trouve cela chez Rothbard, mais il n'a rien inventé. C'est Buchanan et Thirlby, dans LSE Essays on Cost, qui l'ont établi.
- (11) James M. Buchanan : "Politics as a Process" Fairfax, Va. Center for the Study of Public Choice Working Paper, George Mason University, 1983.