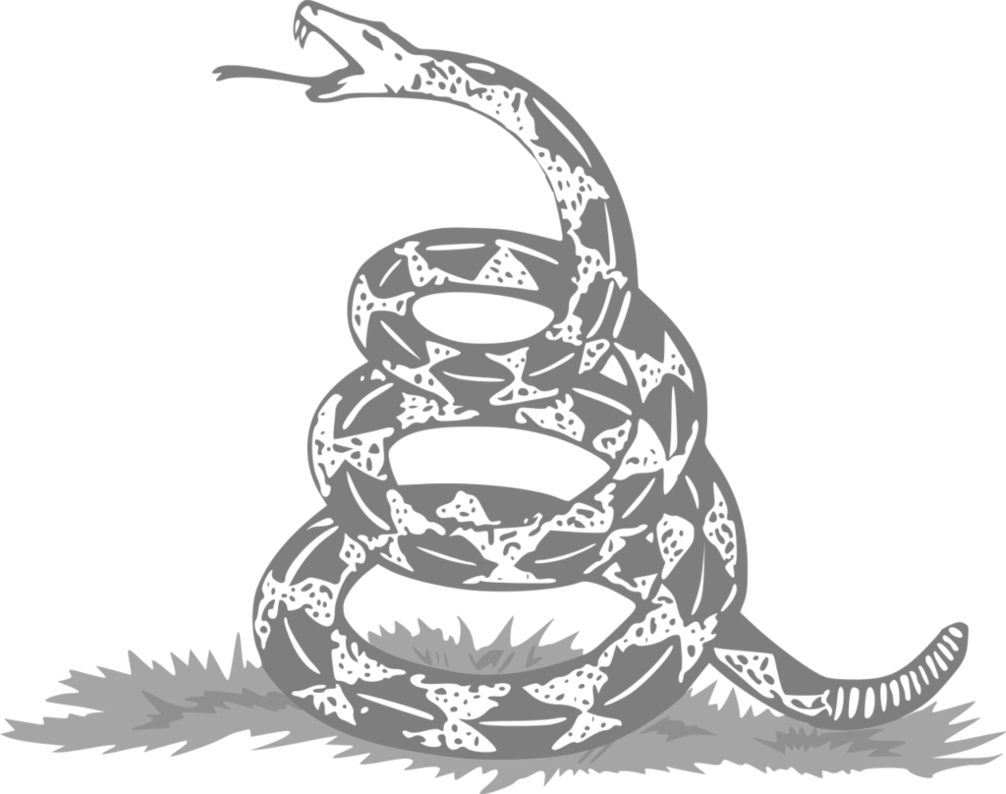Les joies de l’« entreprise publique »
François Lefort, La France et ses entrepreneurs, 1992, Chapitre 9
La production des biens et des services est assurée, en France, certes par un grand nombre d’entreprises de droit commun, mais pour une part au moins équivalente par d’autres organismes « producteurs ». Sans toujours porter le titre d’« entreprise » au sens usuel du terme, ces organismes répondent à des missions et suivent des comportements qui permettent de les assimiler à des entrepreneurs, à tel point que certains portent le titre d’« entreprises publiques », « d’entreprises nationales », de « sociétés nationales » aussi. On en trouve de nombreux désignés par d’autres vocables : l’« établissement public à caractère industriel et commercial », à caractère « social » etc. voire aussi l’Agence de ceci ou de cela, l’Association déclarée d’utilité publique etc.
De tels organismes prolifèrent. Il s’agit bien d’entrepreneurs mais qui ne sont pas de droit commun en ce sens que s’ils échappent quelquefois à certaines des prescriptions et obligations auxquelles ceux-ci sont astreints, en raison de leurs missions de « service public », ils doivent en suivre d’autres particulières à l’abri prétendu de divers privilèges de monopole. Finalement, ces organismes sont des entreprises encore moins libres que les autres et de ce fait ajoutent aux difficultés que l’économie française rencontre pour devenir une économie d’entreprises libres.
Tous les « entrepreneurs publics » ont des caractères économiques communs
Pour un économiste formé à l’analyse des droits de propriété, les règles internes à l’organisation des « services publics » à « caractère industriel et commercial », à finalité « sociale » l’écartent par définition des critères de l’efficacité productive. Il suffit notamment qu’une organisation productive soit un « service public » pour qu’on y observe toujours les mêmes types d’écarts par rapport à l’optimum.
Les influences qui écartent le « service public » des critères stricts de l’efficacité productive proviennent de ce que l’organisation est d’une manière ou d’une autre financée par la force. C’est une loi générale. S’y ajoute que l’organisation peut être utilisée pour prendre aux uns pour donner aux autres - et elle l’est effectivement - mais aussi pour afficher ostensiblement des limites aux possibilités de redistribution arbitraire. Pour ce faire, l’organisation est soumise à des règles a priori, appelées ici « règles bureaucratiques », qui n’ont aucun rapport avec les normes de l’efficacité productive et entravent l’autonomie de décision des agents de l’organisation, des entrepreneurs eux aussi ou tout au moins des personnes qui aspirent à l’être.
Les premières de ces règles instaurent des transferts de richesse qui sont soumis aux déterminismes de la société politique, c’est-à-dire administrés par les gens politiquement puissants conformément à leurs intérêts. Ces transferts encouragent les parties prenantes financiers, producteurs et receveurs du service à agir par les moyens politiques, menacer de faire usage d’un pouvoir de nuire pour obtenir des privilèges et éviter d’en être victimes, plutôt que par un effort productif pour obtenir argent et services et gagner des parts de marché.
Lorsqu’il devient possible d’obtenir l’agent et les biens d’autrui par des moyens politiques, ceux qui peuvent y prétendre sont prêts à faire des efforts pour obtenir leur part à concurrence de sa valeur espérée. Ceux qui risquent d’en être victimes sont prêts à faire des efforts pour éviter la spoliation à concurrence de sa valeur redoutée. C’est ce qui explique que, à côté de quelques réussites personnelles, on voit tant de gens qui ont perdu à la redistribution politique, alors que les « investissements » qu’ils y avaient faits étaient entièrement perdus pour toute production.
Les intérêts sont naturellement antagonistes dans le cadre de cette concurrence, puisqu’on n’a le choix qu’entre prendre aux autres ou se faire soi-même exploiter.
Devenir politiquement puissant devient donc essentiel pour améliorer son sort ou éviter de le voir se dégrader et les gens s’organisent progressivement pour acquérir les compétences nécessaires et pour les mettre en commun. Ils se servent pour cela du principe politique majoritaire. Les fameuses majorités réputées porteuses d’une sanctifiante « volonté générale » en quête du Graal purificateur de l’« intérêt général », ne sont en réalité que des associations habiles de volontés et d’intérêts minoritaires avides de s’emparer par la force du bien d’autrui en raison de leur capacité de pression au sein d’une majorité plus composite. Ceci est parfaitement démontrable et les agissements des thuriféraires des « majorités » le confirment à l’évidence pour qui s’affranchit de sa naïveté ou de sa mauvaise foi.
Lorsqu’il devient plus facile de s’enrichir avec l’argent des autres qu’en produisant et en recherchant de meilleurs services, l’initiative disparaît et la capacité productive s’atrophie. Ceux qui fournissent le service savent de moins en moins l’améliorer. Certains deviennent incapables de gagner leur vie autrement. Ceux qui reçoivent le service n’imaginent plus qu’il puisse être fourni sans elle. La violence institutionnelle du monopole et de l’impôt crée des rentes politiques qui détournent l’organisation du service de ses clients, l’asservissent à des préoccupations étrangères à l’efficacité productive et créent des dépendances liées au privilège pour ses clients comme pour ses agents.
Les limites politiques au pouvoir arbitraire issu de la violence de l’impôt et du monopole sont elles-mêmes des obstacles à une bonne gestion parce qu’elles empêchent de mettre en oeuvre les meilleures manières de rendre le service.
Les entreprises publiques ne sont pas de vraies entreprises
Les entreprises publiques dérogent au droit commun de la libre entreprise et échappent toutes aux disciplines de la concurrence et de la responsabilité personnelle bien qu’elles prétendent se confondre avec les entreprises privées libres et responsables. Dès leur création, les gouvernants se sont en effet substitués au marché pour définir la qualité et bien souvent la quantité des biens et des prestations à assurer et en fixer le prix. Aussi ces entreprises ont-elles encore pour préoccupation première de répondre aux objectifs du Gouvernement, de se plier aux considérations politiques qui les inspirent et comme elles varient indifféremment aux préférences des consommateurs, leur gestion est par construction enfermée dans d’insurmontables contradictions.
Tantôt les Ministres prescrivent à leurs dirigeants et à leurs administrateurs, qu’ils désignent, des règles et des méthodes de bonne gestion. Tantôt, comme tuteurs, les mêmes Ministres leurs désignent des objectifs de production et leur imposent des conditions d’action qui y font obstacle. C’est ainsi que le financement des investissements n’est pas assuré par des capitaux à risque redevables d’intérêts, l’amortissement des dettes ou de déficits antérieurs n’est pas obligatoire ; les tarifs répondent au souci de favoriser les clientèles ou d’opérer des transferts sociaux sans référence à l’équilibre général de l’exploitation ; les déficits ne sont pas sanctionnés par le marché et échappent aux juges ; ils sont finalement de façon globale imposés aux contribuables et aux consommateurs captifs ; les rémunérations échappent aux disciplines du marché du travail et comportent des avantages dérogatoires aux droits des salariés dans les autres entreprises ; des obligations de « service public » généralement imprécises, jamais remises à jour, contestables dans leur principe, dont les effets ne sont pas toujours vérifiés, conduisent à entretenir des activités non rentables et à susciter des besoins de financement toujours insatisfaits.
Des obligations de résultat consignées dans des « contrats de plan », des « lois de programme » des « lois de plan » sont là pour les empêcher de suivre les indications du marché. De surcroît, les Gouvernements leur ont quelquefois imposé des pratiques sans rapport avec leurs missions : emprunter des devises à terme, conclure des contrats d’approvisionnement comportant des surcoûts ou des ventes au rabais, acheter des équipements à des conditions non concurrentielles ; ou bien exercer des pressions imparables sur les sous-traitants français ; ou bien expérimenter des régimes de rémunération de leurs agents sans rapport avec les exigences du service.
Les entreprises publiques ne reçoivent pas leurs indications du marché
Comme elles ne peuvent pas négocier librement leurs transactions ni leurs prix, elles ne peuvent donc pas recevoir du marché les indications utiles à des stratégies concurrentielles et les autres entreprises ne peuvent pas contester par la concurrence la qualité et le prix de leurs services. Elles échappent donc aux disciplines du marché, et ce faisant en faussent le fonctionnement. Ne courant institutionnellement aucun risque, elles n’ont pas le droit moral d’en rechercher la rémunération.
Les entreprises publiques, non seulement ne reçoivent pas leurs indications du marché, mais quand elles le voudraient elles ne le peuvent pas, parce qu’elles échappent trop à la concurrence. Privilèges de monopole, étatisation du financement et de la gestion, définition politique de leurs objectifs, réglementation de leur activité constituent pour elles autant de facteurs qui ne leur permettent pas d’offrir le meilleur service au moindre coût. Elles mettent sur le marché certains biens et services dont le rapport qualité/prix n’est sûrement pas le meilleur possible puisque leur coût pour l’utilisateur est toujours falsifié. Ce rapport qualité/prix est fictif, ce qui autorise soit de payer trop cher un service médiocre soit de mal payer un autre meilleur avec les pénuries et les excédents que cela peut entraîner.
La tarification des services publics au prétendu « coût marginal » ne peut refléter que des conditions de production faussées par l’ingérence politique et ne constitue même pas une norme d’optimalité économique dans la mesure où le prix de revient marginal, choisi comme « mesure, » ne correspond pas au vrai coût d’opportunité à la marge qui est lui une norme valide.
Leurs prix sont sans signification puisqu’elles ne sont pas vraiment soumises à la discipline du profit. Tout au plus, peuvent-elles plaider que leurs résultats sont conformes aux objectifs changeants que chaque gouvernement leur assigne successivement. Pouvant toutes imposer « institutionnellement » aux autres les risques qu’elles prennent, elles sont en situation de concurrence déloyale et prennent de ce fait de mauvaises décisions. Les autres entreprises ne sont pas libres de contester par la concurrence la qualité et le prix de leurs services.
Les entreprises publiques singent la concurrence et la responsabilité financière
Le gouvernants s’aperçoivent quelquefois du manque de concurrence et des inconvénients qui en résultent. Ils s’ingénient alors à travestir le service public en pseudo-entreprises commerciales. Ils développent avec les ressources des contribuables et sur les fonds propres des entreprises publiques des technologies concurrentes des leurs. Ils singent la concurrence. Ainsi, les Gouvernements ont laissé s’affaiblir la poste pour assurer l’essor des télécommunications, testé des énergies concurrentes de celles dont l’Etat est déjà le producteur ; lancé le TGV contre le transport ferroviaire classique et des transporteurs aériens propriétés de l’Etat. Maints autres exemples pourraient être cités. N’est-ce pas l’aveu que la concurrence est nécessaire alors qu’on l’empêche de fonctionner?
Les entreprises publiques ne sont pas des entrepreneurs de droit commun parce qu’elles ne peuvent pas rechercher le meilleur service au moindre coût. Encore une fois, leurs prix sont sans signification puisqu’elles ne peuvent spéculer sur le profit. Comme leurs dirigeants ne sont pas responsables sur leurs fonds propres des fautes et des erreurs qu’ils peuvent commettre, les entreprises publiques ne peuvent que singer la responsabilité financière.
Elles désorganisent le marché
Rien ne nuit plus aux entreprises publiques et finalement aux autres entreprises et à leurs clients, que ces contradictions. En ce sens le secteur public est un facteur permanent de désordre du marché d’autant plus redoutable qu’il agit sur une multitude d’autres entreprises en amont ou en aval. Certes, tout le monde peut prendre de mauvaises décisions, mais les leurs ont de ce fait les plus graves conséquences. Ainsi le retard, désormais rattrapé, pris en matière de commutation électronique, la tentative de passage hâtif au « tout électrique », les déficits croissants dans l’industrie métallurgique et dans l’automobile, l’imprévoyance en matière pétrolière, la dégradation du service postal, le frein opposé à l’essor des télécommunications malgré la prétention du contraire, les erreurs en matière de production d’énergie nucléaire etc. Toutes ont perturbé à un moment quelconque les stratégies et la gestion des entreprises dont les dirigeants ne peuvent faire appel à la violence fiscale pour équilibrer leurs comptes et sont exposées à la sanction du consommateur comme à celle du juge.
Les stratégies des entreprises publiques sont, elles, décidées par des gens que leur statut rend irresponsables vis-à-vis de ceux qui les paient. Leurs dégâts sont payés par le contribuable ou par le client, ils ne peuvent en être que plus spectaculaires. Les erreurs que commettent les grandes entreprises publiques ne sont pas imputables à leurs chefs, mais au fait qu’elles ne reçoivent pas leurs indications du marché.
Les entreprises publiques, quel que soit le degré de leur soumission à l’appareil d’Etat, empêchent les pouvoirs publics comme les consommateurs de déceler les éventuelles carences sur le marché et interdisent sa régulation par les entrepreneurs sous le contrôle objectif du juge et de l’Etat.
L’opinion croit que les entreprises publiques poursuivent l« intérêt général »
Malgré des déficits chroniques - elles ne peuvent même pas faire faillite pour faire place à des concurrents véritablement efficaces - et des conflits sociaux fréquents, malgré des erreurs et des négligences de gestion chaque année dénoncées par la Cour des Comptes, l’opinion ne s’insurge pas encore contre la multiplicité des protections et privilèges dont elles bénéficient, parce qu’elle les méconnaît et lorsqu’elle les perçoit, ne les conteste pas. Elle croit en effet qu’il s’agit de « services publics » chargés de satisfaire « l’intérêt général », et la classe politique entretient cette croyance. Ni la gauche, ni la droite ne leur conteste le caractère de « service public » au service de l’« intérêt général ».
L’idée qu’elles s’acquittent de leurs obligations en respectant l’impératif de gestion industrielle et commerciale la rassure aussi. Pourtant l’idée de gestion industrielle et commerciale d’un service public, c’est une contradiction dans les termes. Un service public est un service public dans la mesure où il n’est pas géré commercialement. Il ne peut y avoir de gestion « commerciale » d’un organisme institutionnellement soustrait aux disciplines de la concurrence et du profit. Hélas, cet état de droit hétérogène repose sur des textes de caractère constitutionnel !
Les privilèges de monopole, les tutelles et autres dérogations au droit commun dont bénéficient les entreprises publiques n’ont pas de contreparties mesurables. Un exemple parmi d’autres : l’Etat demande à la SNCF d’accorder à des catégories d’usagers potentiels des avantages tarifaires qui engendrent des pertes pour la société nationale. En conséquence lesdits usagers privilégiés qui bénéficient de la perte - et c’est plus ou moins le cas de tous si le transport ferroviaire est vendu au-dessous de son prix de revient - exigent des services qu’une société exposée à la concurrence ne rendrait ni au même prix ni aux mêmes conditions. Libre de ses prix et de la qualité de ses services, elle ferait mieux.
Les effets du privilège de monopole
Il est tiré prétexte de l’existence de monopole de fait pour justifier de soustraire l’activité en cause à une entreprise de droit commun pour la confier à un organisme de service public. Or le « monopole de fait » n’existe pas quoi que le Préambule de la Constitution de 1946 puisse laisser supposer. Leurs effets prétendus pervers ne sont même pas évoqués par l’histoire politique. Qui peut constater la prétendue existence d’un monopole de fait et déclarer qu’il est nuisible? Sans doute personne, puisque les nationalisations opérées en 1936, 1945 et 1946, puis en 1982, n’ont pas concerné des monopoles de fait, mais réuni en des monopoles de droit des entreprises généralement faibles ou déjà détentrices de monopoles de droit. Ni le Gouvernement, ni le Parlement n’ont identifié de « monopoles de fait ».
S’il se peut qu’une entreprise dominante ait temporairement découragé les progrès sur un marché déterminé, il n’y a pas lieu de tirer une loi générale de cette circonstance particulière. D’ailleurs, le législateur ne s’est pas davantage appuyé sur cet argument en 1982.
En fait, le terme de monopole n’a de sens que comme « privilège restrictif imposé par la puissance publique » (sens qu’il avait dans la Common Law anglaise). Une entreprise peut pendant quelques temps être la seule à fournir un produit ou un service déterminé parce qu’elle est performante et qu’elle a choisi avant d’autres une meilleure technique. La position dominante ainsi conquise est signe de dynamisme si elle demeure révocable soit par le consommateur soit par une autre entreprise.
Par nature, le privilège de monopole fait obstacle à la liberté d’entreprendre et à celle du consommateur. C’est un fait que protégé de la concurrence d’entreprises plus dynamiques, il peut retarder son adaptation à l’évolution du marché et contraindre les usagers de ses services à des prestations de moindre qualité ou différentes de celles auxquelles ils aspirent.
Les privilèges de monopole font obstacle à toute analyse comparative de l’efficacité de qui en bénéficie. Il n’existe aucune entreprise concurrente qui puisse leur contester, par l’exemple, la qualité et le coût du service rendu. Les contre-exemples sont ou bien étrangers ou bien réduits à des références marginales peu significatives. Quant au consommateur, il ne peut être appelé à les juger puisque le monopole lui retire par définition et par la force la possibilité de faire valoir ses préférences, captif qu’il est de leur offre.
A l’abri des exigences de leurs clients, les entreprises monopolistiques sont protégées de l’obligation d’améliorer et diversifier leurs offres de services. Et quand elles s’efforcent de le faire, elles doivent en demander la permission à des gens qui ne sont pas capables de savoir mieux qu’elles ce qu’elles devraient faire.
Quant au privilège d’accès à l’offre suscitée par le monopole, il est accordé indifféremment au fait de savoir si la demande est solvable ou non aux conditions du marché et si un autre entrepreneur ne ferait pas mieux. Ainsi le monopole suscite et entretient une demande artificielle aux dépens des utilisateurs potentiels d’autres services que pourraient rendre d’autres entrepreneurs aux conditions du marché. On ajoutera que le fait qu’un service ait été Renaud depuis un certain temps dans certaines conditions ne suffit pas à présumer qu’il demeure nécessaire ni qu’il faille organiser des incitations à en user.
L’attribution du privilège de monopole à un producteur ou à un groupe spécifique d’acheteurs a toujours pour effet d’interdire la concurrence à l’entrepreneur choisi sans même qu’il puisse en tirer un véritable profit. Le monopole détruit de lui-même les informations produites par le marché et pour cette simple raison provoque nécessairement sa « défaillance ». Si, sous le prétexte qu’un projet dépasserait avant même d’avoir été soumis à un appel d’offres les capacités du marché financier (depuis longtemps gavé de garanties, protections et privilèges) l’Etat décide d’instituer un monopole disposant des ressources arrachées aux contribuables, il est évident qu’un entrepreneur libre hésitera à rivaliser avec ce monopole, en supposant que la loi le lui permette avec l’intention de le « révoquer ». En revanche la transformation des « monopoles de fait » en vrais monopoles, c’est-à-dire en monopoles légaux, tend précisément à interdire cette révocabilité. Dès lors la position dominante, loin de servir la collectivité, de réduire les coûts, de favoriser le progrès et l’innovation, est un privilège spoliateur générateur de sclérose. L’attribution d’un privilège de monopole est toujours une expropriation de quelqu’un.
Aussi bien l’obligation constitutionnelle de transformer les monopoles de fait en monopoles de droit pour assurer le libre fonctionnement du marché doit-elle être abrogée. Une Constitution ne peut énoncer une contrevérité.
De tels privilèges de monopole sont conférés par l’Etat à une multitude d’entreprises à commencer par la Banque de France, la Sécurité sociale et la grande famille des entreprises publiques. Beaucoup d’autres sont distribués à de nombreux établissements publics, offices, régies, concessions diverses, sociétés d’économie mixte, administrations économiques et sociales et agences de toute sorte. Cet ensemble forme le secteur public national le plus important en Europe. A ces privilèges de monopole créés par l’Etat s’ajoutent désormais ceux décidés par les institutions communautaires et distribués en application des politiques communes.
Que signifie pour les monopoles l’interdiction de faire des bénéfices ?
Pour éviter que la rente politique n’apparaisse comme un revenu financier trop voyant, les bénéfices financiers sont limités ou interdits au « service public ». L’interdiction de monnayer entièrement la rente du monopole empêche ses agents de s’approprier les occasions de profit marchand qui y seraient découvertes. Peu de monde a donc intérêt à faire des économies ou à mieux servir le client parce que celui qui a eu l’idée et le courage de la mettre en oeuvre a moins de chances d’en tirer un profit personnel.
L’organisation bureaucratique est privée des informations sur les prix de revient dans la mesure où la concurrence est interdite ou entravée. Les prix de revient qui pourraient servir de comparaison sont toujours trop élevés, comme cela se passe lorsqu’on fait des comparaisons internationales entre services également « publics ».
Est « bureaucratique » toute organisation dont les membres sont payés indépendamment du service rendu au client. Dans la mesure où une entreprise est privée et concurrentielle (ce qui n’est pas le cas quand le marché de la direction d’entreprises est réglementé), elle est aussi peu bureaucratique que possible. Une agence de l’Etat est bureaucratique par définition, puisqu’elle reçoit tout ou partie de son argent au mépris du consentement de ceux qui la paient. (Cf. Ludwig von Mises : La Bureaucratie ; Mancur Olson : Logique de l’action collective et Grandeur et décadence des nations)
En outre, il est impossible à l’organisation de décentraliser les décisions parce qu’il n’y a pas de profit marchand qui puisse être imputé à aucun de ses sous-ensembles. Cela veut dire non seulement qu’on est dispensé d’être efficace et encore plus d’améliorer la productivité. Cela veut dire aussi qu’on ne sait pas toujours ce qui est efficace et qu’on a peu l’occasion de mettre en oeuvre ce qui le serait davantage.
Le public consentirait majoritairement à la violence du monopole
S’il est évidemment absurde de supposer qu’on peut consentir à subir une violence, que le fait majoritaire légitime en soi les actes violents et que ceux qui acceptent le monopole pour eux-mêmes auraient le droit de forcer les autres à y être soumis, il faut se rendre à l’évidence : le consentement à la violence du monopole existe et l’aspiration de tous au partage égalitaire de sa rente demeure très forte. Est sanctionné tout gouvernement qui n’en distribue pas assez.
Ce que personne ne voit et ce que les hommes de l’Etat se gardent de mettre en évidence, c’est qu’en interdisant la concurrence, le monopole interdit de fournir de meilleurs produits à moindre prix et cache ainsi son inefficience. Il censure et altère nécessairement les opinions des citoyens.
Ne comprenant généralement pas quelles pertes le monopole leur fait subir, ceux-ci ne réclament pas son abolition. Affirmer que les gens « consentent » au monopole, c’est taire volontairement que ceux qui pourraient donner la preuve de ses inconvénients, ainsi que ceux qui n’y « consentent » pas, sont empêchés par la force publique de traduire dans leurs actes les opinions et les connaissances qui sont les leurs. Lorsque les gens ont la liberté du choix, ils l’exercent. Dire que le monopole ne viole pas le consentement des gens implique que des opinions exprimées dans un cadre de censure, d’impuissance et d’irresponsabilité institutionnelles, sont plus dignes de foi que des choix responsables.
A l’abri d’un privilège de monopole, le « service public » obtient les moins bons résultats
Tout service public bénéficie par nature d’un privilège de monopole et c’est la raison pour laquelle toute intervention de l’Etat dans l’activité économique et sociale désorganise le marché et détruit l’efficacité productive. Le « service public » ne peut y atteindre que des résultats désastreux et ceci en raison de sa seule définition institutionnelle.
De nombreux « services publics » étant déficitaires, la rente de monopole apparaît nécessaire pour les payer. C’est méconnaître que dans toute activité commerciale, les prix ne diffèrent que très peu entre des produits semblables, parce que les différences de prix, qui reflètent aussi bien la rente du sol que l’indivisibilité des biens de capital ou le coût du transport, sont maintenues au minimum par la recherche du profit par les entrepreneurs.
Cette recherche acharnée de la réduction des coûts est absente du « service public » dans la mesure de l’irresponsabilité institutionnelle qui y règne par définition. Ainsi, deux agences fournissant des produits quasiment identiques ont des prix de revient plus élevés qu’une agence de droit commun comparable et éventuellement multiples l’un de l’autre. Pour imaginer d’emblée comment réduire ces coûts, il faudrait pouvoir réinventer instantanément tout ce que tous les entrepreneurs ont pu trouver pour le faire au cours du processus de marché. Aussi intelligents que soient les dirigeants du « service public », ils ne le peuvent pas et c’est pourquoi, erreur lourde de conséquences, ils croient que ces différences sont indépendantes des institutions.
Si les « services publics » déficitaires continuent à exister, c’est bien grâce au monopole et aux subventions. Les déficits ne sont pas la cause mais la conséquence des subventions ; ce n’est pas la technique, ce sont les institutions qui engendrent les différences et le niveau élevé des prix de revient. Ce fait échappe généralement aux agents du monopole, précisément parce que celui-ci empêche les entrepreneurs de montrer comment on abaisse les coûts et élimine ces différences.
En conséquence, supprimer le « service public » ne ferait disparaître que très peu de fournitures, la plupart des « services publics » déficitaires seraient bénéficiaires s’ils cessaient d’être des monopoles d’Etat ou des collectivités locales. Les entrepreneurs amenés à leur faire concurrence ont toujours eu des prix de revient plus bas, qui leur permettent de reprendre les productions délaissées par l’Etat. Cette concurrence, les entrepreneurs peuvent la mettre au service de tous alors qu’une autorité publique quelconque, surtout quand elle est locale, ne peut le faire qu’au bénéfice d’une part très restreinte de la population, celle qu’elle administre.
Nécessairement monopolistique, le « service public » gaspille et déqualifie les « ressources » dont dispose tout homme
Un effet majeur du monopole est la faible productivité du personnel. Dans la mesure où l’action collective d’un « service public » peut paralyser une grande partie des échanges sur le territoire national, on peut en déduire qu’à condition de les compromettre avec assez de constance, les agents du service politiquement organisés peuvent s’approprier une grande partie de la rente résiduelle du monopole. Du fait que leur rémunération est soumise aux règles de la fonction publique, cette part de la rente sera essentiellement dissipée dans des sureffectifs et dans un laissez-aller général conduisant à une faible productivité, à une faible charge de travail pour chacun, à un profond découragement voire à une délinquance impunie de la part de certains.
L’action collective se produira là où l’organisation laisse le moins de prise à l’initiative personnelle et où il est le plus facile de s’organiser pour nuire : aucun agent n’y maîtrise individuellement son existence, mais comme partie prenante à un mouvement collectif, il peut détruire impunément pour des dizaines de milliers de francs de production. Les agents du « service public », du fait de la définition uniforme et a priori des tâches, voient toujours leur initiative, par essence limitée, plus ou moins intégralement étouffée, ce qui s’exprime suivant les circonstances par de l’absentéisme, de la mauvaise humeur, du sabotage ou des grèves.
Le statut d’agents de la fonction publique les soumet cependant à des contraintes communes, lesquelles sont étrangères au souci de produire efficacement.
Tout d’abord, il arrive qu’ils ne soient pas embauchés localement mais au niveau national et qu’on les « affecte » n’importe où, ce qui veut dire qu’ils peuvent se retrouver là où ils n’ont pas envie d’aller, sans être pour autant mieux payés. C’est notamment le cas de la Poste, des Télécommunications, de l’Education nationale, et même de l’Electricité de France. Ensuite, le « service public » les contraint à travailler dans l’inefficacité, avec trop peu d’équipement et de faibles progrès dans la productivité. Enfin, ils sont mal payés, et quand on dit « mal payés », cela veut dire aussi, naturellement, qu’ils le sont indépendamment de la valeur marchande du service rendu. C’est naturel quand on travaille pour une administration publique, mais cela n’incite guère à se soucier des clients. Les agents réussissent néanmoins à s’approprier une partie de la rente sous la forme d’un surcroît de dépenses courantes au détriment de l’investissement, et comme les salaires sont bloqués, elle est convertie en baisse de la charge personnelle de travail.
Naturellement le résultat de décennies d’innovation ralentie est que les gens doivent travailler plus qu’ils ne le feraient avec cet équipement dans un cadre privé, mais étant donné ce gaspillage et le manque d’équipement qui agit dans le même sens, ils travaillent aussi peu que possible. D’un autre côté, il faut savoir à quel rythme la rente de monopole disparaît ; si le développement de la concurrence et la stagnation de la productivité se poursuivent, l’organisation même du service risque d’être remise en cause.
Le développement du « service public » au profit exclusif des organisations puissantes, éventuellement privées, n’est pas une conséquence d’un quelconque « esprit commercial ». Cela tient au contraire au « service public ». Ses dirigeants ne peuvent augmenter leur prestige en se faisant payer davantage, ni en faisant plus de bénéfices, puisque cela est interdit par la loi ; en revanche ils peuvent augmenter le volume de leurs activités au détriment de l’efficacité productive en partageant la rente de monopole (ou ce qui en reste) avec leurs clients les plus intéressants. Ils ont donc démarché les entreprises, leur proposant une véritable subvention pour participer à l’augmentation du volume d’affaires qu’elles traitent. Les gros clients bénéficient de contrats privilégiés, de rabais sans commune mesure avec l’abaissement des coûts qu’ils permettent ; ils sont donc des parties prenantes au privilège et des bénéficiaires de la rente.
Face à la concurrence, les agents du monopole ressentent durement les contraintes de leur statut
Le statut légal du service public lui impose des contraintes de gestion qui sont clairement contraires à l’efficacité productive : par exemple, que tous les établissement quels que soit leur taille doivent théoriquement assurer les mêmes prestations dès lors qu’ils sont gérés par du personnel fonctionnaire.
Par ailleurs, les pressions politiques imposent le maintien d’un trop grand nombre de lieux de prestation des services. La raison en est naturellement que le statut de la fonction publique, dans une certaine mesure, dispense et empêche les agents de servir les clients. Il n’est pas possible de gérer le personnel d’une façon conforme à l’efficacité productive puisqu’il est interdit de mieux payer ceux qui travaillent mieux, et d’embaucher ou de licencier librement suivant les nécessités du service.
S’il s’agit d’améliorer le fonctionnement du « service public », seuls les professionnels de la chose sont capables de répondre aux questions techniques ; l’économiste, en revanche, sait fort bien pourquoi et comment les règles internes au « service public » nuisent à l’efficacité productive ; il se demande surtout dans quelle mesure on peut convaincre les parties prenantes de renoncer aux charmes douteux de l’irresponsabilité institutionnelle. Quant à la question de savoir si celle-ci peut être éliminée sans renoncer à la violence du monopole, il faut bien y répondre « non ».
Les contraintes du statut administratif empêchent de bien produire
Le monopole et le statut public de l’administration dispensent tous ses agents de ressentir personnellement la sanction immédiate du retrait qu’un client mécontent fait connaître à une entreprise normale. Il n’est obligé de tenir compte du public que par l’intermédiaire lointain, imprécis, et nécessairement faussé, de l’arène politique. Les diverses influences politiques qui s’exercent sur elle n’ont aucun rapport avec l’efficacité productive et se contredisent mutuellement, ce qui étouffe la voix du public, retarde ou empêche les adaptations et bloque la réforme institutionnelle. C’est un obstacle permanent à tout progrès par l’expérimentation, proscrite par statut.
La plupart des décisions : prix, investissements, statut du personnel, voire nature des services à fournir, sont déterminés dans l’arène politique et échappent aux dirigeants de l’organisation. Ces contraintes l’empêchent de mettre au point les stratégies nécessaires pour s’adapter aux conditions du marché. Le statut administratif protège mais emprisonne les agents du « service public » qui doivent s’en remettre à l’action collective pour améliorer leur sort ; le monopole décuple l’efficacité de cette action alors que le statut public atténue ses conséquences pour les agents qui l’entreprennent. Le résultat est que les revendications sont permanentes et les grèves nombreuses. Toutes ces contraintes, et les dirigeants du service en sont conscients, sont un handicap majeur au développement et à la modernisation du service.
Les services publics sont handicapés dans la concurrence
Ils subissent le désintérêt des agents pour leur entreprise, ce qui affaiblit sa compétitivité bien plus que d’autres facteurs ordinairement invoqués. De plus en plus nombreux sont les agents qui ne portent plus d’intérêt à leur métier. Les décisions se prennent en-dehors d’eux et ils ne peuvent manquer de remarquer les ambiguïtés du « service public » de moins en moins au service des personnes, profitant à des groupes industriels ou commerciaux. La redistribution politique n’est pas forcément dirigée vers les gens qu’ils voudraient. Les cadres hésitent à sanctionner les excès d’absentéisme et les négligences dans l’accomplissement du service.
Comme l’autorité hiérarchique dépend directement du pouvoir politique, elle hésite à abdiquer devant les menaces de grève. Elles sont d’autant plus faciles à organiser qu’il leur suffit dans le cas de la Poste par exemple, de se concentrer sur les centres de tri pour paralyser toute la production. L’organisation syndicale est à l’image de l’organisation politique, elle est intégrée et les revendications sont uniformes en dépit de la diversité des services et des problèmes. Ils ajoutent leurs propres contraintes à celles du « service public » et de la fonction publique et ces contraintes vont à l’encontre de l’efficacité productive : une modification de la nature des tâches ou une variation de la demande ne peut pas conduire à changer les rémunérations, de peur de déclencher des revendications dans les autres parties du service.
Les agents du « service public » peuvent rarement maîtriser leur milieu de travail. Ce sont des gens qui mènent une double vie : le travail est une parenthèse, une simple nécessité pour eux, un simple moyen de vivre. Ils font des voyages qui leur donnent conscience d’être des privilégiés et en même temps ils vivent comme des citoyens de seconde zone. En somme, ils sont les seuls à ne pouvoir faire valoir et respecter leurs droits de propriété sur les produits de leur action, ce qui fournit un mauvais exemple aux chefs d’entreprise et entretient des inégalités juridiques évidentes entre partenaires de la production, fut-elle strictement administrative et bureaucratique.
La crise du service public trouve une de ses origines dans le fait que ses agents ne peuvent négocier avec les dirigeants un quelconque partage des résultats, proposer une quelconque adaptation des tâches et de l’organisation à la différence des agents des autres entreprises qui rendent des services comparables. A défaut de pouvoir mesurer ceux-ci, ils ne peuvent pas davantage négocier les contreparties des contraintes réelles qu’on leur impose et qui du fait qu’on les leur impose, doivent en bonne logique apporter des avantages à des gens qui ne peuvent les payer. Alors il ne leur reste que le recours à la grève, reconnue comme un droit constitutionnel absolu. Comment dans ces conditions assurer la continuité du « service public », obtenir sa « modernisation », ce qui d’ailleurs ne veut rien dire.
Il ne faut pas oublier que le « service public » est par essence sous-capitalisé, même s’il est aussi en sureffectifs par construction. En plus de l’absence d’initiative, de considération et de la dépendance dus au monopole d’Etat, les agents sont de moins en moins conscients de rendre des services à des personnes et de plus en plus que leur apostolat se fait au service de grandes organisations anonymes.
La disparition de la rente de monopole imposerait de moderniser, mais le statut public y fait obstacle
Le monopole public est garant d’inefficacité, mais il ne protège pas contre la concurrence. La question de savoir si la rente de monopole a complètement disparu est difficile à trancher ; ce qui est certain est qu’elle disparaîtra. Loin d’étendre le domaine du privilège exclusif, le « service public » lui-même développe ses propres activités hors monopole. Le développement des filiales de droit privé et de la sous-traitance auprès d’organismes libres témoigne que les dirigeants du « service public » ont pris conscience des con-traintes d’improductivité qu’il impose à la gestion. Ils s’exposent à l’accusation de profiter d’un accès privilégié au domaine et à l’argent publics pour faire une concurrence déloyale, parce qu’ils sont conscients de la position désavantageuse dans laquelle les contraintes internes du monopole les placent vis-à-vis des autres producteurs.
Il est clair que le problème posé consiste, pour l’activité publique en général, à acquérir les moyens de produire correctement que donne le statut concurrentiel. C’est d’ailleurs le seul moyen d’adapter les prestations à l’évolution de la demande des clients.
Les autres solutions telles que « rationaliser, »moderniser« , »réformer« le »service public" n’ont que des effets limités
On parle d’importer les méthodes de gestion modernes du secteur privé, ou des « managers ». Ces propositions sont vaines car un « service public » ne peut pas, par définition, être géré de façon commerciale : la discipline et les informations issues de la concurrence et du profit y sont atténuées et dégradées par le statut public et le monopole. Les désordres qu’on y observe sont d’origine institutionnelle.
L’état terminal d’un « service public » est donc celui-ci : pour un cadre institutionnel donné, les décisions de gestion y sont aussi peu que possible distinctes de la politique. C’est le gouvernement qui décide des mesures concernant le personnel recrutement, statut, salaires et aussi des décisions qui concernent le public : services à rendre et à ne pas rendre, à quel prix, où et par qui. Les clients, réduits au statut d’« usagers », n’ont qu’une influence très vague sur la prise des décisions : non seulement la concurrence est interdite dans certains cas, mais il n’y a pas de profit marchand appropriable par quelqu’un, et seules des variations amples du chiffre d’affaires pourraient témoigner du mécontentement des clients.
Certaines lois générales de la décision politique imposent leurs déterminismes au « service public »
Le pouvoir politique appartient aux minorités organisées, motivées par la valeur que le privilège représente pour ses membres et notamment ses dirigeants. En sont exclus le public inorganisé, sauf lorsqu’un critère voyant comme une décision officielle rend l’autorité politique attentive à ses réactions ; les minorités impopulaires, qu’on peut faire passer pour riches ou criminelles (Juifs, patrons, opposants au régime, etc.), les entrants potentiels sur le marché, dans la mesure où ils sont petits, désorganisés ou absents (comme la plupart des étrangers) de l’arène politique nationale.
Le gaspillage le plus visible qui en résulte immédiatement, sont les queues qui s’accumulent toujours lorsque le « service public » est ouvert au public. Le privilège de monopole, inhérent au « service public », interdit d’offrir de meilleurs services aux entrepreneurs honnêtes - ceux qui, à le différence des agents du monopole, ne vivent pas d’argent pris par la force - Il réduit les services offerts et conduit à des prix d’ajustement plus élevés que ceux d’un marché libre. Cependant, les prix effectivement pratiqués sont déterminés par l’autorité politique, et le public peut exiger qu’elle cherche à les abaisser ce qu’elle concède souvent !
Ils seront donc moindres que ceux qui ajusteraient la demande à l’offre artificiellement raréfiée. Pour compenser cette différence de valeur et ajuster la demande à l’offre, il faut que les clients subissent un coût supplémentaire sous la forme d’un pur gaspillage de leur temps, qui consiste à faire la queue. Le public peut bien se plaindre et protester ni lui ni les dirigeants du monopole ne comprennent pourquoi il y a des queues ni, par conséquent, comment s’en débarrasser ; et chacun de s’en prendre à la fatalité ou à quelque « insuffisance des moyens » dont personne n’est responsable.
En fait les queues ne sont donc pas dues à des bureaux trop petits, à des agents trop peu nombreux, ni même au fait que leur rémunération est indépendante du service rendu ; les trois phénomènes résultent du monopole public et de la détermination politique des prix. Il suffirait que ceux-ci montent jusqu’au prix d’ajustement au monopole, ou que ce dernier soit supprimé, pour que les queues disparaissent comme par enchantement.
Comme le transfert politique décourage l’efficacité productive et encourage la rivalité prédatrice, il pousse à la constitution de groupes de pression qui n’existeraient pas sans lui. Le taux élevé de syndicalisation dans les « services publics » et toutes les organisations qui bénéficient peu ou prou d’un privilège de l’Etat en est le signe.
Le « service public » est donc toujours relativement inefficace ; il est aussi toujours sous-capitalisé et en sureffectifs. Un système de transferts politiques profite toujours aux gens en place au détriment des nouveaux arrivants ; par ailleurs une rente politique est en général imparfaitement appropriée en ce qu’elle ne peut profiter qu’aux gens effectivement présents dans l’organisation et ne peut pas être capitalisée sur un marché. Cela a pour conséquence que pour s’approprier la rente, les gens en place doivent la transformer en revenu courant, qui est le seul à pouvoir être accumulé et capitalisé. Si la rémunération est libre, cela se traduira par des salaires plus élevés. Comme elle est généralement réglementée dans les « services publics », et c’est le cas pour les fonctionnaires subalternes, cela se traduit par une charge de travail en moyenne réduite, ce qui implique l’embauche de fonctionnaires supplémentaires.
La rente politique sera répartie suivant le pouvoir politique de chacun : sinécures voire impunité des trafics et des vols pour les syndicalistes, laissez-aller général pour les titulaires, exploitation des non-titulaires qui doivent payer leur accès à la rente. De la même façon, chaque fois que les dirigeants du monopole ont à choisir une dépense, elle peut être affectée soit au capital, soit au travail. Le capital a un inconvénient c’est que les services qu’il rend - c’est sa définition - sont répartis dans l’avenir : une partie de sa valeur échappera aux gens en place. Ils ont donc intérêt à faire pression pour qu’on s’en serve pour des dépenses courantes.
Ainsi, le « service public » souffre d’un défaut chronique d’entretien du matériel et, à moins que les dirigeants n’utilisent leur pouvoir politique pour faire financer des tours de force techniques sans rapport avec les nécessités de la production, cela se traduit par un manque d’équipement. L’équipement, donc, fait défaut ou il est gaspillé, ce qui implique dans les deux cas une insuffisance de capitaux productifs. Ce sous-équipement peut échapper aux dirigeants du service parce qu’il est le même dans les monopoles qui leur servent d’éléments de comparaison. Le biais en faveur des dépenses courantes ne leur apparaît vraiment que lorsqu’il s’exprime dans un choix extérieur, par exemple lorsqu’il résulte des arbitrages budgétaires du gouvernement.
En effet le sacrifice de l’investissement au profit des dépenses courantes peut être décidé en-dehors de l’organisation si ses ressources lui viennent d’une autre instance politique. Celle-ci reste soumise aux mêmes pressions de la part d’autres « services publics ». C’est l’ensemble du secteur public qui est en sureffectifs et sous-capitalisé. A terme, la rente est entièrement dissipée ; le monopole institutionnel parvient à interdire les produits immédiatement concurrents mais il existe des concurrents plus éloignés qui lui échappent. Or il stimule justement leur production en maintenant une offre réduite, ce qui leur garantit des prix plus élevés et donc une rentabilité supérieure. Aussi longtemps que cette rentabilité supérieure n’a pas disparu, les entrepreneurs investissent dans la production concurrente, et ils ne cessent de le faire que lorsqu’ils ont entièrement fait disparaître la rente.
Il arrive que les hommes de l’Etat étendent le champ du privilège de monopole pour mettre en échec la concurrence. C’est à terme une démarche vaine parce que tout produit a une infinité possible de substituts ; on ne pourrait maintenir la rente indéfiniment qu’en monopolisant toutes les activités, ce qui est impossible. Cependant, l’extension du privilège institutionnel peut retarder sa disparition inéluctable.
Aussi longtemps qu’elle n’a pas entièrement disparu, la rente est en partie dissipée en inefficiences. Une partie de celles-ci tient à la difficulté d’innover ; une autre tient à ce que les dirigeants recherchent la taille (qu’ils peuvent augmenter) plutôt que la rentabilité (qui est réglementée voire interdite). Comme il n’y a aucun profit certain à tirer de la redistribution politique, l’attribution d’une rente publique aux agents du monopole doit se traduire à terme par des coûts d’entrée qui égalent la valeur du privilège. Dans certaines professions, le privilège se paie en argent ; c’est la situation la plus claire parce que la raison d’être du monopole y est la plus explicitement visible : créer un pseudo-capital en raréfiant par la violence une ressource qui est naturelle, et par conséquent ne vaut rien normalement, le droit de produire. C’est le cas pour les pharmaciens, les chauffeurs de taxis, etc.
Une autre manière de payer le privilège est de se soumettre à des conditions d’entrée non marchandes les membres de la classe moyenne intellectualisée, politiquement puissante. Ils peuvent imposer des concours d’entrée pour se favoriser eux-mêmes ou leurs enfants. Une partie de la valeur du privilège est dissipée dans le risque d’avoir préparé une formation spécifique pour rien. Le reste de la rente se paie par des file d’attente, éventuellement avec des étapes de pré-admission au cours desquelles le sous-employé qui attend est exploité (au sens qu’il ne reçoit pas la valeur marchande de ses services). C’est le cas des apprentis dans les corporations de l’Ancien régime, des étudiants en médecine dans les hôpitaux, des auxiliaires dans l’enseignement et dans la Poste.
L’emploi des auxiliaires est une caractéristique endémique du monopole d’embauche. A côté des privilégiés du monopole, il y a ceux qui restent à la porte mais ne s’en vont pas, alléchés par la perspective d’un privilège possible à venir. On les exploite dans la mesure où ils sont attirés par la rente et déjà prisonniers des avantages qu’elle promet et où le défaut de la garantie de l’emploi, les privent d’un des privilèges essentiels qui fondent le pouvoir politique des agents du monopole. Les statuts internes au monopole public ménagent aussi à ceux qui y disposent d’un pouvoir d’en abuser de façon arbitraire. Ni la capacité productive de chacun ni le pouvoir d’achat n’y sont un moyen d’acquérir une influence ou de se protéger contre l’arbitraire. Le pouvoir est d’origine politique. Quant au client, il est captif du monopole.
Comme à terme tout profit et toute rente de monopole disparaissent, et comme à l’intérieur du « service public » la rente tend à être gaspillée en inefficiences, et comme les clientèles politiques ne sont pas prêtes à renoncer à leurs prébendes, la distribution doit se poursuivre d’une autre manière. Tout d’abord on consomme le capital matériel installé on laisse se dégrader équipement et matériel, en affectant les recettes aux dépenses courantes ; ce n’est évidemment qu’une solution à court terme parce que la dégradation du service qui en résulte peut devenir sensible et parce que les capitaux matériels ne sont pas illimités. Ensuite, on réclame de l’argent à l’Etat, mais si les hommes de l’Etat ne trouvent pas naturel de financer ces déficits, notamment lorsque l’opinion n’y est pas habituée, la crise devient politiquement visible et le gouvernement commence à chercher des solutions. Une des solutions peut être de faire accepter à l’opinion le principe d’un déficit permanent au nom du principe que la desserte est normalement « déficitaire ». On associe éventuellement cette subvention d’un « contrat » qui vise à attirer l’attention sur lesdits services « déficitaires » et à assurer le public qu’elle est nécessaire.
L’importance des gaspillages du service public dépasse la valeur de ses déficits
Dans certains cas, les règles imposées par les hommes de l’Etat permettent aux dirigeants des organismes publics, adossés à leurs privilèges de monopole, de lancer des entreprises productives en concurrence déloyale avec les entrepreneurs normaux grâce à leur accès privilégié au domaine et à l’argent « publics » ; il s’agit de monnayer ce privilège en étendant les activités au-delà de leur domaine initial. Cela peut être utilisé pour profiter à des clientèles politiques que soignent le gouvernement, les collectivités locales et d’autres distributeurs de privilèges. Le précédent du câblage monopolistique par les collectivités locales en est un exemple, celui de forcer à construire et mettre en circulation des voitures électriques que le marché ne demande pas en est un autre. L’importance des pillages ainsi opérés ne s’apprécie par seulement au vu des déficits que de telles initiatives entraînent.
Les déficits ne sont en eux-mêmes la preuve ni d’un transfert au profit des clients ni même au profit des employés, et ils peuvent aussi bien traduire une décision arbitraire de tarification au-dessous du prix de revient ou refléter une inefficience relative face à des entreprises concurrentielles. Il faut donc bien comprendre quelles contraintes traduisent les résultats des organismes publics : ils ne sont en rien une indication de leur efficacité productive mais reflètent principalement les décisions politiques prises. Qu’il y ait un excédent ou un déficit n’indique pas en soi quelle est l’efficacité productive ; néanmoins, un « déficit » pose des problèmes politiques ; il est considéré comme l’indice d’un problème et les dirigeants doivent le présenter comme tel, ne serait-ce que pour annoncer qu’on exploitera encore davantage les consommateurs ou comme occasion de réduire les parts de la rente distribuée à tel ou tel groupe privilégié.
Un nouveau leurre : l’évaluation scientifique des résultats des services publics
Comme le service public, quelle que soit sa finalité industrielle, commerciale ou sociale, ne peut simuler le libre fonctionnement du marché sans le détruire par ce fait même, il intervient nécessairement par l’édiction de normes de besoins et de satisfaction des personnes, déduites d’un projet théorique de société qui n’a pas de référence dans la société réelle. Confronté à une demande exponentielle de « politiques publiques » dans toutes sortes de domaines le gouvernement ressent aujourd’hui la nécessité de vérifier leurs effets concrets par rapport aux fins poursuivies, ne serait-ce que pour trouver des critères objectifs aux décisions qu’il prend pour répartir l’inévitable pénurie des moyens financiers publics. Il s’ingénie depuis peu à procéder à l’« évaluation scientifique des politiques publiques » . Il a confié le soin d’en élaborer les concepts et les méthodes à un établissement administratif spécialisé, un de plus, le « Centre de l’évaluation scientifique » des résultats obtenus par les politiques publiques. L’Etat achève ainsi de s’enfermer sur lui-même puisque les évaluations que produira ce centre vaudront plus que celles des citoyens eux-mêmes, cibles muettes des actions publiques, à moins que ce centre ne soit a son tour bientôt contraint à se taire.
Nous allons pour notre part vérifier les effets du monopole appliqué à deux activités essentielles pour les entrepreneurs, celui de la protection sociale attribué à la Sécurité sociale et celui de l’émission et de la gestion de la monnaie confié à un réseau bancaire d’Etat.