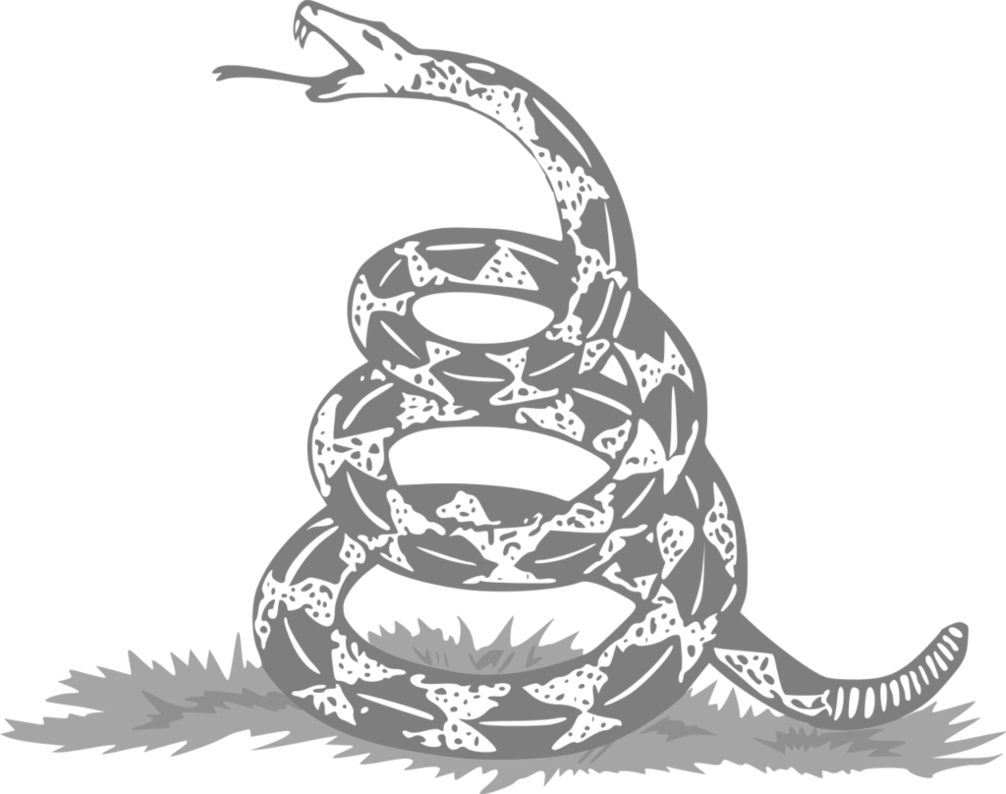Le prétendu « Service public »
François Lefort, La France et ses entrepreneurs, 1992, Chapitre 4
La théorie économique dominante prétendant le marché naturellement défaillant, les hommes de l'Etat affirment que leur intervention peut et doit pallier cette défaillance. A leur intervention ils donnent diverses formes, mais toutes procèdent d'une théorie centrale, celle du « service public », présenté comme la panacée, l'antidote à la « carence naturelle » du marché.
De multiples versions institutionnelles en dérivent ; elles ont presque toutes pour traits communs d'être astreintes à des « obligations » et en tous cas au moins protégées par des privilèges de monopole. Leur effet principal est d'imposer à certaines organisations productives de satisfaire les désirs de leurs clients non pas tels qu'ils les expriment mais bien tels qu'eux, les hommes de l'Etat, les définissent à leur place et souvent pour convenance personnelle.
De ces « obligations », certaines sont de portée générale et d'autres, de nature particulière. Parmi les premières figurent celles de satisfaire des « besoins » déclarés « fondamentaux » par ceux qui font la loi ; d'assurer la « continuité du service », d'assurer aux usagers des « prestations égales » en toutes circonstances et lieux« ; enfin, finalité suprême, de »servir l'intérêt général". A leur côté, apparaissent selon les cas des obligations spéciales, inhérentes à la nature particulière d'un service.
Leurs supports institutionnels peuvent être le « service public à caractère administratif », le « service public à caractère industriel et commercial », le « service public à caractère social ». Ils sont attribués par les administrations civiles de l'Etat à des « établissements publics dotés de l'autonomie administrative et financière », à des « établissements publics à caractère industriel et commercial », à des associations déclarées d'utilité publique« ; enfin à des »entreprises publiques« et autres »sociétés nationales« , »sociétés d'économie mixte" etc.
Il existe certes des activités de l'Etat, notamment dans le cadre de ses missions régaliennes, pour lesquelles la notion d'obligation de service public« pourrait à la rigueur inspirer des normes d'action pour traduire des nécessités ressenties en commun. Cependant, dans le domaine de la production et des échanges, il est au contraire impossible de trouver dans la réalité un fondement à ces »obligations« d'agir qui toutes font fi du libre consentement. Comme le droit doit avoir un fondement objectif, alors le concept même de »service public" qui fonde l'obligation est purement et simplement indéfinissable en droit.
Il n'en faudra pas moins examiner de près cette définition absente, car les hommes de l'Etat ne cessent d'user et d'abuser du concept pour étatiser les entreprises, déposséder les entrepreneurs des fruits de leur travail ou leur interdire de les offrir sur le marché.
Première conséquence de ce concept, deux catégories d'entrepreneurs s'affrontent en France, ceux qui a l'abri des privilèges de monopoles s'approprient en réalité les organismes publics et en obtiennent des avantages particuliers, quelquefois exorbitants, et les autres qui exposés à tous les risques de la concurrence doivent réaliser les efforts nécessaires pour atteindre et conserver la compétitivité. Si France à deux vitesses il y a bien, celle-là est ignorée, jamais dénoncée comme injuste : pour cause, la partie privilégiée est l'objet de tous les soins de la classe politique.
L'« obligation de service public » dans la hiérarchie des normes
Dans La France et son Droit, nous avions vu que les lois se classent en quatre catégories : certaines règlent l'exercice de la liberté de chacun de telle manière que ne soit pas menacé l'exercice de la leur par les autres. D'autres, tout en laissant l'initiative de l'action aux agents moraux, leur imposent certains objectifs à atteindre par certains moyens. D'autres encore ont pour effet de déposséder les agents moraux de leur liberté et de leur capacité d'agir pour les transférer exclusivement à des organismes publics. Enfin, vient la quatrième catégorie de lois, celles qui régissent la production du droit elle-même, les règles constitutionnelles, dont quelques-unes font un devoir aux hommes de l'Etat de soustraire nombre d'activités aux entreprises libres pour les confier à des organismes qualifiés de « services publics ».
Les lois qui permettent aux hommes de l'Etat de substituer leurs propres projets à ceux des entrepreneurs, de leur retirer les moyens d'en concevoir d'autonomes et de les réaliser, appartiennent aux deuxième et troisième groupes. Ce sont les plus nombreuses, et elles constituent le terrain de prédilection de l'imagination interventionniste des administrations. Toutes ces lois s'inspirent de l'idée, présente dans la Constitution, que les « besoins » seront mieux satisfaits par des organismes publics assujettis à des obligations d'agir, plutôt que par des contrats librement conclus.
Que vaut l'obligation d'assurer des services dits « fondamentaux » ?
Les partisans du « service public » semblent se raccrocher à l'idée qu'il serait là pour assurer les services « fondamentaux » sur une base « égalitaire ». L'examen des services en cause ne permet guère, cependant, de les trouver le moins du monde plus « fondamentaux » que ceux qui n'ont pas été monopolisés de cette façon. Pourquoi l'enseignement et pas la nourriture ? Pourquoi la poste aux lettres plutôt que l'habillement ? Pourquoi certains transports et pas d'autres ? Pourquoi certains soins et pas tous ? Comment ne pas être frappé par le fait que les services les plus indispensables à la subsistance des personnes ne sont pas organisés en « services publics » ? A cette question, on ne trouve guère de réponse cohérente.
Ce qu'est une « obligation de service public »
L'obligation de service public, si elle donne lieu quelquefois à une définition réaliste de ce qu'elle impose, ne peut pas en revanche être justifiée sur des critères identifiables. Elle repose sur le postulat suivant lequel, les entrepreneurs privés étant incapables d'assurer un service de la « meilleure » façon, sa définition devrait être imposée par une autorité publique présumée mieux informée que les gens véritablement concernés quant aux besoins et aux moyens de les satisfaire.
Pour ceux qui font la loi, nous l'avons déjà souligné, dès qu'un service leur apparaît « nécessaire », ils s'imaginent devoir l'assurer eux-mêmes, étant capables de le garantir mieux que quiconque. Aussi laissent-ils proliférer les obligations de service public sans aucun contrôle de leur nécessité ni de leur efficacité. Et ils ne les remettent jamais en cause, quand bien même plus personne ne comprendrait à quoi elles peuvent servir, chose qu'ils ne se préoccupent d'ailleurs jamais de vérifier. Au demeurant, qui s'en aperçoit ?
L'obligation de « service public », dans la plupart des cas, consiste à imposer à certains producteurs de réaliser certains objectifs. Comme ces producteurs, en son absence, se seraient conformés aux demandes de leurs clients, elle n'a pas d'autre but que de permettre aux fonctionnaires qui sont les véritables auteurs de la loi, de confisquer aux utilisateurs d'un service le pouvoir de décider de sa nature, de sa qualité et de la quantité fournie, et d'imposer la manière dont ils seront forcés de les payer.
L'« obligation de service public » implique nécessairement l'idée que, par définition et par nature, le choix d'acheter et de définir certains services « doit » être confisqué à leurs clients (par ce fait même réduits au statut inférieur d'« usagers ») au profit des hommes de l'Etat. Aussi ces derniers interdisent-ils aux entrepreneurs honnêtes, c'est-à-dire privés et concurrentiels, de fournir librement ces services conformément aux voeux de leurs utilisateurs, qu'ils privent le plus souvent du Droit de ne pas payer ce dont ils ne veulent pas. Tout cela repose donc sur ce présupposé absurde que ni les entrepreneurs, spécialistes de la production, ni leurs clients, directement concernés, ne seraient capables d'identifier les « besoins » de ces mêmes clients, mais que des fonctionnaires et des politiciens y parviendraient seuls par la vertu naturelle de leur pouvoir de contrainte.
Naturellement, la seule chose qui puisse entretenir les hommes de l'Etat dans cette illusion est l'impunité dont jouit par définition la violence étatique, et qui les dispense automatiquement de ressentir personnellement la nocivité de leurs interventions et d'en être eux-mêmes pénalisés. Ce sentiment grisant d'avoir toujours raison, et qui les entretient dans cette invraisemblable arrogance que nous leur connaissons, leur vient de la situation proprement irresponsable dans laquelle ils se trouvent face à leurs sujets. C'est l'alpha et l'oméga du sentiment extravagant de supériorité intellectuelle qui habite les hommes de l'Etat à l'abri de leur immunité institutionnelle.
Car, bien entendu, il n'y a actuellement pas d'exemple que la production d'un bien ou d'un service quelconque, dès lors qu'il est demandé, qui ne puisse être assurée par une entreprise privée sur un marché libre.
Par exemple, qui a pu prétendre que la pose de fibres optiques par les communes correspond à une « mission de service public » et qu'il ne valait mieux pas qu'une entreprise privée puisse s'en acquitter ? Sur quel fondement, alors qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'une anticipation des techniciens d'Etat sur un besoin que le marché des télécommunications n'a pas encore révélé ? Et comment le marché le pourrait-il tant que le monopole public offre de tels services et qu'il ne court aucun risque en les offrant ? Et entre quelles techniques et quelles prestations l'utilisateur aura-t-il la liberté de choisir ?
On pourra invoquer la « protection du consommateur » contre la mauvaise qualité, ou la sécurité insuffisante, mais ce sont là des illusions. Par exemple, quel transporteur aérien, routier ou ferroviaire privé, exposé à la concurrence, pourrait se permettre de renoncer à la sécurité, et se dispenser de chercher le meilleur service au moindre coût ? C'est au contraire lorsqu'une organisation productive est maintenue sans que le public puisse la sanctionner par son refus de payer... ce qui est la nature du « service public », que le consommateur est en danger. Qu'on demande ce qu'ils en pensent aux « usagers » du Centre National de Transfusion Sanguine.
Naturellement, une fois que le « service public » a confisqué au consommateur son pouvoir au profit des hommes de l'Etat, ce nouvel enjeu servira à satisfaire des intérêts personnels. L'argent « public », rappelons-le, finit toujours dans des poches privées. L'« obligation de service public » est donc nécessairement à la fois un appât et une pomme de discorde pour les divers appétits qui se disputent les richesses confisquées. Elle doit donc forcément devenir un prétexte à toutes sortes de revendications de plus en plus pressantes adressées aux hommes de l'Etat, et qui finiront par être satisfaites aux dépens des consommateurs et des contribuables.
Que peut bien vouloir dire l'obligation de « continuité » ?
La théorie officielle du « service public » prétend justifier sa création par la nécessité d'assurer en permanence et en tout lieu la « continuité » d'un service et ceci pour tous ses usagers actuels et virtuels.
Or, on ne sait pas très bien à quoi peut rimer cet argumentation. Si la « continuité » est possible, on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas assurée de façon privée. Si elle ne l'est pas, ce n'est pas l'emploi de la force publique qui pourra empêcher l'opération des lois de la nature.
Il est un sens dans lequel la « continuité » peut être concevable. C'est la possibilité pour tout le monde de recevoir un service dès lors qu'il est prêt à en payer le prix. Cette possibilité, synonyme d'absence de pénurie, est ce que le marché libre réalise au mieux. En effet, lui seul permet au prix de contenir la demande et de stimuler l'offre exactement autant qu'il est nécessaire, pour autant qu'il est humainement possible, éliminer les cas où l'on veut acheter sans trouver à se fournir.
Cette fameuse « continuité », par conséquent, il n'est pas d'exemple que si les lois de la nature s'y prêtent et si les gens sont prêts à la payer, l'entreprise privée ne la puisse pas la réaliser. L'entrepreneur qui dépend du consentement de ses clients pour la survie de son entreprise n'a nul besoin qu'un homme de l'Etat vienne lui dire quand ils en ont besoin. Prenons encore une fois le cas de la production et de la distribution de l'électricité. Aucun producteur privé d'électricité ne pourrait échapper aux contraintes de production et de distribution auxquelles se plie EDF. Est-ce vraiment l'« obligation de service public » ou bien plutôt la nature des choses, qui veut que ces services soient fournis en permanence ? Ne serait-ce pas plutôt la nature de l'électricité qui interdit à son producteur et à son consommateur de la stocker ? Et n'est-ce pas la masse des consommateurs, c'est-à-dire le marché, qui exige d'en disposer à tout moment et sans préavis ?
En conséquence, les obligations imposées au gestionnaire d'un « service public » ne sont jamais telles que s'il s'interrompait, une entreprise libre n'en prendrait pas immédiatement le relais. Et qu'on ne s'y trompe pas : s'il arrive que l'entrepreneur privé ne le fasse pas, c'est toujours parce qu'une violence étatique l'en empêche. Par exemple, dans des secteurs aussi essentiels que la nourriture, la sécurité, les soins, les achats de biens coûteux et rares, ce sont les interdictions imposées par le « droit » du travail qui empêchent de répondre à la demande de « continuité » du service par celui qui en éprouve le besoin.
Cet ajustement précis et contraignant aux exigences de la clientèle que réalise l'ordre marchand, aucun service de l'Etat n'est en revanche capable de l'assurer réellement, qu'il s'agisse même de la défense, de la sécurité, de la justice, de la poste, de l'éducation. Ils s'efforcent plus ou moins d'y tendre, mais on reste fort loin du compte. Ainsi il a été exceptionnel que nos forces armées aient pu disposer à temps des concepts et des matériels adéquats aux opérations dans lesquelles elles furent engagées - et ne nous appesantissons pas ici sur les échecs de l'Education nationale... Dispensés par leur statut même de l'obligation de servir le public, les « services publics » ne pouvaient manquer d'ignorer voire de s'opposer aux désirs des « usagers », dans ce domaine comme dans bien d'autres.
Les auteurs du « droit public » sont-ils conséquents avec eux-mêmes quand ils affirment l'exigence de « continuité », puisque le non respect de cette obligation par son redevable n'est exposée à aucune sanction du juge, et qu'on n'a jamais pu obtenir réparation par un « service public » d'un dommage résultant de l'interruption de son activité prétendument « continue » ? C'est au contraire comme s'il suffisait d'écrire le mot « continuité » dans ses statuts pour que l'organisation productive soit dispensée de toute autre obligation vis-à-vis de cette notion.
Par ailleurs, les syndicats des « services publics », protégés de la concurrence par le monopole et de la faillite par le financement public, y ont acquis un pouvoir tel qu'il n'est même plus possible de maintenir réellement cette obligation dans les textes. Ainsi a-t-il fallu sérieusement en rabattre sur les proclamations initiales et, dans certains services, « négocier » un substitut, sorte de radeau de la Méduse, que l'on a qualifié de « service minimum ».
Cependant, la dégradation du mythe de la « continuité » est bien plus avancée encore, puisque l'on dénonce aujourd'hui comme « réactionnaire » le principe du « service minimum », et que la bonne vieille réquisition, à laquelle l'« obligation de service public » devait servir de cache-sexe, réapparaît maintenant dans sa nudité crue, dans les domaines où l'interruption serait catastrophique. C'est ainsi que, pour assurer le fameux « service minimum, » les agents d'EDF sont purement et simplement requis. Cependant, pourquoi donc sont-ils les seuls, et pourquoi les contrôleurs de la navigation aérienne, les conducteurs de train y échappent-ils ? La continuité du transport n'a-t-elle pas la préférence de ses usagers ? Croit-on que le pays puisse vivre sans transports s'il ne peut se passer d'électricité ?
Aujourd'hui, la « continuité » du « service public » a perdu tellement de sens que, comme sa définition, elle semble ne plus désigner que l'institution elle-même. En somme, si « continuité du service » il demeure, c'est ainsi qu'elle se traduit dans les faits : aucune impossibilité de servir les clients causée par le statut public, aucune interruption du service par ses agents ne conduit jamais le Gouvernement à supprimer ses monopoles à licencier ses agents, ni à dissoudre l'organisation.
Telle que l'entend la classe politique, la « continuité » du « service public » signifie donc réellement ceci :
- « quelle que soit la manière dont le service est ou n'est pas rendu, les hommes de l'Etat interdiront toujours à d'autres fournisseurs de rendre de meilleurs services et, plus généralement, continueront imperturbablement à l'entretenir au mépris du consentement de ceux qui le paient. »
Conclusion : si un service est tel qu'il est nécessaire de le fournir de manière ininterrompue, ses usagers en exprimeront le besoin sans besoin ni d'une aide ni d'un tuteur, et l'obtiendront des entrepreneurs privés au plus près de ce qu'ils sont prêts à payer. Les distinctions que le « service public » établit entre les « besoins » n'expriment donc que la subjectivité et les conceptions voire les intérêts personnels des hommes de l'Etat. Quant à son statut, étant destiné à priver le public de son Droit de déterminer le service, il ne peut qu'empêcher de le servir où et quand il le désire. Il est donc injustifiable d'imposer le « service public » sous prétexte de « continuité », car à cette prétendue « continuité », il n'est pas simplement inutile : il est le principal obstacle à sa réalisation.
La raison d'être du « service public » est d'instituer la discrimination entre des castes de citoyens
Cette conclusion, les tenants du « service public » ne veulent pas l'admettre, et feignent de croire qu'une pénurie pourrait subsister sur un marché libre. « Certains, affirment-ils, risquent de manquer d'un service essentiel si la force publique ne le leur garantit ». L'idée suivant laquelle la violence pourrait faire disparaître un risque est une des illusions les plus tenaces de l'étatisme ; cependant, rien n'est plus facile, la démagogie aidant, que de décréter « essentiel » un service, et de trouver des gens qui en reçoivent moins que les autres. La « continuité » se teinte alors d'égalitarisme apparent et perd ipso facto son rapport avec le réel pour entrer dans le royaume de l'abstraction flottante et n'être plus qu'une incantation.
Les partisans du « service public » prétendent donc qu'il serait absolument nécessaire de « traiter également les usagers » et que seul le « service public » y parviendrait : il est censé y parvenir de plusieurs manières différentes, éventuellement contradictoires.
Le premier sens dans lequel le « service public » est censé « assurer l'égalité » est celui où il entend pratiquer partout un même prix de vente pour des services comparables, quel que soit le prix de revient. Pour obtenir ce résultat, il est prêt à imposer à certains un prix plus élevé que le prix de revient, afin de permettre à d'autres de payer moins. Cette notion-là au moins se traduit par une politique claire. A l'évidence, elle impose de subventionner la consommation des uns en forçant les autres à payer plus cher.
Cette remarque est essentielle car elle implique, si les mots ont un sens, que, fort loin de vouloir réaliser une quelconque « égalité » entre les usagers, le « service public » vise délibérément à les séparer en deux catégories : ceux qui, par l'emploi de la force publique, seront forcés de payer plus cher que sur un marché libre et les autres, ceux qui profiteront de cette violence en se laissant subventionner par eux. Le « service public » a donc pour seule raison d'être la redistribution politique, dont le principe inavoué est que l'humanité se sépare en deux castes : la caste supérieure (dont ils font eux-mêmes partie, mais dont on serait bien naïf de croire que les pauvres y sont inclus) qui a le droit de vivre par la violence sur le dos des autres et la caste inférieure, qui n'a que le droit de se laisser dépouiller par la première.
Cette division de la société en groupes antagonistes n'est d'ailleurs qu'un des effets du privilège d'Etat. L'existence de l'Etat lui-même, c'est-à-dire d'une organisation qui habilite les hommes qui lui sont rattachés à commettre éventuellement, et dans la plupart des cas impunément, des agressions violentes contre le droit des gens, divise tout autant la société en deux castes inégalitaires : dans la première se retrouvent ceux à qui il est interdit de commettre des agressions, et dans la seconde ceux qui l'interdisent aux premiers mais s'y livrent eux-mêmes à leur détriment.
Il est vrai que l'étendue de la caste supérieure est peut-être bien plus étroite que les hommes de l'Etat ne se plaisent à le faire croire. Car en lui-même, son entretien violent par l'impôt et le monopole est cela même qui dispense le « service public » de servir le public pour le mettre sous la coupe des hommes de l'Etat. Rien, en conséquence, ne permet de penser que les prétendus « bénéficiaires » du « service public » n'auraient pas accès à de meilleurs services, et de moins chers, s'ils les payaient honnêtement. C'est particulièrement vraisemblable dans les « services » entièrement payés par la force et contrôlés par des corporations politiques, tels que la « sécurité sociale » ou l'« éducation nationale ». Bertrand de Jouvenel le disait déjà dans The Ethics of Redistribution :
- « pour modifier sensiblement le niveau de vie de larges couches de la population, l'ampleur des redistributions qui seraient nécessaires est tel qu'aucun gouvernement ne peut se le permettre ».
L'activité redistributive de l'Etat consiste donc essentiellement à donner d'une main ce qu'il a pris de l'autre, avec pour seul résultat qu'au fil des ans le pouvoir de décision se trouve progressivement confisqué à son profit.
Un exemple du « vampirisme normatif » qui caractérise le « droit » public
Il n'est donc même pas certain que le statut public assure le moins du monde un accès plus uniforme à la fourniture du service. Car les conditions d'accès uniforme elles-mêmes, ce n'est pas le « service public » qui les a inventées. Il les a purement et simplement reprises des pratiques que la concurrence imposait spontanément aux entreprises normales. Car la tarification uniforme, dans les entreprises normales, est spontanément décidée pour des raisons de concurrence et de coût de l'information, elle est elle-même une invention des entrepreneurs libres, de surcroît susceptible d'être persécutée comme « entente » par les hommes de l'Etat.
La différence est que, pour tenter de parvenir au même résultat dans les « services publics », il a fallu inventer tout un système de règles afin, autant que faire se pouvait, de limiter l'arbitraire redistributif. Car c'est le statut public, institué pour prendre aux uns pour donner aux autres, qui permet de multiplier à l'infini les abus et les faveurs politiques. On le voit bien assez à notre époque post-bolchevique où, confondant décidément l'esprit d'entreprise avec l'enrichissement par tous les moyens, les dirigeants de certains « services publics », sans céder d'un pouce sur leurs privilèges monopolistiques, multiplient les tarifications « différentielles » et discriminent de plus en plus entre leurs types d'usagers*.
Il est en l'espèce particulièrement significatif, que les tenants du « service public » tirent prétexte, pour violer la liberté des contrats, de sa prétendue incapacité à réaliser une norme qu'ils croient propre au « droit public », alors que celle-ci est en réalité tant bien que mal copiée sur les pratiques de la société non-violente à laquelle ils font en permanence ce procès. Une telle perversion du raisonnement caractérise d'ailleurs un grand nombre de principes, ou supposés tels, du « droit public », à l'aune desquels les hommes de l'Etat prétendent juger la société civile. C'est ce que l'on pourrait appeler la vampirisation du droit par l'appareil d'Etat.
A toutes les fausses valeurs du « service public », pures rêveries ou perversions plus ou moins conscientes de valeurs authentiques, on trouve des précurseurs dans les pratiques du marché concurrentiel. Ce sont les entreprises de droit commun qui ont inventé les pratiques d'égalité de rémunération des prestations et de prix de vente, de continuité de l'action, de libre concurrence, etc. Ce sont elles qui en ont développé l'application par des contrats de toute nature, et les anti-concepts « publics » de « non-discrimination », d'« égalité de traitement ou d'accès » ou de « continuité » en sont de simples perversions.
Le processus est le même à chaque fois : dans la mesure où elle permet à certains de faire impunément violence à des innocents, l'intervention étatique dans l'économie viole forcément les principes généraux du Droit. Cette violence, les hommes de l'Etat ont besoin de la faire passer pour « juste ». Pour cela, ils inventent des normes auxquels ses résultats seront censés se conformer. A cette fin ils soumettent les actes de leurs agents à certaines règles, dites de « droit public », dont la dénomination prouve en elle-même qu'ils cherchent à les faire passer pour des règles de droit. Une bonne partie de ces règles n'ont aucun sens identifiable et ne servent que de prétexte à l'arbitraire. Nous en avons vu quelques-unes : la notion de « besoin » en fait partie, comme celle de « défaillance du marché », ou de « justice sociale ». Nous verrons que c'est aussi le cas du « service public » lui-même.
La norme d'« égalité d'accès » est légèrement différente : comme le principe « à travail égal, salaire égal », l'idée de ne pas faire payer des prix différents pour un même produit, fait partie des résultats qu'un processus concurrentiel réalise approximativement, c'est-à-dire qui, sans être en eux-mêmes des normes de justice, sont suffisamment inséparables d'une société juste pour qu'on puisse les confondre avec elle. L'astuce consiste à faire passer ces résultats pour la justice elle-même, et à prétendre les réaliser au moment même où, par leur intervention, ils détruisent les conditions de leur véritable réalisation spontanée.
Au départ, les hommes de l'Etat prétendent les réaliser malgré la violence de leurs procédés. Il s'agit alors de faire croire qu'on peut obtenir les effets sans accepter les causes, et la justice sans se conformer au Droit des gens. Puis les années passent et, dûment élevés dans la religion étatiste par le monopole d'Etat sur l'école, les citoyens finissent par oublier ce que signifiait pour eux la liberté d'entreprendre. C'est alors qu'on leur présente les « principes » du « droit public », non plus comme une limite posée à l'arbitraire étatique, mais comme un idéal que le « secteur privé » devrait atteindre, et qu'on lui fait grief de ne pas réaliser. Pour qu'on puisse faire croire qu'elles en avaient un dans le « service public », les normes en question ont nécessairement dû être privées de leur sens réel : toujours aussi impossibles à identifier, elles restent à l'évidence strictement irréalisables par qui que ce soit, le « secteur privé » ne faisant pas exception. La différence est que, désormais, elles sont acceptées sans examen. Elles peuvent donc servir de prétexte automatique à toutes sortes d'interventions abusives contre des personnes honnêtes.
Le vampirisme normatif est donc constitué : le « droit public » se développe par assassinat du Droit authentique, puis se sert de son cadavre pour revenir hanter ceux qu'il avait épargnés. C'est ainsi que les hommes de l'Etat, principaux violateurs du Droit, imputent aux personnes honnêtes des crimes imaginaires qui ne sont que le pendant anti-conceptuel de leurs propres agressions. Les hommes de l'Etat volent-ils les uns au profit des autres, distribuent-ils des faveurs arbitraires ? Ils accuseront donc les personnes privées de « discrimination » si elles exercent leur Droit de ne pas échanger avec qui elles veulent. Leur violence ne cesse d'interdire aux autres de leur faire concurrence ? Alors, ils accuseront les entrepreneurs honnêtes de « monopole » parce qu'ils se trouvent être les plus appréciés sur un marché. Nous verrons à ce dernier propos que la conception juridique utilisée par les hommes de l'Etat pour censurer la concurrence s'inspire typiquement d'une conception administrative de l'activité productive.
Le service public au service de l'« intérêt général »?
Le dernier recours des hommes de l'Etat pour imposer leur pouvoir aux autres est de se prétendre les seuls à pouvoir réaliser l'« intérêt général ». Le caractère anti-conceptuel de cette fausse notion sera facilement établi : s'il est un fait général, et même universel et immuable, c'est que par nature, seuls des êtres vivants peuvent avoir un intérêt. En conséquence, l'intérêt est toujours et partout individuel, et en matière humaine, personnel. Il n'y a donc pas plus d'« intérêt général », que la justice ne peut être « sociale » et, dans une république, on ne peut même pas trouver de « général » dont l'intérêt personnel puisse recevoir le sobriquet d'« intérêt général ». Un autre fait général, qu'on ne répétera jamais assez, est que l'action de l'Etat est par définition violente, et par ce fait même prend aux uns pour donner aux autres.
En conséquence l'action des hommes de l'Etat, qu'elle soit conforme ou non au Droit des gens, ne se fait jamais qu'au détriment d'intérêt personnels et singuliers, au profit d'autres intérêts personnels et singuliers. Nous en avions déjà vu un cas particulier quand nous rappelions que l'argent « public » va toujours dans des poches privées : il n'y a pas d'intérêt public définissable. Il n'y a même pas, à proprement parler, de personnes « publiques ». Le fonctionnaire, l'élu, n'est pas moins une personne privée que les autres. A cette personne privée il arrive seulement, en certaines occasions, d'accomplir des actes qualifiés de « publics » : des actes qui, à un titre ou à un autre, revêtent un caractère violent.
Il peut arriver que, sur un territoire donné, dans une organisation ou un groupe culturel, des gens se trouvent avoir des intérêts en commun, vis-à-vis desquels ils sont solidaires. Cependant, quand bien même ces personnes seraient majoritaires dans un pays donné, rien ne les autorise à se servir du pouvoir politique pour qu'il les satisfasse aux dépens de ceux qui ne les partagent pas, ou dont la satisfaction peut leur nuire. De cet intérêt commun, la notion d'« intérêt général » reste donc une perversion purement imaginaire et n'est qu'un prétexte pour imposer certaines violences à des fins strictement personnelles. Car la notion vise en fait à faire croire qu'il y aurait une manière de voler les uns au profit des autres qui se tiendrait par nature au-dessus du jugement moral. Pour l'essentiel, elle décourage d'identifier spontanément les individus singuliers qui seront nécessairement les auteurs, les bénéficiaires et les victimes des interventions de l'Etat.
L'examen des obligations de « service public » révèle l'imposture de l'Etat
Les « obligations de service public » sont des obligations de résultats substituées aux objectifs que le marché désigne à qui sait l'étudier. Cependant, si on les examine concrètement, on constate que, lorsqu'elles ne visent pas seulement à prendre aux politiquement faibles pour donner aux politiquement puissants, il est bien difficile de les distinguer des objectifs que les entreprises concurrentielles s'assignent d'elles-même, sans bénéficier pour les réaliser des concours publics ni des protections monopolistiques réglementaires.
C'est une preuve, s'il en était besoin, que ces concours et protections ne font qu'empêcher le « service public » de servir le public. En effet, si ce sont ces exceptions au droit commun qui font la différence entre le « service public » et l'entreprise privée et concurrentielle, et si des normes de résultats doivent être imposées à un « service public » pour qu'il soit amené à servir le public, alors qu'elles sont parfaitement inutiles pour y inciter une entreprise normale et que leur rigidité entrave l'efficacité gestionnaire, cela ne peut vouloir dire qu'une chose : c'est que le statut particulier du « service public » a pour effet de le dispenser de servir le public comme celui-ci souhaite l'être, et que le législateur, en s'estimant contraint de lui imposer des normes de résultats, est implicitement le premier à reconnaître ce fait.
Une autre remarque à faire est que, si l'« obligation de service public » a un fondement dans la réalité, celui-ci ne peut se traduire que dans un résultat à atteindre et non par une action spécifique qu'un gendarme pourrait vous contraindre d'accomplir. Car la seule définition d'un « meilleur service » se trouve dans une réponse plus adaptée aux sollicitations du client, et voilà bien qui est complètement étranger à tout commandement préalable de « faire » ceci ou cela qui appellerait en renfort l'intervention violente de quiconque. Cependant, cela veut aussi dire autre chose : pour que le service corresponde réellement à quelque chose, il faudrait que les résultats désignés comme objectifs soient changés aussi souvent que changent les préférences de ses utilisateurs. Or, dans les « services publics », les obligations en question sont imposées d'en haut, elles ne sont que rarement révisées et les privilèges ne le sont pratiquement jamais. De sorte qu'on est pratiquement certain de leur inadéquation aux besoins ressentis par les gens, et qu'ils exprimeraient par leurs demandes s'ils avaient la liberté de le faire sur un marché. On est donc fondé à dire que la pérennisation des aides et compensations dont bénéficient ceux qui les assument, par la procédure des services votés et la consolidation de leur nécessité par les lois qui garantissent les intérêts acquis, suffit en elle-même à faire peser sur la notion d'obligation de service public" un soupçon irrémédiable, a fortiori sur leur protection par des privilèges de monopole censés assurer leur accomplissement.
En effet, alors que ses privilèges monopolistiques le dispensent automatiquement de servir le public, les espèces d'« obligations » que l'on impose au « service public » sont largement impuissantes à l'y contraindre en compensation. Dès lors que son statut le fait sortir du droit commun qui force naturellement les entrepreneurs à servir le public pour recevoir son argent, aucune obligation de résultat ne peut plus amener un « service public » à se mettre véritablement au service du public.
La raison d'être réelle des « obligations de service public » est donc différente de ce que proclament les hommes de l'Etat. Il ne peut s'agir de pallier des « carences du marché » dont l'existence ne peut pas être prouvée, ne serait-ce que parce que le « service public » interdit par sa seule présence d'établir ou de réfuter leur réalité. Il ne peut s'agir que secondairement de forcer le « service public » à servir le public, puisque le meilleur moyen de résoudre ce problème-là serait de supprimer le statut public, et que les hommes de l'Etat sont prêts à « tout » pour résoudre les problèmes... mais pas à reconnaître que leur solution passe par la disparition de leurs ingérences. Non : la seule véritable raison d'être des « obligations de service public » est d'exprimer le pouvoir des hommes de l'Etat, et de traduire leur nature véritable de mouches du coche dans l'activité productive.
Mais qu'est-ce au juste qu'un « service public » ?
Il reste à discuter de l'assise juridique sur laquelle les hommes de l'Etat prétendent établir les « services publics ». Nous avons vu que la notion de « carence du marché » est purement et simplement absurde ; dès lors que l'on a refusé d'admettre cette conclusion nécessaire, on peut dire et faire n'importe quoi. Ce n'importe quoi-là, juridiquement, se traduit par un fantôme auquel l'institution du « service public » est censée donner corps. Ce fantôme est l'idée qu'il existerait, dans la nature des choses, des caractéristiques propres à certains services et qui en feraient, par nature, des « services publics ». En somme, un service devrait être « public » parce qu'il est (déjà!) un « service public ». On voit les hommes de l'Etat prendre au sérieux cette chimère, et discuter gravement pour savoir si l'information, ou le transport, « sont » des « services publics ». Comme nous avons vu que tout cela ne repose sur rien, et sert essentiellement à asseoir le pouvoir abusif des hommes de l'Etat, ne soyons pas trop surpris qu'à cette importante question, ces mêmes hommes de l'Etat ne répondent pas trop souvent par la négative.
Toujours est-il que notre droit positif, officiellement et solennellement pince-sans-rire, accorde une large place à cette plaisanterie. Il n'est que de prendre connaissance des attendus de la jurisprudence administrative pour s'en rendre compte et même bien souvent craindre qu'à force de se prendre au jeu, les hommes de l'Etat qui les rédigent ne finissent par y croire. Comme pour confirmer ces inquiétudes, on pourra constater que les textes constitutionnels eux-mêmes reprennent à leur compte cette chimère : le préambule de la Constitution de 1946, auquel la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence, ne mentionne-t-il pas (pour justifier sa confiscation par les hommes de l'Etat) l'éventualité qu'une organisation productive acquière le caractère d'un service public ? Si l'entreprise peut devenir un « service public » avant que les hommes de l'Etat ne l'aient décidé, c'est qu'elle possède des caractéristiques spécifiques qui la destinent naturellement à en devenir un. Telle est, du moins, la version officielle.
Tout cela reposant sur un refus d'admettre une vérité nécessaire (à savoir qu'il n'y a pas de « défaillances du marché »), nous allons voir qu'au contraire ce sont les hommes de l'Etat et eux seuls, comme la Reine d'Alice au pays des merveilles, qui décident dans l'arbitraire et la subjectivité la plus complète, ce qui « est » un « service public » (et plus rarement, ce qui n'en « est pas » un) et que, pour quiconque se soucie d'un minimum d'objectivité, la définition du « service public » se réduit à l'institution elle-même.
« Est » un « service public », par conséquent, ce dont les hommes de l'Etat ont décidé de faire un « service public ». Que ces mêmes hommes de l'Etat l'aient fait pour des raisons déterminées, cela n'est que trop certain. Qu'ils se soient fondés pour le faire sur des motifs démontrables, c'est en revanche ce qui ne saurait être établi. Nous l'avions prouvé a priori ; nous allons maintenant établir par l'observation que la seule chose qui permette de définir objectivement le « service public » est qu'à la différence du service de droit commun, rendu par des personnes libres d'agir et responsables de leurs actes sur leur personne et leurs biens, il est dispensé de servir le public pour recevoir son argent. D'où l'obligation, pour quiconque a un minimum d'honnêteté, d'assortir l'expression « service public » des guillemets appropriés.
La définition institutionnelle du « service public » est la suivante :
- le « service public » est une organisation monopolistique contrôlée par les hommes de l'Etat, à laquelle ils garantissent statutairement tout ou partie de son financement indépendamment de la satisfaction de ceux qui utilisent ses services ainsi que du consentement de ceux qui les paient.
- Cette dispense se traduit par des privilèges (des exceptions au droit commun) défendus par la force publique, des monopoles d'activité, le financement par l'impôt plutôt que par la vente libre de ses produits, la garantie d'emploi accordé aux agents, l'accès privilégié au domaine public, etc.
Indépendamment de cette définition institutionnelle, quels sont les critères du « service public » extérieurs à lui-même et qui permettraient de le définir autrement ? Aucune observation ne permet de les découvrir. Quand la jurisprudence décide qu'un service est « public » ou non, ce n'est jamais à partir de critères précis qui permettraient de l'identifier. Bien au contraire, lorsque les juges ont à en connaître, ils se gardent bien de dévoiler leurs motifs et de lier leurs décisions à venir par des critères identifiables a priori. Bien au contraire, on est censé déduire ce qu'ils ont dans la tête à ce moment-là du fond même de leurs décisions. Que la plupart des juristes, accoutumés à ne traiter que des cas limites, ne voient pas le danger d'un tel arbitraire est une chose. Que l'on puisse accepter que les hommes de l'Etat, dans tous les domaines, puissent choisir de confisquer aux autres leur liberté de choix sans la moindre limite de principe en est une autre, assurément plus grave.
Nous connaissons bien les économistes qui affirment avoir découvert des concepts théoriques permettant d'identifier ce qui devrait être un « service public » et ce qui pourrait ne pas en être. Il s'agit des « biens publics » et des « monopoles naturels ». Ces concepts, malheureusement, souffrent des mêmes inconvénients que la prétendue « défaillance du marché » dont ils ne sont que des variantes : c'est que personne ne peut les identifier dans la réalité. Nous prouverons bien entendu que ces concepts ne sont pas moins faux (et que c'est bien pour cela qu'on les utilise) ; cependant, même leurs partisans pourront admettre ce qu'il nous suffira d'affirmer ici, à savoir qu'il n'existe aucun moyen indiscutable de savoir ce qui est ou n'est pas un « bien public » ou un « monopole naturel ». D'ailleurs, personne ne se sert réellement de ces constructions intellectuelles pour décider s'il faut ou non imposer le monopole d'Etat. On les invoque seulement auprès de ceux qui sont susceptibles d'y croire, en guise de rationalisation automatique a posteriori.
Le « service public » est une cause majeure des « carences » attribuées au « marché »
Nous n'en avons pas moins besoin, pour examiner les conséquences du « service public », de nous servir du concept de « monopole ». En effet, de toutes ses interventions, le « service public » est la création monopolistique de l'Etat qui vise le plus délibérément à interdire la concurrence : lorsque le pouvoir politique décide de l'instaurer, c'est au préjudice des productions concurrentes qu'il définit les « obligations de service public » : nature des services, conditions de leur fourniture et types de rémunérations, car ces obligations seront toujours imposées en l'échange d'un privilège de monopole, prétendument nécessaire et suffisant pour garantir la permanence de l'offre : une subvention, qui privilégiera ces productions, ou une interdiction pure et simple de produire signifiée aux autres. (Ayant ainsi chassé l'initiative privée, le pouvoir politique se félicitera d'avoir paré à la « carence des entrepreneurs »).
Par conséquent, avant même de dissiper la chimère officielle du « monopole-sur-un-marché-libre », nous devons sauter à la conclusion de l'analyse sémantique et fournir au monopole les définitions objectives dont dépend une compréhension correcte de ses conséquences.
Ce qu'est un monopole
Correctement entendu, le monopole désigne l'emploi de la force pour empêcher la concurrence, c'est-à-dire interdire à un entrepreneur d'offrir de meilleurs services à la vente. L'Etat est à la fois le parangon et la source de tous les monopoles. « L'Etat », disent les juristes, « dispose par définition du monopole de la violence légitime ». Comme cette approbation implicite prend un parti idéologique, nous dirons plutôt que par définition, les hommes de l'Etat en tant que tels prétendent au monopole de la violence manifeste et impunie. Il faut en déduire que, quels que soient les autres services qu'ils rendent, la seule activité qui distingue les hommes de l'Etat des autres personnes est que les secondes ne peuvent pas se livrer impunément à la violence.
La violence consiste à disposer de la personne et des biens d'une personne sans son consentement ou, plus techniquement (en termes de la théorie de l'information et du contrôle), à interférer physiquement avec le contrôle qu'une personne exerce sur ses possessions. La violence peut aller de la simple menace d'interférer jusqu'à l'assassinat de la victime et au vol de tous ses biens. Elle peut être directe ou indirecte, ouverte ou latente ; dans tous ces cas, le monopole reste un monopole. C'est ainsi que le privilège exclusif, qui permet à une entreprise de produire un certain service en l'interdisant aux autres, institue un privilège de monopole à son profit au détriment des secondes. De même la subvention, qui privilégie une organisation productive et place celle-ci dans une situation de supériorité concurrentielle déloyale, institue à son profit un privilège de monopole. Confèrent, par conséquent, un privilège de monopole sur le marché toute aide, protection ou avantage quelconque accordés par une action de l'Etat. Dans ces conditions, ces monopoles ne peuvent que pulluler. Sans préjudice de ceux qu'on ne voit pas immédiatement (dont l'identification requiert de connaître les lois de l'incidence et de la protection effective) on peut directement les observer dans toutes les activités économiques et sociales, et les hommes de l'Etat en créent constamment de nouveaux sans jamais supprimer les anciens. Quand ils le font ouvertement, ils les attribuent de préférence aux entreprises publiques, mais leurs interventions faussent aussi bien la concurrence au profit de certains entrepreneurs « privés ».
Mais il faut aller plus loin et constater que la contrepartie violente de toute faveur accordée crée elle-même une interdiction de produire qui fausse la concurrence. C'est évidemment le cas de la réglementation : une réglementation peut-être une interdiction conditionnelle de produire et d'échanger, qui fausse la concurrence au détriment de certains et au profit d'autres. Cependant, c'est aussi celui de l'impôt, car celui-ci taxe forcément certaines productions et en épargne d'autres, vers lesquelles les acheteurs sont susceptibles de reporter leur demande. La conséquence logique à en tirer est qu'en fait, toute intervention de l'Etat crée un privilège de monopole, parce qu'elle fait toujours violence aux uns en épargnant les autres, et qu'elle s'exerce toujours au profit des uns et aux dépens des autres.
Ces interdictions d'entrer sur le marché sont bien entendu innombrables : toutes empêchent de satisfaire un besoin, toutes interdisent de résoudre un problème, toutes font naître un écart trop perceptible entre ce qui est et ce qui devrait être : des rémunérations inégales pour des services comparables, des services qui ne sont pas rendus là où l'on en ressent le besoin, des gens qui se découragent de résoudre leurs problèmes sans savoir à quoi attribuer leur impuissance. En effet, ces écarts ne sont pas seulement inévitablement induits par les monopoles institutionnels : par-dessus le marché, leur origine est le plus souvent difficile à déceler, voire impossible pour qui n'a pas l'expertise appropriée. Parce que des fanatiques proclament que celui-ci n'a pas encore assez exterminé la liberté dans l'enseignement, on perçoit encore assez bien à quel point le financement public y évince l'entrepreneur qui refuse de porter le collier.
Mais qui se rend compte, lorsque les « banlieues » sont en flammes, que les brandons sont tenus par des gens habitués à tout attendre de la politique, et que le multiplication des « services publics » ne fait que les décourager de vivre par eux-mêmes ? Qui voit que la plupart des lignes TGV n'auraient aucune rentabilité si les réglementations de l'aviation civile ne doublaient le prix du billet d'avion par rapport à ce que l'expérience américaine prouve réalisable ? Aussi inéluctables et destructeurs qu'ils soient, les monopoles nécessairement induits par les interventions de l'Etat sont généralement trop indirects pour être perçus comme tels, et la cause de ces carences est alors attribuée à la liberté des contrats alors que c'est précisément son absence qui est à l'origine du problème. Alors que les privilèges de monopole nécessairement induits par toute intervention de l'Etat sont, et de loin, les causes les plus vraisemblables des « carences » observées dans la société, celles-ci n'en seront pas moins le plus souvent attribuées au « marché ».
Les "services publics, qui prétendent les pallier, figurent au premier rang de ces causes, et sont donc une source essentielle des désordres auxquels ils sont censés remédier. Entretenir soi-même les troubles que l'on prétend traiter, voilà qui semble paradoxal ; mais n'est-ce pas le fonds de commerce de la pratique étatiste ?
La seule caractéristique identifiable du « service public » est d'être l'agent de la violence agressive
L'existence du « service public » est en elle-même grosse d'un mensonge considérable, d'ailleurs caractéristique de l'étatisme. Ce mensonge consiste à faire croire que l'action de l'Etat serait indispensable à la fourniture d'un service, et le fait empirique concret susceptible d'asseoir ce mensonge est le mélange systématique de production réelle et de redistribution politique qui caractérise le « service public ». Cette confusion des genres vise évidemment à confondre les esprits puisque le discours officiel reprend explicitement le mensonge à son compte tandis que la fourniture d'un véritable service n'a nul besoin qu'on l'entretienne par le vol, tandis que pour sa part la redistribution politique pourrait fort bien emprunter des voies plus directes. Or, nous allons voir que le seul « service » pour la fourniture duquel le statut de « service public » ne soit pas nuisible mais indispensable est précisément cette redistribution politique même.
La première démarche intellectuelle à accomplir si l'on veut y voir clair est donc de démêler ce salmigondis afin de découvrir ce que l'on doit au statut public du service, et ce qu'on doit à son caractère d'organisation productive. Le critère de distinction est bien simple à trouver : c'est la violence. Le monopole, qui interdit la concurrence par la force, est un acte de violence. L'impôt, qui finance tout ou partie du « service public », est un autre acte de violence. La violence est donc tout ce qui distingue le « service public » d'une entreprise normale. Or, la violence est par essence destructrice. Elle ne peut servir la production que si elle s'oppose à une violence plus destructrice encore. En somme, la violence n'est productive que si elle est défensive et réparatrice. Au-delà, elle est destruction et vol.
La conclusion est simple : la violence impunie est la caractéristique fondamentale qui distingue le « service public » de l'organisation productive privée. Dans les cas de la police et de l'armée, la violence peut être défensive et réparatrice et donc utile, car les hommes de l'Etat y combattent des voleurs et des assassins. Les autres « services publics », en revanche, sont de pure agression, la violence qui les fonde n'étant dirigée que contre des innocents. Le service public est donc pour l'essentiel un instrument de redistribution politique. Si l'on excepte les services authentiques qui, à l'exception des fonctions dites « régaliennes », sont par définition de nature non violente et se passent donc fort bien de son statut d'exception, le « service public » n'est là que pour rendre ce service particulier qui consiste à voler aux uns pour donner aux autres. De l'aveu même de ses partisans, la raison d'être du « service public » est de substituer une allocation politique des richesses, services et rémunérations, à une détermination marchande. Et cela, il le fait en s'appuyant sur la force publique. C'est ce qu'Oppenheimer appelait disposer de ressources par des moyens politiques, le vol, qu'il opposait aux moyens économiques : la production, l'échange et le don.
Pour examiner la nature et les conséquences du « service public » proprement dit, par opposition à la production authentique de services, il suffira d'étudier les actes d'agression qui le maintiennent dans son être. On identifiera donc la nature de ses actes, leurs auteurs, leurs victimes et bénéficiaires ostensibles, ainsi que leurs victimes et bénéficiaires réels. Une partie de cette analyse va de soi, puisque dans l'arène politique les décisions appartiennent par définition à ceux qui sont politiquement puissants. Comme d'un autre côté, le pouvoir de prendre s'exerce forcément aux dépens de qui ne peut l'empêcher, on désignera la victime comme le « faible » de cette distribution.
On pourra en conclure que la raison d'être du « service public » est de permettre aux gens politiquement puissants de s'emparer des richesses des gens politiquement faibles. L'expérience montre d'ailleurs, les théoriciens des « choix publics » l'ayant illustré par de nombreux travaux, qu'ils en disposent conformément à leurs intérêts les plus étroitement personnels. La vraie question consiste à savoir dans quelle mesure la fourniture de services authentiques est sacrifiée au profit de cette distribution politique, et la vraie difficulté est plutôt d'établir qui sera réellement enrichi ou appauvri par cette redistribution.
L'expression « service public » est un instrument de combat idéologique
Ayant établi que le « service public » n'a pas d'autre définition ni raison d'être que celle d'un instrument de pillage, il faut immédiatement noter que l'expression « service public » n'est absolument pas innocente : elle est au contraire apologétique et même doublement malhonnête puisqu'elle vise à faire admettre, et ce sans examen, le contraire de ce qui est : à savoir que le statut « public » aurait pour but de servir le public, et qu'il y pourrait y avoir des raisons objectives de l'imposer à cette fin. Impliquer que le « service public » puisse avoir une définition autre que circulaire, c'est-à-dire institutionnelle (« est un 'service public' ce que les hommes de l'Etat ont décidé de nommer tel et de traiter comme tel »), est un procédé éminemment sophistique qui appartient à la langue de bois.
La langue de bois est un discours dont on use délibérément pour neutraliser l'esprit critique, et qui conduit à chercher dans la réalité ce qui ne peut pas s'y trouver. Le discours de bois n'a pas de référent observable dans la réalité, c'est-à-dire qu'il n'a pas de signification possible ; il consiste à aligner des abstractions flottantes. Sa raison d'être est de paralyser la volonté de quelqu'un pour le soumettre : lorsque le rapport avec la réalité est purement absent, il vise simplement à neutraliser la pensée. Lorsque l'absurdité flamboie et s'étale, il s'agit de sidérer un adversaire qui ne pouvait concevoir une telle mauvaise foi*.
L'expression « service public » appartient à la langue de bois dans la mesure où elle empêche de réfléchir sur les problèmes induits par l'étatisme. Elle fait admettre sans examen le présupposé selon lequel imposer le monopole obéirait à des critères rationnels, alors que la Raison exigerait qu'ils fussent tous supprimés. Elle conduit à écarter par hypothèse, et par hypothèse inconsciente, la seule solution à la question posée : « servir le public », qui serait de supprimer ce « service public » dix mille fois prétendu. Ainsi permet-elle de neutraliser toute opposition aux monopoles arbitrairement imposés par les hommes de l'Etat : car elle voue à une impuissance obligée quiconque voudrait argumenter à leur encontre sans remettre en cause la notion elle-même.