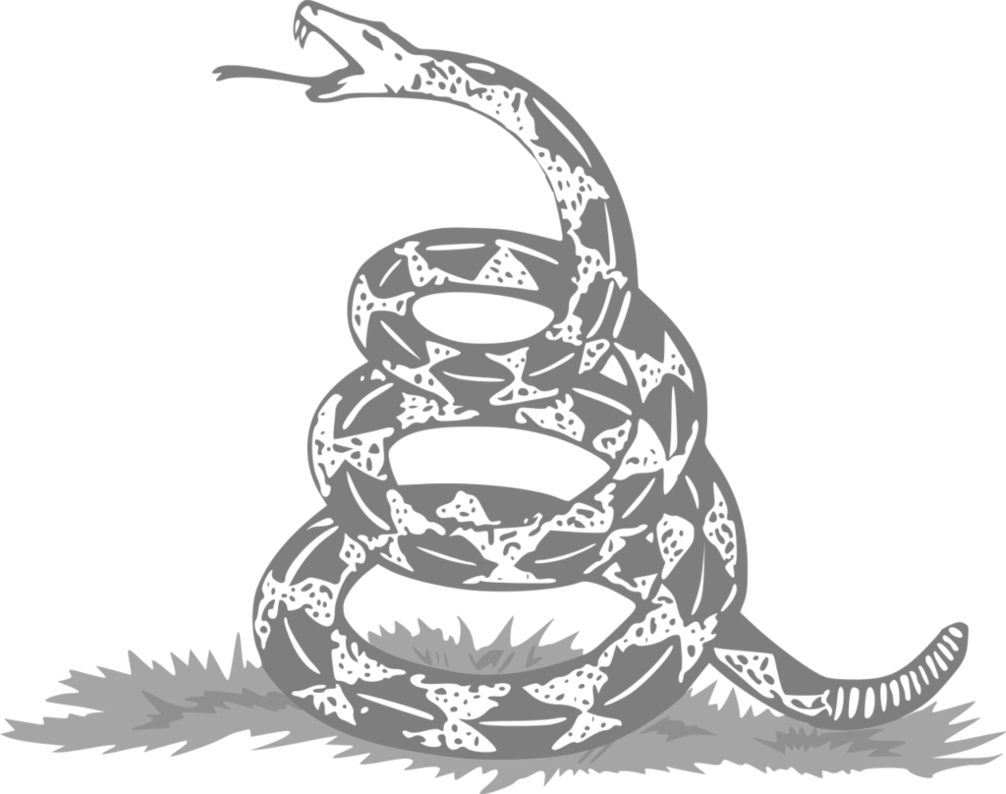L'Antitrust
par Alan Greenspan (1)
Le monde des politiques de concurrence rappelle celui d'Alice au Pays des merveilles : tout semble à la fois être mais en même temps, semble-t-il, n'est pas. Dans un monde où l'on exalte la concurrence comme l'axiome fondamental, comme le principe directeur, on trouve pourtant à condamner une concurrence "excessive" comme prétendument destructrice. C'est un monde où l'on dénonce comme "délictueux" les actes qui visent à atténuer la rivalité lorsqu'ils sont accomplis par les dirigeants d'entreprise, mais où l'on exalte leur caractère "éclairé" quand ils sont commis par les hommes de l'Etat. C'est un monde où la législation est si vague que les entrepreneurs n'ont aucun moyen de savoir si telle ou telle action sera tenue pour illégale tant qu'ils n'auront pas entendu le verdict du juge, bien après les faits.
Vu la confusion, les contradictions, et le légalisme absurde qui caractérise les "politiques de concurrence", je soutiens que c'est le système entier qu'il faut remettre à plat. Il est nécessaire de s'assurer
- (a) des racines historiques de la législation antitrust et
- (b) des théories économiques sur lesquelles ces lois s'appuient.
Les Américains ont toujours craint la concentration d'un pouvoir arbitraire aux mains des hommes politiques. Et bien peu étaient, avant la Guerre de sécession, ceux qui attribuaient un tel pouvoir aux chefs d'entreprise. On se rendait compte que c'étaient les hommes de l'Etat qui ont le pouvoir légal d'imposer la soumission par le recours à la force physique et que c'est là une capacité que les dirigeants d'entreprise n'ont pas. Un entrepreneur avait besoin de ses clients. Il devait les convaincre en vertu de leur intérêt propre.
Cette manière de juger de la question changea très vite, immédiatement après la Guerre de sécession, principalement avec l'apparition des chemins de fer. Ceux-ci, en apparence, n'avaient pas l'appui de la force légale. Mais pour les agriculteurs de l'Ouest, les chemins de fer semblaient bien détenir le pouvoir arbitraire qu'auparavant on n'attribuait qu'aux hommes de l'Etat. On aurait dit que les sociétés ferroviaires n'étaient pas contraintes par les lois de la concurrence. Elles paraissaient pouvoir imposer des tarifs calculés pour ne laisser aux cultivateurs que le grain pour les semailles ni plus, ni moins. La protestation paysanne prit la forme du National Grange Movement, l'organisation qui fit voter l'Interstate Commerce Act de 1887.
Dans la foulée, on prétendit aussi que les géants industriels, tels que la Standard Oil Trust de Rockefeller qui se développait à cette période, échappaient à la concurrence aini qu'aux lois de l'offre et de la demande. La réaction du public contre les trusts atteignit son apogée avec le vote du Sherman Act de 1890.
On prétendit alors, comme on le fait encore aujourd'hui, que le capital, si on le laissait faire, se changerait nécessairement en une institution dotée d'un pouvoir arbitraire. Or, cette affirmation-là est-elle vraie ? L'après-guerre de sécession a-t-elle vraiment donné naissance à une nouvelle forme de pouvoir arbitraire ? Ou était-ce encore les hommes de l'Etat qui étaient la source d'un tel pouvoir, l'entreprise se bornant à fournir un nouveau truchement pour l'exercer ? Voilà la question historique essentielle.
Avant la Guerre de sécession, les chemins de fer s'étaient développés dans l'Est dans le cadre d'une âpre concurrence les uns avec les autres, de même qu'avec les autres formes de transport : chalands, navires ou chariots. Or, vers les années 1860, apparut une agitation politique exigeant que les chemins de fer s'étendent vers l'Ouest pour relier la Californie au reste du pays. L'honneur national, paraît-il, était en jeu. Cependant, le volume du trafic au-delà de l'Est fortement peuplé était insuffisant pour attirer le transport commercial vers l'Ouest. Le bénéfice éventuel ne justifiait pas le coût élevé de l'investissement en équipements de transport. On décida donc, au nom de l'"intérêt général", de subventionner les transporteurs ferroviaires pour les pousser vers l'Ouest.
Entre 1863 et 1867, ce furent près de quarante millions d'hectares de terrains publics qu'on distribua aux chemins de fer. Comme ces attributions n'avaient été faites que pour certains trajets, aucune société concurrente ne pouvait pousser à son tour vers l'Ouest pour offrir ses propres services à la même clientèle. De même, les autres modes de transport (chariots, bateaux fluviaux, etc.) ne pouvaient pas non plus financer une concurrence faite au train dans cette partie-là du pays. C'est ainsi qu'avec l'aide des hommes de l'Etat fédéral, une partie de l'industrie des chemins de fer put se soustraire aux contraintes de la concurrence qui régnait à l'Est.
Comme on pouvait s'y attendre, les subventions avaient attiré le genre de promoteurs qui existe toujours à la marge de la communauté des affaires et qui sont toujours à la recherche du "coup facile". Un grand nombre des nouvelles lignes de l'Ouest étaient tracées à la va-vite. On ne les avait pas construites pour transporter quelque chose, mais pour obtenir les terrains attribués.
Cela faisait donc des chemins de fer de l'Ouest des monopoles authentiques au sens des manuels. Ils pouvaient bel et bien exercer un pouvoir arbitraire, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ce pouvoir-là, ce n'est pas d'un marché libre qu'il l'avaient tiré ; ils le devaient aux subventions et interdictions imposées par les hommes de l'Etat (2).
Lorsqu'à l'Ouest le trafic eut atteint des niveaux permettant à d'autres transporteurs d'être rentables, le pouvoir de monopole des chemins de fer disparut rapidement. Leurs privilèges initiaux ne les protégèrent en rien contre les pressions de la libre concurrence.
Entre-temps, néanmoins, notre histoire économique avait pris un tournant inquiétant avec l'Interstate Commerce Act de 1887.
Ce n'étaient pas les "défauts" du marché libre qui avaient nécessité cette législation. Comme toutes celles qui suivirent pour réglementer les entreprises, cette loi était une tentative pour remédier aux désordres qu'avait causés l'intervention antérieure des hommes de l'état. A son tour, l'Interstate Commerce Act faussa encore davantage l'organisation et le financement des chemins de fer. Et aujourd'hui, c'est à coups de nouvelles subventions qu'on propose de les corriger. Les chemins de fer sont au bord de l'effondrement final, mais personne ne met en cause la fausseté du diagnostic initial, pour découvrir la véritable cause de la maladie et lui porter remède.
Que l'on interprète l'histoire des chemins de fer au XIXème siècle comme "prouvant" les défaillances du marché libre est une erreur catastrophique. Une même erreur au XIXème siècle, persistant encore aujourd'hui, consistait dans la crainte des prétendus trusts.
Le plus impressionant de ces "trusts" était la Standard Oil. Cependant, au moment où le Sherman Act fut voté, avant qu'il n'y eût des automobiles, l'industrie pétrolière dans son ensemble ne représentait que moins d'1 % du PNB et à peine un tiers de l'industrie de la chaussure. Ce n'était pas tant la taille absolue de ces trusts que leur domination dans leurs domaines propres d'activité qui avait engendré l'appréhension. Pourtant, ce que les observateurs ne comprenaient pas, c'est que le contrôle par la Standard Oil, au tournant du siècle, de plus de 80 % de la capacité de raffinage, avait une justification économique, accélérant la croissance de l'économie américaine.
Ce contrôle-là engendrait des gains évidents d'efficacité productive, en intégrant les diverses opérations de raffinage, de distribution et de transport ; il rendait aussi plus facile et moins chère la levée du capital. Les trusts étaient apparus parce qu'ils étaient les entités les plus efficaces dans des activités qui, étant relativement neuves, étaient encore trop petites pour entretenir plus d'une seule grande entreprise.
Historiquement, le développement général de l'industrie a suivi le déroulement suivant : une activité commence avec une poignée de petites entreprises ; avec le temps, un grand nombre d'entre elles fusionnent ; cela accroît l'efficacité et augmente les bénéfices. A mesure que le marché s'étend, de nouvelles entreprises entrent dans le domaine, réduisant la part de marché détenue par l'entreprise dominante. C'est le scénario suivi par les industries de l'acier, du pétrole, de l'aluminium, les récipients et nombre d'autres grandes industries.
Cette tendance observable, où l'on voit les entreprises dominantes d'une branche d'activité finir par perdre une partie de leurs parts de marché, ce n'est pas à la législation de la concurrence qu'on la doit. Elle tient au fait qu'il est difficile d'empêcher de nouvelles entreprises d'entrer sur le marché lorsque la demande pour le produit augmente. Texaco et Gulf Oil, par exemple, seraient devenues des grandes entreprises, même si la Standard Oil Trust du départ n'avait pas été divisée. De même, la domination de l'industrie de l'acier par la U. S. Steel Corporation aurait été érodée même sans l'application du Sherman Act.
Dans une économie libre, il faut une adresse extraordinaire pour conserver plus de 50 % du marché d'une grande industrie. Il faut une capacité productive hors du commun, un sens des affaires jamais pris en défaut, un effort continu pour améliorer sans cesse son produit et ses techniques. La société exceptionnelle qui parvient à conserver sa part de marché année après année, décennie après décennie, le fait parce qu'elle produit efficacement et mérite l'admiration ; certainement pas qu'on la condamne.
On peut comprendre le Sherman Act si on le considère comme une projection de la peur et de l'ignorance économiques du XIXème siècle. En revanche, il n'a absolument aucun sens dans le contexte de la connaissance économique contemporaine. Les soixante-dix années supplémentaires que nous avons eues pour observer le changement industriel auraient dû nous apprendre quelque chose.
Si c'est à tort que l'on cherche à trouver des historiques à nos réglementations antitrust, si elles reposent sur une interprétation fallacieuse de l'histoire, c'est sur une erreur conceptuelle encore plus fondamentale que reposent les tentatives faites pour les justifier par la théorie.
Aux débuts des Etats-Unis, les Américains jouissaient d'une grande marge de liberté économique. Toute personne était libre de produire ce qu'elle voulait, et de vendre à qui bon lui semblait, à un prix convenu d'un commun accord. Si deux concurrents en venaient à la conclusion qu'il était de leur intérêt commun de fixer ensemble leurs politiques de prix, ils étaient libres de le faire. Si un client demandait un rabais en échange de sa pratique, une entreprise (généralement de chemin de fer) pouvait accepter ou refuser à sa convenance. L'économie politique classique, qui avait une profonde influence au XIXème siècle, enseignait que la concurrence assurerait l'équilibre de l'économie.
Cependant, alors que nombre des théories des économistes classiques décrivaient correctement le fonctionnement d'une économie libre, leur conception de la concurrence était ambiguë et conduisit à une confusion dans l'esprit de leurs partisans. On entendait la "concurrence" comme consistant uniquement à produire et à vendre le maximum possible, à la manière d'un robot, subissant passivement le marché comme on accepte une loi de la nature, sans jamais faire aucune tentative pour influencer sa configuration.
Or, ce que faisait l'entrepreneur de la deuxième moitié du XIXème siècle, c'était tenter d'affecter les conditions du marché par tous les moyens de la publicité, des changements dans le rythme de la production, de la négociation avec les clients comme avec les fournisseurs.
Nombre d'observateurs, constatant que ces activités n'étaient pas prévues par la théorie classique, et en conclurent que la concurrence ne fonctionnait plus correctement. En fait, dans le sens où ils comprenaient la concurrence, celle-ci n'avait en fait jamais existé, sauf peut-être sur quelques marchés isolés de produits agricoles. En revanche, dans une acception qui n'est pas dépourvue de sens, la concurrence existait bel et bien au XIXème siècle, comme elle existe aujourd'hui.
La "concurrence" est un terme qui désigne l'action, non la passivité. Il s'applique à tous les domaines de l'activité économique, non seulement à la production mais aussi à l'échange ; il implique la nécessité d'agir pour faire pencher en sa faveur les conditions du marché.
L'erreur des observateurs du XIXème siècle consistait en ce qu'ils limitaient une vaste abstraction, celle de la concurrence, à un ensemble étroit de caractéristiques, la "concurrence" passive projetée par leur interprétation particulière de l'économie classique. En conséquence, ils conclurent que l'"absence" supposée de cette fiction d'une "concurrence" passive contredisait toute la construction théorique de l'économie classique, y compris la démonstration suivant laquelle le laissez-faire est le plus efficace et le plus productif de tous les systèmes économiques. Ils conclurent qu'un marché libre, par nature, conduit à sa propre destruction, et en vinrent à la contradiction grotesque de prétendre préserver la liberté du marché par des ingérences étatiques, c'est-à-dire de préserver les avantages du laissez-faire en entreprenant de l'abolir.
La question essentielle qu'ils n'avaient pas posée est de savoir si la concurrence "active" conduit ou non à l'institution de monopoles coercitifs, comme ils le supposaient, ou si une économie de laissez-faire, avec sa rivalité "active", ne posséderait pas un régulateur propre qui la protège et la préserve.
Un "monopole coercitif" est une société commerciale qui peut fixer ses prix et ses politiques de production indépendamment du marché, immunisée contre la concurrence, contre la loi de l'offre et de la demande. Une économie dominée par de tels monopoles serait rigide et stagnante.
La condition préalable nécessaire à l'établissement d'un monopole coercitif est l'interdiction d'entrer sur le marché : qu'on empêche les producteurs concurrents de pénétrer dans un domaine donné. Or cela, on ne peut le faire que par un acte d'intervention étatique, sous la forme de privilèges de réglementation, de subvention ou d'autorisation. Sans l'aide des hommes de l'Etat, il est impossible à qui voudrait devenir monopoleur d'établir ses politiques de production et de prix indépendamment du reste de l'économie. Car s'il tentait de fixer ses prix et sa production à un niveau qui offre à de nouveaux entrants une rentabilité sensiblement meilleure à celle qu'on peut trouver dans d'autres domaines, il est certain que les concurrents envahiraient son marché.
Le régulateur suprême, dans une économie libre est le marché des capitaux. Aussi longtemps que le capital est libre de circuler, il tendra à rechercher les domaines où le taux de rentabilité est le plus élevé.
L'investisseur éventuel ne prend pas seulement en compte le taux de rendement effectivement atteint par les entreprises d'une activité donnée. Sa décision quant à l'endroit où il investira dépend de ce que lui-même pourra gagner dans cette branche particulière. On calcule les taux de marge au sein d'une industrie à partir des prix de revient existants. Il lui faut envisager l'éventualité qu'un nouvel entrant sur le marché n'arrive pas tout de suite avec une structure de coûts aussi basse que celle de producteurs expérimentés.
Par conséquent, l'existence d'un marché libre du capital ne garantit pas qu'une entreprise dominante faisant beaucoup de bénéfices se trouvera nécessairement et immédiatement confrontée à des rivaux directs. Ce qu'elle garantit, c'est que si ces bénéfices sont dus à des prix élevés et non à des coûts plus bas, elle sera rapidement confrontée à une concurrence qui trouvera sa source dans le marché des capitaux.
Le marché des capitaux joue le rôle de régulateur des prix, mais pas nécessairement des bénéfices. Il laisse tout producteur individuel libre de gagner autant qu'il le peut s'il réduit ses prix de revient et accroît son efficacité relativement aux autres. Ainsi fonctionne le mécanisme qui crée une plus grande incitation à accroître la productivité et conduit par conséquent à un niveau de vie plus élevé.
C'est ce processus qu'illustre l'histoire de l'Aluminium Company Of America avant la Deuxième guerre mondiale. Calculant son intérêt propre et sa rentabilité à long terme en tenant compte d'un marché en expansion, l'ALCOA maintint le prix de l'aluminium à un niveau compatible avec l'expansion maximale de son marché. A de tels niveaux de prix, cependant, la rentabilité ne se maintenait qu'au prix de terribles efforts pour accroître efficacité et productivité.
L'ALCOA était un "monopole" au sens d'être le seul producteur d'aluminium de base, mais ce n'était pas un monopole coercitif, dans ce sens qu'il ne pouvait pas fixer ses politiques de prix et de production indépendamment du monde de la concurrence (3*) . En fait, c'est seulement parce que la société avait mis l'accent sur la baisse des coûts et l'efficacité et non sur des prix élevés, qu'elle put maintenir pendant si longtemps sa position de seul producteur d'aluminium de base. Si l'ALCOA avait tenté d'accroître ses bénéfices en augmentant ses prix, elle se serait vite retrouvée en concurrence avec de nouveaux entrants dans la production de l'aluminium de base.
En analysant le processus concurrentiel d'une économie de laissez-faire, on doit absolument reconnaître que les dépenses en capital (les investissements dans de nouvelles installations, soit de la part des producteurs en place, soit de celle de nouveaux entrants) ne sont pas déterminées par les seuls bénéfices actuels. On fait, ou on ne fait pas un investissement, suivant l'idée qu'on se fait de la valeur actualisée des bénéfices attendus dans l'avenir. Par conséquent, savoir si oui ou non un nouveau concurrent va entrer dans un domaine d'activité jusqu'à présent assuré par une seule entreprise, c'est sa rentabilité future attendue qui en décide.
La valeur actuelle des bénéfices qu'une entreprise est censée obtenir dans l'avenir est représentée par le prix de marché des actions ordinaires des sociétés de cette industrie (4). Si la valeur du capital augmente pour une société donnée (ou une moyenne de sociétés), ce changement implique une plus grande valeur actuelle des gains à venir.
L'observation statistique démontre la corrélation entre les prix des actions et les dépenses en capital, non seulement pour une branche d'activité, mais pour leurs regroupements (5). En outre, le délai entre les variations du prix des actions et les changements correspondants des dépenses en capital est plutôt court, fait qui implique que le lien entre les investissements en capital et les attentes de gain est relativement étroit. Si une telle corrélation marche aussi bien que cela, considérant les obstacles étatiques actuels au libre mouvement des capitaux, on doit conclure que sur un marché complètement libre le processus serait beaucoup plus efficace.
La rotation du capital d'un pays, dans une économie complètement libre, dirigerait sans cesse celui-ci vers les domaines de rentabilité, ce qui régulerait efficacement les politiques de prix concurrentiel et de production des entreprises commerciales, rendant impossible l'imposition d'un monopole coercitif. C'est dans ce qu'on appelle une économie mixte qu'un monopole coercitif peut croître et embellir, protégé qu'il est des disciplines du marché des capitaux par des privilèges d'exemption, de subvention et autres réglementations des hommes de l'Etat.
Pour résumer : tout l'appareil de la législation antitrust dans ce pays est un fatras d'irrationalité et d'ignorance économiques. Il est le produit a) d'une interprétation grossièrement erronée de l'histoire et b) de théories économiques plutôt naïves, et certainement irréalistes.
En dernier recours, certaines personnes prétendent qu'au moins les lois antitrust n'auront pas fait de dégâts. Ils affirment que, même s'il est vrai que le processus concurrentiel empêche de lui-même les monopoles coercitifs, il n'y a pas de mal à s'en assurer doublement en interdisant certains actes économiques.
Cependant, l'existence même de ces statuts indéfinissables et de cette jurisprudence contradictoire paralyse les dirigeants d'entreprise pour entreprendre ce qui serait autrement des projets parfaitement sains. Personne ne saura jamais quels sont les nouveaux produits, les procédés inédits, les machines et fusions réductrices de coûts qui ont été étouffés dans l'œuf par le Sherman Act. Personne ne pourra jamais calculer le prix que chacun d'entre nous a dû payer à cause de cette loi qui, en provoquant un emploi moins efficace du capital, nous inflige niveau de vie plus bas qu'il ne pourrait l'être autrement.
Aucune spéculation, en revanche, n'est exigée pour prendre la mesure de l'injustice et du mal faits aux carrières, aux réputations, et aux vies des dirigeants d'entreprises qu'on a mis en prison au prétexte des lois antitrust.
Ceux qui prétendent que le but de ces lois serait de protéger la concurrence, l'entreprise et l'efficacité, ont besoin qu'on leur rappelle la citation qui suit du Juge Learned Hand, dans son inculpation des pratiques prétendument monopolistiques de l'ALCOA.
- Il n'était pas inévitable pour elle de toujours prévoir les accroissements de la demande de lingots et de se donner les moyens d'y répondre. Rien ne la forçait à toujours doubler et redoubler sa capacité avant que d'autres n'entrent sur le marché. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais tenu aucun concurrent à l'écart ; mais nous ne pouvons pas imaginer d'exclusion plus efficace que de saisir progressivement toutes les occasions à mesure qu'elles se présentaient, et d'accueillir tout nouvel arrivant avec une capacité nouvelle, déjà intégrée à une grande organisation, avec les avantages de l'expérience, des relations d'affaires et de l'élite du personnel.
C'est condamner l'ALCOA parce qu'elle marche trop bien, qu'elle est trop efficace, et réussit trop dans la concurrence. Quelque dommage que la législation antitrust ait fait à notre économie, quelque distorsion qu'elle ait fait subir à la structure de son capital, ils sont moins catastrophiques que ce fait-là : la raison d'être réelle, l'intention cachée et la pratique effective des politiques de concurrence aux Etats-Unis conduisent à ce qu'on condamne des membres productifs et efficaces de notre société pour cette raison même qu'ils sont productifs et efficaces.
Notes
- 1 Alan Greenspan a été Président de la Banque de Réserve Fédérale aux Etats-Unis.
- Titre original : "Antitrust", texte tiré du discours fait à l'Antitrust Seminar de la National Association of Business Economists, Cleveland, le 25 septembre 1961. Publié par le Nathaniel Branden Institute, New York, 1962 ; réédité dans Ayn Rand et al., Capitalism : The Unknown Ideal, New York, New American Library, 1967, pp. 64-65.. Traduit par François Guillaumat.
- 2 C'est à Ayn Rand que je dois d'avoir identifié ce principe. Cf. Rand, "Notes on the History of American Free Enterprise", ch. 7 de Capitalism, The Unknown Ideal.
- 3 L'auteur semble raisonner comme si la définition du "marché" était objective, de sorte qu'on puisse définir sans ambiguïté un "monopole" comme un vendeur "seul sur son marché", qui "n'aurait pas à se soucier de la concurrence".
- En fait, tout produit a nécessairement des substituts plus ou moins proches, à plus ou moins long terme. Il n'y a donc jamais de "monopole" absolu (il vaudrait mieux conserver le terme pour les actes de violence qui faussent la concurrence) et la définition "du marché" n'est jamais incontestable.
- On peut toujours définir "le produit" de telle manière que son producteur paraisse détenir une part prépondérante ou au contraire négligeable de "son marché", et l'entrepreneur doit toujours tenir compte, en même temps que de l'apparition éventuelle de nouveaux rivaux pour "son produit", de la concurrence permanente et nécessaire de ses substituts [F. G.].
- 4 Alan Greenspan, "Stock Prices and Capital Evaluation", texte présenté le 27 décembre 1959 à une session commune de l' American Statistical Association et de l'American Finance Association.
- 5 Pour une analyse détaillée de cette corrélation, cf. Alan Greenspan, "Business Investment Decisions and Full Employment Models", American Statistical Association, 1961 Proceedings of the Business and Economic Statistics Section.