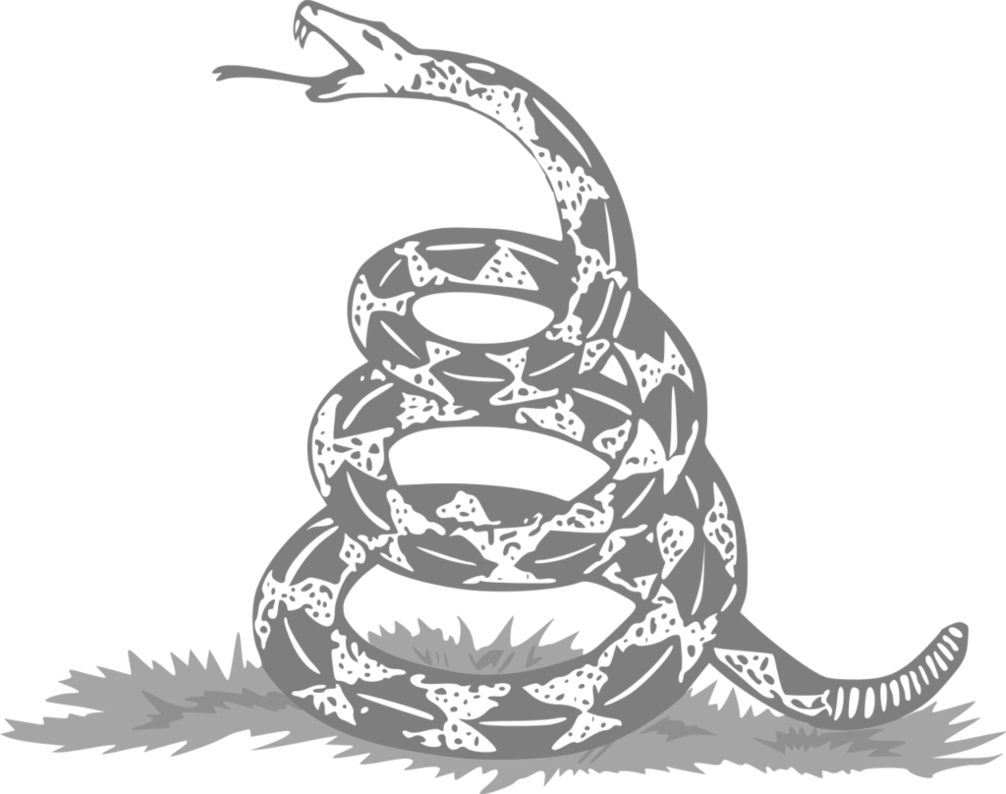« Voleurs de pauvres » : différence entre les versions
Kae (discussion | contribs) Aucun résumé des modifications |
Kae (discussion | contribs) |
||
| Line 202: | Line 202: | ||
:Ni la réflexion, ni l’expérience ne permettent de penser qu’un autre système social puisse être aussi avantageux pour les masses que ne l’est le capitalisme. Le marché libre n’a pas besoin d’apologistes. Il lui suffit de s’appliquer à lui-même les mots qui figurent sur l’épitaphe de Sir Christopher WREN, architecte de la cathédrale Saint-Paul à Londres : ''si monumentum requiris, circumspice'' ; “si c’est un monument qu’il te faut, regarde autour de toi” [15]. | :Ni la réflexion, ni l’expérience ne permettent de penser qu’un autre système social puisse être aussi avantageux pour les masses que ne l’est le capitalisme. Le marché libre n’a pas besoin d’apologistes. Il lui suffit de s’appliquer à lui-même les mots qui figurent sur l’épitaphe de Sir Christopher WREN, architecte de la cathédrale Saint-Paul à Londres : ''si monumentum requiris, circumspice'' ; “si c’est un monument qu’il te faut, regarde autour de toi” [15]. | ||
:::::::::'''[[François Guillaumat]]''' | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
Revision as of 5 August 2006 à 03:05
La justice sociale, cause essentielle de l’exclusion du même nom
- Les gens qui se battent pour la libre entreprise […]
- ne défendent pas les intérêts de ceux qui se trouvent aujourd’hui être riches.
- Ludwig von MISES, L’Action humaine
- Le Droit de propriété,
- qui interdit aux riches comme aux pauvres
- de coucher sous les ponts
- Anatole FRANCE
Pour une fois, une citation avec laquelle je ne suis pas d’accord. Elle aurait été bien plus pertinente si elle avait mentionné
- “la propriété naturelle, qui interdit de voler aux puissants comme aux faibles”.
Car ce qu’a l’air d’y suggérer Anatole FRANCE, c’est que la propriété ne serait une contrainte que pour les pauvres, et ne gênerait guère les riches. Je souhaite rappeler un certain nombre de faits évidents, et d’autres qui le sont moins, pour montrer que l’intérêt suprême des pauvres est au contraire, bel et bien, que personne ne vole personne.
Rappel de quelques évidences
Le pauvre est prétexte à force politiques de redistribution, entreprises au nom d’une prétendue “justice sociale”. Or, à dénoncer celle-ci comme une escroquerie morale, on risque encore de faire de la peine à des gens sincères. Ils semblent penser qu’on pourait comettre une injustice sans violence, mensonge ni ignorance coupable, et à l'inverse, qu'on pourrait en toute innocence commettre des violences, organiser des tromperies et refuser de conaître les effets de ses actes.
On pourrait associer cette idée à la conception augustinienne, janséniste voire protestante de la nature humaine, réfutée par le canon 7 du Concile de Trente, où la nature humaine est si totalement pervertie par le péché originel que l’on pourrait faire le mal sans avoir aucune possibilité de le connaître.
On n’exprime pas toujours clairement cette idée, et c’est ce qui fait sa force parce qu’elle ne résiste pas à l’examen rationnel. Et lui opposer des “preuves” factuelles est quand même faire trop bon marché du fait que la propriété naturelle comme critère de justice - qui réfute toute idée d'injustice sans interférence avec la possession légitime - est logiquement prouvée et que l’expérience ne peut pas contredire la logique, parce qu’elle en est elle-même dépendante.
Pour reprendre les termes de Hans-Hermann HOPPE :
- L'expérience ne peut pas l'emporter sur la logique, c'est le contraire qui est vrai. C'est la logique qui améliore l'expérience et qui nous dit quel est le type d'expérience qu'il nous est possible d'avoir et lesquelles sont au contraire le produit de la confusion intellectuelle, et qu'on fera donc bien d'appeler des "rêveries" ou des "fantaisies" plutôt que de les prendre pour des "expériences" de la réalité [1].
La “justice sociale”, c’est le n’importe quoi idolâtre de l’État
La propriété naturelle consiste à ne pas voler ni tromper autrui. Elle n’est pas seulement un principe traditionnel et irréfutable, universel et exclusif de tout autre, ce qui suffit à disqualifier toute définition concurrente de la justice, elle est aussi son seul critère objectivement observable.
Toute notion de “justice sociale” oppose expressément à la justice naturelle, dont elle prétend réformer les effets, une prétendue “justice distributive” incompatible avec elle. Elle ouvre donc la boîte de Pandore de l’arbitraire et du subjectivisme inhérents au socialisme. Et c’est une idolâtrie de l’État parce que seul Dieu peut être propriétaire et maître de toute chose, et sonder les reins et les cœurs au point d’apprécier les besoins en dépit de ceux qui les éprouvent, les mérites en dépit de ceux qui reçoivent les services.
La redistribution politique socialiste est faite par les puissants aux dépens des faibles
Mais il est une évidence bien plus sûre encore, c’est qu’on ne peut pas trouver de meilleure définition du pouvoir politique que d'être en mesure de faire impunément violence aux autres, ni de la faiblesse que d’être impuissant contre une agression.
Comme la propriété naturelle est toujours première, il en résulte de toute nécessité que toute redistribution politique socialiste qui la nie et prétend, soi-disant, la “réformer”, est faite par les puissants et s’exerce aux dépens des faibles.
Qui donc est puissant dans la démocratie sociale ?
Il est vrai que dans une société démocratique idéale au sens de ROUSSEAU, société de masse sans corps intermédiaire, aux choix politiques déterminés par la seule cupidité, le candidat au pouvoir doit toujours voler la moitié riche pour y accéder. Mais au profit de qui ? Si sa coalition majoritaire dépasse les 50 %, il aura moins de butin à répartir, entre davantage de receleurs, il risque d’être battu. Dans ces conditions, il y a bien des chances que les votes s’équilibrent. C’est donc l’électeur du milieu, l’électeur médian, qu’il faut courtiser. C’est lui qui recevra l’essentiel des redistributions. Mais les candidats seront aussi sensibles aux lobbies, qui contrôlent des blocs de voix et menacent de les donner à l’adversaire, et aux riches, qui peuvent leur donner d’autres moyens de l’emporter dans la rivalité électorale, notamment se faire connaître ou acheter les juges. Ainsi s’organise la politique.
Dans ces conditions l’un et l’autre parti de gouvernement ont intérêt à faire, et feront largement la même politique, le “parti des riches” devant constamment dépouiller ses propres électeurs en s’efforçant de leur présenter comme pire l’autre terme de l’alternative. Comme le dit Anthony de JASAY, appliquant aux marges de manoeuvre de la politique les lois universelles de la tendance vers l'équilibre concurrentiel :
- [que ce soit] avec l'argent de la minorité qu'il faut payer la majorité […] ne laisse guère aux hommes de l'Etat le choix du système redistributif à imposer […] le principe même de la "décision populaire" conduit à une situation où il n'y a plus grand-chose entre quoi décider [2].
Les pauvres sont des cons
Le pauvre c’est celui qui n’a pas su produire… ou voler suffisamment : il a donc peu de chances d’être lui-même puissant, soit qu’il n’ait pas assez d’instruction, soit qu’on le dupe facilement. Le dessinateur REISER avait donné ce titre à l’un de ses albums : Les pauvres sont des cons.
Car le pauvre qui devient puissant — le gangster cégétiste, par exemple — eh bien il devient riche (Michel de Poncins a calculé le capital qu'il faudrait avoir pour se payer les avantages en nature des syndicalistes et autres fonctionnaires : ces gens-là arrivent à le cacher, mais leur richesse est fabuleuse).
On pourrait appeler cela le Paradoxe de Robin des Bois. René GOSCINNY l’a présenté dans une aventure de LUCKY LUKE où Jesse JAMES, qui affecte de voler les riches pour donner aux pauvres, après lui avoir officiellement demandé s’il l’était, donne à un pauvre le butin d’un de ses vols — “je suis riche !” s’écrie celui-ci Alors Jesse JAMES le vole à son tour, puisqu’il est riche.
Bref, lorsqu' il arrive que les riches ne soient pas puissants ni les pauvres faibles (cela peut se produire à la suite d'une révolution), cela ne peut pas durer : avec un État voleur comme la démocratie sociale, il faut que l'argent achète les armes et que les armes volent l'argent. La tendance est donc à ce que les riches soient puissants, et les pauvres faibles. Ce n'est là qu'une tendance, l'un et l'autre sont formellement distincts, et c'est l'essence de la falsification marxiste de la lutte des classes que de postuler que les riches seraient automatiquement puissants : c'est une injustice ignoble que de traiter automatiquement les riches comme s'ils étaient de puissants voleurs, et comme si les socialistes au pouvoir n'en étaient pas. Cependant, cette tendance est toujours à l'oeuvre.
Non seulement les pauvres ne peuvent pas acheter le pouvoir, mais on les trompe facilement. On comprendra mieux à quel point quand on aura mesuré l’ampleur de l’ illusion fiscale, l’ignorance qui règne sur les effets réels de la redistribution politique socialiste. Car celle-ci ne conduit jamais aux résultats promis. C’est d’ailleurs pourquoi tous ses adeptes haïssent les économistes, dont c’est le métier que de le savoir.
On peut mentionner au moins quatre grands procédés d’illusion fiscale :
- — la violence indirecte, qui joue sur le fait que ce sont des échanges que rançonnent les hommes de l’État, et que la plus grande victime du pillage n’est pas l’agressé direct, mais celui qui peut le moins se passer de l’échange (c’est la loi fondamentale de l’incidence fiscale) : par exemple, les “cotisations” de “Sécurité Sociale” sont des taxes qui amputent les salaires, alors que ce sont les patrons que les démocrates-sociaux vont menacer pour voler l’argent. Le comble de la réussite en la matière est que les ouvriers applaudissent à ce vol, croyant que les hommes de l’État qui s’en vont avec près de la moitié de leur paie ont volé le patron à leur profit. La mythologie des “conquêtes sociales” repose essentiellement sur ce type d’illusion.
- — l’amalgame entre le pillage redistributif et la vraie production, caractéristique des prétendus “services publics” : il s’agit de faire croire à chacun qu’il profite de la redistribution parce que le service lui est utile. Par exemple, l’assurance contre les risques personnels prétendument fournie par la “Sécurité sociale”. Bien entendu, les “pauvres” sont l’alibi de ce pillage de tous (au profit des puissants). Le comble de l’amalgame réussi consiste à faire croire que le pillage politique serait indispensable à la fourniture du service réel. Si les hommes de l’état avaient monopolisé la production de chaussures, et les finançaient par le vol, il y aurait une majorité de gens pour dire que “si vous privatisez la production et le financement des chaussures, les pauvres iront pieds nus”.
- — La concentration des avantages et la dispersion des charges : les receleurs membres des lobbies sont peu nombreux et reçoivent beaucoup chacun, les victimes du pillage perdent peu (et ont donc un faible intérêt à s’organiser).
- — la persécution ostensible et corruptrice : il s’agit de voler beaucoup à peu de gens présentés comme riches, pour faire croire (en liaison avec les autres sources de l’illusion fiscale) que c’est ce groupe discriminé-là qui paie, de sorte que la redistribution politique soit perçue comme une bonne affaire pour les autres. Par ailleurs, en les rendant complices de cette injustice manifeste, on les prive du droit moral de résister aux autres prédations. L’impôt progressif est l’exemple type de cette persécution ; pour des raisons de technique démocratique, il remplace partiellement aujourd’hui la discrimination raciale qui est fondée sur les mêmes principes et appelle le même jugement.
Quelques politiques qui volent les pauvres alors qu’on croit le contraire
Rien n’est donc plus facile à quiconque connaît l’incidence réelle de la redistribution que d’énumérer des politiques qui volent les pauvres, alors que l’opinion reçue est qu’elles volent les riches au profit des pauvres [3]. ainsi,
- — l’impôt sur les sociétés, ostensiblement dirigé contre les capitalistes, vole surtout les salariés : ce sont les marchés financiers qui déterminent la rentabilité nette des placements. Dans un pays affligé par cet impôt sur les sociétés, les capitalistes n’investissent que si la rentabilité brute est assez grande pour compenser cet impôt, rétablissant la rentabilité nette imposée par la concurrence. Et il faudra bien prendre la différence sur le prix des fournitures de l’entreprise, donc largement sur les salaires. .
- — L’incidence de la redistribution est aussi incertaine à l’arrivée qu’au départ. Ainsi, le versement transports, qui ampute les salaires pour subventionner les transports en commun, peut bien contribuer à les rendre moins chers sur le moment, encore que le monopole ainsi créé gaspille largement la subvention. Mais en attirant du monde sur les lignes, il renchérit les logements avoisinants, et se retrouve finalement dans la poche des propriétaires. De sorte que si vous êtes salarié, et que vous vous déplaciez par vos propres moyens, vous aurez l’avantage qu’on ampute votre salaire pour qu’on puisse vous faire payer plus cher votre logement.
- L’impôt ou la subvention porte toujours principalement sur l’objet le plus spécifique à l’activité taxée : c’est pourquoi les subventions insanes au foutebole se retrouvent dans le prix des joueurs, celles à l’opéra dans la poche des PAVAROTTI. C’est un raisonnement emprunté à l’agriculture, où on le connaît depuis deux siècles sous le nom de théorie de la rente, c’est pourquoi, de même,
- — le protectionnisme agricole, qui appauvrit les acheteurs de produits alimentaires (les plus pauvres, proportionnellement, y dépensant le plus) profite exclusivement aux propriétaires fonciers, et d'autant plus qu'ils sont plus riches. Il n’y a aucun moyen de faire que de telles subventions, déguisées en monopole protectionniste ou expresses et directes, profitent au travail agricole, qui est toujours payé en moyenne 20 % de moins que les travaux urbains pour une formation équivalente.
Cependant, c’est souvent de manière plus expresse que la redistribution politique vole les pauvres. Il suffit alors que quelques-uns d’entre eux servent d’alibi aux riches profiteurs principaux. Ainsi,
- — Il est bien connu que le logement dit social est peuplé par des gens en moyenne plus riches que la population dans son ensemble. Il semblerait que dans ce domaine-là aussi, les amis auxquels hommes de l’État préfèrent faire cadeau de dizaines de milliers de francs soient plutôt des gens aisés. Ces gens-là ne fréquentent pas n’importe qui…
- — Les subventions aux "arts" et à la "culture" (musées, théâtres, opéras, bibliothèques) profitent essentiellement à une clientèle aisée.
- — L'enseignement pseudo-gratuit n’est pas seulement un instrument de guerre civile parce qu’il sert à censurer les opinions : c’est aussi parce qu’il permet à la bourgeoisie petite et moyenne de forcer ouvriers et employés à payer les études plus longues de ses enfants.
Enfin, il y a l’injustice couverte par une propagande qui falsifie constamment sa nature, comme
- — le salaire minimum dont on parle comme s’il s’agissait d’une garantie de revenu. Or, il n’est absolument jamais rien d’autre qu’une interdiction de travailler imposée aux moins qualifiés, ceux dont le travail ne pourrait pas rapporter plus d’une certaine somme à un employeur éventuel. Et les receleurs de cette injustice, ce sont les autres salariés, par définition plus riches, que cette interdiction protège de leur concurrence.
- — Mais on est toujours le pauvre de quelqu’un et rançonner un échange c’est l’interdire. L’impôt-subvention crée toujours des monopoles, et réciproquement. À son arrivée, on a l’exemple de l’enseignement, soumis à la concurrence déloyale des écoles subventionnées. À son départ, imposer le revenu des patrons individuels les prive aussi des moyens de concurrencer les entreprises plus grosses.
Ce qui nous permet d’arriver à la dernière catégorie du vol de pauvres, celui qui, non content de les dépouiller directement, prive les autres du moyen essentiel d’améliorer leur sort :
- — c’est le cas, entre autres, de la retraite par répartition : non seulement elle subventionne les bourgeois et les fonctionnaires, qui vivent plus longtemps et commencent plus tard à travailler, aux dépens des pauvres, qui travaillent plus tôt et meurent vite, mais elle freine l’accumulation du capital, décourageant les actifs d’épargner pour leurs vieux jours. Or, cette accumulation des capitaux matériels est le seul moyen d’accroître le salaire de celui dont la compétence ne progresse plus, parce qu’elle lui permet encore de produire davantage et donc d’être mieux payé, en associant à son travail une quantité plus grande de capitaux matériels.
- — C’est aussi le cas du déficit budgétaire, qui partage avec la retraite par répartition la caractéristique intéressante de vouer à l’esclavage les générations futures, et par ailleurs dissipe l’épargne réelle dans des fonds d’État qui, à la différence des fonds privés, ne servent pas à entretenir du capital matériel mais ne sont que de simples promesses d’argent volé.
Von MISES le rappelle :
- “le pouvoir utilise une partie de l’épargne personnelle pour la consommation courante, et […] rien n’empêche les hommes de l’État d’augmenter cette part jusqu’à en absorber en fait la totalité [4]”.
- Et il précise encore : “L’Histoire ne fournit aucun exemple d’accumulation de capital productif réalisée par les hommes de l’État [5]”.
La redistribution politique socialiste est la cause de l’“exclusion sociale”
Le démocrate-social écartera ces démonstrations comme théoriques (avec le simplisme et l’ extrémisme, c’est ce qu’il y a lieu de dire quand on n’a rien à répondre : conseil aux aspirants politiciens) : car, voyez-vous, c’est la “crise”. En attendant que l’on puisse réduire leurs interventions, il faut bien que les hommes de l’État, comme des pompiers, parent aux urgences qui se déclarent ici et là.
Bien entendu ces pompiers sont pyromanes et les feux, ce sont eux qui les allument. C’est la démocratie sociale qui crée le chômage, parce qu’elle interdit le travail et le rançonne, l’un et l’autre étant équivalents. Et c’est elle aussi qui crée la précarité parce qu’elle appauvrit tout le monde et multiplie les agressions.
Les interdictions de travailler
Par définition, le prolétaire c’est celui qui n’a pour richesse… que sa force de travail. Lui interdire de l’employer, c’est l’appauvrir radicalement. Ceux qui interdisent aux autres de travailler sont certes des esclavagistes : car la définition correcte de l’esclavage, c’est agir comme si on était propriétaire du travail d’un autre, à sa place : cela inclut de lui interdire de travailler comme de lui voler les fruits de son travail [6]. Mais ce sont avant tout, des voleurs de pauvres.
Nous sommes tellement habitués au chômage que des analphabètes à la FORRESTER peuvent échapper au ridicule public en prétendant que l’emploi va disparaître. Or, la question ne se pose de façon aiguë qu'en France et dans les autres pays européens, parce que c’est là que les hommes de l'Etat mettent tout leur zèle à interdire de travailler : pas seulement le salaire minimum mais toutes les dispositions autoritaires du code du travail, dont, les conditions de diplômes, d'âge, etc. et autres interdictions de produire et d'échanger.
Comme en dernière analyse, les services s’échangent contre les services (Frédéric BASTIAT), il faut rappeler à cette occasion que toute interdiction d’échanger, quand elle proviendrait d’un règlement de construction ou d’une taxe à l’importation, est également une interdiction de travailler. Et toute interdiction de travailler est elle-même une interdiction d’acheter les services d’un autre : elle déprime l’emploi non seulement directement mais indirectement.
Les punitions pour avoir travaillé
Quand ils ne l’interdisent pas délibérément, les hommes de l’État rançonnent le travail. Mais rançonner une activité c’est l’interdire au-delà d’une certaine limite et réciproquement (ça s’exprime même en termes mathématiques : c’est la théorie dite de la dualité). J’avais dit la dernière fois que le travail taxé à plus de 50 %, c’est du travail classé 'X. Or, c’est bien le niveau moyen atteint par le pillage démocrate-social des revenus, au titre de la “sécurité sociale” ou de l’“Etat”.
Par ailleurs, aucun impôt ne peut manquer de punir le travail : d’abord parce que la plupart des d’impôts réputés voler “les entreprises” amputent les salaires. On l’a vu des “cotisations sociales” et de l’impôt sur les sociétés. C’est aussi vrai de la TVA qui n’est pas une taxe sur la consommation mais un impôt sur la production — paradoxalement, son nom l’indique, les hommes de l’État ont sans doute jugé inutile de mentir sur ce point. Mais plus généralement, on ne taxe jamais que le travail de quelqu'un. Parce qu’on ne peut voler que la production et que toute richesse est produite par quelqu’un. Quand, par démagogie, on prétend “imposer le capital”, on ne vole jamais que le travail du passé.
En outre, voler l’épargne la décourage non moins nécessairement. Et comme on l’a vu, c’est léser les pauvres que décourager la formation du capital.
Les récompenses pour ceux qui ne travaillent pas
On n’annule pas une interdiction de travailler en distribuant des aumônes volées : c’est une marque d’aveuglement moral que d’imaginer qu’en leur rendant une part du butin, les hommes de l’État “compenseraient” une partie des vols qu’ils font subir aux pauvres : ils ne font qu’ y confisquer une deuxième fois le pouvoir de décision à leur seul profit, amputant la vie des autres aussi bien à l’arrivée qu’au départ (comme les bonbons Kiss-cool, la malédiction de l’argent volé a donc un double effet ).
Rappelons que, quand les hommes de l’État subventionnent, soi-disant, telle ou telle “production”, ce n’est jamais pour avoir produit. La production, c’est ce que des clients acceptent de payer ; la distribution du butin, elle, ne rémunère que les efforts faits par les lobbies pour obtenir l’argent volé aux autres. Par conséquent, la redistribution politique socialiste punit toujours le travail et récompense toujours ceux qui ne travaillent pas.
Or, l’aisance matérielle est secondaire. L’essentiel est de maîriser son existence, et cette aspiration est tellement forte que seule une minorité de gens, principalement âgés, s’attardent dans ce que les statisticiens appellent les tranches de bas revenus. Mais cette aspiration est ce que le matérialisme démocrate-social refuse de reconnaître, et ce caractère transitoire de la pauvreté ce qu’il combat par tous les moyens.
Dans le cas qui nous occupe, les récompenses pour n’avoir pas travaillé sont la trappe qui se referme sur un véritable piège de la pauvreté. Avec l'“indemnisation” du chômage, le RMI et autres avantages, distributions et exemptions fiscales, même les statisticiens gauchistes reconnaissent qu’au voisinage du salaire minimum, celui qui se met à travailler perd de l’argent. En somme, les hommes de l’État ne font même plus semblant de combattre la pauvreté. Désormais, ils s’acharnent à contrecarrer ceux qui cherchent à en sortir.
La redistribution politique socialiste est la cause de la “précarité”
La dernière cause de la pauvreté se trouve dans l’incertitude sociale qui rend précaires et détruit emplois et placements d’épargne. Là aussi les hommes de l’État prétendent corriger les effets d’un aléa qui ne serait pas de leur fait. Là encore, il s’agit d’un mensonge.
Dans L'Etat, Anthony de JASAY résume leur sophistique :
- "Ce que les versions les plus élaborées de l'idéologie démocrate-sociale [7] prétendent faire admettre est que ce ne serait pas tout à fait l'absence de liberté qui remplace la liberté. Ce serait plutôt la substitution d'une ingérence rationnelle systématique à l'ingérence arbitraire et aléatoire […] que cause "la loterie du darwinisme social qui se fait passer pour une économie de libre marché". La différence salvatrice serait que, tandis que les "loteries sociales" sont causes d'interférences "involontaires", l'Etat les cause pour sa part "délibérément" ce qui […] serait […] un bien moindre mal [8].
On peut toujours échanger l’incertitude et la rareté
Que les hommes de l’État prétendent assurer la sécurité au prix de contraintes accrues permet immédiatement de faire remarquer que leur fameux dilemme entre sécurité et liberté ne les regarde en rien. Car ils pratiquent l’amalgame : on n’a absolument aucun besoin d’eux pour faire l’arbitrage entre l’incertitude et la richesse ou les convertir l’une dans l’autre : c’est ce que permettent et illustrent les techniques de l’assurance et l’industrie financière.
Comme le dit ROTHBARD :
- "Dans une société libre, donc, chacun assume […] la "charge de risque appropriée" […]. Bien sûr, ces personnes pourraient volontairement mutualiser leurs risques, comme dans les diverses formes de l'assurance mutuelle, où les risques sont partagés et les perdants indemnisés à partir du pot commun.
- Sinon, des spéculateurs pourraient volontairement se charger du risque de changement des prix à venir dont les autres se débarrasseraient par des opérations de couverture sur les marchés. Ou alors, une personne pourrait reprendre les risques de paiement d'une autre, comme dans les exemples de la garantie de bonne fin et autres [9].
A partir du moment où on peut vendre et acheter le risque, sécurité et richesse sont équivalents et croire qu'une politique quelconque pourrait directement supprimer la précarité, équivaut à accuser des institutions particulières d’être la cause de la rareté à laquelle tout être humain est nécessairement confronté [10] ; et c’est tout à fait comparable à la même accusation imbécile que les marxistes portent contre la propriété. C’est une utopie totalitaire qui, en détruisant le droit, a pour seul effet d’appauvrir tout le monde, créant de ce fait une précarité supplémentaire.
La précarité, c’est d’abord d’être pauvre
L’assurance la plus universelle est d’abord celle que chacun se procure directement par l’épargne personnelle. Quand on n’en a pas… En outre, les assureurs constatent toujours que ce sont les riches qui s'assurent les premiers ; tout cela n’étant qu’une conséquence du fait que le risque peut s’échanger contre de la richesse et réciproquement. Bref, la précarité, c'est d'abord d'être pauvre.
Les hommes de l’État qui prétendent réduire le risque social n’aboutissent qu’à l’accroître.
Donc, quelque illusion que la pensée magique du socialisme puisse entretenir à cet égard, la violence étatique ne fera jamais disparaître l'incertitude, qui est inhérente à la condition humaine : elle traduit à la fois l'imperfection de notre connaissance et notre capacité à créer de l'information.
Concrètement : si l’intervention de l’État ne peut pas réduire le risque social, c’est que ce sont toujours des personnes qui prennent des risques, et à moins d'un contrôle totalitaire de leurs actes (la surveillance constante de chacun et le pouvoir d’intervenir à tout moment), elles pourront toujours choisir la recherche d'informations, le degré de précautions, le partage et la mutualisation des risques ou l'épargne personnelle qui l'amèneront au degré de risque qu’elles seules auront choisi :
- l'existence est toujours risquée et incertaine, et il n'existe aucun moyen d'éviter ce fait primordial. Transférer la charge du risque ne peut que le faire supporter à un autre
- […] il n'existe aucun moyen de réduire le risque par la loi [la raison fondamentale en est que] le risque est un concept de la pensée, unique pour chaque personne : c'est pourquoi on ne peut le mettre sous aucune forme quantifiée.
- Donc, comme on ne peut comparer aucun degré de risque personnel à celui d'un autre, on ne peut opérer aucune mesure générale du risque. En tant que concept quantitatif, la notion de “risque global” ou “social” est aussi dépourvue de sens que celle des “coûts sociaux” et autres “avantages pour la société” des [soi-disant] économistes [utilitaristes] :::::(Murray ROTHBARD [11]).
Dans ces conditions, quel est l’effet de la prédation sous prétexte de “sécurité sociale” ? En imposant certaines formes d’assurance, forcément inadaptées à la situation de chacun, elle ne fait qu’ entraver la meilleure gestion de leurs risques par les particuliers, contrainte artificielle et inutile qui ne crée que des gaspillages. Cependant, les hommes de l’État se servent pas seulement de ces vols pour forcer les gens à payer des services dont ils ne veulent pas. Ils s’en servent aussi pour s’enrichir, eux-mêmes et leurs complices. Ce double effet, gaspilleur et redistributif, aggrave la charge du risque pour la plupart, à trois titres :
- — ces combines d’assurance forcée à but lucratif pour les hommes de l’État renchérissent inutilement la couverture des risques.
- — Les victimes désignées de ces redistributions politiques doivent en plus payer pour les autres.
- — Enfin, en subventionnant la prise de risque, elles accroissent la probabilité des pertes (qui seront payées par d’autres). C’est ce qu’on appelle le risque moral.
Bien entendu, ce sont les pauvres, non seulement parce qu’ils le sont mais en outre parce qu’ils sont faibles, que frappe les premiers ce risque politique accru.
Risque marchand et risque politique
Les utopistes de la “protection” accusent la propriété naturelle d’accroître l’incertitude sous prétexte que la liberté des contrats exacerberait la rivalité entre les hommes sous la forme d’une “concurrence et destructrice”. Mais par définition, liberté des contrats veut dire coopération volontaire, et ne porte atteinte à la propriété légitime de personne ; or, “il n'y a pas de conflit d'intérêts entre des gens qui ne réclament pas ce à quoi ils n'ont pas droit” (Ayn RAND). En outre, dans ce cadre, si mon voisin désire davantage de chaussures, il ne m'empêche pas d'en obtenir moi-même. Bien au contraire, il me rend la chose plus facile (von MISES).
La propriété naturelle ne peut donc qu'atténuer la rivalité entre les hommes : dans son expression, en lui interdisant de passer par violence et fraude, et dans ses conséquences en la forçant de ce fait à passer par une production meilleure.
C'est au contraire dans la redistribution politique socialiste, par définition proscrite dans le régime de liberté naturelle, que "le proufict de l'un est la perte de l'autre" (MONTAIGNE [12}). C’est le socialisme qui, ayant aboli la propriété dans son principe, livre le bien de chacun à la foire d'empoigne de la politique, interdisant à tous de voir dans leurs semblables autre chose que des agresseurs potentiels ou des proies à dévorer. Et ce cannibalisme moral-là crée par nécessité un risque démesuré comparé à l’incertitude marchande. Car celle-ci porte sur l’approvisionnement et les débouchés : sa limite est celle de l’intérêt à échanger. Le risque politique, lui, n’est pas seulement qu’on vous interdise d’échanger (et Dieu sait si on le fait) : il porte sur toutes vos possessions, votre intégrité physique et même votre vie.
Le risque marchand maximum, c’est que vous ne trouviez pas à acheter ou à vendre. Il dépend de vous que vous ne soyez pas aussi mauvais. Le risque politique maximum, c’est d’être dépouillé de tout, de voir sa famille massacrée sous ses yeux, d’être torturé à mort. Et vous savez, de science certaine, qu’il y a des gens capables de vos faire subir ce sort-là.
Et par définition, la propriété naturelle annule le risque politique, alors que le socialisme l’exacerbe. Et l’utopie de la “protection sociale”, fort loin d’atténuer les troubles issus de la rivalité entre les hommes, n’en est au contraire qu’une expression manifeste, et des plus directement destructrices.
L’étatisme démocrate-social, cause essentielle du risque politique
En outre, et de manière plus générale, ces pertes sont dues à la réalisation d'un risque politique : elles résultent des redistributions mêmes des hommes de l’État.
Car leurs ingérences imprévisibles ne sont pas la simple usurpation d’un pouvoir social discrétionnaire : centralisées, elles créent un risque supplémentaire considérable en concentrant la décision entre quelques mains. Ils peuvent en outre agir de façon autrement arbitraire que des propriétaires privés, parce qu’ils forcent autrui à payer les conséquences de leurs choix. Le socialisme est irresponsabilité institutionnelle et entraîne le risque moral : savoir que les autres paieront encourage les puissants à la négligence, à l'imprévoyance (à l'exemple des prétendus "services publics") et à la prise de risques exagérée (à l'exemple des banques nationalisées françaises), causes de pertes spectaculaires.
La politique monétaire est l'exemple parfait de cette fabrication institutionnelle d'une incertitude massive et parfaitement évitable, qui disparaîtrait dans une société libre. Car elle n’est rendue nécessaire que par l’institution révolutionnaire [13] du monopole d'émission, et revient à planifier la production de monnaie sur le mode soviétique. Elle engendre des crises financières et conjoncturelles à répétition, qui font perdre aux gens et leurs économies et leurs emplois. Le dernier exemple est la crise de 1992-1995, provoquée par la politique monétaire déflationniste dite du franc fort.
Conclusion :
L'intervention étatique ne fait pas disparaître l'aléa social, elle surajoute au contraire à l'incertitude d'origine marchande, dont elle ne fait que transférer les charges à grands frais sur les gens politiquement faibles, une incertitude d'origine politique, forcément bien pire et de surcroît aggravée par l'arbitraire juridique et l'irresponsabilité institutionnelle.
Considérations que JASAY résume ainsi :
- “il faudrait que l'on puisse constater qu'une plus grande ingérence de l'Etat conduit à une moindre gêne due aux forces imprévues du hasard. S'engager dans l'armée, où tout est organisé, doit signifier que dans les casernes on sera en fait moins exposé aux circonstances accidentelles et aux caprices des autres que si on devait gagner sa vie dans le bazar [14]“.
Métaphore parfaite du leurre de la “sécurité sociale”: est-ce vraiment pour leur garantir une protection indéfinie contre tous les risques que les hommes de l'Etat paient des soldats, et peut-on imaginer comment ils pourraient leur payer même cette apparence de "sécurité"-là s'ils ne menaçaient pas constamment le "bazar" afin de le dépouiller ?
La “justice sociale” n’est donc pas seulement un faux concept, destructeur de tout droit. Le souci des pauvres, son prétexte le plus émouvant, si émouvant qu’il suffit à faire disjoncter le cerveau d’un démocrate-chrétien, ne peut justifier qu’une condamnation radicale de touteredistribution politique. Les démocrates-sociaux prétendent, soi-disant, améliorer leur sort. Eh bien la seule manière d’y parvenir c’est qu’ils cessent de les appauvrir. Qu’ils cessent de leur interdire de travailler, de leur voler le fruit de leur travail, d’interdire aux autres de les enrichir, de les maintenir dans la pauvreté par toutes leurs extravagances, récompenses, et surtout par leurs agressions, directes et indirectes
Les démocrates-sociaux aiment les pauvres, soi-disant. Pour une fois donnons-leur raison. À l’évidence, il les aiment tellement qu’ils font ce qu’il faut pour qu’il y en ait sans cesse davantage. Quant aux capitalistes, il est certain qu’eux ne les aiment pas. la preuve, c’est qu’en dépit de la démocratie sociale, ils s’efforcent toujours de faire qu’il y en ait moins. On laissera le dernier mot sur ce point au plus grand économiste de tous les temps, Ludwig von MISES, qui écrivait dans L’Action humaine :
- Ni la réflexion, ni l’expérience ne permettent de penser qu’un autre système social puisse être aussi avantageux pour les masses que ne l’est le capitalisme. Le marché libre n’a pas besoin d’apologistes. Il lui suffit de s’appliquer à lui-même les mots qui figurent sur l’épitaphe de Sir Christopher WREN, architecte de la cathédrale Saint-Paul à Londres : si monumentum requiris, circumspice ; “si c’est un monument qu’il te faut, regarde autour de toi” [15].
Notes
- [1] Hans-Hermann HOPPE, "The Socialism of Social Engineering and the Foundations of Economic Analysis", chapitre 6 de A Theory of Socialism and Capitalism. Auburn/Dordrecht/Boston : Ludwig von MISES Institute/Kluwer, 1989.
- [2] L’État, Paris, les Belles Lettres, 1993
- [3] Pour d’autres exemples, cf. le chapitre "Robin des Bois est un vendu" dans David FRIEDMAN, Vers une société sans Etat, Paris, Les Belles Lettres, 1992.
- [4] Ludwig von MISES, L’Action humaine, Paris, PUF, 1985, p. 891.
- [5] Ibid., p. 897.
- [6] Mal le payer n’est en revanche qu’une présomption d’esclavagisme, et dont l’employeur n’est pas le premier suspect, étant donnés tous les moyens indirects que les hommes de l’État ont de rançonner et d’interdire ce travail par ailleurs.
- [7] On notera que JASAY n'hésite pas à mettre dans le même sac d'une “idéologie démocrate-sociale” de la ”protection sociale” le pseudo-conservatisme qui voudrait empêcher le changement et le pseudo-progressisme qui prétend seulement annuler ses effets. En effet : pourquoi distinguer analytiquement deux interventionnismes également contraires au droit, et qui visent en fait au même résultat ?
- [8] Paris, les Belles Lettres, 1993, p. 170.
- [9] Murray ROTHBARD, "Law, Property Rights and Air Pollution", Cato Journal n°1, Spring 1982, pp. 55-99. Réédité dans The Logic of Action vol. II, Cheltenham, Edward Elgar, 1997, p. 136.
- [10] historiquement, la Sécurité Sociale française a été imposée par les communistes, mais c'était une invention (en moins fou) du pseudo-conservateur BISMARCK, et Pierre LAROQUE, l'incompétent irresponsable qui l'a instituée, l'avait conçue sous le régime pseudo-conservateur de Vichy.
- [11] Murray ROTHBARD, "Law, Property Rights and Air Pollution", Cato Journal n°1, Spring 1982, pp. 55-99. Réédité dans The Logic of Action vol. II, Cheltenham, Edward Elgar, 1997, p. 136.
- [12] Essai n° 22. C'est ce que Ludwig von MISES appelait "Le Sophisme de MONTAIGNE", car si c’est vrai du pillage politique, ce ne l’est jamais des relations volontaires entre les gens, par définition avantageuses aux deux parties.
- [13] En France, on la doit au nabot jacobin Napoléon BONAPARTE (1803).
- [14] L'Etat, p. 170.
- [15] L’Action humaine., p. 900.