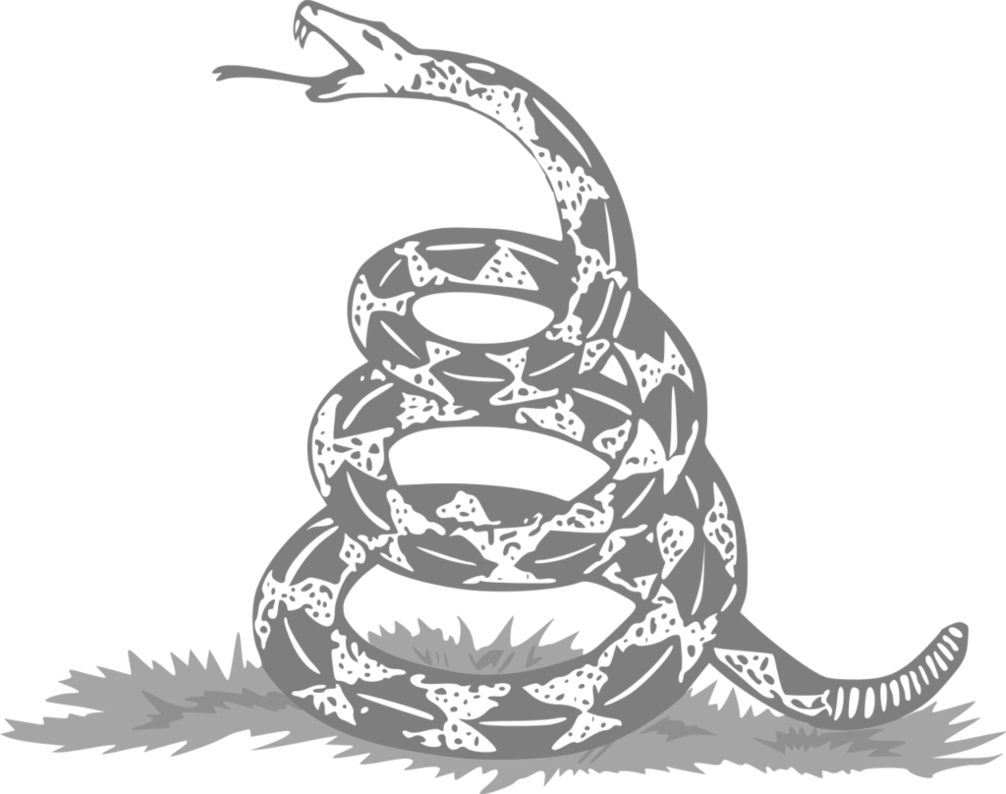« La Micropolitique » : différence entre les versions
Kae (discussion | contribs) |
Kae (discussion | contribs) |
||
| Line 1 230: | Line 1 230: | ||
Un des épisodes de ''Yes, Minister'', la série télévisée qui décrit les mœurs des fonctionnaires, montrait à quoi avaient mené les réductions budgétaires dans le service de santé5. Un hôpital flambant neuf avait un service administratif de cinq cent personnes, parfaitement affairées, mais n'avait pas un seul patient. Aucune réduction de postes administratifs n'avait été possible, alors même que le service était toujours entièrement fermé. Quiconque suppose que les fonctionnaires ne se conduisent ainsi qu'à la télévision peut toujours prendre connaissance de ce qu'a fait le service américain des Douanes et de l'Immigration. A l'annonce d'une réduction de 10% dans son budget, le directeur réagit par la mise à pied de tous les fonctionnaires chargés d'empêcher l'importation de drogue dans les aéroports. On n'avait proposé aucune économie d'administration, mais sacrifié le service le plus apprécié, et celui où le gouvernement était le plus vulnérable. Cela fut quand même considéré comme un abus, et le fonctionnaire en question perdit son poste. Il ne fut pas renvoyé, rassurez-vous : seulement muté à un autre service. | Un des épisodes de ''Yes, Minister'', la série télévisée qui décrit les mœurs des fonctionnaires, montrait à quoi avaient mené les réductions budgétaires dans le service de santé5. Un hôpital flambant neuf avait un service administratif de cinq cent personnes, parfaitement affairées, mais n'avait pas un seul patient. Aucune réduction de postes administratifs n'avait été possible, alors même que le service était toujours entièrement fermé. Quiconque suppose que les fonctionnaires ne se conduisent ainsi qu'à la télévision peut toujours prendre connaissance de ce qu'a fait le service américain des Douanes et de l'Immigration. A l'annonce d'une réduction de 10% dans son budget, le directeur réagit par la mise à pied de tous les fonctionnaires chargés d'empêcher l'importation de drogue dans les aéroports. On n'avait proposé aucune économie d'administration, mais sacrifié le service le plus apprécié, et celui où le gouvernement était le plus vulnérable. Cela fut quand même considéré comme un abus, et le fonctionnaire en question perdit son poste. Il ne fut pas renvoyé, rassurez-vous : seulement muté à un autre service. | ||
=TROISIEME PARTIE : LA MICROPOLITIQUE= | |||
==De la critique à la créativité== | |||
===La théorie des choix publics explique la croissance de l'Etat=== | |||
La théorie des choix publics est une critique. C'est un outil d'analyse qui permet de comprendre et d'expliquer pourquoi certains phénomènes se produisent dans le secteur public, et pourquoi ils le font ainsi. Elle nous invite à rechercher les intérêts des différents groupes impliqués dans la conception et l'exécution des politiques publiques, ceci nous permettant de prévoir et d'expliquer les réactions que celles-ci vont engendrer. | |||
Grâce à cette approche, il devient possible de comprendre certains phénomènes qui, sinon, nous sembleraient inexplicables, voire irrationnels. Elle nous montre immédiatement pourquoi il est inévitable que les programmes politiques conservateurs s'épuisent dans des difficultés du genre de celles qu'ils ont rencontrées. L'essence de la formule traditionnelle de "la droite" est de diminuer le rôle joué par les hommes de l'Etat dans la vie économique, et la charge qu'ils imposent à leurs concitoyens. Elle essaie de réduire l'importance et l'étendue de leurs actions, et de diminuer le fardeau réglementaire qu'ils imposent aux entreprises ; elle voudrait qu'ils cessent de confisquer une si grande partie de l'argent des individus et des entreprises, leur interdisant de le dépenser suivant leurs lumières propres. | |||
Evidemment, ces projets se heurtent directement à l'intérêt de la plupart des groupes associés aux ambitions étatiques. Ils pourraient bien favoriser l'ensemble de la société, permettre enfin la création de richesses, et par conséquent améliorer le sort d'une majorité écrasante de la population, mais rien de tout cela ne suffit à les faire passer dans le domaine de la politique pratique. Toutes les conceptions "de droite" du pouvoir, et les projets qu'on leur prête, s'opposent dans une certaine mesure à ce que les groupes de pression perçoivent comme leur intérêt vital. N'importe quelle minorité peut se laisser démontrer qu'elle y perdra des plumes si les dépenses totales sont réduites. Alors qu'elle pourrait, dans l'abstrait, soutenir le principe d'une diminution générale des dépenses publiques, chacune se battra pour maintenir sa part du butin, et bien plus âprement que d'autres n'essayeront de la réduire. | |||
''La bureaucratie comprend immédiatement qu'un programme "de droite" constitue une menace réelle pour ses perspectives d'enrichissement et de pouvoir''. Ce qu'elle veut, c'est accroître le domaine de ses prérogatives et le nombre de ses subordonnés. Son intérêt en tant que classe est qu'il y ait davantage de programmes publics, et de plus vastes encore. Toute annonce d'un projet de réduction de l'activité et de la dépense publiques devrait suffire à la mobiliser contre lui, jusqu'à la faire capoter si besoin est. | |||
On a donc maintenant les moyens identifier la raison d'un phénomène majeur dont tous les adversaires du socialisme ont eu l'occasion de se plaindre. Ils ont souvent observé que le pouvoir et les dépenses des hommes de l'Etat se développaient rapidement sous les gouvernements collectivistes et centralistes, et seulement moins vite sous un gouvernement de "droite". Ils parlent d'un "cliquet socialiste", qui ne tournerait que dans un sens : celui de l'augmentation de la taille de l'Etat. Si un gouvernement de tendance libérale parvenait à obtenir un arrêt temporaire, empêchant l'accroissement du pouvoir étatique au cours de son mandat, on considérait cela comme le maximum de ce qu'il était possible d'espérer. | |||
Pour leurs partisans, et pour tous ceux qui avaient pris part à ces gouvernements, le phénomène était aussi confondant qu'exaspérant. ¨Privés de l'éclairage de la théorie des choix publics, ils ne savaient où chercher son origine. Grâce à ce nouveau type d'analyse, en revanche, il nous est désormais possible de comprendre pourquoi les choses devaient se passer ainsi. Quand l'on considère l'opposition de tous les groupes qui bénéficient d'un privilège d'Etat, et les agissements d'une Administration directement opposée aux objectifs essentiels du programme de "la droite", on découvre tout de suite l'explication. Ce n'est pas parce que les politiques proposées seraient "incompatibles avec notre monde moderne", voire "inapplicables dans le monde réel" ; c'est parce qu'elles sont politiquement trop difficiles à imposer par la seule volonté du gouvernement, face au bunker des intérêts en place qui se mobilisent contre elles. | |||
===Nixon et Heath dans l'ornière=== | |||
Reprenons donc notre tentative d'explication des échecs relatifs des gouvernements de Richard Nixon aux Etats-Unis et d'Edward Heath au Royaume Uni. Ni l'un ni l'autre ne disposaient d'une technique efficace face aux phénomènes que nous venons de voir, et qui s'opposent à toute mesure de désétatisation. Dans un climat en principe plutôt favorable à une diminution du rôle et des ponctions de l'Etat, ni l'un ni l'autre n'avaient pressenti les difficultés pratiques qu'impliquait la mise en œuvre de ce type de projet, a fortiori les tactiques nécessaires pour les surmonter. Pensant apparemment que les événements succèdent naturellement à l'adoption des idées, ni l'un ni l'autre n'avait l'avantage de connaître l'analyse proposée par la théorie des choix publics. Celle-ci existait, mais n'en était qu'aux premiers stades de son développement, et n'avait pas encore suffisamment attiré l'attention. | |||
Or, cette dernière permet de beaucoup mieux apprécier leurs échecs, aussi bien que de juger la variété des explications qu'on leur a trouvées. D'un côté, on trouvait les gouvernements avec leurs intentions et leurs programmes, et de l'autre, les forces réelles inhérentes au système, et auxquelles ils voulaient s'attaquer. Résultat, aussi bien sous Nixon que sous Heath : le pouvoir réglementaire des hommes de l'Etat et leur rôle dans l'économie furent accrus. De même, bien entendu, que ce qu'il en coûtait aux autres. | |||
Sans théorie valide permettant de rendre compte des comportements du secteur public, aucun des deux gouvernements ne pouvait imaginer ce qui l'attendait. ''Les conseillers et autres experts sur lesquels ils comptaient pour appliquer leurs politiques, étaient ceux-là même dont ces politiques menaçaient les intérêts''. Les deux gouvernements, par exemple, se rendirent compte que les salaires et les prix montaient plus vite qu'ils ne le souhaitaient, sans comprendre les pressions qui poussaient dans cette direction. Tous deux imposèrent des contrôles administratifs aux salaires et aux prix, étendant ainsi considérablement le pouvoir d'ingérence de la bureaucratie1. | |||
En somme, ni l'administration Nixon ni le gouvernement Heath ne connaissaient vraiment les contraintes qui pèsent sur l'action publique, et qui sont imposées par les conduites égoïstes de ceux qui y participent. S'ils avaient compris quelle force d'opposition serait mobilisée par les groupes de pression voyant leurs privilèges mis en cause, ou par la bureaucratie craignant pour ses perspectives de carrière, peut-être auraient-ils essayé des politiques totalement différentes, et obtenu un autre résultat. A tout le moins, l'échec de leurs programmes affichés aurait été justement attribué à leur compétence insuffisante pour traiter avec le système politique. | |||
===Alors, on se résigne ?=== | |||
L'approche des choix publics explique aussi bien la croissance irrépressible du secteur public année après année, que les échecs des tentatives faites à diverses occasions pour inverser ce processus. Elle explique même le fatalisme de ceux qui, tout en le considérant comme pervers et en s'y opposant en principe, pensent néanmoins que personne n'y peut rien. Cependant, c'est là tout ce qu'elle fait. ''L'école des choix publics a proposé une nouvelle méthode d'analyse. Elle fournit une critique ; elle nous montre ce qui ne va pas. La question reste de savoir s'il est possible de construire quelque chose sur ces découvertes''. | |||
La nouvelle analyse a du moins le mérite de faire connaître leurs limites aux politiciens. Elle leur permet de prévoir quelles sont les politiques qui n'ont que peu de chances de réussir. Si l'on ne pouvait en tirer que ce résultat, ce serait déjà fort précieux. Cela nous épargnerait de nourrir de faux espoirs, pour les voir ensuite déçus. En comprenant comment les groupes d'intérêt vont réagir à l'intérieur du système, les dirigeants politiques pourraient au moins éviter les mesures qui sont condamnées à se les mettre à dos. Ainsi, l'analyse des choix publics, même si elle n'est qu'une critique, offre déjà au politique un moyen de filtrer à l'avance, de retenir les réformes qui ne peuvent qu'échouer. Elle permet par conséquent de s'épargner des affrontements inutiles, sources de discorde et d'affaiblissement, et offre aux hommes politiques le moyen de restreindre leurs ambitions pour se fixer des objectifs plus réalistes. Ces résultats sont déjà appréciables en eux-mêmes, mais ils se bornent à signaler aux hommes politiques ce qu'il ne faut pas faire. Aucun n'indique aux gouvernements comment mettre en œuvre les politiques qu'ils jugeraient devoir appliquer. | |||
===Simple critique ou point de départ ?=== | |||
Raisonnons, cependant : si la théorie des choix publics est une critique, pourquoi n'impliquerait-elle pas, de façon latente, des propositions créatives symétriques de ses conclusions ? Si le système politique dominant agit de manière à bloquer certains types de réformes, alors savoir lesquels et comment ne pourrait-il pas aider à en imaginer d'autres ? Des réformes qui, au lieu d'essayer de forcer les contraintes du système, essayeraient de s'en servir pour parvenir à leurs fins. Ces déterminismes, nous les connaissons maintenant : nous savons à quoi ils conduisent, nous savons d'où ils viennent. Alors pourquoi ne pourrait-on pas créer des politiques qui sauraient s'en servir, s'en jouer ou même les neutraliser ? | |||
===Mission impossible=== | |||
A première vue, cela ressemble à "Mission impossible". L'intérêt des groupes minoritaires est de recevoir des privilèges particuliers sur le dos de tous les autres. Et comment imaginer que les hommes de l'Etat puissent trouver leur intérêt ailleurs que dans un secteur public bien gras et bien étouffant ? Il faudrait vraiment des politiques bien paradoxales pour retourner ces intérêts-là contre les privilèges et autres prébendes accordés par les systèmes publics, ou pour réduire la part des biens et des services produits par leur secteur d'activité. A priori, ces politiques devraient amener ces gens à agir directement contre leur propre intérêt. | |||
Eh bien justement, l'analogie avec "Mission impossible" est exactement appropriée : comme dans la série télévisée américaine, quelques spécialistes, décidés à consacrer leur ingéniosité et leur expertise à la résolution de ce problème apparemment insoluble, ont finalement découvert certaines manœuvres et procédés techniques capables de surmonter cette contradiction apparente. En fait, il est même possible d'imaginer un grand nombre de façons d'aborder les gens, et qui les persuaderont bel et bien d'accepter certaines politiques, voire de les soutenir, alors même que leur effet sera de réduire le volume d'ensemble des privilèges accordés aux minorités dominantes et de diminuer globalement le pouvoir et les dépenses des hommes de l'Etat. | |||
===Comment persuader les gens d'abandonner leurs privilèges ? | |||
Une des possibilités envisagées est que les gens abandonnent leurs privilèges actuels, si on peut trouver un autre type d'avantage pour les dédommager. Pour conserver leur privilège, les gens sont prêts à se battre à concurrence de sa valeur perçue, celle-ci étant plus grande pour eux que les autres ne perçoivent ce qu'elle coûte. Cependant, rien ne leur interdit de renoncer à cet avantage particulier à l'occasion d'un échange où ils se sentiraient gagnants. Cela suppose qu'ils reçoivent en l'échange de leur privilège d'origine une chose qui ait plus de valeur, et surtout pour eux. | |||
S'il en est ainsi, ne pourrait-on pas supprimer tous ces privilèges d'un seul coup, par exemple en les échangeant contre la liberté retrouvée ? Après tout, il est fort vraisemblable que, si l'on supprimait tout l'appareil de la redistribution politique, l'immense majorité des gens s'en trouveraient mieux, puisque la plus grande partie de ce qui leur est donné d'une main leur est repris de l'autre, avec le poids mort des hommes de l'Etat à entretenir en sus. Cependant, il faut se rendre à l'évidence : c'est une politique qui ne marcherait pas, parce que cet avantage net pour chacun serait beaucoup trop difficile à faire voir concrètement. Quiconque reçoit un privilège de l'Etat ressent fortement cet avantage, alors que son coût est presque insignifiant pour les autres. | |||
Par conséquent, s'il doit y avoir une politique qui offre une compensation, ''il ne suffit pas que le nouvel avantage soit en fait plus important : il doit apparaître évidemment comme tel'' au bénéficiaire visé. Cette précision est essentielle parce qu'en politique justement, les gains et les charges sont rarement perçus pour ce qu'ils sont. C'est une des perversions constantes de l'intervention de l'Etat que d'inspirer à toutes les parties prenantes, profiteurs supposés, victimes réelles et nuisibles bien intentionnés, des illusions qui empêchent de la mettre en cause. C'est d'ailleurs pourquoi il est si fréquent que les réformes doivent d'abord être entreprises pour que les opinions changent. | |||
Conclusion : il n'y aura de gain politique à l'échange proposé que si l'on s'arrange vraiment pour que les gens aient effectivement l'impression de s'en tirer à leur avantage. ''Il suffira donc de mettre sur pied des politiques d'échange, conçues pour que les substituts qui remplaceront les privilèges soient perçus comme plus importants''. Ce système revient-il à donner un nouveau tour au "cliquet socialiste", en accroissant le volume de la distribution des prébendes ? Pas nécessairement. Car justement, le nouvel avantage peut être de nature totalement différente. | |||
===Des avantages d'une autre nature=== | |||
On peut par exemple imaginer des politiques qui conduiraient les gens à accepter de perdre un privilège d'Etat en échange d'un avantage privé qui leur semblerait plus grand. Alors, le système prébendier des hommes de l'Etat serait progressivement érodé par la substitution de droits privés en leur lieu et place. | |||
Il peut y avoir des cas où les gens sont prêts à abandonner un privilège permanent et à long terme, en échange d'un avantage immédiat qui vaudrait plus à leurs yeux... et mettrait fin au système. Dans ce cas, les politiques à créer proposeraient aux gens un gain substantiel et immédiat en échange de leur privilège perpétuel. S'ils donnent plus de valeur au bénéfice immédiat, et si cette proximité dans le temps leur permet de l'emporter sur la valeur actuelle cumulée du privilège permanent, alors il y aura une bonne base pour faire l'échange. | |||
Si des gens acceptent de perdre un privilège d'Etat parce que la politique choisie leur remet un avantage privé plus important en contrepartie, alors cette politique peut bel et bien diminuer le rôle des hommes de l'Etat. Si les gens pensent qu'un gain immédiat remplacera avantageusement la perpétuation d'un privilège politique, alors la politique qui en fait l'offre pourra, petit à petit, diminuer à terme le fardeau de l'Etat, même si elle doit l'alourdir dans le court terme immédiat. Aucune de ces deux conclusions ne devrait nous surprendre. Une fois que l'on adopte l'approche des choix publics, et considère que le système politique comporte un véritable marché, alors des transactions normales de ce genre devraient passer comme allant de soi. | |||
===Il ne s'agit que de rendre explicite une pratique qui existe déjà | |||
Sur les marchés privés, les gens s'échangent tous les jours des profits marchands, abandonnant une chose à quoi ils donnent moins de valeur contre une autre à laquelle ils tiennent davantage. C'est la raison d'être de l'échange volontaire. C'est aussi une banalité quotidienne de l'économie privée, que les gens vendent du long terme contre du court terme. Certains vont renoncer à une partie de leur pouvoir d'achat aujourd'hui pour s'assurer un revenu régulier plus tard. D'autres abandonnent leur revenu futur en échange d'une somme liquide à dépenser dans l'immédiat. De telles transactions sont de pure routine dans une économie de marché ; il n'empêche, dans un contexte politique, l'idée de les intégrer à une approche systématique prend un air de nouveauté. | |||
En réalité, tout ce que feraient les politiques en question serait de rendre explicites les principes de l'échange qui existent et fonctionnent déjà sur le marché politique. Il ne s'agit que de reconnaître le marché qui existe qu'on le veuille ou non, et s'y engager pour y passer des contrats. Au lieu d'essayer, sans autre arme que la seule autorité du gouvernement, de s'opposer aux forces et aux contraintes qui dominent ce marché, on utilise ces déterminismes mêmes pour obtenir des résultats plus acceptables. | |||
===Accepter l'existence du marché politique est la clé qui ouvre les portes | |||
Les deux approches que nous venons d'examiner ne sont que les premières pièces d'une batterie de techniques que l'on peut déduire des mêmes principes. Dès lors que l'on aura accepté l'existence et le fonctionnement d'un marché politique, on aboutira à une gamme complète de politiques spécifiquement conçues pour ce marché. Le conflit idéologique, sur le mode conventionnel de l'activité politique, sera alors relayé par le jeu des groupes d'intérêts, et l'on mettra au point des politiques faites sur mesure pour la situation de chacun sur le marché. Au lieu d'affronter bille en tête l'opposition des différents groupes qui s'accrochent à leurs privilèges étatiques, les nouvelles politiques iront chercher la transaction et proposer, chaque fois que c'est possible, d'offrir un avantage dont la valeur perçue sera supérieure, et qui permettra néanmoins de réduire la taille et les prérogatives de l'appareil d'Etat. | |||
Bien sûr, il existe des cas où la situation d'un groupe lui donne un pouvoir tel qu'il puisse exiger davantage que tout ce qu'il est raisonnablement possible de lui offrir en échange. Ce type de situation inspire une autre gamme de politiques. Peut-être pourra-t-on constituer un nouveau groupe qui sera plus puissant que le premier. Une politique qui aura décidé de s'en prendre au groupe d'origine y trouvera un partenaire potentiel. L'hostilité de l'ancien groupe sera alors plus que compensée par le soutien du nouveau. Forts de ce soutien, les législateurs seront alors en mesure de supprimer les privilèges de l'ancien. | |||
On pourrait aussi imaginer que des politiques réussissent à contourner, puis à neutraliser le pouvoir du groupe dominant, avant de s'attaquer au privilège dont il jouit aux dépens de la société. Une fois son pouvoir amoindri, il en ira de même de sa capacité d'exiger et de conserver un privilège de cette taille. Sa capacité de nuire ayant diminué avec son pouvoir, il aura moins à échanger, et recevra donc moins en échange. | |||
Ces politiques portent en filigrane la marque d'une origine commune : chacune d'elles transcrit, dans le domaine de l'action créatrice, une des conclusions critiques de la théorie des choix publics. S'il est vrai qu'il existe un marché politique, où les gens font des échanges, ce fait doit limiter ce qu'un gouvernement peut espérer obtenir par le moyen classique de l'autorité. Mais il lui donne aussi l'occasion de trouver, pour préparer ses politiques, de nouvelles approches qui pourront réussir parce qu'elles seront en prise avec ce marché et utiliseront ses lois propres, là où les autres échouaient pour s'y être opposées. | |||
===Quelle procédure suivre ?=== | |||
Puisqu'il existe une approche commune, quelle est la procédure générale qui pourrait la traduire ? A supposer qu'on puisse la mettre en œuvre, ce type de politique prendrait comme point de départ la critique des choix publics. D'abord comprendre, pour en tirer les leçons, pourquoi les politiques précédentes ont échoué. Démonter, par l'analyse des choix publics, le processus qui a conduit les groupes d'intérêt à mettre en échec les politiques de type traditionnel, ce qui donne la bonne base de départ pour en refaire d'autres. La nouvelle politique visera à créer de toutes pièces des situations où les groupes d'intérêt chercheront d'eux-mêmes à saisir les nouveaux objectifs mis à leur portée, ou se trouveront neutralisés par des groupes plus puissants créés exprès pour les mettre sur la touche, ou encore verront rogner le pouvoir qui garantissait leurs privilèges. En théorie, toutes ces tactiques pourraient permettre de réduire le rôle des hommes de l'Etat comme distributeurs d'avantages particuliers sur le dos des autres. | |||
===La révolution du réalisme politique=== | |||
On voit évidemment que cela implique un style de politique radicalement différent. Car ce dont il s'agit maintenant, c'est de prêter une attention extrême aux détails pratiques. Il faut, armé de la théorie des choix publics, identifier tous les avantages acquis par les différents groupes d'intérêt, tout comme les influences et les soutiens qui s'échangent sur le marché. Ce ne sera qu'après avoir parfaitement compris la situation existante, que l'on pourra se mettre à préparer des politiques jouant avec les forces en présence pour changer la situation. C'est le travail d'un créateur. Il est aussi, bien entendu, fait pour les "bûcheurs", car il n'y a pas de formule idéologique toute faite qui produise automatiquement les bonnes réponses. En fait, il se peut même qu'il n'existe pas de "bonnes" réponses, mais uniquement des solutions meilleures et d'autres moins bonnes. | |||
La caractéristique la plus spectaculaire, si l'on peut dire, de ce type de création politique, c'est l'échelle à laquelle on la pratique. Il faudra faire descendre l'analyse jusqu'au niveau où les individus expriment leurs préférences sur le marché politique, et c'est aussi à ce niveau-là qu'il faudra négocier. La différence est aussi grande que celle qui sépare la macro-économie de la micro-économie. La première traite de grands agrégats et autres statistiques qui représentent ou ne représentent pas — les événements réels. La seconde traite des ''actes'' voulus par des personnes qui cherchent à réaliser leurs projets. Elle tient compte des raisons d'agir concrètement présentes, et elle se soucie de savoir quels arbitrages seront faits lorsque les conditions du choix auront changé. | |||
===La politique, comme l'économie, doit s'aborder comme un réseau d'interactions entre les personnes | |||
Nous avons déjà observé que nombre d'économistes, alors qu'ils reconnaissent l'importance primordiale des facteurs micro-économiques, n'appliquent pas cette sagesse au domaine de la politique. Il est courant d'entendre des économistes, dont l'analyse s'inspire pourtant de la micro-économie, appeler à des politiques telles que "l'abolition des entreprises d'Etat" ou "la suppression de toutes les subventions". Ils conseillent aux Premiers Ministres britanniques d'"en finir avec la médecine d'Etat", aux Présidents américains de "supprimer la sécurité sociale". Les politiques savent très bien qu'on ne peut pas obtenir ces résultats par un simple acte de la volonté, et considèrent par conséquent des avis aussi désinvoltes comme étrangers à toute réalité politique. La théorie des choix publics donne à penser qu'ils ont raison. | |||
Si bon nombre d'économistes considèrent que l'étude au niveau micro-économique est indispensable à une vision réaliste de l'économie, alors disons qu'il ne serait pas inutile non plus d'appliquer ce type de raisonnement au domaine politique. S'il est exact que les gens font des offres et des demandes sur les marchés politiques comme ils en font sur les marchés de la production, alors il se pourrait bien que l'approche de la politique à l'échelle "micro" en donne une image bien plus claire et conduise à des solutions bien plus applicables. | |||
===Il existe une micropolitique, qui est à la politique ce que la microéconomie est à l'économie | |||
Voilà donc la nouveauté théorique que je propose dans ce livre : il doit exister une "micropolitique", qui sera à la politique ce que la microéconomie est à l'économie. La microéconomie examine la conduite des personnes et des groupes sur les marchés économiques ; la micropolitique l'étudiera sur les marchés politiques. En outre, de même que la microéconomie est plus proche du niveau où les décisions sont prises et les actions entreprises sur les marchés économiques (ce qui veut dire qu'elle est plus proche des événements réels), il en sera de même de la micropolitique sur les marchés politiques. | |||
Il est facile de parler, en termes "macro", de mettre un terme à l'étatisation, ou d'abolir toutes les subventions, mais les gouvernements ne sont pas près de suivre ces conseils-là, parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Quand les gouvernements connaîtraient tous les défauts de la médecine étatisée ou de la sécurité sociale, cela n'empêcherait pas qu'ils soient impuissants à y changer quoi que ce soit. La macropolitique propose les solutions globales et drastiques que personne n'applique, et qui ratent quand d'aventure on les essaie quand même. Elles échouent parce qu'elles ne tiennent pas suffisamment compte de la réalité politique, celle des décisions prises par les individus et les groupes qui négocient leurs avantages sur le marché politique. | |||
La micropolitique, à l'inverse, va conduire à formuler des programmes qui prennent en compte les conclusions de la théorie des choix publics, et s'en servir pour réorienter la conduite des personnes et des groupes concernés. Au lieu d'essayer d'agir à grande échelle contre les privilèges dont les groupes de pression bénéficient aux dépens de tous les autres, la micropolitique s'attachera à créer des politiques qui modifieront les choix que font les gens, en transformant les conditions de ces choix. | |||
===L'intérêt personnel l'emporte le plus souvent sur les principes | |||
Nous restons encore au niveau théorique, et pourtant nous avons déjà fait bon nombre de découvertes, annonçant une manière de concevoir les politiques publiques bien différente de l'approche traditionnelle, dans le style comme dans le contenu. En premier lieu, on trouve le postulat implicite que l'action politique ne concerne pas seulement la bataille des idées. La micropolitique, forte des conclusions de la théorie des choix publics, partira au contraire du présupposé que l'intérêt personnel joue un rôle prédominant dans la manière dont les gens réagissent aux politiques publiques. | |||
Etant établi qu'il existe un marché politique, et que les gens y font des échanges, c'est à la lumière de leurs effets éventuels sur la valeur de ce qui est échangé qu'ils jugeront les politiques en cause. Il est donc tout à fait possible qu'un groupe soutienne dans l'abstrait une idéologie donnée, et qu'on le voie dans la pratique saboter toute tentative faite pour appliquer ses principes à son cas particulier. Même s'il arrivait que les employés du secteur public se mettent à penser que l'Etat est trop gros, il s'en trouvera bien peu pour accepter que l'on fasse maigrir leur petit morceau d'Etat à eux. | |||
===On ne persuadera pas les gens de renoncer à leurs privilèges parce qu'ils sont injustes | |||
Une deuxième différence essentielle réside dans l'attitude adoptée par la micropolitique face aux multiples privilèges que les groupes minoritaires reçoivent des hommes de l'Etat. L'attitude libérale classique consiste, les tenant pour illégitimes, à vouloir les éliminer. Etant donné que les gens défendent leurs fromages, et qu'il y a peu de soutien à attendre de ceux qui doivent les payer, cette ambition ne conduit jamais qu'au ressentiment et à l'hostilité des groupes dont les privilèges sont menacés ; d'où l'échec qui s'ensuit généralement. | |||
L'attitude de la micropolitique consiste à s'accommoder du fait que le privilège existe, et qu'il sera défendu, quoi que puisse valoir sa prétention à être légitime. Si l'on veut que les gens acceptent son élimination, il faudra leur offrir quelque chose de plus intéressant en échange, ou alors commencer par réduire le pouvoir qui leur permet de conserver cet avantage. Ce qu'on oublie dans l'analyse traditionnelle est que le ''statu quo'' lui-même est considéré comme une source de légitimité. Si un privilège existe depuis longtemps, ses bénéficiaires vont le considérer comme un droit acquis, un élément "à part entière" de la société établie. Ils se battront pour le défendre, se sentant agressés par l'initiative qui le menace, et n'étant certes pas en peine de trouver l'idéologie adéquate pour justifier leur attitude. Telle était d'ailleurs — en gros — la situation fondamentale pendant la lutte pour l'indépendance américaine ; si on se battait, c'était pour préserver des avantages déjà acquis2 contre de nouvelles prétentions, et non pour réclamer des privilèges inédits. | |||
Il ne manque sans doute pas de bonnes raisons pour contester la légitimité des privilèges particuliers. Ces arguments peuvent être importants pour les principes, mais il n'y a aucune raison d'en attendre qu'ils réussissent à éliminer les avantages en question. On a bien plus de chances d'obtenir un changement en ayant recours à des politiques d'échange de ces privilèges, qu'à l'occasion d'une confrontation directe visant à les abolir. Ce n'est pas que la micropolitique refuse de tenir compte des principes moraux ; simplement, elle va mieux comprendre le point de vue de ceux dont l'assiette est beurrée par les hommes de l'Etat. En descendant au niveau où les décisions sont prises par les personnes et les groupes, et en examinant leurs raisons d'agir, elle est naturellement amenée à envisager la manière dont ils perçoivent la situation. Sans l'accepter le moins du monde pour autant, elle va tenir compte de leur prétention à faire de l'usage une source de légitimité, et rechercher des politiques leur offrant compensation pour ce qu'ils doivent perdre. | |||
===Adieu au "grand soir"=== | |||
La micropolitique ne sera pas seulement moins agressive que les méthodes conventionnelles, elle sera aussi moins globale dans ses ambitions. Elle abandonne l'idée d'appliquer la vision d'une économie de liberté immédiatement et dans tous les domaines. A la place, elle va partout chercher des politiques qui permettront de faire des brèches, puis des incursions dans la forteresse de l'Etat ; elle veut créer une situation dans laquelle les privilèges redistributifs des hommes de l'Etat seront peu à peu négociés en échange de droits qui paraîtront avoir plus de valeur. En somme, le coup de balai est remis aux Calendes grecques, et la micropolitique propose des coups de pinceau ; il s'agit d'étudier attentivement chaque situation, et d'imaginer d'une politique qui devra réussir dans ce domaine-là. Elle est donc plus détaillée et plus progressive. | |||
Pour réussir, au lieu de prendre à rebrousse-poil les groupes d'intérêts en place, elle propose de leur tenir la main. Il lui arrivera d'envisager une augmentation temporaire des dépenses publiques, afin de pouvoir enclencher un processus de diminution par la suite. Parfois, elle offrira à un groupe particulier ce qui a tout l'air d'être une faveur injuste, pour l'inciter à abandonner un privilège plus détestable et plus durable encore. | |||
===Un opportunisme d'apparence=== | |||
Non seulement elle est moins globaliste, mais elle semble aussi moins cohérente. Elle n'entend pas appliquer le principe simple d'une société libre, débarrassée dans tous les domaines des subventions et des ingérences des hommes de l'Etat. Ce principe-là est davantage un objectif à long terme qu'un guide pratique pour la formulation d'une politique. La micropolitique produira des politiques différentes dans presque tous les cas, parce qu'elle sait que chaque activité pose des problèmes particuliers. Chacun des groupes d'intérêt, les caractéristiques de son privilège, et son mode de fonctionnement initial varient d'un secteur à l'autre. Il n'existe pas de formule simple. Si les problèmes sont différents dans chaque domaine, les solutions doivent l'être aussi. | |||
La micropolitique a bel et bien une cohérence, mais celle-ci tient à l'unité de son approche. Politiques et recommandations vont changer d'un domaine à l'autre, mais la méthode qui les aura produites sera toujours celle que la théorie commune a imaginée. Tout commence par une analyse détaillée du statu quo ; différents privilèges et rentes obtenus, nature des groupes d'intérêts concernés, pouvoir et pressions qu'ils peuvent exercer. De là, on imagine les politiques d'échange des avantages, pour modifier la structure des incitations et changer les rapports de pouvoir entre les différents groupes. Ces réformes créeront une nouvelle situation qui, pour ainsi dire par construction, devra être acceptée par les personnes et les groupes et conduire, à terme, à diminuer les rentes de redistribution et à réduire la part des biens et services fournis par le secteur d'Etat. | |||
===Peut-on mettre en place un processus d'évolution spontanée ? | |||
L'approche micropolitique est plus conservatrice que les politiques libérales classiques, précisément parce qu'elle est plus graduelle et plus progressive. Il est rare qu'elle propose des politiques faites pour obtenir un changement soudain et un impact immédiat. Elle essayera plutôt de déclencher une suite de décisions qui, au bout du compte, mèneront aux objectifs désirés. | |||
Ce processus exige du temps. Il prend la société comme elle est. Il introduit çà et là des réformes qui la feront changer progressivement, mais inexorablement, dans le sens d'une diminution des subventions et de l'influence des hommes de l'Etat dans l'économie. Le résultat cumulé de cette approche politique sera d'accroître le degré d'autonomie au sein de la société, d'élargir les domaines de décision qui échappent au contrôle étatique et relèvent du choix des particuliers et des associations volontaires. Alors qu'il est le contraire d'un programme révolutionnaire, il vise cependant à susciter un mouvement massif, régulier et cohérent, dans une seule direction. | |||
C'est une chose de se faire une image de ce que pourrait être une société meilleure. C'en est une autre d'analyser le fonctionnement de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Le rôle de la micropolitique sera de se placer sur le terrain intermédiaire, et d'imaginer les politiques qui, prenant le monde tel qu'il est, le rapprocheront de ce qu'il pourrait être. Le rêve est que les hommes de l'Etat cessent d'intervenir dans les choix économiques, de réglementer et de confisquer l'argent des gens au mépris de leurs préférences. La réalité est qu'il ne suffit pas de le vouloir, ni même d'en persuader les autres pour y arriver. Seules des politiques peuvent le faire, si elles conduisent les gens à renoncer aux privilèges et au pouvoir de dominer les autres que leur donnent les hommes de l'Etat, d'une manière qui rapportera plus de sympathie que d'hostilité au gouvernement qui les mène. | |||
===La réforme micropolitique n'est pas conçue pour être tolérée, mais préférée à la situation existante=== | |||
Il y a une distinction très nette à faire entre cette approche et le simple gradualisme. Ce dernier implique une politique des petits pas, pour ainsi dire à un train de sénateur. Ces petits pas peuvent très bien aller à l'encontre des intérêts de la société, supposant que s'ils sont suffisamment modestes, ils ne déclencheront pas d'opposition assez forte pour les empêcher de s'imposer. Le fabianisme3 en est un bon exemple, dont l'idée de base était d'instaurer le socialisme — qui à l'époque était totalement rejeté — à travers une série d'étapes dont chacune serait assez minime pour "passer" sans rencontrer l'opposition que l'objectif final aurait immanquablement suscitée. | |||
La micropolitique n'est pas gradualiste. Les politiques conçues à l'intérieur de ce cadre ne sont pas faites pour être tolérées, mais pour être préférées à l'état actuel de la société. Certaines de ses réformes pourront être massives si un nombre suffisant de groupes et de personnes adopte la solution proposée à la place. Elle n'a pas non plus la moindre conception d'un projet terminal pour la société ; elle ne se soucie que d'instaurer un processus qui réduira les transferts forcés et autres ingérences des hommes de l'Etat. Quel que soit le type de société qui émergera de ce processus, ce sera le produit spontané du jeu réciproque entre des millions de décisions et d'actions différentes, et non un ordre social déclaré "supérieur" par on ne sait quelle autorité planificatrice. En outre, son approche s'appuie essentiellement sur les forces établies de la société, s'efforçant seulement de créer les conditions nécessaires pour les réorienter. | |||
===La micropolitique n'est pas un programme : c'est un mode d'emploi=== | |||
Par conséquent, s'il est possible que ses réformes se fassent progressivement, elle n'est pas gradualiste. Elle ne cherche pas à faire les ''mêmes'' choses que les politiques classiques, en se contentant de les réaliser ''plus lentement''. Elle cherche à créer des politiques ''nouvelles'', pour faire des choses ''différentes''. Plus précisément encore, elle cherche à les faire ''d'une autre façon''. Elle ne part pas avec une liste de mesures à prendre, pour s'y atteler ensuite tout doucement. Elle part en ''ignorant ce qu'il faut faire'', armée seulement d'une ''technique'' qui lui permettra de faire naître des politiques en réponse aux différentes situations qu'elle rencontre. C'est une ''approche'' et non un ensemble de ''priorités''. Au lieu d'un ''programme'' à mettre en œuvre, on trouve un ''mode d'emploi'' pour la fabrication des politiques. | |||
===Du rêve à la réalisation=== | |||
Notre projet est donc complet. L'analyse des choix publics nous a permis de comprendre pourquoi la réaction aux politiques traditionnelles prenait la forme qu'on lui connaît : elles méconnaissent le marché politique qui est à l'œuvre, ou ne savent pas s'y adapter. Alors apparaît cette idée d'un système qui concevrait les politiques publiques en se fondant sur cette analyse même, et contre lequel ces obstacles seraient inopérants, parce qu'il tiendrait compte du marché politique et fonctionnerait dans son cadre de référence. Un tel système, semble-t-il, permettrait de créer des politiques à la demande, chacune en réponse à une situation différente. Son unité serait au niveau de la méthode, et non plus du contenu. | |||
Alors, voilà la question qui se pose maintenant : cette belle théorie, peut-elle s'incarner dans une pratique, et produire un tel système ? Existe-t-il dans les faits une approche "micropolitique", qui réaliserait ce que la théorie affirme être possible ? La réponse est oui. L'approche existe bel et bien, et qui plus est, elle est déjà à l'œuvre. Conformément à notre thèse, suivant laquelle en politique la théorie explique la pratique, et la précède rarement, tout ce que nous venons d'envisager décrit quelque chose qui existe déjà. La pratique micropolitique est déjà à l'œuvre, et ne compte plus ses succès. Les programmes issus de cette pratique ont déjà permis d'obtenir ce que les tentatives précédentes n'avaient pas su réaliser. Les gouvernements de droite qui l'ont utilisée ont pu faire aboutir une bonne partie de leurs projets initiaux. Qui plus est, à mesure que ses résultats concrets devenaient visibles, elle a déclenché une cascade de changements dans le monde entier. | |||
===C'est le choix d'une approche micropolitique qui a déterminé les succès de Thatcher et Reagan | |||
Cette fameuse différence entre les gouvernements Nixon et Heath dans les années soixante-dix, et les gouvernements Reagan et Thatcher dans les années quatre-vingts, rien ne nous empêche plus de la reproduire, connaissant désormais tous ses secrets. Aucune nouvelle victoire notable dans la bataille des idées, pas de différences de caractère suffisantes entre les protagonistes ; aucun changement dans le monde rendant subitement viables des politiques impraticables dix années plus tôt. C'est dans les politiques elles-mêmes que se trouvait le changement. Et ce changement, nous lui avons donné un nom et une explication théorique : ce changement, c'était la micropolitique. | |||
Les propositions de réforme dont les gouvernements récents s'étaient pourvus provenaient d'une approche micropolitique. Comme les précédents, ils savaient ce qu'ils voulaient. Cependant, à la différence de ces derniers, ils avaient dans leur sac un certain nombre de programmes qui, eux, permettaient effectivement de l'obtenir. L'émergence, dans le courant des années soixante-dix, d'une méthode radicalement nouvelle pour formuler les politiques, avait mis une panoplie complète d'applications détaillées à la disposition de ces gouvernements. Au lieu de se jeter tête baissée dans le piège d'un affrontement avec les groupes d'intérêt mis en cause, ils surent alors proposer à ces groupes des politiques qui leur offraient l'occasion d'obtenir, en échange, des avantages supérieurs. | |||
Les programmes conservateurs des années soixante-dix ont échoué. Ceux des années quatre-vingts ont largement réussi. La différence résidait dans la technique politique. Elle tenait directement à l'assimilation du concept de "marché politique" par les professionnels de la mise au point des réformes. | |||
==Problèmes, leurres et solutions== | |||
===Deux domaines où la micropolitique a renouvelé l'approche des problèmes=== | |||
Poursuivons l'analyse de la micropolitique en comparant les propositions concrètes de la politique conventionnelle avec celles qui sont nées de la vision de la politique comme lieu d'échanges. Le meilleur moyen de percevoir leurs différences peut être de montrer en quoi elle s'opposent sur la solution de certains problèmes particulièrement tenaces. | |||
===Les "services publics" locaux=== | |||
Parmi les nombreux domaines de la société et de l'économie qui méritent la critique des gens "de droite" ou des "libéraux", on peut citer les prestations offertes par les "services publics" locaux : l'essentiel du problème est que les collectivités ont progressivement pris le contrôle d'un grand nombre de services locaux, ce qui a largement politisé la vie économique, avec tous les problèmes qu'entraîne la production de type "public". | |||
Typiquement, un "service public" local est directement contrôlé par les élus de la collectivité locale, qui gère ses services et emploie directement son personnel. Le service est financé par les recettes publiques locales, qui proviennent d'impôts sur les entreprises, sur les propriétaires fonciers locaux ou les particuliers, et aussi par des subventions de l'Etat qui constituent une part croissante du total. Le financement et la production des "services publics" locaux sont donc fournis par le secteur "public" de l'économie. | |||
===Excès de dépenses et dégradation du service=== | |||
Comme l'a montré l'étude du fonctionnement des services étatisés, tout cela force le public à payer sans qu'il puisse contrôler le niveau de la production ni la qualité du service. A long terme, le service tend à être produit en excès, le rapport efficacité/coût diminue, avec un personnel en surnombre et un capital dégradé, et le service est capturé par les producteurs, méprisant entièrement les préférences des consommateurs. Les finances publiques locales n'échappent pas à la loi du genre et sont délibérément redistributives ; les charges élevées constituent un handicap réel pour les entreprises locales, et la forte imposition foncière tombe de façon discriminatoire sur certaines catégories de propriétaires immobiliers qui, dans bien des cas, ne représentent qu'une petite minorité de l'électorat. | |||
Les lois du marché politique qui devaient y conduire sont faciles à retrouver : la petite proportion de ceux qui font l'acte de payer les taxes locales est moins nombreuse que ceux qui pensent en profiter à leurs dépens. Les entreprises locales n'ont pas de suffrages à échanger, et le système n'impose guère de sanctions aux élus dont les excès affaiblissent leur propre base d'imposition, parce que le système compense la différence par une dotation de l'Etat central. Les candidats aux élections locales ont donc intérêt à offrir le plus possible de services, car ils sont quasiment perçus comme "gratuits" là où ils sont reçus. | |||
===La réforme technocratique=== | |||
Le paradigme conventionnel a inspiré deux propositions de réforme. La première, qui ne mérite qu'un bref examen, entendait refondre l'ensemble du système des collectivités locales. L'amalgame en unités plus grandes était censé permettre des économies d'échelle, conduisant à de nouveaux sommets dans l'efficacité productive des services. Cette solution, qui fut appliquée en Grande-Bretagne au début des années soixante-dix, engendra exactement le contraire de ce que l'on avait prétendu souhaiter. Les nouvelles entités étaient trop grandes et trop éloignées des électeurs pour subir la moindre influence de leur part, ce qui, bien sûr, réduisait d'autant l'intérêt qu'ils pouvaient y trouver. Ils ne trouvaient pas du tout à leur goût ce nouveau gigantisme, ni ces administrations trop grosses, trop puissantes et trop lointaines pour qu'on puisse se faire entendre d'elles. | |||
L'inefficacité et le gaspillage se développèrent en conséquence, et les abus devinrent rapidement endémiques. Certains élus locaux s'étaient rendus compte que le nouveau système mettait à leur disposition des ressources supplémentaires, littéralement pour acheter les suffrages de groupes minoritaires dans leur région. Ils se mirent à distribuer force subventions à toutes sortes de causes, dont le principal point commun semblait être leur dépendance vis-à-vis des politiciens qui les leur avaient octroyées. | |||
===La "macro"-politique libérale=== | |||
Une autre proposition fut avancée à plusieurs reprises. Elle proposait de pallier l'impuissance du consommateur en lui permettant de ne payer le service qu'au moment de sa fourniture. Les services continueraient à être fournis par les autorités locales, mais seraient réglés directement par les consommateurs au moment où ils les recevaient, au lieu d'être financés par l'imposition générale1. Cette proposition visait à faire ressentir aux consommateurs le coût de chacun des services, ce qui n'était pas possible lorsque le financement avait lieu par l'impôt. Contraints à un paiement direct, sonnant et trébuchant, les citoyens prendraient la mesure du coût réel de chaque service, et feraient pression sur les autorités locales afin d'en avoir pour leur argent. | |||
L'avantage supplémentaire offert par ce système était la possibilité pour le consommateur de limiter la quantité du service à ce qu'il était effectivement prêt à payer. On tenait pour acquis que le tarif à la fourniture devrait couvrir la plus grande partie du prix de revient, et que la quantité fournie s'ajusterait donc progressivement à ce que le consommateur était prêt à dépenser. Par exemple, si les coûts du ramassage des ordures étaient directement facturés à l'usager, peut-être serait-il prêt à accepter une seule collecte hebdomadaire au lieu de deux, et peut-être même une tous les quinze jours. La fourniture serait alors ajustée à cette demande. | |||
A première vue, ce système offrait au consommateur un pouvoir de décision considérable, là où il n'en avait eu aucun. Devant payer directement, il apprécierait le coût de chaque service, d'une manière que le financement centralisé interdit de réaliser, et deviendrait maître de sa propre consommation. Economiquement, c'était un avantage indiscutable. Le citoyen ferait sentir au "service public" le poids de son porte-monnaie. Faute d'avoir le choix du fournisseur, il pourrait au moins décider de la quantité de service demandée. | |||
===On aurait continué à subir les tares de la fourniture publique=== | |||
Or, du point de vue des marchés politiques, ce système est beaucoup moins intéressant. Pour commencer, il laisse la production du service intégralement entre les mains des personnages publics, ne transférant que son financement à des mains privées. Ce qui veut dire que tous les effets de la fourniture publique se perpétuent imperturbablement. L'inefficacité relative, les sureffectifs, la décapitalisation, l'absence de choix et la capture par les producteurs, autant de caractéristiques de la production par un monopole public, et transférer son financement au secteur privé n'en atténue pas forcément les effets. | |||
===On négligeait les illusions que l'intervention publique engendre systématiquement=== | |||
Non moins importante est l'objection qu'au départ, la plupart des usagers perçoivent les avantages du service bien plus qu'ils ne perçoivent la charge de son coût. Même si l'objectif — fort louable — est de faire en sorte qu'ils perçoivent ce dernier, ils n'ont aucune raison de désirer en prendre conscience. Nombre d'entre eux s'imaginent que ce sont "les autres" qui paient la plus grande partie des services reçus, et ne se rendent pas compte de ce qu'ils paient eux-mêmes, par l'imposition directe et surtout indirecte. Par conséquent, alors même que leur liberté de choisir en serait évidemment accrue, envisager une tarification directe pour leur faire payer l'intégralité du service risque en fait de provoquer leur opposition furieuse à un tel projet. | |||
Bien sûr, le corollaire du système de la tarification directe est que l'impôt servant généralement à financer les services locaux et nationaux serait réduit en conséquence. Les gens pourraient alors disposer de l'argent pour acheter ou non les services, comme ils l'entendent. Cependant, rendre aux gens leur argent en lieu et place de services (pseudo-)gratuits ne s'accorde pas avec les conclusions de l'analyse des choix publics, suivant lesquelles un groupe donne davantage de valeur aux services qu'il reçoit que les autres ne souffrent d'avoir à les payer. En d'autres termes, passer de la pseudo-gratuité à la tarification directe en matière de "services publics" méconnaît les réalités du marché politique au lieu de les prendre en compte. | |||
===jeu continuel des pressions politiques aurait progressivement érodé les disciplines envisagées=== | |||
A propos de l'impact politique, autre chose mérite d'être noté : ce système de tarification exige que le prix des services soit fixé par les autorités locales. Il se peut bien qu'à l'origine, le tarif soit établi d'après le prix de revient réel, mais il faudra bien qu'il soit révisé périodiquement par l'assemblée locale, ne serait-ce que pour tenir compte des accroissements des coûts de production. Ce qui signifie que les élus devront envisager des augmentations de tarifs, et prendre leurs responsabilités en la matière. C'est à ce stade qu'ils sont exposés à des pressions extrêmement fortes de tous les groupes minoritaires qui pensent que leur cause est juste, ou dont les porte-parole et autres "conseillers en communication" ont jugé qu'elle pouvait l'emporter. On leur demandera d'exempter les chômeurs de ces augmentations, et aussi peut-être les personnes âgées et les bénéficiaires de l'aide sociale. S'ils refusent, on fera connaître à l'opinion la dureté de leur cœur de pierre. | |||
Les groupes de pression pourront alors être abordés sur le marché politique par des candidats qui proposeront de leur offrir les mêmes services à des tarifs spéciaux subventionnés, et la pression s'exercera partout pour réduire l'impact des augmentations de prix. Au bout d'un certain temps, il n'est pas impossible du tout que ce qui avait démarré sous la forme d'un financement intégral par l'usager termine sa carrière sous la forme d'un paiement de plus en plus symbolique, le déficit étant couvert par la subvention pour entretenir certains groupes clés de la population. C'est ainsi que les pressions politiques peuvent conduire le principe du paiement direct à se détruire lui-même, les élus qui voudraient imposer un système de vérité des prix s'exposant inutilement aux inconvénients électoraux d'une impopularité que d'autres auront su éviter. | |||
Pour éviter cela, peut-être faudrait-il que le Parlement vote une loi pour abolir le pouvoir discrétionnaire de fixer les tarifs publics. Mais une telle décision engendrerait à son tour une tempête d'opposition de la part des élus locaux dépouillés de leurs prérogatives, ainsi que des groupes minoritaires menacés dans leurs privilèges. Son incapacité à reconnaître la force des marchés politiques condamne donc vraisemblablement le système du paiement direct à l'échec. Il est de fait qu'on ne le voit guère fonctionner au niveau local. | |||
===La proposition micropolitique : privatiser non pas le financement, mais la fourniture des services publics locaux=== | |||
Voyant peut-être mieux que d'autres les ouvertures et les impasses de cette configuration politique, les tenants de la micropolitique ont, à la place du paiement direct des services, mis au point la proposition symétrique, qui consiste à faire appel aux entreprises privées pour ''fournir'' les services habituellement fournis par le secteur public. C'est ce qu'on appelle la "convention", transfert par contrat de la fourniture des services au secteur privé. Cette démarche laisse les autorités locales responsables des services, qu'elles continuent à financer à l'aide des fonds publics locaux et nationaux. La différence est qu'au lieu d'employer son propre personnel et ses propres cadres, la collectivité locale paie des entreprises privées pour exécuter la mission de fournir les services, les ayant mises en concurrence pour l'obtention des contrats. | |||
Le système du paiement par l'usager envisageait de confier le financement au secteur privé, tout en laissant la production entre des mains publiques. Le système de la convention, à l'inverse, transfère la production au secteur privé, tout en lui conservant un financement public. Cela ne donne aux usagers aucun contrôle direct sur la consommation, comme l'aurait fait le système du paiement direct, et ils n'ont pas davantage le choix de leurs fournisseurs qu'avec le système du paiement direct ou de la régie2 locale. Ce que fait la convention, c'est créer une concurrence entre les candidats pour la fourniture des services. | |||
===Des contraintes qui poussent à l'amélioration du service=== | |||
Avec le système de la convention, les entreprises doivent surenchérir pour les contrats de service local. C'est ainsi que l'on introduit la concurrence, les fournisseurs devant maintenir les coûts les plus bas possibles pour une qualité élevée. S'ils ne le font pas, le contrat ira à d'autres entreprises. En général, les conventions seront de courte durée, par exemple trois ans, cela dépend du type de service. Les entreprises qui répondront aux appels d'offre doivent rester efficaces, et se maintenir à niveau en matière d'équipement et de technique. Celle qui n'y parviendrait pas verrait le contrat passer à des entreprises restées compétitives. | |||
Le résultat est que la plupart des traits caractéristiques de la fourniture publique disparaissent. Avec la fourniture privée, l'inefficacité, les sureffectifs et le manque de capital ont beaucoup moins de chances de persister, pour la raison bien simple que les entreprises qui se laissent aller à ce genre de pratiques savent qu'elles perdront leur marché au profit de celles qui savent s'en garder. La capture par les producteurs y est également beaucoup plus difficile, parce que les contrats peuvent être repris par des concurrents capables de satisfaire le consommateur, et que ceci entraîne un risque de faillite pour celles qui ne le feraient pas. | |||
Il en résulte que la collectivité bénéficie d'un service meilleur et moins cher. Les économies ainsi réalisées sont estimées entre 20 et 40 %, selon le type de service et le pays. En Grande-Bretagne, les premières économies calculées par l'Institut des Etudes Fiscales étaient de 22 % en moyenne. Ce chiffre est probablement en-deçà de la réalité, car les économies sont généralement moindres la première année. Les chiffres représentent la différence entre le prix de revient des services municipaux et celui d'un équivalent privé, y compris les bénéfices de l'entreprise et les impôts qu'elle doit payer. | |||
===Bien ménager les intérêts tels que les groupes les perçoivent=== | |||
Il y a donc là un gain possible pour les élus locaux, qui n'ont pas toujours tout l'argent nécessaire pour leurs projets, comme pour le public, qui n'aime pas payer plus cher que nécessaire. Le système conventionnel offre potentiellement un avantage net s'il est possible de le mettre en place en prenant en compte les contraintes du marché politique. C'est loin d'être une tâche facile, et cela exige que les projets s'inspirent de l'analyse des choix publics, les différents groupes d'intérêt devant tous être pris en considération. | |||
Le public est surtout sensible à la qualité du service. Par conséquent, tout transfert à un contractant extérieur doit essayer d'obtenir une qualité au moins égale. Ce qui peut se faire si les contrats sont rédigés avec rigueur, comportant clauses de pénalité et garanties d'exécution. Le public souhaite aussi qu'on tienne compte de ses besoins, et nombre d'entreprises, dès qu'elles ont remporté un contrat avec une collectivité locale, prennent la peine de faire des études de marché pour se tenir au courant de ce que désire le public. | |||
La bureaucratie locale risque de perdre position et avantages si ses tâches sont dévolues au secteur privé. Il faut donc que les élus qui passent les conventions forment leurs équipes d'encadrement à la tâche de suivi et de police des contrats. Cela leur donnera une occasion de remplacer les responsabilités perdues par un travail plus intéressant encore. | |||
C'est le personnel des "services publics" qui est le plus menacé, et par conséquent le plus susceptible de s'opposer fortement à ce qu'on remette les tâches au secteur privé. C'est pourquoi les collectivités locales stipulent souvent que leur personnel aura priorité pour les nouveaux emplois créés dans le privé. Nombre d'entre elles neutralisent aussi l'opposition potentielle par une politique évitant toute perte d'emploi forcée. Elle consiste à recaser leur personnel en lui offrant les emplois qui, sinon, auraient été occupés par des nouveaux venus. Une autre politique est encore de leur offrir des indemnités de départ à des conditions suffisamment généreuses pour amener assez d'employés à les accepter volontairement. | |||
Les dirigeants syndicaux sont les plus difficiles à traiter, car on ne peut pas leur offrir de poste qui puisse se comparer au pouvoir dont ils jouissaient dans leurs fonctions antérieures. En conséquence, il faut habituellement offrir au personnel des conditions suffisamment intéressantes pour passer par-dessus la tête des chefs syndicalistes et obtenir un accord direct des employés. | |||
===Les salariés satisfaits=== | |||
L'expérience pratique de l'appel aux entreprises privées pour les services locaux en Grande-Bretagne a montré que les services pouvaient fonctionner avec 15 à 20 % de personnel en moins. Les salariés en surnombre peuvent être affectés ailleurs, éventuellement après recyclage. Ceux qui sont engagés par le contractant privé y trouvent des emplois plus qualifiés et des conditions d'avancement plus favorables. La sécurité de l'emploi est moindre dans le privé, et les systèmes de retraite moins avantageux, dans une large mesure parce qu'aucune entreprise privée ne peut se permettre d'indexer les retraites comme le fait le secteur public. En revanche, le salaire est aussi bon, et les avantages sont les mêmes. Le travail n'est pas plus dur, mais il est utilisé de façon plus efficace, et beaucoup de salariés se félicitent d'avoir sauté le pas. | |||
===La satisfaction de l'usager dépendra des procédures prévues pour garantir la qualité des services=== | |||
Cependant, si l'élu, soumis à tant de pressions, est fort sensible aux économies de coûts, il ne faut pas en attendre trop de satisfaction de la part du consommateur. Il n'est pas contre l'abaissement des coûts et des impôts locaux qu'apporte la convention, mais nous savons qu'il perçoit le service lui-même beaucoup plus directement que ce qu'il lui en coûte. C'est pourquoi le contrôle de la qualité est si important pour le succès de cette politique. Si l'on peut mettre en place un nouveau service qui sera plus efficace et attentif à ses besoins, le consommateur verra vraiment la différence avec le service déplorable et souvent hautain qui résulte de la capture par les producteurs dans le secteur public. | |||
Ceci, à son tour, exige la mise en œuvre d'un certain nombre de techniques détaillées. Beaucoup de collectivités locales "pré-qualifient" les soumissions, examinant soigneusement les offres pour éliminer celles qui n'atteindraient pas les normes de qualité requises. La sélection finale se fait à partir d'une liste des entreprises jugées suffisamment compétentes et expérimentées. Nombre d'élus font appel à des consultants extérieurs pour mettre au point les contrats, et presque tous exigent des garanties d'exécution, de sorte que si l'entreprise fait défaut, ou faillite, le service n'en pâtisse pas. Une autre procédure prévoit des pénalités pécuniaires au cas où le service ne correspondrait pas aux normes fixées, chose qu'aucune collectivité ne pourrait se permettre d'exiger de ses propres services. Bien sûr, la corruption demeure possible dans le système d'octroi des contrats mais, avec un appel d'offre largement public, elle est bien moins développée que dans les services locaux, qui échappent largement à la vigilance des citoyens. | |||
===Une réforme typiquement micropolitique=== | |||
Les méthodes de la micropolitique transparaissent à toutes les étapes du processus. L'analyse identifie tous les groupes du marché politique en question, et repère l'avantage particulier de chacun. Puis une politique est mise au point, qui offrira un avantage supérieur au plus grand nombre possible. Toutes les oppositions sont envisagées, la politique étant faite pour en neutraliser la plupart à l'avance. Le résultat est une politique qui marche, et dont le succès inspire tellement confiance qu'il permettra de l'appliquer ailleurs. | |||
La convention n'est pas la solution libérale pour les "services publics" locaux. C'est un succès parce qu'elle conduit à de meilleurs services, et pour moins cher. Elle introduit des éléments de liberté en soustrayant la production au secteur public pour la restituer au secteur et à l'entreprise privés. Elle introduit la concurrence, aussi bien pour la qualité des services que pour la détermination des prix, et encourage l'innovation et la performance. | |||
Les macro-politiciens la critiqueront et la critiquent parce qu'elle ne va pas assez loin. La vraie liberté, font-ils valoir, serait que les habitants d'une circonscription quelconque décident eux-mêmes directement à quelle entreprise ils feront appel pour les fournir, et quelle quantité de service ils vont recevoir. La critique est parfaitement juste ; faire appel à des contractants privés n'est pas la libre entreprise. Le financement est toujours collectivisé, et refuse sa place au choix personnel. Le problème se pose lorsque, voulant mettre en place un système totalement libre, la théorie des choix publics annonce que vous vous heurterez à un mur du fait des pressions des groupes d'intérêt concernés, alors qu'un système de contrats serait accepté. Le résultat ? Alors que les partisans d'une solution complète s'efforçaient encore de gagner la bataille des idées, en Grande-Bretagne les micropoliticiens se sont entre-temps débrouillés pour porter le système de la convention à un niveau de réussite tel que le gouvernement, bien assuré sur ses arrières, a rendu obligatoire l'appel à des entrepreneurs privés par les collectivités locales. | |||
Le contraste entre la solution micropolitique et celles du paradigme conventionnel (comme le paiement direct par l'utilisateur), montre à quel point extrême la première s'implique dans le monde réel. Elle veut tellement transformer l'idée en réalité sur le marché politique qu'en mettant au point ses techniques, elle recherche le moindre détail lui permettant de contourner les obstacles éventuels. Son souci n'est donc pas de chercher une solution passe-partout, mais de tailler sur mesures une politique pour chaque situation. Et elle réussit souvent parce que, lorsqu'elles sont faites sur mesure, les politiques sont évidemment mieux ajustées. | |||
===Deuxième exemple : l'enseignement étatisé=== | |||
Un autre exemple de problèmes sérieux engendrés par la production étatisée est l'enseignement public. En Grande-Bretagne, environ 93 % des enfants dépendent du secteur public et de lui seul pour leur instruction primaire et secondaire. Il existe un substitut théorique sous la forme d'écoles entièrement payantes, mais comme tout le monde doit payer l'impôt au système d'Etat, seule la minorité des gens qui peuvent se permettre de payer deux fois a effectivement accès à ces écoles privées. En conséquence, les écoles payantes apparaissent trop chères, alors que leurs tarifs ne font que correspondre en gros à ce que coûte l'enseignement public, si l'on y inclut les dépenses administratives au niveau local et national. | |||
===L'inversion classique du "service public" : impuissance des bénéficiaires prétendus, tyrannie des employés officiels=== | |||
La plupart des parents n'avaient aucune option réelle dans le cadre du système d'Etat. Leur enfant était affecté à l'école la plus proche, et bien qu'on ait prévu une possibilité de choisir, il suffisait aux autorités locales d'invoquer les "intérêts de l'éducation" pour la faire annuler. La plupart des tares de l'offre publique y apparaissaient au grand jour. Les parents étaient mécontents de la qualité de l'enseignement, et pouvaient constater qu'on répondait à la baisse du niveau en essayant d'empêcher qu'on le mesure, au lieu de chercher à l'améliorer. | |||
A toute occasion, on se heurtait aux effets de la capture par les producteurs . La "qualité du service" par exemple, n'était pas appréciée d'après les résultats, mais d'après les ressources utilisées. Ainsi, ce n'était pas le niveau de connaissances des enfants qui était censé compter, mais l'effectif des classes et le niveau de qualification supposé des enseignants. Le coût et la taille des services administratifs prenaient une part énorme, et croissante, du budget global. Les tentatives pour faire des économies n'affectaient en rien le gaspillage, mais touchaient en revanche le capital et l'équipement, ainsi que les services essentiels. | |||
Les parents étaient forcés par l'impôt de payer une somme qu'ils ne pouvaient pas contrôler, pour financer un enseignement où ils n'avaient aucun choix et aucune possibilité de faire connaître leurs préférences. En somme, ils payaient cher une ration imposée. L'uniformité était reine, sans variété ni choix, et les priorités "pédagogiques" étaient bien sûr dictées par les producteurs. Quelle idée, de demander leur avis aux consommateurs ! Ces priorités comprenaient évidemment ce que nombre de parents comprenaient comme un endoctrinement politique, n'ayant rien à voir avec de l'enseignement3. | |||
===Comment privatiser les décisions sans toucher au mythe de la "gratuité" ?=== | |||
Réintroduire dans le système éducatif des disciplines de marché pour laisser un peu de place aux besoins des consommateurs, posait aux législateurs un double problème. Aussi mécontents qu'ils aient été du produit fourni, les gens avaient pris l'habitude d'un service d'enseignement "gratuit" lors de sa consommation. | |||
===Faciliter l'inscription aux écoles privées ?=== | |||
Un type de solution envisagé consistait à se tourner vers les écoles privées, en cherchant les moyens d'en ouvrir l'accès à un plus grand nombre de parents ordinaires, pour accroître le nombre des enfants qui leur étaient confiés. | |||
L'une des mesures proposées consistait à permettre de déduire des impôts les frais de scolarité privée, ce qui en réduisait le coût en termes réels, et donnait à davantage de gens les moyens d'accéder aux écoles payantes. Une variante similaire proposait d'offrir un abattement fiscal à ceux qui quitteraient l'enseignement d'Etat pour choisir une école privée. Ces solutions s'appuyaient sur l'idée que ces parents épargnaient à "l'Etat" le coût de l'éducation de leurs enfants, et que peut-être une petite incitation en encouragerait d'autres à les imiter. Si l'abattement était bien calculé, l'"Etat", en n'ayant pas à instruire ces enfants, pourrait épargner davantage qu'"il" n'y perdrait en impôts non versés. | |||
===Il fallait trouver une solution pour tout le monde=== | |||
Toutes ces propositions souffraient de cette faiblesse fondamentale que le nombre des bénéficiaires éventuels du secteur privé serait de toutes façons trop restreint. On a de bonnes raisons de penser qu'il existe dans les classes moyennes un groupe de pression latent qui ne demande qu'à s'exprimer, pour avoir davantage les moyens d'accéder aux écoles privées. Les sondages ne montrent aucune hostilité de la part de la majorité des parents, lesquels semblent plutôt enclins à laisser le libre choix à ceux qui peuvent se le permettre. Politiquement parlant, il semble donc tout à fait possible de faciliter l'accès au privé. Le problème est que, même si l'on y doublait le nombre de places, cet événement improbable laisserait quand même quelque 86 % des parents piégés dans le système public. Par conséquent, pour la plupart des parents, la réforme devait passer par l'amélioration du secteur public. | |||
===La "macro"-solution semi-libérale : le "bon scolaire" | |||
Les partisans des solutions de liberté prônent depuis longtemps la mise en place d'un système de bons scolaires. Dans un système de bons, on ne donnerait plus aux parents une place (pseudo-) gratuite dans une école publique. Ils recevraient à la place un bon, de valeur équivalente à ce que coûterait cette place, et seraient libres de le donner en paiement à l'école de leur choix. Le bon prendrait la place de l'argent. Plutôt que de leur rendre leur argent, avec obligation de le consacrer à l'école, les hommes de l'Etat donneraient aux parents un coupon de papier qui fonctionnerait comme lui, avec cette différence importante qu'ils ne pourraient pas le "détourner" à d'autres fins. Ce système répond ainsi à l'objection selon laquelle, si on laissait aux parents la possibilité de payer directement, ils iraient dépenser l'argent au jeu ou alors le boire. | |||
Le système du bon scolaire ne vise en rien à instituer un système de liberté authentique. Subventions et transferts persistent, les contribuables qui n'ont pas d'enfants sont toujours forcés de payer des bons qu'ils ne reçoivent pas, de sorte que les parents se font entretenir par les non-parents. En outre, le montant du bon impose une somme minimum à consacrer à l'école, interdisant aux parents d'y dépenser moins. On pourrait envisager l'apparition d'un marché noir, d'un commerce illégal où les bons s'échangeraient contre de l'argent, de sorte que les gens pourraient en fait choisir ; mais cela se ferait contre la législation du bon scolaire, et non sous son égide. | |||
L'objectif de ce système est d'introduire un élément de discipline marchande. En choisissant où dépenser leurs bons, les parents choisiraient le type d'école qu'ils préfèrent. Les écoles considérées comme "mauvaises", ne recevant plus assez de bons pour payer leurs frais, devraient réduire leurs activités, voire envisager la fermeture. Les écoles bien cotées, attirant une demande supplémentaire, obtiendraient grâce aux bons suffisamment d'argent pour prendre de l'extension. En outre, elles serviraient de modèle aux autres. Petit à petit, l'éducation prendrait la forme que les parents souhaitent pour leurs enfants. Elle se dégagerait de l'emprise des producteurs, et se retrouverait aux ordres des consommateurs, désormais admis à faire prévaloir leurs choix. | |||
Il existe plusieurs variantes du système de bons, mais la plupart d'entre elles permettent aux parents d'ajouter de l'argent à la valeur de leur bon pour acheter une place dans une école plus chère. Ce qui implique que les parents pourraient choisir une école privée s'ils le souhaitent, en compensant la différence entre le prix de l'école et la valeur du bon. Ceci implique également que certaines écoles d'Etat choisiraient de proposer une éducation plus coûteuse que les autres. L'effet net serait d'apporter davantage de ressources au système éducatif, tout en rapprochant encore davantage le niveau de sa production de ce que les parents souhaitent, et sont prêts à financer par leurs bons et leur argent. | |||
===Les obstacles politiques=== | |||
Le système des bons présente bien des aspects intéressants et pourrait, s'il pouvait être réalisé, constituer une amélioration bien réelle par rapport au quasi-monopole des hommes de l'Etat dans le domaine de l'enseignement. Malheureusement, l'expérience semble montrer que le système des bons ne peut pas être mis en application. Malgré ses indubitables atouts économiques, il présente des faiblesses politiques qui le font gravement déconseiller. Sous sa forme moderne, cela fait plus de soixante ans qu'il fait l'objet de débats. Il a été sérieusement examiné par les gouvernements conservateurs anglais, mais jamais introduit. Même une conjoncture exceptionnelle, où l'on comptait à la fois le Ministre et le secrétaire d'Etat à l'Education parmi ses partisans, n'a pas suffi pour le mettre en pratique. | |||
Pour commencer, il y a une opposition très forte de la part de ceux qui produisent l'enseignement. Les syndicats d'enseignants résistent parce qu'ils ne veulent pas que leurs adhérents soient exposés aux disciplines du marché. Les bureaucrates des ministères sont absolument fanatiques dans leur opposition. Ils comprennent bien, et avec juste raison, que ce système rendrait aux parents le pouvoir, qu'ils ont confisqué, de contrôler ce qui est enseigné. Les parents eux-mêmes se laissent facilement inquiéter par la perspective de perdre la place (pseudo-)gratuite qui leur est garantie à l'école locale. Ils craignent d'être obligés de payer davantage pour assurer à leurs enfants une éducation correcte. | |||
===La peur de l'inconnu=== | |||
En outre, il n'est pas vraiment possible de mettre en place ce projet de façon progressive. On peut bien parler d'expériences limitées, ce système ne peut pas être vraiment efficace ni offrir la diversité et le choix, s'il ne concerne pas l'ensemble des écoles, et sur un espace assez large. A cette échelle, il est exposé au sabotage de ceux qui refusent de perdre leur pouvoir abusif sur l'enseignement. C'est donc un projet globaliste, où tous les changements doivent se produire d'un seul coup. Les parents recevraient une feuille de papier par la Poste, au lieu d'une place "gratuite" dans une école. Les écoles, aussi bien que les parents, se trouveraient tout-à-coup plongées dans l'incertitude. Rien n'est plus facile que de présenter tout cela comme un projet de théoriciens, jamais vraiment essayé, et qui ferait courir un danger à l'éducation des enfants. Plusieurs gouvernements ont essayé d'imposer des systèmes de bons, mais ont dû à chaque occasion battre en retraite face à l'opposition politique des groupes d'intérêt. | |||
===Le triptyque des micropoliticiens=== | |||
Une proposition de remplacement, qui doit beaucoup à l'analyse micropolitique et à sa manière de faire, propose trois réformes indépendantes, dont chacune peut en soi être justifiée, mais dont la combinaison forme un nouveau système. | |||
===Supprimer la "carte scolaire"=== | |||
Tout d'abord, elle prétend que les parents aient un véritable Droit de choisir, et propose en conséquence que l'entrée soit totalement libre dans le système d'Etat, de sorte qu'un enfant puisse être envoyé à toute école qui l'acceptera. | |||
Cette politique-là est calculée pour faire plaisir aux parents. Nombre d'entre eux sont piégés par leur lieu de résidence dans la zone d'affectation d'une mauvaise école. La liberté de choisir l'école doit leur permettre de s'échapper. Le Droit de choisir, en présence d'une sectorisation de droit ou de fait, est réservé à ceux qui ont les moyens de déménager à proximité d'une bonne école. Il n'est pas rare, d'ailleurs, que des maisons situées du "bon" côté de la rue affectées à la bonne école vaillent plusieurs milliers de livres de plus que leurs vis-à-vis, physiquement identiques. La politique du libre accès laisse toujours les parents se débrouiller avec les problèmes de transport. Elle doit aussi conduire les bonnes écoles à un excédent d'inscriptions, les obligeant à refuser des candidats. Il n'empêche que ce serait un mieux, et un mieux apprécié. | |||
===Rapatrier la responsabilité au niveau où les problèmes se posent | |||
Le second pilier de la réforme est une politique qui rend les écoles beaucoup plus indépendantes dans leur fonctionnement. Dans chaque école, un Conseil où le vote des parents serait fortement représenté, prendrait en charge l'ensemble des décisions. Il aurait le pouvoir de choisir son directeur, et de lui donner l'autorité nécessaire pour embaucher le personnel et le renvoyer, avec approbation du Conseil. L'école déterminerait sa propre politique en ce qui concerne la discipline et les programmes, avec une inspection régulière des résultats de ses élèves dans un tronc commun minimum. | |||
Avec une telle réforme, les écoles sont enfin autorisées à offrir davantage de diversité, de même que des approches différentes de l'enseignement et de la pédagogie. A son tour, cette diversité permettra de donner un contenu concret au choix entre les écoles exprimé par les parents. Les parents apprécient cette politique, qui leur promet voix au chapitre dans les orientations de l'école. Elle reçoit un accueil mitigé de la part du personnel, les directeurs y étant globalement favorables pour le meilleur statut et le pouvoir qu'elle leur donne, et les enseignants étant plus divisés. Certains y reconnaissent des possibilités d'avancement et de rémunérations accrues, d'autres craignent pour la sécurité de leur emploi. Des garanties précisant la durée de l'emploi et les motifs de licenciement pourraient faire beaucoup pour calmer de telles inquiétudes. | |||
===Subordonner étroitement le financement de l'école à la présence de l'élève | |||
Le troisième pilier de la réforme impose un financement direct des écoles sur la base du nombre d'enfants inscrits. Notre système les finance actuellement par l'impôt, par l'intermédiaire de l'administration du Conseil Local de l'Enseignement. La réforme court-circuitera la bureaucratie installée, autorisant les écoles à choisir de quitter son orbite, en étant financées directement par le centre, en fonction des effectifs. Bien sûr, cette solution déplaît fortement aux Conseils en place, mais ces derniers sont tout petits, et n'auront plus grand-chose à offrir sur le marché politique. Notre administration centrale y est plus favorable, car elle voit peut-être davantage d'ouvertures pour ses membres dans la supervision d'un tel projet, sans pour autant avoir à envisager des pertes d'emploi ou de statut. | |||
On propose que le financement pour chaque élève soit calculé d'après le coût de l'enseignement pour chaque classe d'âge, avec peut-être des exceptions vers le haut pour les établissements urbains où les problèmes de langue sont importants, ainsi que pour les écoles de campagne isolées qui ont davantage de charges fixes par élève. Deux groupes qui auraient pu se sentir menacés par la réforme sont donc pris en charge. Les parents, dans l'ensemble, n'ont rien à perdre à un financement direct des écoles, et ils y gagnent l'économie qui résulte de ce qu'on supprime toute une strate de l'administration, ce qui en laisse davantage pour financer le service. | |||
===Un quasi-marché pour les services d'enseignement | |||
Une fois ces trois piliers de la réforme mis en place, il deviendra évident que leur effet combiné est de créer un marché de l'enseignement. Comme les écoles sont désormais contrôlées par leurs propres Conseils, elles suivent leurs propres priorités pédagogiques, et diffèrent par la qualité et le type des formations. Comme les parents ont la liberté d'accès, ils choisissent pour leurs enfants le type d'enseignement qu'ils préfèrent. Comme les écoles sont directement financées d'après le nombre d'élèves, celles qui reçoivent une demande accrue reçoivent aussi plus d'argent. Les écoles mal vues des parents se réforment, ou doivent fermer. | |||
===Le changement se fera exactement au gré des personnes directement concernées | |||
Un des grands avantages de cette réforme micropolitique est que chacune de ces étapes peut être appuyée indépendamment par des groupes différents, et le changement résultant de la synthèse de leurs effets. On n'impose aux parents aucun bouleversement soudain contre leur volonté, car pour ceux qui n'en demandent pas davantage que de disposer de la place "gratuite" à l'école du quartier, celle-ci est toujours là pour eux. La liberté de choisir n'est offerte qu'à ceux qui en veulent, personne n'y est poussé contre son gré. Bien sûr, à mesure que ce système se développe, un nombre croissant de parents va profiter du choix offert. Il faudra donc y intégrer de nouvelles techniques pour permettre de créer de nouvelles écoles publiques là où il existe une demande, et attirer d'autres sources de financement de la part du secteur privé. | |||
Cette politique n'institue pas un marché complètement libre. A cet égard, elle en fait même moins que le système de bons, car elle ne concerne que les écoles publiques. Elle laisse les écoles payantes telles qu'elles sont ; celles-ci ne sont pas touchées par le nouveau système, et n'y prennent aucune part. Elle vise directement le système public qui concerne tout de même 93 % des élèves, et cherche à l'améliorer en transférant le pouvoir des producteurs au consommateur. Les écoles sont toujours des écoles d'Etat, toujours pour l'essentiel financées par l'impôt. Les nouvelles écoles fondées par les parents et les enseignants restent aussi des écoles de l'Etat, directement financées par lui. | |||
===Une "micro-révolution" | |||
Malgré ces lacunes, le nouveau système est un véritable bouleversement. Les écoles publiques sont gérées de façon indépendante, alors même qu'elles restent dans le secteur public. Les parents ont une possibilité de choisir, qui détermine l'endroit où ira l'argent pour financer l'éducation de leur enfant. Les écoles doivent répondre à la demande pour attirer les effectifs dont leur budget dépend. La frontière très nette qui existe, dans l'ancien système, entre le secteur public et les écoles privées devient, avec le nouveau système, un peu plus floue. Des forces et des pressions sont libérées, qui poussent à l'amélioration progressive du niveau d'éducation à atteindre dans le secteur d'Etat. Elles ont été voulues par ces réformes, calculées pour s'attirer le soutien d'une bonne partie des groupes qui ont un intérêt direct dans l'enseignement public. | |||
===Invisible, le bon scolaire "passe" mieux | |||
Il existe des différences clés entre le système des bons et la nouvelle approche. Une d'entre elles est que la nouvelle méthode obtient les mêmes résultats qu'un système de bons, tout en dispensant de les utiliser. Car l'argent peut tout aussi bien suivre l'enfant, une fois que ses parents ont fait leur choix parmi toute une gamme d'écoles. | |||
Une autre différence est que la proposition est une politique praticable, qui va dans le sens du marché politique. On peut la mettre en place par étapes et, petit à petit, en tirer un système d'enseignement plus souple, plus varié et plus en phase avec les besoins et les désirs des parents. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais c'est une solution viable à notre problème. Et il est significatif, alors que le bon scolaire est rejeté depuis des années, que le nouveau système ait figuré dans le programme conservateur pour l'élection de 1987 ; ses éléments ont été présentés dans le discours de la Reine consécutif à la nouvelle victoire des conservateurs, des propositions comparables étant faites pour l'Ecosse plusieurs mois plus tard. | |||
==Détails pratiques== | |||
===Le détail des programmes conservateurs des années 1980=== | |||
Nous savons désormais ce qui, au-delà de leur inspiration commune, distingue historiquement les programmes conservateurs des années 70 et ceux des années 80 : les professionnels du projet politique s'emparant de la théorie des choix publics avec sa critique de la conception traditionnelle du changement politique, pour en faire un outil de création systématique. Cette créativité érigée en principe, nous allons maintenant voir à quel point elle caractérise les nouvelles politiques par opposition aux anciennes1. | |||
===Avant tout, un état d'esprit différent=== | |||
La différence essentielle, on ne le rappellera jamais assez, était avant tout une ''différence d'approche''. Le présupposé initial était que, pour inverser la dérive vers le socialisme, on allait ''imposer'' les solutions de liberté, même si cela devait conduire à provoquer la fureur des groupes de pression susceptibles d'y perdre. La nouvelle approche mettait au contraire l'accent sur la ''recherche'' de techniques nouvelles, applicables dans la pratique, donnant aux personnes visées un ''avantage net'' par rapport à leur situation antérieure. | |||
===Les privilégiés du logement "social"=== | |||
Prenons les choix qui furent faits en matière de logement "social". A l'époque, quelque 35 % de la population vivaient dans des logements publics, aux loyers en général fortement subventionnés, et qui, dans certains cas, coûtaient plus cher à entretenir qu'ils ne rapportaient. ''Naturellement, toute redistribution profite d'abord aux gens bien placés'', et les locataires des municipalités (la Ville étant propriétaire dans la plupart des cas) avaient, comme partout en pareil cas, un revenu moyen ''plus'' élevé que celui des locataires du secteur privé. Les Conservateurs voyaient une injustice évidente dans le fait d'obliger ceux qui s'efforçaient de se loger par leurs propres moyens, allant jusqu'à se priver pour s'acheter un logement, à payer un surcroît d'impôts et de taxes pour permettre à d'autres, éventuellement plus riches qu'eux-mêmes, de ne payer que des loyers de faveur. | |||
===Imposer le retour à un loyer "normal" ?=== | |||
Les candidats conservateurs aux élections locales et nationales avaient préconisé de réévaluer les loyers au niveau du marché ; mais ils se rendirent vite compte que, pour sa part, le locataire moyen des HLM préférait un loyer subventionné à un loyer de marché. Ainsi, le milieu des HLM formait un bloc d'opposition résolue à la réforme du système, alors que celui-ci paralysait l'offre de logement et entravait la mobilité des locataires. Ces derniers rechignaient à déménager, par crainte de perdre leur place s'ils habitaient déjà un logement subventionné, ou leur tour sur la liste d'attente s'ils l'attendaient encore. | |||
Comme dans bien d'autres cas d'avantages réservés aux minorités, les bénéficiaires du privilège lui donnaient plus de valeur que ses victimes ne trouvaient à s'en plaindre. Les bureaucraties locales s'étaient constitué de véritables empires sous prétexte d'administrer ces logements "sociaux", lesquels avaient aussi permis aux élus locaux de "bétonner" leurs majorités électorales. Bref, les intéressés étaient tous acquis au système en place, et toute proposition de réforme vouée à une hostilité unanime. | |||
===Permettre aux bénéficiaires de racheter leur logement à un prix de faveur=== | |||
La nouvelle politique, sans laisser tomber l'idée de la vérité des prix, fit tout pour faciliter aux locataires l'achat de leur logement, s'efforçant en outre d'attirer toute l'attention sur elle. Les locataires HLM étaient tout acquis à l'idée que les autres soient forcés de leur payer le logement, mais il s'en trouva un bon nombre pour apprécier encore davantage la perspective de devenir propriétaire. Pour s'assurer leur appui, le gouvernement fit bien en sorte que les logements leur fussent vendus à un prix inférieur à celui du marché. Celui qui habitait son logement depuis deux ans avait une réduction de 20 % sur la valeur vénale, le rabais pouvant atteindre 50 % pour ceux qui étaient là depuis vingt ans. Si grand que fût leur goût pour le parasitisme locatif, on découvrit que la perspective de posséder leur propre maison, en faisant au passage un bénéfice de plusieurs dizaines de milliers de francs, était encore plus alléchante pour une bonne partie des locataires HLM. | |||
===Bouleverser, comme en se jouant, les données du problème=== | |||
Que s'était-il passé? c'est bien simple : en faisant une nouvelle offre sur le marché politique, on avait créé une situation nouvelle, à laquelle les groupes de pression avaient tout naturellement adapté leur position ; et pour certains, l'offre proposée avait décidément plus de valeur que la subventionnite. Les municipalités se virent alors ardemment pressées de vendre leurs logements. Certaines essayèrent de résister, utilisant tous les moyens pour faire obstruction, mais les partisans de la réforme étaient devenus suffisamment nombreux pour permettre au gouvernement d'instituer un "droit d'acquisition", qui obligeait les autorités locales à vendre si les locataires le demandaient. Les rabais furent d'abord relevés à 60 %, pour passer ensuite jusqu'à 80 %. | |||
===Une force irrésistible=== | |||
En septembre 1986, sur les cinq millions de locataires "municipaux", un million avait déjà acheté sa maison, et une loi était en préparation pour disposer de même des appartements. Le groupe des nouveaux propriétaires formait déjà une force considérable dans l'arène politique. Le parti travailliste, qui s'était toujours prononcé contre les ventes, dut, à son corps défendant, reconnaître la nouvelle situation et brûler ce qu'il avait adoré. Il lui fallut non seulement renoncer à toute idée de renationaliser les logements vendus mais encore, mangeant son chapeau jusqu'au bout, s'engager à poursuivre la politique de ventes à des prix de faveur. | |||
Impuissants, les bureaucrates locaux assistèrent à l'écroulement de leurs empires, et quant aux élus, ils virent leur échapper les électeurs qu'ils avaient cru tenir captifs pour toujours. La pression exercée par le nouveau lobby était irrésistible. Pour la première fois, le gouvernement avait domestiqué la force du marché politique en surenchérissant sur ses acteurs habituels2. Le transfert de pouvoir et de propriété qui en résulta fut considérable. Rappelons que, de 1979 à 1986, un cinquième des locataires HLM avaient déjà choisi de devenir propriétaires de leur maison. Dans l'intervalle, la recherche micropolitique s'était ingéniée à trouver d'autres moyens pour accroître le nombre de ceux qui pourraient être persuadés de le faire à l'avenir. | |||
===La magie de la nouvelle approche=== | |||
Alors que le gouvernement précédent avait échoué à imposer les disciplines du marché libre, le gouvernement Thatcher réussit à en introduire quelques-unes, simplement parce que ses propositions avaient pris le marché politique tel qu'il est. L'ancienne approche cherchait à passer outre aux intérêts des locataires HLM, en les privant du privilège des subventions locatives dont ils jouissaient depuis longtemps ; la nouvelle essayait de leur offrir en échange quelque chose qui valait davantage. Le résultat fut qu'on vit les opposants farouches de l'ancienne méthode se métamorphoser, comme par magie, en ardents partisans de la nouvelle. Elle avait permis non seulement de rapatrier un grand nombre de logements dans le secteur privé, où ils étaient soumis à des prix et des charges d'entretien réels, mais aussi d'assurer au gouvernement un soutien électoral substantiel. | |||
===Le logement locatif privé paralysé par la politique=== | |||
Les problèmes du logement locatif en Grande-Bretagne ne se bornent pas au secteur public. Il existe encore un logement locatif privé, mais l'intervention des hommes de l'Etat l'a rendu bien malade. En fait, il ne représente plus qu'un faible pourcentage du marché. La concurrence déloyale du logement d'Etat subventionné en est certainement responsable, mais le coup de grâce lui a été porté par deux politiques dont l'effet est immanquablement de détruire le parc immobilier : le contrôle des loyers, associé à un "droit à" un maintien dans les lieux. Les locataires avaient su former un groupe de pression puissant, bien plus nombreux que les propriétaires, et qui multipliait les prétextes à l'ingérence des organisations "humanitaires" et autres lobbies intéressés3. | |||
===Les premières victimes : les locataires à venir=== | |||
Le résultat est que les locataires en place ont reçu des privilèges, non seulement aux dépens des propriétaires — c'était voulu -, mais aussi des locataires à venir. Car la politique en question a naturellement eu pour effet de tarir presque complètement l'offre de nouveaux logements à louer. Là encore, la main invisible du marché politique est à l'œuvre : pas plus que les propriétaires, les futurs locataires ne peuvent former un groupe de pression efficace. Les propriétaires sont trop peu nombreux, et quant aux locataires à venir, ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils perdent à l'affaire4. | |||
===Qui serait volontaire pour se faire voler ?=== | |||
La loi a donc fixé les loyers bien au-dessous de leur prix de marché, tout en refusant, bien sûr, aux propriétaires le droit de récupérer leur bien, même pour y habiter eux-mêmes ou en cas de risque grave de cessation de paiement. Comme les locataires sont autorisés à occuper le logement d'un autre pour un loyer moindre que le propriétaire ne l'accepte, voire inférieur aux coûts d'entretien, il est difficile de voir en quoi cela se distingue d'un vol pur et simple, à cela près que ce vol-là est reconnu par la loi. Naturellement, les propriétaires rechignent à louer dans ces conditions. Ceux qui, par exemple, ont hérité de leurs parents un logement supplémentaire se refusent à le louer, par crainte de le perdre au profit des "locataires". | |||
===Les privilégiés ont bien appris à se servir des pauvres=== | |||
Comme on a tout de même besoin d'un secteur locatif privé en état de marche, les gouvernements conservateurs ont essayé de faire avancer les choses dans le sens d'une suppression du contrôle des loyers et du "droit" au maintien dans les lieux. La seule évocation de cette idée a toujours provoqué une réaction indignée non seulement des locataires, mais plus encore de ceux dont le fonds de commerce est de les représenter, ou dont l'idéologie est hostile à la propriété privée. Elle a toujours donné l'occasion de manifester, ou d'écrire article sur article dans les média sur les souffrances qu'une telle réforme ne manquerait pas d'occasionner aux malheureux locataires. Quant aux tourments des propriétaires, ils ne feront jamais couler d'encre, parce que ceux-ci sont piégés dans la caricature du riche-qui-exploite-le-désespoir-des-pauvres-sans-logis. Si l'on devait choisir un saint patron des propriétaires, Monsieur Vautour ferait un bon candidat aux yeux des média. Si bien que les timides tentatives faites pour libérer le marché n'ont jamais pu aller très loin. | |||
Rétablir la liberté des contrats de location privée augmenterait immédiatement l'offre de logements sur le marché, et engendrerait probablement une stabilisation des prix en accroissant considérablement la construction. Malheureusement, comme dans bien d'autres cas, la solution la meilleure et la plus juste ne peut pas être réalisée par les moyens habituels. Les groupes qui profitent de ces privilèges se battront avec plus d'acharnement pour les conserver que d'autres pour les abolir. | |||
===Faire la part du feu=== | |||
Les solutions mises en avant par la micropolitique ne prétendent certainement pas être justes. Elles consistent essentiellement à maintenir les privilèges de la génération actuelle des locataires, mais en précisant que tout nouveau bail échappera au contrôle des loyers et autres maintien dans les lieux. Le raisonnement est que les locataires en place n'auront aucune raison de s'opposer à cette mesure, puisque leurs propres avantages ne seront pas menacés. En revanche, une situation aura été créée, où toute nouvelle location sera libre de ces contraintes. Au départ ou au décès des locataires en place, les logements qu'ils occupaient seraient reloués à des loyers de marché. On pourrait même favoriser certains départs à l'aide de dessous de table. Le nombre de locations protégées diminuerait progressivement, jusqu'à ce que toutes les locations finissent par se trouver sur le marché libre. | |||
===Séparer les idéologues de leurs complices intéressés=== | |||
Le résultat ne serait pas moins injuste pour les propriétaires actuels que le système en place, mais au moins, il empêcherait l'injustice à venir tout en amenuisant progressivement son étendue. C'est une politique réaliste, puisqu'elle est taillée sur mesure pour neutraliser l'opposition du groupe visé. Les lobbies idéologiques y seraient toujours hostiles mais, tout comme les propriétaires, ils sont peu nombreux. Sans l'armée des locataires pour défiler derrière leurs banderoles et jouer la comédie du mélodrame devant les caméras de télévision, ils sont parfaitement impuissants. | |||
===Distinguer les "catégories" pour exorciser le fantasme | |||
Une deuxième proposition tirée de ce type d'approche est de distinguer entre différentes catégories de propriétaires, chacune étant soumise à un type de contrôle différent. Par exemple, le petit propriétaire qui loue un ou deux logements à l'occasion n'appartiendrait pas à la même catégorie que le propriétaire établi comme tel et qui possède plusieurs immeubles de rapport. De même, un propriétaire institutionnel, comme l'Eglise d'Angleterre ou la Caisse des Dépôts en France, ainsi qu'une grande société immobilière, ne serait pas dans la même catégorie que le particulier qui loue quelques logements. Une fois de plus, l'objectif d'une telle subdivision est d'introduire quelques éléments de libéralisation dans le marché locatif actuel, même s'ils ne peuvent pas lui être appliqués dans son ensemble. | |||
L'idée de départ est qu'il y a certains groupes qui ont plus d'influence que d'autres (ce pouvoir, rappelons-le, ne tient pas forcément aux seuls effectifs ; cela peut être leur visibilité, ou leur capacité de nuire, qui leur donnent du poids). Dans ce contexte, l'expulsion d'un logement a une puissance d'émotion difficile à parer. C'est un fantasme terrible que celle des malheureux-chassés-de-chez-eux-parce-qu'ils-n'ont-plus-les moyens-de-payer-le-loyer. Il n'y a pas un homme politique qui ne préférerait se casser une jambe plutôt que d'en être tenu pour responsable. Conséquence : on connaît des sociétés immobilières qui pourraient louer à des particuliers, et qui se l'interdisent résolument par crainte du dommage que subirait leur réputation si une telle situation se présentait. | |||
===Des baux à court terme ?=== | |||
Une solution pourrait être trouvée dans des baux à court terme, parce qu'ils prévoient que le propriétaire récupérera les locaux vides à leur expiration. Il est toujours possible alors de négocier de nouveaux baux. Le bail à court terme n'évoque pas les mêmes images immémoriales de familles chassées de leur maison de toujours, avec un propriétaire rapace à montrer du doigt. Des variantes de ces idées ont été essayées, et d'autres encore sont à l'étude. L'idée fondamentale est que l'on renonce à libéraliser le marché pour imposer la justice à tout prix, et à braver la tempête en racontant aux parlementaires que toute cette agitation finira bien par se calmer. Au contraire, on tente de contourner l'hostilité des groupes en cause en s'assurant que la politique, telle qu'elle est conçue, ne sera pas une menace pour eux. | |||
===Les "canards boiteux"=== | |||
Les changements de style qu'apporte l'approche micropolitique sont aussi visibles dans les méthodes employées face aux secteurs déficitaires des entreprises d'Etat. Lorsque l'accumulation des déficits attire l'attention du gouvernement sur des implantations ou des usines qui sont causes d'une proportion particulièrement importante du déficit total, l'évocation de la fermeture provoque une réaction trop prévisible. Les travailleurs défilent dans la rue, scandant des slogans et menaçant de faire grève. Dans les cas extrêmes, ils vont jusqu'à occuper les locaux. Les élus de la région font pression sur le gouvernement, qui se retrouve finalement confronté à une forte opposition, avec bien peu d'appuis. Comme toujours, les bénéficiaires de la subvention sont ceux qui militent avec le plus d'ardeur. | |||
===Des offres généreuses à la main-d'œuvre=== | |||
Les gouvernements du passé ont souvent battu en retraite sous le feu, retirant leur projet de fermeture, prévoyant de moindre dégâts politiques en maintenant les subsides qu'en allant jusqu'au bout de leur choix de les supprimer. Or, l'approche a récemment changé en Grande-Bretagne : maintenant, l'effort consiste essentiellement à essayer d'obtenir le consentement de la main-d'œuvre. Les dirigeants et autres délégués syndicaux continuent à freiner des quatre fers ; cependant, en faisant des offres très généreuses, aussi bien en indemnités de licenciement qu'en primes de transfert, le gouvernement embellit fortement la proposition aux yeux des salariés. | |||
Pour remplacer les subventions à l'emploi, en associant les aides de l'Etat à un capital substantiel, on propose aux employés une somme suffisante pour permettre à certains de créer une entreprise ou, pour les plus âgés, de s'assurer une retraite anticipée confortable. On compense parfois l'éventualité de perdre un emploi avantageux à un endroit par l'offre d'un reclassement ailleurs. Tout est fait pour minimiser le nombre d'emplois effectivement perdus : c'est une des zones les plus sensibles du marché politique, où il est vraiment nécessaire de faire des concessions. | |||
Des indemnités de licenciement vraiment coquettes, parallèlement à des offres de reconversion parfois associées à des cours de recyclage, ou à des possibilités de reclassement dans l'entreprise elle-même, tout cela finit par désarmer la résistance rencontrée. Le résultat est qu'il devient désormais possible de fermer une partie des activités déficitaires. A court terme, cela peut coûter plus cher qu'une fermeture pure et simple, mais, lorsqu'on a réussi à le faire, cela représente une économie sur les subventions à venir, dont on est privé lorsque l'on a laissé les perdants potentiels empêcher la fermeture. | |||
===La réforme du droit syndical=== | |||
La manière dont le droit syndical a été réformé illustre aussi excellemment la différence de style entre les deux approches. Les gouvernements précédents, travaillistes aussi bien que conservateurs, s'étaient rendus compte que la législation protectrice des syndicats leur avait accordé trop de pouvoir et d'immunités. La crainte que ce pouvoir ne finisse par détruire l'économie et la société s'il restait incontrôlé avait conduit Harold Wilson, en tant que Premier Ministre travailliste, et Edward Heath, quand il était Premier Ministre conservateur, à tenter des réformes pour les ramener sur le chemin du Droit. Or, tous deux avaient échoué. Le projet travailliste dut être retiré ignominieusement, et la loi d'origine conservatrice fut rendue inapplicable par la résistance massive des travailleurs ; elle fut d'ailleurs immédiatement révoquée par le gouvernement qui suivit. | |||
L'administration Thatcher, pour sa part, a lancé une série de réformes dans le droit du travail qui ont transformé le climat social et l'activité syndicale en Grande-Bretagne. On la crédite d'avoir réussi là où ses prédécesseurs avaient échoué. Or ce qu'elle a obtenu en fait, c'est un résultat ''différent''. | |||
===L'échec de la confrontation directe=== | |||
Les deux tentatives avortées avaient pour l'essentiel essayé de priver de leurs pouvoirs les syndicats et leurs adhérents. L'une et l'autre étaient caractérisés par l'imposition de nouvelles entraves et de nouvelles restrictions à leurs activités, soutenues par des sanctions légales. Certains types d'action syndicale, auparavant autorisés, devenaient interdits. Les dirigeants et les membres des syndicats qui violaient la nouvelle législation devaient verser de lourdes amendes, le défaut de paiement étant puni d'emprisonnement. Dans chacun des cas, le Parlement avait pris la peine de donner à cette réforme la sanction d'une loi solennelle. | |||
Le projet Wilson fut retiré au niveau du Conseil des Ministres, lorsqu'il devint évident que l'hostilité des syndicats, de leurs appuis au sein du gouvernement et des parlementaires dépendants de leur soutien, serait trop forte. La proposition Heath, quant à elle, fut votée, mais aussitôt impunément bafouée, le gouvernement reculant devant la perspective d'une confrontation majeure s'il avait vraiment essayé de l'imposer. Les deux tentatives de réforme firent contre elles l'unité du mouvement syndical. Les dirigeants syndicaux appelèrent à la résistance, et la base les suivit pour défendre ce qu'elle considérait comme ses droits. Les syndicats de Grande-Bretagne jouissaient donc d'une protection légale, voire d'une impunité judiciaire, qui étaient sans précédent et semblaient devoir s'accroître indéfiniment. Il était devenu possible, au cours d'un conflit du travail, de commettre des actions qui, dans un autre cadre, auraient été punies comme des atteintes au Droit, voire des délits purs et simples. Le groupe en cause défendait tout naturellement ses privilèges, et y réussissait fort bien. | |||
===Surtout pas de "grande" réforme=== | |||
Les réformes Thatcher eurent un tout autre visage. Tout d'abord, elles ne prirent pas la forme d'une grande loi, mais d'une succession de petits amendements au droit. Lorsque le premier fut inauguré par James Prior, Ministre de l'Emploi, bien des gens s'imaginèrent que ce serait le seul. En fait, il l'a peut-être cru lui-même, jusqu'à ce que la pression des députés conservateurs de la base en impose une autre. Chaque mesure semblait très limitée dans sa portée, peut-être calibrée pour rester toujours en-deçà du seuil qui provoquerait une forte réaction protestataire. Chacune d'entre elles semblait relativement anodine... Ce fut l'accumulation de leurs effets qui constitua la véritable réforme. Ainsi, en l'absence de tout "grand projet" susceptible d'attirer l'attention et de coaliser les résistances, le public finit par s'habituer à l'idée qu'on continuerait à faire des réformettes, jusqu'à ce que l'effet désiré eût été obtenu. | |||
===Instituer une vraie représentation=== | |||
La seconde différence importante est que le but officiel des réformes Thatcher n'était pas du tout de limiter le pouvoir des syndicats. Au lieu d'attribuer au gouvernement de nouveaux moyens pour s'imposer à eux, la plupart ne firent que donner aux camarades syndiqués le pouvoir... de contrôler ''réellement'' leurs dirigeants. Loin de supprimer ces pouvoirs, ces réformes se contentaient de les redistribuer, de manière à rendre obligatoire la consultation des salariés. Les militants ordinaires s'étaient habitués à voir leurs meneurs passer d'abord à l'action, et ensuite demander à "la base" de les soutenir lors des assemblées générales par le moyen — passablement intimidant — du vote à main levée. Or, les nouvelles lois obligeaient à les consulter, bien en amont dans le processus, grâce au vote à bulletin secret. Elles leur donnèrent également, par le même biais, le droit effectif de choisir leurs dirigeants. En d'autres termes, des forces qui œuvraient précédemment au profit exclusif des permanents étaient désormais employées pour donner le pouvoir au militant de base. | |||
===Agir au civil et non pas au pénal=== | |||
Une autre différence essentielle est que réformes Thatcher les plus importantes étaient de droit civil et non de droit pénal. S'ils violaient les dispositions du code, les contrevenants n'étaient pas traînés en correctionnelle : on leur faisait un procès civil. Si par exemple un piquet de grève s'installait à la porte d'entreprises autres que celles impliquées dans le conflit, les entrepreneurs concernés pouvaient engager des poursuites, obtenir des astreintes, voire des dommages et intérêts. Si les grèves étaient déclenchées sans un vote à scrutin secret des travailleurs syndiqués, leurs responsables perdaient les immunités légales applicables aux ruptures du contrat de travail par fait de grève. | |||
C'étaient là trois différences essentielles : les réformes étaient progressives, elles forçaient les dirigeants à laisser le pouvoir à la base, et aucune ne donnait l'occasion aux dirigeants ni aux militants de jouer les martyrs devant un tribunal répressif. C'est ce qui explique le succès des réformes Thatcher, par opposition aux échecs des tentatives précédentes. | |||
===Ce n'est pas le chômage qui avait affaibli les syndicats=== | |||
On ne peut pas dire que ces réformes aient réussi parce que le gouvernement avait affaire à un mouvement syndical affaibli par le chômage. Personne n'a expliqué comment cette influence aurait pu s'exercer. Si une grève avait conduit à licencier les ouvriers pour les remplacer par des chômeurs, cela aurait pu être le cas ; mais qu'une entreprise ait pu s'en tirer en ayant recours à une tactique de ce genre était alors tout aussi impensable que par le passé. | |||
===Pas de quoi fouetter un chat=== | |||
Les réformes Thatcher ont réussi parce qu'elles prenaient en compte les groupes d'intérêts concernés, et se donnaient un mal de chien pour éviter le type de confrontation directe qui avait garanti l'échec des projets précédents. Les dirigeants syndicaux avaient toutes les peines du monde pour mobiliser l'opposition de la base, parce que chacune de ces mesures était relativement indolore. Chacune n'était qu'un petit pas de plus par rapport aux précédentes, pas vraiment de quoi fouetter un chat. En outre, on ne pouvait guère compter sur le militant de base pour se mobiliser contre des mesures qui allaient lui donner davantage voix au chapitre. Les dirigeants syndicaux pouvaient grimper aux rideaux à l'idée de devoir se soumettre à un vote de leurs adhérents, mais ces derniers n'étaient pas près de réagir comme eux. Le gouvernement ne les privait d'aucun de leurs droits : il les répartissait différemment entre adhérents et activistes. Enfin, il n'y avait aucune répression pénale à braver, aucune possibilité d'évoquer le fantasme du Valeureux Leader ou du Camarade-Syndiqué-Traîné-en-Prison-en-Martyr-de-la-Cause-Ouvrière. Cette nouvelle législation n'offrait aucune prise aux meneurs pour Mobiliser contre elle la Solidarité des Masses Travailleuses. | |||
===Le triomphe de la micropolitique=== | |||
Si ces réformes ont réussi, c'est parce qu'elles traduisaient un nouveau style politique, une manière nouvelle d'aborder la formulation des politiques publiques. Elles tenaient compte des forces réellement en présence dans l'arène politique, au lieu de considérer celle-ci comme une table rase attendant seulement que le Législateur y impose sa Marque Souveraine. Les tentatives précédentes commettaient toutes l'erreur fondamentale de la macropolitique : elles avaient étudié la situation existante, imaginé celle qui aurait dû régner à sa place, sans tenir le moindre compte des réalités intermédiaires. La nouvelle méthode avait soigneusement balisé le chemin à suivre pour passer de l'une à l'autre. C'est une de ses caractéristiques principales que d'agir de cette façon. | |||
===Le test décisif : la grève des mineurs=== | |||
La grève des mineurs de 1984-1985 fut une bonne occasion de mettre à l'épreuve les méthodes que l'on avait mises au point pour traiter le problème des entreprises déficitaires du secteur public ou pour faire passer la réforme dans les relations de travail. C'était d'ailleurs une grève des mineurs qui avait fait tomber le gouvernement Heath, après avoir forcé le pays à vivre dans le noir et à ne travailler que trois jours par semaine. Or, sous le gouvernement Thatcher, la même grève fut un échec. Les différences sont pleines d'enseignements. | |||
===Seuls les activistes avaient vraiment intérêt au conflit=== | |||
Alors que le président de la NUM, le Syndicat National des Mineurs, en avait pris personnellement la tête, la seconde grève ne fut jamais celle de l'ensemble du syndicat. A quelques mois près, la direction syndicale eût été contrainte d'organiser un référendum pour pouvoir déclencher la grève, et la base avait voté contre à deux reprises lors de consultations organisées dans les houillères. Comme il avait été déclenché sans vote préalable, plusieurs sections du syndicat, notamment les mineurs du Nottinghamshire, se sentirent en droit de ne pas suivre le mouvement. Le nouveau droit contre les piquets "de solidarité" empêchait en partie de faire pression sur les autres syndicats pour qu'ils soutiennent le mouvement. Les entrepreneurs pouvaient obtenir des tribunaux des astreintes contre les actions "de solidarité", et le syndicat des mineurs fut condamné pour outrage à magistrat pour avoir refusé de les payer. Ses dirigeants virent leurs comptes bloqués jusqu'à ce qu'ils eussent payé les amendes. | |||
Alors que le syndicat des mineurs passait pour l'organisation la plus forte et la plus militante, il ne cessait de se heurter à la nouvelle donne que les réformes avaient instaurée dans les relations de travail. En outre, le combat lui-même était loin d'être tranché quant à ses enjeux essentiels. Les meneurs présentaient la grève comme une lutte pour sauver les emplois en empêchant les fermetures par la direction des houillères. Or, les propositions de la direction garantissaient qu'aucun mineur ne serait ''forcé'' de quitter son travail. Tous ceux qui quittaient les puits à fermer devaient être recasés ailleurs, avec de fortes indemnités de transfert à la clé. Ceux qui choisissaient de partir en retraite se voyaient offrir les primes de départ les plus somptueuses de toute l'Histoire britannique. Comme personne n'était forcé de perdre son emploi, et comme ceux qui choisissaient de partir plutôt que d'être recasés recevaient un énorme magot, il n'était pas très facile de voir où se trouvait le motif de la querelle. Il se réduisait à demander quelle devrait être la taille à venir de l'industrie, problème certes fort intéressant pour le syndicat, mais sûrement pas un souci majeur pour les salariés. | |||
Contrairement à la précédente, cette grève fut un échec, échec qui provoqua l'éclatement du syndicat des mineurs. Un élément décisif de cette défaite avait été la nouvelle manière dont on avait traité les suppressions d'emploi et fait passer les réformes dans les relations de travail. Au lieu de jouer la confrontation directe pour aborder les deux questions comme l'avait fait le gouvernement Heath, le gouvernement au pouvoir une décennie plus tard utilisa des méthodes qui rassuraient les groupes d'intérêts et offraient des compensations en échange des privilèges mis en cause par le changement. | |||
===Les meneurs ne sont rien si la base ne suit plus=== | |||
L'expérience des syndicats sous l'administration Thatcher permet d'évoquer une conclusion très importante de la micropolitique. A savoir que ''les dirigeants des groupes d'intérêts et des minorités ne représentent pas nécessairement le point de vue de la base''. Cela peut se vérifier, même lorsqu'ils sont démocratiquement élus au cours d'élections honnêtes. Lorsque l'action politique passe par l'affrontement, avec des groupes qui se battent pour défendre leurs privilèges, l'intérêt de la base est de se choisir des dirigeants doués pour ce type d'activité. Elle aura souvent tendance à les choisir plus militants et plus agressifs qu'elle ne l'est elle-même : c'est cela qui en fait de bons dirigeants. La société sera confrontée à des cliques véhémentes, réclamant sans cesse et prêtes à employer la force au premier désaccord. Voilà quel type de chefs on choisit dans un tel climat, type dont les représentants syndicaux de l'époque constituaient un exemple véritablement achevé. | |||
Lorsque l'on gouverne en ménageant les forces politiques en présence, l'atmosphère n'est plus à la confrontation. On ne supprime pas unilatéralement les avantages ; bien au contraire, on offre des compensations. A-t-on encore tellement besoin de meneurs agressifs ? Les membres d'un groupe de pression peuvent même en arriver à percevoir un conflit direct entre leur propre intérêt et celui de leurs dirigeants. Ces derniers sont peut-être bien arrivés au sommet grâce à leur aptitude à se battre, et peuvent encore chercher à justifier leur place par ce moyen, mais leurs adhérents ont quelque chance de gagner davantage à des compromis, plutôt que de continuer sur la voie des extrêmes. | |||
Voici un scénario qu'on a vu se dérouler à maintes reprises sous le gouvernement Thatcher : la hiérarchie fait des propositions, et celles-ci sont immédiatement rejetées par la direction syndicale. Puis on organise le référendum prévu par la loi pour décider de l'action à mener... et voilà que les adhérents, désavouant leurs "représentants", votent contre la grève. L'expérience des syndicats illustre donc cette vérité plus générale sur les groupes d'intérêts, que leurs dirigeants n'en sont pas nécessairement représentatifs. La leçon à en tirer est que les politiques doivent être faites pour les membres ordinaires, et non pour les meneurs. Les permanents de la direction hurleront toujours pour en avoir plus et avoueront rarement que l'offre qu'on leur fait est bien davantage qu'un os à ronger ; c'est pour cela qu'on les paie. En revanche, la base peut trouver tout à fait à son goût les propositions en question. En pratique, cela pourra conduire à des cas où les dirigeants de groupes minoritaires lancent aux quatre vents protestations et insultes, tandis que les minorités, de leur côté, s'installent tout tranquillement dans le nouvel équilibre du marché politique. | |||
''Les événements sont plus importants que les mots qui les accompagnent.'' | |||
==La privatisation== | |||
===Une proposition de la micropolitique=== | |||
Le terme, comme l'idée de privatisation, sont venus relativement tard à l'équipe Thatcher. Le Manifeste électoral de 1979 mentionnait la vente de l'industrie aérospatiale, des chantiers navals et de la ''National Freight Corporation'', mais ne précisait pas que l'on entendait aller au-delà de la "dénationalisation", présentée depuis longtemps comme un objectif de la politique conservatrice sans jamais y parvenir. Dans ''The Right Approach'', ouvrage publié par le parti Conservateur en 1976, on lisait "dans certains cas, il peut aussi être désirable de revendre à l'entreprise privée des actifs ou des sociétés pour lesquelles on pourra trouver un repreneur". Le mot-clé est le préfixe ''re-'', qui indique une volonté de défaire ce que des années de nationalisation avaient fait, même si on n'y arrivait qu'à petite échelle. | |||
===La privatisation n'est jamais un retour en arrière=== | |||
La privatisation effectivement pratiquée n'a rien eu à voir avec le caractère symbolique de la petite brasserie et de l'agence de voyages que le gouvernement Heath était péniblement arrivé à vendre entre 1970 et 1974. Pas grand-chose non plus, en fait, avec le retour au secteur privé de certains éléments de la sidérurgie pendant la législature 1951-55. Dans les deux cas, il s'agissait de ''dé''-nationalisation, terme qui implique que l'on ''dé''-fait quelque chose qui a été fait auparavant. C'est en 1979 que l'on a commencé à employer le terme de "privatisation", lorsque tout le monde s'est aperçu qu'on avait affaire à un spécimen tout à fait inconnu. Car ''il ne s'agissait pas de revenir en arrière, mais de créer une situation radicalement nouvelle''. | |||
Jamais, après 1979, on n'a rendu les éléments du secteur étatisé à leurs anciens propriétaires. Dans chaque cas de privatisation, ils se sont retrouvés dans des mains également privées, mais à maints égards totalement différentes de celles des propriétaires précédents. La privatisation est une politique nouvelle, un pur produit de la micropolitique. | |||
===Un système intégré=== | |||
Bien que le profane n'y voie généralement rien d'autre qu'une simple vente des actifs de l'Etat, la privatisation est en réalité un système intégré de mesures pour rétablir une gestion responsable, c'est-à-dire privée, dans des activités auparavant contrôlées par le secteur public. Il n'existe pas de formule ni de recette simple pour arriver à ce résultat. Bien au contraire, une grande diversité de techniques ont été mises au point, chacune conçue pour traiter une entreprise ou un "service public" particulier. | |||
===L'essentiel du savoir-faire est tiré de la pratique=== | |||
Nous avons vu les raisons théoriques de la privatisation, aussi bien que les principes de la micropolitique qui la guident aujourd'hui ; mais prendre la mesure des rapports de force est une question empirique, et découvrir les politiques qui marchent ne peut se faire que par l'expérience. | |||
C'est pourquoi une part considérable du savoir-faire désormais acquis en matière de privatisations l'a été grâce à la pratique. Le gouvernement, au cours de son mandat, a suivi un ''processus d'apprentissage'', s'exerçant à distinguer les méthodes efficaces de celles qui ne le sont pas, et à traiter les divers groupes d'intérêts concernés pour s'assurer l'appui, ou du moins l'assentiment de puissantes factions qui auraient pu s'opposer à ses tentatives. | |||
===Quand on ne sait pas faire... et quand on a appris=== | |||
On mesurera l'importance de ce processus en comparant l'échec de la dénationalisation des boutiques du Gaz en 1981-82 avec l'énorme succès rencontré par la privatisation de ''British Gas'' en 1986. La différence entre les approches suivies est une bonne illustration des progrès accomplis dans l'approche analytique. | |||
Dans le premier cas, on avait voulu vendre le réseau de distributeurs en le détachant du reste de l'entreprise, parce qu'il était le seul à rapporter de l'argent. A première vue, cela semblait raisonnable, puisque les magasins en question n'avaient aucun lien organique avec la production ni la distribution du gaz lui-même : ce n'étaient que des boutiques, et si l'on y vendait ou réparait quelque chose, ce n'étaient jamais que des appareils ménagers. | |||
Or, ce modeste projet s'attira immédiatement les foudres de la direction de l'entreprise. Son président, Sir Dennis Rookes, se lança à la tête d'un groupe d'action pour s'opposer au "démantèlement" de son empire, avec le soutien unanime de l'équipe de direction. Le personnel menaça de faire grève si on "lui" retirait "ses" points de vente pour les brader aux capitalistes. On fit circuler des histoires d'horreur sur les "cow-boys" qui allaient débouler sur le marché, ne songeant qu'à faire un profit facile au mépris de la sécurité. Les usagers se mirent à exprimer leurs craintes à voix haute : est-ce qu'on n'allait pas leur couper le gaz, ou leur installer des appareils dangereux ? Les parlementaires sentaient croître la pression des opposants, et le gouvernement se rendit compte qu'en face d'une telle campagne, le soutien du député de base se faisait de plus en plus rare. Le projet fut retiré, ayant trouvé le moyen de s'aliéner l'Administration, la direction de l'entreprise, son personnel, ses usagers, et les parlementaires eux-mêmes. | |||
Le contraste entre cette débâcle et la mise en vente publique de British Gas de 1986 n'aurait pu être plus marqué. La privatisation de 1986 obtint l'adhésion de l'ensemble des principaux groupes impliqués, et fut un immense succès pour le gouvernement. La différence, bien entendu, c'est dans la politique proposée qu'on pouvait la trouver. On en avait beaucoup appris en cinq ans... | |||
===S'assurer le soutien des dirigeants=== | |||
Les dirigeants s'étaient opposés de toutes leurs forces au "démantèlement" qu'impliquait la première proposition. La seconde version conserva l'entreprise en un seul morceau, et obtint le soutien de sa direction. L'austère Sir Dennis lui-même se mit en quatre pour promouvoir la privatisation (même si on ne l'a tout de même pas vu sourire à cette occasion). Le soutien de la hiérarchie d'entreprise semble bien être une condition nécessaire pour qu'une privatisation réussisse. En effet, celle-ci a le pouvoir de faire énormément de dégâts, réduisant les résultats anticipés et, partant, le prix que l'on pourra tirer de la vente. Elle dispose également d'un pouvoir de pression efficace dans le débat public, surtout vis-à-vis des adversaires du secteur privé. La première tentative, avec démantèlement, et vente des magasins d'appareils à gaz, avait donné l'occasion à un lobby rusé et entreprenant de faire triompher ses intrigues au Parlement même. A la deuxième tentative, en gardant l'entreprise intacte, on avait créé la possibilité d'un échange : les dirigeants avaient pris goût au pouvoir et à l'autorité en dirigeant une grande entreprise publique, mais ils allaient encore mieux aimer se trouver à la tête d'une grande entreprise privée, puissante... et rentable. | |||
===Privilégier les salariés en place=== | |||
Les salariés, qui avaient menacé de se mettre en grève et même organisé un arrêt de travail symbolique contre la première tentative, appuyèrent la seconde. Parmi les actions émises, une bonne partie était d'ailleurs réservée aux employés du gaz. Chacun reçut son petit lot gratuit, avec le privilège de pouvoir en réserver un grand nombre sans devoir participer au tirage au sort. Comme l'optimisme était très grand sur les perspectives de la vente et la valeur future de l'entreprise, plus de 90 % des salariés se portèrent acquéreurs. Ainsi, ils réalisèrent deux objectifs importants à leurs yeux : ils devinrent co-propriétaires de leur entreprise, avec un intérêt personnel dans ses résultats à venir, et firent par-dessus le marché un gain en capital substantiel, de plusieurs milliers de livres dans certains cas. En outre, les acheteurs potentiels aiment bien les entreprises dont les salariés sont devenus actionnaires ; cela veut dire qu'ils travailleront vraiment pour elle, au lieu de la traiter comme une puissance étrangère. | |||
===Rassurer les groupes d'usagers=== | |||
Les utilisateurs du gaz, auquel l'idée d'un personnel non qualifié voire prêt à rogner sur la qualité avaient fait craindre toute privatisation la première fois, ne furent pas les derniers à participer au rachat de British Gas. Ils avaient droit à l'attribution d'actions privilégiées s'ils en faisaient la demande, obtenant un traitement favorable dans tout tirage au sort d'actions en cas de souscription excédentaire. On leur offrit en outre, s'ils conservaient leurs actions, le choix entre des bons de réduction sur leurs factures de gaz et l'attribution d'actions gratuites. | |||
===Enrôler le grand public=== | |||
Pour encourager une participation maximum du grand public, les actions furent mises en vente avec des facilités de paiement, la mise de fonds initiale ne dépassant pas cinq francs et le solde étant réglable par la suite. Enfin, l'émission fit l'objet d'un matraquage publicitaire complet, avec un budget de communication dans les centaines de millions de livres. Le succès se mesura au très fort afflux de premiers actionnaires, dont la plupart choisirent de conserver leurs actions malgré une plus-value initiale de plus de 30 %. | |||
===Un succès politique considérable=== | |||
Le gouvernement et ses partisans l'avaient emporté parce qu'ils avaient su faire gagner aussi les autres groupes. Le succès de l'aventure profita à tous. Plus précisément, le gouvernement pouvait à présent compter un nombre record d'actionnaires-capitalistes, plus de cinq millions de propriétaires de British Gas qui s'opposeraient à toute renationalisation par un gouvernement mal intentionné. Il récoltait aussi les fruits d'une campagne de publicité qui vantait les mérites de la privatisation et du capitalisme tout en faisant l'article pour les actions vendues. Certains observateurs l'avaient bien noté, c'était "la campagne politique la plus chère de l'histoire". | |||
===Privatiser, c'est le rêve fou du politicien : pouvoir distribuer de l'argent sans devoir le voler à qui que ce soit | |||
Encore un autre avantage pour le gouvernement : les cinq milliards de livres que la vente avait rapportées. Il put les reverser dans son budget courant pour réduire les impôts ou satisfaire les revendications de dépenses. Bien que cette pratique ait fait et fasse encore l'objet de critiques, elle est parfaitement licite. Dans le budget britannique, il n'existe pas de compte pour le capital, qui n'y est pas non plus correctement amorti. L'argent dont on s'était servi pour acheter les entreprises au secteur privé avaient dû être prélevé sur les dépenses courantes ; rien ne s'opposait donc à ce que les sommes tirées d'une vente y soit reversées. Par ailleurs, présenter la privatisation comme un "gaspillage de la richesse nationale" est foncièrement inexact. La richesse ne cesse pas d'être "nationale" quand elle passe dans des mains privées, et en fait, la privatisation lui donne même bien meilleure allure. | |||
===Si l'on échoue, ce n'est jamais que parce qu'on s'y est mal pris | |||
Les leçons à tirer de ces deux tentatives ? Naturellement, qu'il vaut mieux ménager les groupes d'intérêts, et réussir, que se les aliéner pour aller à l'échec : en l'occurrence, satisfaire les divers groupes impliqués dans les entreprises publiques, leur offrir des compensations acceptables pour leurs avantages acquis. Cela, les hommes politiques pragmatiques s'en laisseront volontiers persuader. Ce qu'ils risquent de méconnaître en revanche, c'est cette leçon très importante : que l'échec d'une politique de libéralisation ne signifie jamais que le projet soit mal inspiré ; mis en œuvre, il ne saurait qu'améliorer les choses. Il signifie seulement qu' ''on s'y est mal pris''. Rien n'empêche de réussir. Ce qu'il faut, c'est être intellectuellement armé aussi bien pour conserver le cap que pour tirer profit de l'expérience acquise. | |||
===Un transfert d'expérience=== | |||
Car le procédé employé pour la vente de British Gas était un pur produit de cette expérience même : il avait été testé lors de la vente deux ans plus tôt, en 1984, de British Telecom, l'ancien "service public" du téléphone et des télécommunications. Ce n'était en aucun cas une ''dé-nationalisation'', puisque cette industrie appartenait au secteur public depuis sa création, ayant toujours fait partie de l'administration des Postes. British Telecom fut le premier grand "service public", par opposition à une entreprise nationalisée, à être privatisé. C'était donc une première. | |||
Lors de sa privatisation, British Telecom était la plus grande entreprise à jamais faire l'objet d'une introduction en bourse, tout comme British Gas devait l'être deux ans plus tard. Avec une valeur de plus de trois milliards, elle doublait la vitesse à laquelle on pouvait estimer la vente des entreprises d'Etat au secteur privé. Dans le cas de British Telecom, la pratique des contreparties offertes aux groupes d'intérêts en cause, connue de tous après la vente de British Gas, fut justement mise en œuvre avec une précision implacable. | |||
===Privatiser d'abord=== | |||
Pour commencer, la direction fut autorisée à vendre l'entreprise en un bloc au privé. Les puristes de la concurrence menèrent un combat d'arrière-garde pour que British Telecom soit divisée en plusieurs entreprises rivales, ou du moins en sociétés régionales dont les performances auraient alors pu être comparées. Il ne semblait pas leur être venu à l'esprit que, si cela pouvait être la solution ''idéale'', ce n'était pas celle qui était ''possible''. Insister pour que British Telecom soit privatisée par morceaux revenait à opter pour une politique qui ne "passerait" jamais. La direction de British Telecom soutenait certes la privatisation de l'entreprise, mais seulement dans les termes où elle avait été proposée. | |||
===Les syndicalistes neutralisés=== | |||
Les dirigeants syndicaux donnèrent l'ordre aux salariés de s'opposer à la manœuvre, et une campagne fut mise sur pied. Elle avait fait faire un logo représentant un fil téléphonique coupé par des cisailles, qui était censé symboliser le destin qui attendait le "service public" après son passage au capitalisme. C'est pourquoi la direction avait réservé pour les employés de British Telecom un bon paquet d'actions mises de côté pour la circonstance ; cela en faisait des co-propriétaires de l'entreprise et leur donnait la possibilité de réaliser des plus-values si la valeur en Bourse augmentait. En l'occurrence, 96 % des salariés se portèrent acquéreurs. C'est ainsi que le personnel, qui aurait pu s'opposer à la vente, fit aussi partie de l'équipe. | |||
===Le public séduit=== | |||
Le grand public fut autorisé à acheter les actions à tempérament, n'ayant à verser comptant que cinq francs par action. On offrit aux nouveaux actionnaires le choix entre une émission d'actions gratuites et des réductions sur leur facture de téléphone. A la fin de l'introduction en Bourse, quelque deux millions de personnes possédaient ces actions, la demande ayant largement dépassé l'offre, et deux tiers des acheteurs choisirent de les conserver, alors même que leur cours avait immédiatement monté de près de 100 %. C'est à l'occasion de la vente de British Telecom que fut organisée la première grande campagne de publicité, laquelle obtint du public la réaction voulue. | |||
===Traiter systématiquement les oppositions possibles=== | |||
British Telecom servit ainsi de banc d'essai pour les techniques de privatisation d'un grand "service public". La moindre objection éventuelle de tous les groupes concernés avait été prévue, et traitée, chaque fois que c'était possible. Comme on avait évoqué la crainte que ce "service public stratégique" ne passe aux mains de l'Etranger, on intégra dans la vente une action spécifique (une "golden share") pour le gouvernement britannique, qui lui conférait un droit de blocage dans le cas d'une tentative de rachat étranger. Comme on avait aussi raconté qu'un British Telecom privé ne trouverait pas rentable d'exploiter et d'entretenir les cabines téléphoniques rurales, il fut précisé que l'entreprise serait tenue de conserver un nombre donné de cabines. Cette obligation, malgré son faible impact, était largement connue des acheteurs potentiels. | |||
===Et la concurrence ?=== | |||
On avait beaucoup mis en cause le "monopole de fait" dont British Telecom allait jouir dans le secteur privé, exprimant la crainte qu'il n'"abuse de sa position dominante". Naturellement, jamais on ne mettait ce "monopole" et ces "abus" en parallèle avec ceux qui découlent nécessairement du statut de "service public". Pour traiter ce problème, outre les obligations intégrées dans le projet de loi, on fit appel à deux méthodes. L'une consistait à susciter une "concurrence à la marge" dans laquelle British Telecom, sans avoir en face de soi un concurrent de sa taille et de sa puissance, serait confronté à des concurrents plus petits sur chacun de ses marchés. Il fut ainsi confronté à ''Mercury'' pour les télécommunications d'affaires, à ''Racal/Vodafone'' pour le radiotéléphone cellulaire, à d'autres concurrents pour la fourniture d'équipements, la transmission de données informatiques et pour la plupart de ses autres activités. Aucun de ces concurrents n'était bien gros, mais pris ensemble, ils faisaient ressentir à British Telecom le risque de perdre ses clients sur bon nombre de ses marchés. | |||
On créa aussi un organisme chargé de surveiller l'industrie et de promouvoir la concurrence. Plutôt que de suivre l'exemple des Etats-Unis, où les organismes réglementaires font obstacle à l'entrée des nouveaux venus sur le marché1, l'OFTEL fut expressément chargé de la promouvoir. Lorsque Mercury demanda l'autorisation d'étendre ses services à la clientèle des particuliers, l'OFTEL la lui accorda, puisqu'il était là pour ça. | |||
La combinaison utilisée pour contenir les "abus du monopole" associe donc des contraintes légales, la concurrence à la marge et un organisme de promotion de la concurrence. Elle a été faite sur mesures pour British Telecom, et ne serait pas nécessairement instituée sous la même forme pour d'autres entreprises. Elle contient une bonne dose d'empirisme, et le souci d'accumuler de l'expérience pour les projets à venir. | |||
Encore heureux que le Parlement puisse toujours revenir à la charge, si le premier essai n'était pas concluant. En 1987, la qualité du service offert par British Telecom après sa privatisation avait provoqué un mécontentement certain, et ceci amena l'OFTEL à faire des propositions de réforme. Critiqué aussi bien par ses actionnaires que par ses clients, le président démissionna en septembre 1987, et l'on parla d'imposer de nouveaux contrôles si British Telecom ne s'en tirait pas mieux que cela. Voilà une autre leçon très importante à tirer de ces événements : s'il ne parvient pas à obtenir un résultat satisfaisant du premier coup, le Parlement peut toujours remettre son ouvrage sur le métier. Si la vente de British Telecom avait dû attendre que l'on trouve un système parfait, elle attendrait encore. | |||
==="Brader le patrimoine national" ?=== | |||
On a reproché au gouvernement d'avoir "bradé" British Telecom. Après tout, une plus-value de 100 % laissait penser que la vente aurait pu obtenir le double. Or, cette interprétation est presque certainement fausse. Il était important, pour que la première vente d'un "service public" réussisse, que l'émission d'actions soit entièrement souscrite. Il était également important d'impliquer les usagers, et de donner envie au plus grand nombre possible de devenir actionnaires. Il s'agissait de multiplier le nombre des détenteurs d'actions, afin de rendre plus difficile toute nationalisation éventuelle par un gouvernement ultérieur. Tout cela veut dire qu'il était vraiment nécessaire qu'il y eût une plus-value sur le prix de vente. Le prix d'émission était difficile à fixer, parce que personne ne savait ce que l'entreprise pourrait valoir. Nombre d'entreprises nationalisées, British Telecom inclus, avaient pendant des années connu des pratiques comptables qui auraient suscité l'hilarité, voire des poursuites pénales si elles avaient sévi dans le secteur privé. | |||
Il faut souligner que le gouvernement n'avait pas cherché à établir lui-même le prix de vente. Il fit appel à des experts financiers de la City pour ce faire, de sorte que, s'ils se trompaient, la responsabilité fût partagée. De toute façon, une erreur dans la fixation du prix n'était pas dramatique. En effet, en ne vendant qu'un peu plus de 50 % de l'entreprise, le gouvernement conservait l'option de se débarrasser du reliquat à un prix bien plus élevé par la suite. Comme les entreprises deviennent généralement plus rentables et plus efficaces dans le secteur privé, la tactique consistant à ne mettre qu'un peu plus de 50 % des actions en vente au départ et à se défaire ensuite du reste par tranches permet au gouvernement d'obtenir davantage lors des ventes ultérieures. Ce fut le cas, entre autres, de British Telecom. | |||
===Privatiser... la privatisation=== | |||
Une caractéristique de la vente de British Telecom était donc la forte participation des experts privés. Au cours du programme de privatisation, on s'était vite rendu compte qu'il n'y avait aucune bonne raison pour ne pas privatiser le processus lui-même. On fit donc de plus en plus appel à des entreprises de la City. Elles ont fourni des analystes, des banquiers d'affaires, ainsi que la compétence nécessaire en relations publiques. Le gouvernement ne s'est pas embarrassé d'apprendre comment on fait pour vendre des entreprises ; il a acheté les services de ceux qui le savaient déjà. Ces cabinets sont eux-mêmes devenus un groupe d'intérêt qui tire profit des privatisations, et ont eux-mêmes été à l'origine de nouvelles propositions dans ce sens, tant en Grande-Bretagne qu'à l'étranger. | |||
Faire appel à des experts privés pour mener la privatisation à son terme présente un avantage, petit quoique important : le gouvernement et le Parlement peuvent ainsi se tenir à quelque distance du processus. Une fois entre les mains des spécialistes, il devient leur responsabilité. Ce n'est pas seulement un prétexte pour accuser les autres si les choses tournent mal. Le gouvernement assume de toutes façons la responsabilité de l'ensemble quand il engage les entreprises concernées. Ce que permet le recours à l'expertise privée, c'est de tenir les élus à l'écart du détail. Il ne serait pas souhaitable que ce soit le Parlement qui fixe la date de lancement de l'émission, le prix d'émission ni le nombre d'actions. Rien ne serait facilité non plus, si les parlementaires se sentaient pressés par leurs électeurs de rechercher quelque privilège à leur accorder au moment de fixer de telles modalités. | |||
===Fixer le prix de vente est des plus difficile=== | |||
Un coup d'œil aux différents prix pratiqués lors de la vente des entreprises d'Etat montre à quel point ce terrain est semé d'embûches. Dans le cas d'Amersham International, petite entreprise de radio-sources qui fut l'une des premières ventes au public, il y eut une grosse plus-value sur le prix d'émission. Les adversaires de la privatisation accusèrent le gouvernement d'avoir vendu un "bien national" à un tarif de faveur, au bénéfice de ses "amis argentés" de la City. On entend ce genre d'accusation chaque fois qu'il y a eu un gain en capital. | |||
La tactique qui consiste à garantir une vaste participation du grand public à la vente émousse l'accusation, mais ne l'élimine pas. Etre accusé de brader des richesses "nationales", au profit de "pékins" ordinaires est plus facile à assumer qu'un même reproche impliquant "les copains de la haute finance", mais cela veut tout de même bien dire qu'une faute a été commise. Lorsque le cours de l'action est fixé trop haut et qu'il n'y a pas suffisamment de souscripteurs, les actions perdent de la valeur dès qu'on les met sur le marché. Les opposants parlent alors d'échec. La demande est trop élevée ? C'est un échec. Trop faible, c'est toujours un échec. Apparemment, seule une faible marge d'écart pourrait passer pour un succès. | |||
Soulignons tout de même que, lorsque la demande est faible et que les actions démarrent à perte, le gouvernement, et les contribuables, touchent tout de même leur argent. La pratique de la garantie d'émission auprès des banques d'affaires et des institutions financières a pour conséquence que la vente des actions sera de toutes façons assurée. La vente n'est interprétée comme un "échec", que dans la mesure où elle n'a pas réussi à attirer un nombre suffisant de souscripteurs au sein du public. | |||
Même la vente des actions BP encore dans les mains de l'Etat, qui fut interrompue par la chute brutale des valeurs boursières du 19 octobre 1987, a rapporté la somme escomptée. Les banques qui garantissaient l'émission, et que l'on accusait depuis des années de "se sucrer à bon compte", se retrouvèrent dans l'obligation de reprendre à 120 pence des actions invendues, alors qu'elles étaient descendues à 70-80 pence. Elles payèrent. Le vent de panique se calma lorsque le Ministre des Finances Lawson garantit un prix de rachat de base de 70 p par action, mais en l'occurrence il n'y eut que 2 % des actionnaires à se défaire des leurs. Le gouvernement fit valoir, à juste titre, que c'était pour subir ce genre de risques que ceux qui garantissent les émissions étaient payés. Il doit bien arriver un jour que le risque se réalise. | |||
En fait, on ne s'est pas trop mal tiré de ces évaluations, surtout si l'on tient compte de la nouveauté du procédé. L'absence d'une comptabilité décente et l'inexpérience en fait de vente des actifs de l'Etat ne facilitaient pas le choix d'un prix. Et pourtant, il y a eu peu de véritables erreurs. Le principe était que les actions devaient rapporter une plus-value, afin d'encourager les investissements futurs et d'obtenir l'appui politique des bénéficiaires. De toutes les privatisations par émission publique d'actions, seules celles liées au pétrole démarrèrent à perte. Etant donné l'inquiétude internationale quant à l'avenir de l'industrie, sa vulnérabilité aux événements à l'extérieur et les fortes fluctuations du prix du brut, c'était compréhensible. | |||
===Il importe que le nouvel actionnaire fasse une bonne affaire | |||
Dans d'autres cas, non seulement il y a eu plus-value le jour de la mise en vente, mais la valeur en Bourse des entreprises privatisées a ensuite dépassé régulièrement la moyenne du marché boursier. Ces deux effets doivent être délibérément recherchés au début du processus de privatisation. Ils apportent maintes satisfactions à bon nombre de groupes d'intérêt impliqués, notamment ceux qui viennent de se constituer. Tout le monde peut voir que la direction et les salariés y gagnent, par l'augmentation de la valeur des actions qu'ils détiennent et de la rentabilité de leur entreprise. Il est essentiel qu'ils tirent du nouvel état de choses plus d'avantages que de l'ancien. Cela encouragera les employés d'autres entreprises d'Etat à prendre fait et cause pour la privatisation lorsqu'elle leur sera proposée. | |||
La nouvelle classe d'actionnaires, dont beaucoup achètent des actions pour la première fois ou sont de petits porteurs, doit pouvoir toucher du doigt ses gains en capital. En devenant propriétaire d'une partie du capital de la nation, elle devient intéressée à ce que le climat politique soit favorable aux entreprises productives. Si elle pense tirer des avantages personnels de politiques favorables à la libre entreprise, elle sera d'autant plus disposée à les soutenir. En outre, plus elle possède de richesse sous la forme d'actions des anciennes entreprises d'Etat, plus il sera difficile à un gouvernement futur de comploter pour les lui confisquer. Déjà, les adversaires de la privatisation qui souhaitent un retour en arrière ne parlent plus de reprendre leurs actions aux petits porteurs. Ils parlent maintenant de "ramener l'entreprise dans le secteur public", mais tout en laissant les actions à des particuliers. Il reste à voir si les entreprises obtiendraient d'aussi bons résultats sous le contrôle des hommes de l'Etat qu'elles en ont avec des dirigeants privés et surtout, comment les électeurs-actionnaires vont estimer cette perspective au moment de voter. En tous cas, lorsqu'on leur en a donné le choix en 1987, c'est une option qu'ils ont rejetée2. | |||
===Privatiser ne supprime pas toute l'irresponsabilité institutionnelle ; mais le progrès à en attendre vaut bien qu'on s'en donne les moyens | |||
Face à la privatisation, il existe une grande différence d'attitudes entre ceux qui prônent des solutions de pur laissez-faire et ceux qui, partant de l'analyse des choix publics, envisagent les politiques en tenant compte des marchés politiques existants. Le premier groupe reproche constamment au gouvernement d'être incapable d'instituer la pure liberté des contrats, et considèrent les échanges de privilèges avec les groupes de pression comme une marque de faiblesse et un manque de résolution. Ils n'ont pas l'air de saisir que ce sont justement ces compromis qui permettent l'opération. Ils ne comprennent pas non plus qu'en l'absence de telles mesures, la réforme ne survivrait pas à son passage dans les remous de la politique. | |||
Certains partisans de l'économie de marché ont l'air de supposer que l'objectif unique de la privatisation doit être d'exposer les entreprises d'Etat à tous les vents de la concurrence. A moins que la privatisation n'aboutisse à une situation de concurrence pure, ils la considèrent comme un échec. C'est une erreur de conception : l'objectif premier de la ''privatisation'' n'est pas de développer la rivalité au sein du secteur d'Etat, mais d'abord de le ''privatiser''. La concurrence est indiscutablement souhaitable et doit être recherchée chaque fois que cela est possible, mais la privatisation présente encore des avantages, même lorsque le degré de concurrence atteint est loin d'être parfait. | |||
===Une entreprise "publique" est une entreprise politisée=== | |||
L'analyse des choix publics est parvenue à la conclusion — peu surprenante — que les activités du secteur d'Etat appartiennent au domaine ''politique''. Elles ne sont pas confrontées à des disciplines marchandes et concurrentielles, mais soumises aux pressions de la politique. Se trouvant directement sous la coupe du "législateur", elles sont asservies aux contraintes qui déterminent les choix de ce "législateur". Les choix faits dans le secteur public relèvent donc d'un marché politique, et non pas économique. | |||
Quelques exemples tirés de la vie de tous les jours : si les entreprises d'Etat ont besoin d'argent pour s'agrandir ou faire des investissements, cela peut être enregistré comme un emprunt "public". De telles décisions se retrouvent alors soumises aux contraintes imposées au Besoin en Financement du Secteur Public3, et cette demande se retrouve alors en concurrence avec d'autres priorités du gouvernement. Si ce dernier a décidé de réduire l'endettement total, on n'aura pas l'argent, aussi justifié que soit son emploi. A l'inverse, dans le secteur privé, une entreprise attire toujours les financements si elle prouve qu'elle est capable d'en faire bon usage et de les rentabiliser. Il n'est pas possible de concevoir un financement public sur une base commerciale. | |||
Les décisions prises dans les entreprises du secteur public sont soumises à l'influence politique jusque dans leurs moindres détails. La décision de construire une nouvelle usine dans le secteur privé est prise en fonction de critères commerciaux, d'après des facteurs tels que les prix de revient, ou la proximité des marchés. Dans des circonstances analogues, l'entreprise du secteur public est confrontée à des données politiques, avec des élus qui font pression pour faire venir l'usine dans leur circonscription. On a déjà vu à quelles extrémités on est conduit pour fermer une installation dans le secteur public. Le fait est qu'une entreprise d'Etat est comme un ballon de football, ballotté entre les groupe de pression et les politiciens qui les représentent. Elle ne prend pas plus ses décisions sur des critères commerciaux qu'elle ne collecte ses fonds à des conditions de marché. | |||
A ces facteurs, il faut ajouter le fait que la gestion publique se caractérise souvent par le monopole d'Etat, avec tout ce que cela implique de capture par les producteurs, de sureffectifs et de mépris du consommateur. Si la privatisation peut remettre tous ces compteurs à zéro pour un nouveau départ dans le secteur privé, c'est indiscutablement un bon point pour elle. Si on ne peut effacer qu'une partie de l'ardoise, eh bien le jeu en vaut encore la chandelle ; et si, en nettoyant cette partie, on expose une entreprise à des conditions qui permettront finalement d'effacer le reste, il en vaut d'autant plus la peine. | |||
===De tous les désordres causés par l'intervention étatique, la politisation est bien pire que le monopole=== | |||
Certains observateurs considèrent que si le monopole public est mauvais, c'est parce qu'il est un monopole. Or, le fait est qu'un monopole public combine deux inconvénients : le fait qu'il soit public, et le fait qu'il s'agisse d'un monopole. De ces deux maux, le plus grand est qu'il soit public. C'est une bien plus grande source de désordres et de gaspillages. Dans le cas où un monopole est privatisé en tant que monopole, on peut dire au moins qu'un monopole privé est préférable à un monopole public. Un monopole privé est plus vulnérable à l'innovation de ses concurrents. Il dépend moins de la politique que les monopoles d'Etat, et il n'a pas leur puissance politique. Alors que les monopoles privés finissent par disparaître avec le temps, les monopoles publics sont entretenus en permanence par de nouvelles lois, qui sont votées pour les protéger contre les nouvelles menaces de la concurrence. | |||
Il n'était pas possible de donner à ''British Telecom'' un caractère suffisamment concurrentiel lors de son transfert au secteur privé. L'analyse micropolitique suggère que, si on avait essayé de le faire à ce moment, la privatisation elle-même n'aurait pu aller à son terme. Toutefois, ''British Telecom'' est exposée à bien plus de disciplines marchandes qu'auparavant, et se trouve confrontée à une plus grande concurrence. Ce sont deux avantages importants d'une solution réalisable, qu'il ne faut pas écarter au profit de solutions plus parfaitement concurrentielles, et qui ne marcheraient pas. | |||
===Privatisée, l'entreprise a moins d'influence politique=== | |||
L'élément temps joue un rôle important. Avec le développement de nouvelles techniques, ''British Telecom'' n'aura plus le pouvoir de les faire interdire, ni de se les accaparer par la loi comme elle le faisait auparavant. On peut aussi envisager une action législative ultérieure pour augmenter la concurrence à laquelle il sera exposé. Dans ce cas, les entreprises, une fois privatisées, découvriront qu'elles ne bénéficient plus des appuis en haut lieu que leur apportait leur statut public. En tant qu'entreprises privées, on leur demandera de se passer de l'appui des gendarmes pour faire face aux pressions de la concurrence. | |||
===La privatisation institue immédiatement des disciplines permanentes=== | |||
Au minimum, la privatisation soumet des entreprises d'Etat aux disciplines de la gestion commerciale. Au mieux, elle les transforme en organisations viables et compétitives, capables de réussir et de tenir leur rôle sur un marché ouvert. De nombreux cas de privatisation se situent entre ces deux cas de figure. L'important est que l'on mette en place les éléments qui conduiront progressivement au second scénario. Si on ne peut créer un cadre complètement concurrentiel dès le départ, on doit s'arranger pour qu'il le devienne davantage à l'avenir, et ne pas lui permettre de glisser en arrière. | |||
Dans plusieurs entreprises, on a pu constater que les préparatifs de la privatisation induisaient d'importantes réformes, avant même le passage à l'acte. Savoir qu'une entreprise d'Etat va être vendue, comme de savoir qu'on sera pendu dans quinze jours, donne une merveilleuse puissance de concentration. L'efficacité s'améliore, on fait des économies. Quand arrive la date fixée, l'entreprise est devenue bien plus vendable qu'avant le déclenchement du processus. Avec cette politique de préparation, on a vu que des entreprises, au départ pléthoriques en effectifs et asservies aux producteurs pour cause d'appartenance au secteur public, étaient devenues efficaces et rentables au moment de leur arrivée sur le marché. | |||
===Comment une entreprise publique déficitaire devient privée et rentable=== | |||
''British Airways'' en est un exemple classique. Lorsque la décision de la privatiser fut prise en 1983, elle faisait d'énormes pertes, qui étaient prises en charge par les subventions de l'Etat. Elle avait trop de personnel, avec un relâchement certain dans tous les aspects de sa gestion. Au moment de sa vente en février 1987, elle était redevenue populaire, et bénéficiaire. Le nombre de ses salariés était passé de 59 000 à 39 000. Elle se souciait visiblement de ses clients, prenant soin de connaître et de prévenir leurs besoins. De nombreuses catégories de passagers la désignaient régulièrement comme la meilleure compagnie aérienne internationale. L'obèse paresseux et égrotant s'était transformé en une société commerciale, saine et très compétitive. Au moment de sa vente au public, ''British Airways'' était un bon placement financier. Et ce n'est pas pour avoir vécu dans le secteur privé qu'elle avait opéré cette transformation. C'est parce qu'elle avait dû se ''préparer'' à y vivre. | |||
Comment avait-on pu le faire, alors que l'entreprise était encore dans le secteur d'Etat, soumise à toutes les pressions qui y règnent ? Ce qui avait rendu cela possible était l'ensemble des techniques employées, avec la carotte qui attendait tout le monde à la sortie. Personne n'a été mis à la porte ; on avait offert des conditions avantageuses pour partir volontairement à la retraite. Quant aux pensions de retraite indexées, on ne les avait pas supprimées, mais rachetées cash. Il a fallu beaucoup investir pour transformer ''British Airways'', mais cet investissement a été plus que compensé par la nouvelle rentabilité de l'entreprise et la valeur que l'on a pu tirer de sa vente. La Compagnie avait tellement le moral que, comme des procès successifs retardaient la date de la mise sur le marché, les employés menacèrent de faire grève si l'on n'accélérait pas le processus. | |||
Comme on l'avait fait si souvent dans d'autres entreprises, les salariés avaient choisi d'être partie prenante dans le rachat. On peut pour le moins douter que ces changements eussent pu avoir lieu dans une entreprise publique sans la perspective de sa privatisation. Sans la nécessité d'être compétitif et rentable dans le secteur privé, les intérêts des groupes impliqués auraient été autres, et la direction n'aurait pas réussi à améliorer la productivité. | |||
La leçon tirée de l'expérience de British Airways est qu'une entreprise qui fonctionne à perte peut toujours être vendue. On vend tous les jours en Bourse des entreprises déficitaires. L'expérience de British Airways a démontré qu'on pouvait redresser une organisation qui est dans le rouge, et en faire une entreprise viable. Par ailleurs, les préparatifs de la privatisation peuvent en eux-mêmes constituer un système d'incitations suffisant pour la transformer dans ce sens. | |||
===Des résultats spectaculaires=== | |||
Sur les marchés, on dit qu'une réputation est très difficile à récupérer une fois perdue. Facile ou non, ''British Airways'' a bel et bien récupéré en un temps record sa réputation de premier plan. En quelques années, elle est passée d'un rang très médiocre à une position lui permettant de disputer la première place. Et ce n'est pas un cas isolé. Les voitures Jaguar avaient perdu leur ancienne image de qualité après leur passage dans le secteur public. Elles avaient perdu du terrain en Amérique parce qu'à juste titre, on les tenait pour peu fiables. Le contrôle de la qualité avait cédé la place à des pratiques de "service public", où les considérations politiques prenaient le pas sur le souci du client. Après la privatisation, Jaguar retrouva son ancienne tradition d'excellence et de fiabilité à une vitesse incroyable. De ce fait, les actions achetées par les salariés à l'époque augmentèrent de 2 000%, ce qui n'est pas le moins important de l'affaire. | |||
==Et les travailleurs ?== | |||
===Quel avantage le salarié trouvera-t-il à la privatisation ?=== | |||
Un élément qui a beaucoup compté dans la réussite des privatisations était le soutien du personnel. Quand on privatise, il faut faire au salarié une offre qu'il perçoive comme au moins équivalente aux avantages dont il bénéficiait déjà. Il se peut, évidemment, que la valeur actuelle de ces avantages acquis implique une décote. Si, dans le secteur public, l'avenir de l'entreprise est compromis, le personnel peut donner moins de valeur à la garantie normalement associée à un emploi dans ce secteur. Il peut alors accepter la privatisation, même au prix d'une réduction sensible de ses avantages. Un emploi certain dans le secteur privé a beaucoup plus d'intérêt que la simple éventualité du maintien de l'emploi "garanti" dans le secteur d'Etat. | |||
Dans ces cas-là, on a vu le personnel accepter la vente d'une entreprise d'Etat, même avec réduction d'effectifs, ayant compris que la seule autre solution était de cesser complètement l'activité. Le traitement réservé aux employés reclassés a été un facteur majeur du succès de ces tentatives. En effet, quand il n'est pas question de licenciements forcés, alors le nombre des gens réellement forcés de changer d'emploi tombe ''ipso facto'' à zéro. Dans les faits, cela réduit l'opposition aux seuls militants syndicaux, car ils sont les seuls à se soucier des effectifs en tant que tels. | |||
L'offre faite aux mineurs dont les puits étaient condamnés à fermer montre bien comment on fait pour négocier les avantages acquis. On leur avait tout offert : un reclassement dans d'autres puits, une prime de déménagement ainsi que des cours de recyclage. Le montant des indemnités de préretraite, on l'a vu, était absolument sans précédent. Si le projet de fermeture était confirmé, un mineur risquait de perdre un emploi chez lui ; mais la certitude de pouvoir être embauché sur un autre site, associée à l'indemnité de déménagement, lui semblait être un substitut raisonnable, ayant bien compris qu'il n'était plus possible de maintenir tous les puits en activité. | |||
===Distribuer la propriété de l'entreprise=== | |||
Le moyen habituel pour s'assurer le soutien du personnel en cas de transfert au secteur privé reste la distribution d'actions. Un bloc de titres est mis en réserve pour les salariés de l'entreprise, et ils peuvent en prendre s'ils le désirent1. Parfois, comme dans le cas de British Gas, un certain nombre d'actions sont offertes gratuitement. Il arrive même que les employés s'en voient offrir davantage qu'il n'en est mis à la disposition du grand public. Ce fut le cas aussi bien pour British Gas que pour British Telecom. On peut aussi autoriser le personnel à financer l'achat des actions sur son salaire en bénéficiant d'un prêt à long terme, généralement sans intérêt. C'est ce qui a été fait chez Jaguar et pour certains chantiers navals. | |||
===Tous capitalistes!=== | |||
Le but de la direction est que le personnel participe au maximum à la vente de l'entreprise. C'est un moyen de s'assurer son adhésion au projet, et de neutraliser ce qui pourrait être une source d'opposition sérieuse. Cela va même encore plus loin. Quand le personnel a un intérêt immédiat dans l'entreprise, il identifie son avenir avec le sien. Cela permet d'en finir avec cette attitude de "nous" opposés à "eux" ; les ouvriers se reconnaissent dans l'entreprise au lieu de la considérer comme un adversaire. Cela améliore les relations de travail et diminue les conflits. Cela fait aussi monter le cours de l'action, toutes choses égales par ailleurs, dans la mesure où les acheteurs potentiels réévaluent à la hausse les résultats à venir de l'entreprise. | |||
Pour le gouvernement, l'intérêt supplémentaire est qu'une société dont les ouvriers sont actionnaires risque fort de s'opposer aux prises de contrôle par les hommes de l'Etat, et autres charlataneries du centralisme que pourraient proposer les partis politiques concurrents. Il existera un préjugé général en faveur du capitalisme et de la libre entreprise si leurs avantages sont assez visibles et partout diffusés, et si le travailleur ordinaire, vu les bénéfices qu'il en tire, se considère lui-même comme appartenant au système. | |||
===La reprise par une autre société...=== | |||
Néanmoins, toutes les privatisations ne se font pas par émission d'actions. Une fraction petite mais significative a lieu par reprise directe. En l'occurrence, comme dans les cas où l'on charge des entrepreneurs privés d'assurer un "service public", il importe de bien s'assurer que le personnel en place sera pris en compte dans la prise de contrôle. Il faut être sûr que les avantages dont ils bénéficiaient comme employés du secteur public seront remplacés par d'autres, tout aussi acceptables. | |||
Il est arrivé que la reprise passe pour une occasion à saisir, comme par exemple lorsque, ayant commencé par annoncer la fermeture de l'entreprise d'Etat, on présentait ensuite sa vente à un industriel privé comme une chance de "sauvetage" permettant de la maintenir en activité. L'acheteur privé est souvent en mesure d'offrir un avenir plus brillant, intégrant l'activité dans un ensemble plus vaste avec le savoir-faire de gestion et la force de vente nécessaires pour la moderniser et la rééquiper. On peut en trouver de bons exemples dans certains chantiers navals de la Marine ou encore les ferries de la Manche. | |||
===Le rachat de l'entreprise par ses salariés=== | |||
A l'autre bout de l'échelle, on trouve les cas où aucun acheteur extérieur n'intervient, mais dans lesquels la privatisation se fait par un rachat au nom de l'encadrement, du personnel ou des deux à la fois. La reprise transforme aussi bien le climat du travail que la viabilité économique des sociétés publiques. Quels qu'aient pu être les intérêts du personnel en tant qu'employés de l'Etat, ils deviennent radicalement autres quand ils sont devenus propriétaires de leur propre entreprise. L'ensemble de leurs priorités se transforme, et surtout ce qu'ils attendent du processus politique. C'est ainsi que bon nombre de rachats par les salariés ont valu un soutien accru au gouvernement. | |||
===L'exemple de la National Freight Corporation=== | |||
L'un des premiers rachats par la direction et les employés fut celui de la ''National Freight Corporation'', qui assure le transport routier du fret en Grande-Bretagne. Le rachat avait été lancé à l'initiative de la hiérarchie, initiative bien souvent imitée par la suite dans d'autres entreprises. Il est très fréquent que ce soit une idée de la direction, et que ce soit elle qui fasse l'offre. Dans le cas de National Freight, bien que la plupart des actions aient été rachetées par les cadres avec l'appui des banques, on fit son possible pour que le personnel y soit aussi associé. Ce fut une réussite, et aussi un précédent désormais classique. | |||
Le personnel de National Freight : chauffeurs, chargeurs, vérificateurs et trieurs, tous achetèrent leur part de la nouvelle entreprise. Il y en eut pour hypothéquer leur maison afin d'acquérir des actions. D'autres mirent dans la cagnotte les économies de toute une vie. Ayant décidé que la nouvelle entreprise serait rentable, ils ne ménageait pas leur soutien. Plusieurs, interrogés par la Télévision, expliquèrent ce que cela représentait pour eux d'être propriétaires de leur entreprise2. | |||
La nouvelle société connut une réussite immédiate. Elle s'avéra très rentable dans son statut privé, sa réussite commerciale traduisant une connaissance parfaite et un souci extrême des vœux de ses clients. Les employés actionnaires virent la valeur de leurs actions d'abord multipliée par quatre, puis par huit, dix, puis par cinquante-quatre. Tous les actionnaires, employés comme direction, avaient fait un gain de plusieurs milliers pour cent par rapport à leur investissement initial. | |||
Il vint un jour où la National Freight dut procéder à une réduction d'effectifs. Elle le fit en douceur, bien que sans joie, pour des raisons — et sur des critères — de rentabilité. Ce qui, dans une entreprise publique, aurait engendré une tempête et occasionné des grèves, voire des occupations d'usines, passa comme une lettre à la Poste. L'entreprise est toujours rentable. Elle avait loué une salle de concert pour la première assemblée annuelle de ses actionnaires, ne sachant pas du tout, parmi les milliers qui existaient, combien se déplaceraient. Ils sont venus par milliers, et l'on considère les participants aux réunions annuelles des actionnaires comme l'un des auditoires les mieux informés de Grande-Bretagne, puisqu'ils travaillent tous aussi pour l'entreprise. | |||
===Des réussites un peu méconnues=== | |||
Si National Freight est un modèle, on en a fait de nombreuses copies3. Les rachats par l'encadrement ont été les plus nombreux, même si ceux qui impliquaient une plus large participation du personnel ont eu plus de publicité. Aucun de ces deux types de rachat ne bénéficie d'autant de réclame qu'une émission publique d'actions ; c'est pourquoi ils comptent quelques-uns des succès les plus méconnus de la privatisation. | |||
===Tout faire pour mettre les salariés "dans le coup"=== | |||
Dans les cas où les employés représentent une partie significative du consortium, on a recours à des méthodes inédites pour accroître au maximum le nombre des actions qu'ils pourront acheter. Celui qui ne voit dans la privatisation qu'une simple vente des actifs de l'Etat devrait étudier l'extraordinaire imagination et l'inventivité des techniques utilisées pour convaincre l'ensemble du personnel de s'engager dans ces opérations. Par exemple, les employés peuvent payer à crédit, par versements mensuels prélevés sur leur salaire. Parfois les actions sont immobilisées dans une caisse pour les salariés, et libérées à mesure qu'elles ont été payées. On peut aussi faire intervenir des banques locales, qui mettront au point des conditions de paiement sur mesure pour les salariés acquéreurs. Dans de nombreux cas, comme la majorité du personnel est néophyte en matière financière, on organise des programmes d'initiation aux opérations boursières, au rôle de l'investissement et à l'importance des bénéfices. Les observateurs pourront noter que c'est en soi un grand service rendu à la société, et qui ne vient pas trop tôt par dessus le marché. | |||
===La privatisation est une opération politique=== | |||
Tout cela montre à quel point la privatisation est une opération politique, et pas seulement économique. Car elle vise aussi bien les marchés politiques que les marchés économiques. Associer les travailleurs à l'achat des actions permet de modifier profondément les termes de l'échange sur le marché politique. | |||
Le rachat des chantiers navals ''Vickers'' par le consortium du personnel en 1986 mit en œuvre aussi bien les bonnes vieilles techniques essayées et éprouvées que des innovations en la matière. Son histoire illustre bien jusqu'à quelles extrémités les responsables de cette politique sont prêts à aller pour atteindre les objectifs souhaités. Dans ce cas précis, pour permettre à la masse des ouvriers des chantiers navals de participer, on associa des conditions de crédit inouïes à un programme de formation intensif. Comme c'était un groupe qui n'avait ni économies de quelque importance ni aucune connaissance en matière financière, il fallut tout monter à partir de zéro pour qu'il puisse vraiment participer. Outre les employés, l'encadrement, les banques et autres investisseurs, l'originalité de la vente Vickers fut que l'on offrit des actions à des tarifs avantageux non seulement aux ouvriers, mais aussi aux membres des communautés locales de Barrow et de Birkenhead, les sites des deux chantiers concernés. | |||
L'événement le plus spectaculaire de la privatisation de Vickers fut que l'on ne vendit pas au plus offrant, mais au second enchérisseur. L'offre la plus élevée était celle de ''Trafalgar House'', un conglomérat géant. Or, ce fut le consortium formé par la direction, les employés et les habitants des communes qui emporta l'affaire, bien que son offre d'argent eût été moindre. Avec un tel engagement personnel dans l'affaire, c'était à eux que l'on donnait le plus de chances de réussir. Certains commentateurs ont trouvé bon de critiquer ce choix, parce qu'il était politique et non purement économique ; en tous cas, voilà qui montre bien à quoi sert la privatisation. | |||
===L'équipe dirigeante installée est souvent la mieux placée pour reprendre l'entreprise=== | |||
Le rachat par la direction ou le personnel a très bien marché pour privatiser des entités relativement réduites, par comparaison avec des colosses comme British Telecom ou British Gas. Lorsque la société est assez petite pour que s'y développe un véritable sens de la communauté, nous avons là un candidat potentiel pour le rachat direct. Il y a de fortes chances que la direction connaisse à la fois le potentiel et les problèmes de son outil de travail, ayant pu observer plusieurs années ses performances à l'intérieur du secteur d'Etat. Elle est bien placée pour savoir quelles améliorations l'on obtiendrait s'il était possible de modifier les procédures et d'obtenir du personnel une attitude différente. C'est pourquoi il est essentiel de la mettre dans le coup, quelle que soit l'ingéniosité comptable nécessaire pour y parvenir4. | |||
On peut dire que la roue de la politique a vraiment bien tourné, quand c'est un gouvernement conservateur qui favorise la constitution de petites coopératives. Or, le rachat par la direction et les employés est l'une des techniques de privatisation qui ont le mieux réussi. | |||
===La privatisation déplaît généralement aux syndicalistes=== | |||
Il existe une interrogation évidente sur le rôle des syndicats en tant qu'ils affirment représenter le personnel. La privatisation a bien montré que, s'il est possible de considérer les syndicats comme représentatifs des intérêts de leurs membres en matière de salaires ou de conditions de travail à l'intérieur de la structure existante, ce n'est plus le cas lorsque cette structure elle-même est en discussion. Dans bien des cas de privatisation, si ce n'est la plupart d'entre eux, on a pu observer une différence assez nette entre les intérêts de la base et ceux de la direction syndicale. | |||
Les dirigeants syndicaux ont depuis longtemps un intérêt personnel attaché au secteur public en tant que tel. La participation syndicale, aussi bien chez les cols blancs que chez les cols bleus, a toujours été plus élevée dans le secteur d'Etat que dans le privé, surtout pour les premiers. Les syndicats du secteur public ont généralement pu établir des relations de travail douillettes avec la hiérarchie et l'encadrement, également publics. Chacun voyait bien l'intérêt qu'il avait à ménager ses autres partenaires, au mépris sinon des employés, du moins de la clientèle et de la population dans son ensemble5. | |||
Les syndicats sont donc généralement hostiles à la privatisation, sachant pertinemment que le privé leur fera la vie moins belle. Les seules exceptions notables ont été les cas où, le gouvernement ou la direction ayant clairement affiché sa résolution de fermer une usine ou un secteur, la privatisation faisait figure de bouée de sauvetage. Par conséquent, la réaction syndicale a toujours été de s'opposer à la vente, sauf dans les cas où la seule autre possibilité était la fermeture immédiate. Alors, on peut se demander pourquoi leur riposte a été aussi inopérante, étant donné l'énorme pouvoir dont ils semblaient jouir en 1979. | |||
===D'où vient que l'énorme pouvoir syndical n'ait pu s'opposer à la privatisation ?=== | |||
Une réponse envisageable est qu'une partie de cet énorme pouvoir ne tenait qu'à l'image qu'on s'en faisait. Tant que le gouvernement et les "responsables" syndicaux se rencontraient deux fois par semaine au 10, Downing Street pour débattre des Intérêts Supérieurs de la Nation, le pouvoir des syndicats semblait faire partie intégrante des institutions britanniques, comme les gardiens de la Tour de Londres, ou la Colonne de Nelson à Trafalgar Square. Leur pouvoir se serait évanoui le jour où le Premier Ministre eut décidé de ne plus les consulter sur autre chose que les relations de travail, parce qu'il n'avait jamais eu d'autre source que sa bonne volonté. Une autre explication serait que le pouvoir des dirigeants syndicaux avait tellement été érodé par l'action législative du nouveau gouvernement, qu'il était désormais trop faible pour faire obstacle à la privatisation. La première explication a quelque valeur, mais la seconde ne tient pas chronologiquement, dans la mesure où les syndicats échouaient déjà dans leur opposition, bien longtemps avant que les nouvelles mesures n'eussent commencé d'entamer le pouvoir de leurs dirigeants. | |||
===Un effet de la micropolitique | |||
En fait, l'explication la plus plausible est que, ''les propositions de privatisation ayant été soigneusement conçues pour neutraliser l'opposition syndicale, elles y sont effectivement parvenues.'' Un examen des tactiques auxquelles les dirigeants syndicaux durent avoir recours montre bien à quelles difficultés ils s'étaient brusquement heurtés. | |||
===Le rouleau compresseur de la publicité officielle=== | |||
Certains s'étaient lancés dans de coûteuses campagnes de propagande. Ce fut le cas des fonctionnaires locaux qui ne voulaient pas que l'on sous-traite certains services municipaux à des entreprises privées, qui dépensèrent plus d'un million de livres en une année, et du syndicat des PTT6, qui dépensa un million et demi de livres pour une campagne de dix-huit mois. Dans les deux cas, ils s'efforcèrent d'atteindre leurs adhérents et le grand public au moyen de brochures, autocollants et films vidéo projetés en réunion. On chapitra dûment des militants bien choisis, pour qu'ils viennent faire leur numéro à la télévision. On s'adressait particulièrement aux indécis, ainsi qu'aux groupes tels que les personnes âgées, les handicapés et les personnes isolées, susceptibles de craindre d'être un jour privés d'un service téléphonique indispensable. | |||
Tout cela eut peu d'impact, l'une des précautions du gouvernement ayant été de lancer une vaste campagne de publicité pour promouvoir les émissions d'actions. Même une communication d'un million de livres ne fait pas le poids face à des campagnes évaluées à des centaines de millions. Ces campagnes, rondement menées par des professionnels, avaient peut-être été conçues pour vendre des actions, mais elles vendaient en même temps le ''principe'' de la privatisation. Une partie de leur message visait à ''rassurer les usagers'' quant à l'avenir du service. | |||
===Quand la micropolitique a réponse à tout=== | |||
Au niveau pratique, les mesures particulières démolissaient un par un tous les prétextes éventuels pour monter une opposition. Les habitants des campagnes étaient inquiets ? Eh bien, on ferait une clause pour imposer le maintien des cabines téléphoniques dans les zones rurales. Si les consommateurs s'inquiétaient d'une hausse éventuelle de leurs factures, alors on lierait les tarifs au taux d'inflation pour plusieurs années. Si une éventuelle prise de contrôle par l'étranger était une menace, pas de problème ! L'action préférentielle de l'Etat y ferait face. Le terrain sur lequel les syndicats auraient pu rassembler une opposition leur était enlevé, centimètre carré par centimètre carré. | |||
===Face à la hiérarchie=== | |||
Une tactique plus prometteuse au départ pour les syndicats avait été de faire front commun avec la direction. Si la hiérarchie et les syndicats d'une entreprise s'opposaient à la privatisation, il devenait difficile de la mener à bien. Ainsi, on les vit s'associer avec Lord Kearton de la ''British National Oil Corporation'', qui s'opposait à la vente de son holding de pétrole et de gaz, et avec Robert Atkinson des ''British Shipbuilders'', qui ne voulait pas entendre parler de vendre les chantiers de la Marine. Il y eut quelques autres opposants dans le groupe des Présidents des Sociétés Nationalisées, mais le gouvernement leur coupa l'herbe sous le pied de deux manières. Tout d'abord, dès qu'un poste était vacant dans les conseils de direction, il y nommait des partisans de la privatisation. Ensuite, il constitua à son tour un front uni des dirigeants, en les associant aux enjeux de la privatisation. | |||
===Vanité de la grève=== | |||
L'action revendicative classique dans les entreprises fut rarement utilisée. Il y avait eu des grèves symboliques dans l'industrie du gaz pour s'opposer à la vente des magasins de détail, dans les ferries de la Manche pour protester contre la vente de ''Sealink'', et dans les usines des Armureries Royales. Un an avant la vente de British Telecom, il y eut des grèves contre Mercury, le concurrent en télécommunications d'affaires qui devait être autorisé après la vente. Elles furent interrompues par les jugements des tribunaux sans avoir jamais eu assez d'impact pour influencer la décision de privatiser. | |||
Ce type de démarche était donc vain, et s'en est finalement tenu à quelques initiatives de petite envergure lancées par des activistes, en partie parce que les dirigeants syndicaux savaient ne pas pouvoir compter sur le soutien de la base pour des actions plus ambitieuses ou de plus longue haleine. C'était l'opposition de la direction qui avait empêché la vente des magasins de détail de gaz ; or ce fut cette même direction que l'on vit mener la vente de British Gas en 1986. | |||
===Faire directement des offres alléchantes court-circuite complètement les hiérarques syndicaux=== | |||
Cette incapacité des manœuvres syndicales traditionnelles à influencer le cours des événements traduit d'une certaine manière la position inconfortable où la politique du gouvernement avait placé les dirigeants syndicaux. Les propositions détaillées de privatisation finalement présentées n'exprimaient pas du tout l'opinion selon laquelle les employés du secteur public étaient surpayés, privilégiés et trop puissants. Au contraire, elles cherchaient à garantir les intérêts de ces employés dans le nouvel état de choses. Elles eurent pour effet de détacher les intérêts des travailleurs syndiqués de ceux de leurs camarades dirigeants. A la suite de quoi ces derniers se mirent vraiment à sentir du mou dans les rangs, de sorte qu'ils ne pouvaient plus faire appel aux réflexes de "solidarité" qui les avaient si bien servis dans les confrontations directes. Pour la ''National Freight Corporation'', par exemple, il était trop manifeste que l'intérêt de la base était de soutenir la privatisation et d'y être associée. | |||
La politique des directions et du gouvernement a été d'obtenir aussi souvent que possible ce type de résultat. Non seulement les offres faites étaient assez alléchantes pour donner aux travailleurs l'envie d'en être, mais il y avait aussi des campagnes de formation et de promotion pour les pousser à participer. Lorsque les salariés eurent comparé ce qu'on leur offrait de ce côté-là et leur avenir probable dans le secteur d'Etat, ils choisirent massivement de dire "oui" au changement, méprisant l'hostilité des hiérarques syndicaux. On en apprend pas mal sur la popularité réelle des industries nationalisées quand on constate l'enthousiasme avec lequel, à plusieurs reprises, les salariés ont participé à la privatisation, et leur fierté manifeste d'avoir pris part à cette nouvelle aventure. | |||
===Résignation des syndicats=== | |||
Entre-temps, les chefs syndicalistes, dont la première réaction avait été de voter motion sur motion au cours des conférences annuelles pour appeler à renationaliser sans indemnités, et de faire campagne au sein du parti travailliste pour qu'il s'engage à revenir sur tout ce qui avait été fait, ont fini par se résigner à considérer comme irréversible une bonne partie de ce qui s'était produit. Les nouveaux groupes d'intérêts, constitués aussi bien par les employés que par le grand public, étaient désormais trop puissants pour qu'on les attaque de front. | |||
===If you can't beat 'em, join 'em7=== | |||
On peut voir un signe des temps dans la vitesse à laquelle certains syndicats, pourtant en principe si lents à changer de position dans d'autres domaines, ont relevé le défi en changeant d'attitude face à la privatisation. Des quatre syndicats impliqués dans la National Freight Corporation, trois ont fini par soutenir le consortium direction/ouvriers qui avait assuré le passage au privé. Le Syndicat National des Cheminots est devenu actionnaire des ''Gleneagles Hotels'', l'une des entreprises qui gère par le biais de British Rail certains des hôtels anciennement possédés par l'Etat. D'autres syndicats n'ont pas manqué de noter la bonne image que l'attribution d'actions aux employés avait valu à ''British Aerospace'', ''Amersham International'' et ''Cable and Wireless'' auprès de leurs propres adhérents. Cela n'a pas échappé au gouvernement non plus : la bonne réaction des militants syndicaux à l'occasion de ces premiers exemples de privatisation était un précédent utile, précédent dont il s'est servi par la suite pour obtenir le soutien massif du personnel à l'occasion des ventes de ''British Telecom'' et de British Gas. | |||
===Y a-t-il une vie après la privatisation ?=== | |||
Il reste à savoir si les travailleurs, en tant qu'employés, tirent également parti de la privatisation. Qu'ils y gagnent en tant qu'actionnaires ne fait aucun doute. La stratégie micropolitique a consisté en partie à donner aux travailleurs un nouveau statut d'actionnaires-capitalistes afin qu'ils aient le sentiment d'être gagnants, quelles que soient les conséquences de ce nouvel état de fait pour leur première casquette. | |||
En l'occurrence, les premiers résultats sont favorables, malgré les sinistres augures des dirigeants syndicaux, mais l'opération est trop récente pour permettre une évaluation définitive. En termes relatifs, les salaires n'ont pas baissé. En fait, à mesure que les entreprises privatisées tiraient parti de leur nouvelle liberté pour élargir leur marché et accroître leur rentabilité, les employés ont bénéficié d'augmentations de salaire en même temps que des plus-values sur leurs actions. | |||
Les relations de travail ne se sont pas dégradées. Il est frappant de constater que la plupart des grands conflits du travail depuis l'avènement du gouvernement en 1979 se sont produits dans le secteur public. Les entreprises passées au privé n'ont connu aucun accroissement notable des conflits du travail. Il y en a eu dans des entreprises récemment privatisées, dont Jaguar et British Telecom. Ils tendaient à être brefs, et cherchaient à préserver la viabilité de l'entreprise. La règle générale est qu'il y a moins d'affrontements dans le secteur privé, et les nouvelles entreprises se sont conformées à cette règle. | |||
Les dirigeants syndicaux s'alarmaient d'éventuelles réductions d'effectifs après transfert au secteur privé. ''Associated British Ports'', par exemple, sous-traite à présent certains services qui étaient assurés par son propre personnel. ''Cable and Wireless'' a procédé à des licenciements, de même que ''British Aerospace''. En revanche, ''Amersham International'' et ''Britoil'' ont embauché. La privatisation a des conséquences contrastées sur le niveau de l'emploi, la position compétitive étant le facteur le plus décisif. C'est à cette position que les pertes d'emploi chez ''British Aerospace'' et ''Cable and Wireless'' ont été attribuées, ce qui semble indiquer que le niveau de l'emploi dans les entreprises privatisées est désormais soumis aux disciplines concurrentielles, et qu'il s'y adapte en conséquence. | |||
===Des salaires plus conformes aux qualifications=== | |||
Un effet possible du passage au privé est imputable à un phénomène caractéristique du secteur public, où le pouvoir syndical a souvent pour effet d'écraser les écarts de rémunération entre salariés qualifiés et non qualifiés. En d'autres termes, dans les entreprises publiques, les syndicats font monter le salaire des non-qualifiés — plus nombreux — aux dépens de ceux, moins nombreux, qui ont des qualifications ou des talents particuliers. On pouvait s'attendre à ce que le tir soit rectifié dans le secteur privé. Les entreprises doivent payer davantage les ouvriers qualifiés, sous peine de les voir partir chez des rivaux plus offrants. De ce fait, une fois passées au privé, les entreprises doivent offrir les avantages correspondants à ceux qui ont une compétence particulière. Et c'est exactement ce qui s'est passé8. | |||
===Ayant fait du travailleur un capitaliste, la privatisation ménage aussi ses intérêts de salarié | |||
Conclusion : à voir les avantages reçus par les travailleurs, il apparaît possible de mettre au point des politiques qui leur apporteront des profits immédiats en tant qu'actionnaires de l'entreprise, sans mettre en danger les avantages à long terme qu'ils perçoivent en tant qu'employés. En outre, la privatisation s'accompagne souvent de meilleures perspectives d'avancement. Tout cela étant avéré, démontré à profusion par les nombreux exemples de privatisations réussies jusqu'à présent, il n'est guère surprenant que le personnel des entreprises du secteur public ait perçu ce qu'il pouvait gagner à ce qu'on privatise, et qu'il ait le plus souvent coopéré dans ce sens. Là encore, par conséquent, les détails de la politique mise en œuvre ont atteint les résultats visés lors de leur mise au point. | |||
Revision as of 15 July 2006 à 09:01
par Madsen Pirie, Président de l'Adam Smith Institute, Londres (TEXTE EN TRAVAUX) Ce livre est dédié au professeur Edwin J. Feulner Jr.
Remerciements
J'aimerais exprimer ma gratitude à Robbie Gibb et à Barnaby Towns, qui m'ont aidé à préparer le manuscrit de cet ouvrage. Je remercie également le professeur Eamonn Butler, et tous ceux qui m'ont donné assistance et encouragements.
Pour la version française, mes remerciements vont à François Guillaumat, pour avoir choisi, révisé et adapté la traduction de ce texte.
Avertissement
Ce livre raconte l'histoire d'une réussite politique ; il est aussi l'aboutissement d'un itinéraire intellectuel que tous n'ont peut-être pas eu l'occasion de parcourir sur la même distance, ou dans le même ordre. Aussi l'une ou l'autre de ses parties pourra-t-elle paraître trop nouvelle à certains, alors que d'autres n'y verraient qu'une mise en forme, dans un cadre plus large, de ce que leur propre expérience leur avait déjà appris. Or, sa nouveauté et son importance sont telles qu'il se devait de traiter tous les aspects de la question.
C'est pourquoi, il est utile de présenter ici chacune de ses parties à l'intention de ceux qui ont le plus de chances d'y faire des découvertes — voire d'en être choqués.
Ainsi, la première s'adresse surtout aux intellectuels, aux militants, propagandistes et autres professionnels des idées. Elle vise à les convaincre que, s'ils veulent réellement influencer les événements, ils doivent aller au-delà d'un simple énoncé des principes, et se lancer résolument dans l'étude concrète des situations politiques réelles. Les deux parties suivantes leur montrent pourquoi faire, et les dernières, comment.
A l'inverse, c'est aux praticiens de la politique, qui nourrissent une robuste défiance à l'égard des idées préconçues, que s'adresse la seconde partie. Elle leur propose une nouvelle manière d'interpréter les faits dans leur propre domaine d'action, qui a valu une supériorité politique durable aux responsables qui l'avaient adoptée.
La troisième partie montre comment on s'est servi de cette découverte pour mettre au point la micropolitique, une nouvelle manière de concevoir les projets de réforme, et une démarche qui a donné à la politique libérale un réalisme qui lui avait souvent manqué dans le passé.
La troisième partie décrivant dans le détail des politiques désormais connues, la quatrième expose certaines conclusions encore inédites de l'approche micropolitique, qui font l'objet des nouveaux projets actuels.
Enfin, la cinquième tire les leçons de l'expérience acquise.
Ce livre étant largement destiné aux professionnels de la politique, il était essentiel de faciliter son utilisation comme manuel pratique ; c'est pourquoi l'ouvrage se présente sous la forme de chapitres largement autonomes, dont le texte a été encadré par des intertitres, certaines phrases essentielles étant mises en italiques. Ces mentions sont reproduites ci-dessous dans la table des matières, afin de faciliter la recherche des thèmes et références.
F. G.
PREMIERE PARTIE : LE ROLE DES IDÉES
1 Les idées et les événements
Les réponses les plus difficiles à trouver correspondent aux questions que personne ne se pose jamais, et la manière dont les idées influencent les événements relève assurément de cette catégorie. La supposition générale est qu'il n'y a rien à expliquer, que les actes se conforment gentiment aux idées qui les ont inspirés.
La question
Cette conception peut prendre une forme simplissime, que l'on peut présenter ainsi : le penseur trouve l'idée, et puis hop ! le législateur la fait appliquer. Or, s'il est une vision qui est complètement fausse, c'est bien celle-là. Toutes sortes d'idées sont proposées à tout instant ; et elles se contredisent plus souvent qu'à leur tour. On en remarque certaines d'emblée, d'autres passant totalement inaperçues. Certaines sont mises en œuvre, les autres rejetées. Les sociétés démocratiques foisonnent de débats idéologiques où chacun milite pour une conception de l'ordre social totalement incompatible avec les autres. On conviendra que toute explication doit au moins tenir compte de ce fait d'évidence : il y a des idées qui sont appliquées, et d'autres qui ne le sont pas.
On peut élaborer sur ce modèle trop simple en y introduisant le facteur temps. Dans cette variante, on voit d'abord exposer certaines idées. Au bout d'un certain temps, certaines d'entre elles voient leurs mérites reconnus, et commencent à influencer le processus politique. Cela permet d'envisager une sorte de "dérive aléatoire" dans le domaine des idées : une certaine vision du monde prédomine un certain temps, puis d'autres la supplantent éventuellement par la suite1.
Contrairement à sa version élémentaire, cette présentation-là ne semble pas totalement fausse a priori ; si l'on n'y regarde pas de trop près, elle peut même fournir quelques éléments d'explication au changement politique. Une fois les idées exposées par les penseurs, certaines finiraient par s'imposer. L'expérience de leur mise en œuvre conduirait alors à les critiquer, conduisant à envisager d'autres conceptions. Ces dernières seraient alors prises en compte, jusqu'à ce qu'à leur tour elles finissent par être contestées. On peut y voir une description plausible de la façon dont, par exemple, des interludes de libéralisme alternent avec des périodes de "conscience sociale".
Le chaînon manquant
Inclure le temps dans le modèle ne suffit cependant pas pour qu'il soit complet. Il faut aussi imaginer quelle procédure rendra compte de l'"émergence" des idées. Etant admis que les intellectuels s'occupent de produire ces dernières, il nous faut expliquer comment, et pourquoi, certaines d'entre elles parviennent à l'attention des politiciens. Les intellectuels s'adressent généralement à un public, c'est-à-dire qu'ils diffusent livres et articles, et donnent des conférences. Nous admettrons donc que leurs idées, en règle générale, sont accessibles aux parties intéressées2.
Il nous reste donc à retrouver la piste des idées en question, entre leur première publication et la décision du législateur. Comment sortent-elles de leur anonymat ? Bien naïf qui croirait que les politiques passent le plus clair de leur temps dans les publications savantes, dans le seul but de se tenir au courant ; il nous faut donc retrouver l'intermédiaire, le quidam qui aura porté les secondes à l'attention des premiers.
Qui ?
Il existe au moins deux possibilités, d'ailleurs compatibles entre elles : la première serait que certaines personnes passent leur temps à suivre et à diffuser les idées politiques ; un groupe en contact aussi bien avec le monde universitaire qu'avec celui de la politique concrète. Il peut s'agir de militants politiques ou de lobbyistes, ou bien de commentateurs informés, éditorialistes et autres publicistes, comme on les appelait au siècle dernier. Tout ce qu'on leur demande pour jouer ce rôle-là est, tout en suivant le progrès des théories économiques et politiques, de se trouver en position d'influencer ceux qui font vraiment la loi.
La deuxième possibilité mais peut-être y en a-t-il encore bien d'autres serait que les idées parviennent au pouvoir à l'occasion d'un changement de génération. La majorité de nos gouvernants a fait des études supérieures. C'est peut-être à ce moment-là qu'ils ont été initiés aux idées nouvelles, soit directement par leurs professeurs, soit à l'occasion de recherches empiriques ou théoriques entreprises pour obtenir leurs diplômes. Baigner dans le milieu universitaire a pu les ouvrir aux idées, et les avoir assez marqués dans leurs jeunes années pour influencer leur action une fois atteint l'âge d'exercer un pouvoir3.
Comment les idées sont-elles choisies ?
Il nous reste à expliquer pourquoi ce sont ces idées-là, plutôt que d'autres, qu'ils auront adoptées. Là encore, la réponse la plus simple est de supposer que leurs vertus supérieures auront émergé du processus de la discussion et de la critique savantes. Le poète Milton et l'économiste John Stuart Mill avaient tous les deux adopté la théorie selon laquelle, dans une compétition libre et honnête, la vérité finit par triompher. Tous deux, bien sûr, y voyaient un bon argument en faveur de la liberté de parole et d'expression.
Si le monde réel présentait l'aspect idyllique de cette vision de l’esprit, le problème serrait résolu. Malheureusement, la réalité est toute autre. Dans l'imperfection de notre monde sublunaire, la vérité est souvent réduite au silence par la force. On oblige Galilée à se rétracter ; on condamne au bûcher les ouvrages hérétiques, parfois accompagnés de leurs infortunés auteurs. De nos jours, la force a mis des gants de velours : elle se borne à promouvoir les universitaires qui sont dans la ligne, tout en le refusant aux autres. Les intellectuels au pouvoir font la carrière de leurs courtisans et autres porte-coton, et s'efforcent de réduire au silence ceux qui pourraient remettre en cause les résultats de toute une carrière de recherches.
On pourra certes toujours soutenir que les passions vulgaires des hommes ne sauraient empêcher indéfiniment la vérité d'éclater. N'a-t-on pas fini par donner raison à Galilée ? Giordano Bruno n'influence-t-il pas davantage notre monde moderne que l'Inquisition qui l'envoya au bûcher ? De même pourrait-on affirmer que l'intellectuel maudit finira toujours par se faire entendre, pourvu que ses idées aient un tant soit peu de valeur. Réhabilitation et célébrité viendront un jour, quand ce serait à titre posthume. Voilà qui réconforte nos intellectuels proscrits ; mais que ce petit jeu-là ne consiste-t-il pas un peu trop à "prédire" un passé que nous connaissons déjà ?
Nul doute que certaines idées ont fini par l'emporter : ce sont celles que nous connaissons. Mais rien n'empêche que, malgré leur valeur, d'autres idées ne nous soient jamais parvenues : et ce sont celles que nous ne connaissons pas4.
Croire que la vérité finit toujours par triompher, c'est l'erreur des historiens libéraux du XIXème siècle5, qui supposaient que le passé n'est finalement là que pour nous amener au présent. Or, si nous voyons ce qui s'est produit, nous ne voyons pas ce qui aurait pu se produire. Les idées qui ont survécu sont celles qui dominent aujourd'hui ; nous ne pouvons pas dire que ce soit forcément "la vérité".
S'il ne suffit pas qu'une idée soit vraie pour qu'elle soit acceptée, alors il nous faut chercher d'autres voies. Si la qualité propre de l'idée n'attire pas l'attention sur elle, peut-être suffira-t-il de vanter ses mérites ? Une fois passée dans le domaine public, certains, séduits par la force de ses arguments, reconnaîtront ses vérités fondamentales. L'ayant adoptée, ils publieront des textes exposant ses avantages ; peut-être même la développeront-ils plus avant que son inventeur ne l'avait fait.
Les lobbies intellectuels
Ainsi l'idée peut-elle obtenir davantage de soutien que sa source unique n'aurait pu lui en assurer. Ceux qui l'ont adoptée forment une communauté d'intérêts. Ils œuvrent de concert pour la promouvoir, s'efforcent d'empêcher qu'elle ne passe à la trappe6. Cet engagement lie leur sort à celui de l'inventeur ; ils font leur chemin en marge de l'opinion reçue du moment, et constituent une sorte de groupe de pression intellectuel pour rappeler aux autres que l'idée existe toujours, de sorte que son audience finisse par se développer7.
Le modèle des "révolutions scientifiques"
De nos jours, le processus par lequel les idées parviennent à influencer les événements ressemble étonnamment à la manière dont Thomas Kuhn a décrit l'apparition des révolutions scientifiques : sous le règne du "paradigme" dominant, seules les recherches faites sous l'égide dudit paradigme peuvent être reconnues. Les idées qui sont explorées, approfondies, développées, sont donc toujours les mêmes. Jamais on ne les conteste directement, car celui qui s'y risquerait n'y gagnerait ni légitimité, ni reconnaissance, ni honneurs. Finalement, explique Kuhn, le paradigme est poussé jusqu'à ses ultimes limites. A mesure que s'accumulent les incohérences et les insuffisances, de plus en plus de gens s'aperçoivent qu'il faut le remplacer par un véritable changement de perspective intellectuelle. C'est alors que l'on assiste à la période la plus créatrice, le paradigme étant toujours en vigueur. Surgit un nouveau modèle, généralement issu de la génération intellectuelle qui suit, dont la carrière n'est pas inextricablement liée à l'ancien. Ce modèle se fraie un chemin et se fait accepter ; on travaille à le développer et à l'élargir, et il établit un nouveau statu quo. On réhabilite les intellectuels qui plaidaient sa cause à l'époque où il n'était pas encore à la mode, et on leur rend l'hommage rétrospectif dû à des pionniers.
Qu'on applique à l'histoire des idées cette théorie des révolutions scientifiques, et on s'apercevra que le processus décrit par Kuhn est très proche du modèle que nous avons présenté jusqu'ici. Il pourrait en principe expliquer la manière dont les idées politiques se succèdent les unes aux autres. Encore faudrait-il qu'un groupe serve de passerelle entre le royaume idéal de la théorie et le monde de la politique pratique. Si ce groupe existe, nous pouvons expliquer comment les idées, qui sont de l'ordre du débat intellectuel, finissent par être acceptées au niveau de la prise de décisions et de l'influence concrète.
L'intérêt tout particulier du modèle de Kuhn tient à ce qu'il repose en fait sur la psychologie. C'est bien pour rendre compte de l'évolution des connaissances scientifiques que Kuhn l'a proposé, mais il ne traite pas des idées elles-mêmes : il montre comment les hommes y réagissent8.
Il n'est pas douteux que la théorie de Kuhn laisse à désirer comme explication des progrès de la science proprement dite ; mais elle nous en apprend beaucoup sur les engouements en la matière. Elle montre de façon très plausible comment certaines théories deviennent à la mode et excitent les chercheurs. Certains de ses éléments nous permettent de comparer le sort fait aux idées politiques avec le processus qu'elle décrit. Quand les idées sont acceptées, elles stimulent la recherche et attirent l'attention sur leurs porte-parole. Quand, au contraire, elles végètent encore dans les oubliettes de l'opposition au consensus du moment, personne ne s'y intéresse, et encore moins à leurs partisans.
Cependant, il existe un phénomène majeur auquel le modèle de Kuhn ne peut plus être appliqué : Kuhn se limite à la façon dont les idées parviennent à dominer une communauté intellectuelle. C'est dans la communauté scientifique que se produisent les "révolutions" auxquelles il s'intéresse, et il n'a donc pas grand chose à dire sur la manière dont les idées sont adoptées par le grand public, ou parviennent à influencer les choix politiques concrets. Même si nous acceptions son modèle pour rendre compte de la victoire des idées dans le monde intellectuel, il nous resterait encore à rendre compte de leur acceptation par la société, et du processus qui leur permet de peser sur les événements et les décisions.
Les "revendeurs d'idées"
Cette passerelle entre les deux univers, c'est peut-être le groupe intermédiaire des disciples et des propagandistes qui pourrait la former. Chaque grand penseur original a des dizaines, voire des centaines de "suiveurs". Ils explorent les ramifications de l'idée originelle, participant par leurs études et leurs critiques à l'élaboration de l'ensemble. Il s'agit souvent de professeurs et autres enseignants d'université. Ensuite, viennent les étudiants qu'ils auront formés, et dont certains seront devenus écrivains, journalistes, ou leaders d'opinion9.
C'est le groupe que F.A. Hayek appelle "les revendeurs d'idées"10. Ils se perçoivent eux-mêmes comme des représentants de commerce au service des points de vue et des principes d'origine, au niveau où ceux-ci peuvent être suivis d'effet. Qu'il s'agisse d'un public de décideurs ou de législateurs, ou bien encore d'un auditoire informé et cultivé, ces "représentants" espèrent ainsi que la pression exercée aboutira à l'adoption des idées défendues.
Tous les éléments du puzzle sont maintenant en place, reconstituant l'image familière de ce que l'on appelle souvent "la bataille des idées". Le décor est planté pour un scénario que nous connaissons bien.
La bataille des idées
Premier acteur : l'intellectuel. Contre les vents et les marées des théories politiques ou sociales de l'époque, on l'a vu prendre le parti d'une position originale, selon laquelle la conception dominante est soit déformée, soit fausse dans ses fondements mêmes. Son œuvre est vaste et ambitieuse, et son approche iconoclaste ; elle implique de déboulonner le paradigme en vigueur. Et ce que lui vaut son audace, c'est l'incrédulité et le scandale. La communauté scientifique rejette ses travaux comme absurdement "dépassés" (toujours une excellente défense contre les idées nouvelles), quand elle n'emploie pas le procédé plus classique, encore plus efficace dans ce milieu : l'omertá, la loi du silence. Ses écrits ? on n'en rend aucun compte. On ne les cite pas, on ne les prend pas au sérieux. Le malheureux est mis au ban de ses pairs. Tout-à-coup, voilà qu'il a du mal à faire publier ses textes, ou pour se faire inviter à des conférences importantes. La chaire qu'on lui avait promise échoit à un autre, il n'arrive pas à obtenir des subventions. Enfin, pire que tout, ses étudiants ont toutes les peines du monde à se caser. C'est le début de la traversée du désert.
Isolé dans le milieu universitaire, l'intellectuel n'en est pas pour autant absolument seul. Une poignée de collègues, ses jeunes admirateurs, d'autres encore, reconnaissent ce que vaut son travail et commencent à écrire des articles que l'on ne diffuse d'abord que dans des revues confidentielles. Le nombre d'étudiants qu'il influence s'accroît avec les années qui passent. Le groupe est toujours minoritaire, mais c'est une minorité soudée et loyale.
Voici maintenant les vulgarisateurs. Anciens étudiants, intellectuels convaincus par des lectures ou des discussions, ils sont prêts à se dévouer pendant des années s'ils sont persuadés que l'idée en vaut la peine. Ils visent la génération montante des étudiants et enseignants, et cherchent à atteindre le public cultivé en publiant des monographies, des essais et des articles de revue. Parmi ceux qu'ils influencent, certains se lancent dans la politique, où ils passent pour une petite minorité d'excentriques, au service d'une idée mal assimilée, et dont le discrédit est presque universel.
Le scénario standard appelle une "happy end"
Patiemment, notre groupe solitaire œuvre pendant des années, fêtant chaque nouvelle conversion, ne manquant jamais de relever les inadéquations et les échecs des théories qu'ils combattent. Et le scénario standard appelle une "happy end". Les événements exposent l'insuffisance des idées politiques dominantes, au moment où le travail systématique des "maudits" finit par payer. Une nouvelle génération d'intellectuels se range à leurs conclusions. Les idées sont devenues respectables, et les chercheurs se précipitent pour faire publier thèses et essais fondés sur ces conceptions.
Pendant ce temps, le travail des "vulgarisateurs" est allé tellement loin que leurs idées ont pu s'infiltrer jusqu'au sein de la société éclairée. Au moment même où elles deviennent scientifiquement respectables, on assiste à la naissance d'un intérêt populaire pour ces idées nouvelles. Il existe une demande : il faut remplacer l'ancien système, désormais failli. La pression populaire, jointe à la respectabilité scientifique, permet maintenant au législateur d'entrer en scène. Inspiré par les idées nouvelles, il s'empresse de les mettre en application.
Le penseur, s'il est encore de ce monde, se retrouve célèbre. C'est le début des tournées de conférences et des offres de publication à ne savoir qu'en faire. Les premiers partisans sont récompensés de leurs années de vaches maigres par des promotions bien méritées. Une idée aura encore réussi à changer le cours des choses. Pendant ce temps, bien sûr, un autre penseur solitaire, qui n'a pas hésité à défendre un paradigme radicalement opposé, éprouve ce qu'est l'ostracisme.
Les raisons de la "bataille des idées"
Voilà un scénario que nous avons tous entendu mentionner, car il n'est pas seulement familier : il est aussi bien réconfortant. Les intellectuels dont le travail n'est pas reconnu peuvent toujours se consoler en pensant qu'un jour, leur tour viendra. Et même si c'est trop tard pour eux, ils peuvent toujours espérer que leurs idées triompheront à titre posthume. Les petits Marx d'aujourd'hui, peinant à leur British Museum, peuvent rêver d'une gloire comparable à celle de leur illustre aîné. Leurs disciples et partisans, bien que chassés du Paradis des intellectuels et réduits au silence, peuvent eux aussi espérer qu'avec la reconnaissance de leurs thèses viendra la leur propre pour avoir, les premiers, compris ce qu'elles valaient et sacrifié leurs perspectives de carrière pour les faire avancer. Les vulgarisateurs, ces "marchands d'idées de seconde main", peuvent se payer de l'espoir que leur patient travail finira par être rentable. Quand les idées sont devenues suffisamment populaires pour permettre aux hommes politiques d'agir, ceux qui ont participé à leur avènement ont l'immense satisfaction morale d'avoir contribué à influencer l'histoire et à déterminer le cours des événements.
Si ce scénario est populaire, cela tient donc pour une part à ce qu'il est plausible en lui-même, et pour une autre à ce qu'il satisfait toutes les parties en présence. Tout d'abord, il est un moyen de rendre compte du mode d'action des idées et de leurs conséquences. Il montre comment un effort fait dans le domaine des idées peut se traduire par un enchaînement d'influences qui finira par peser sur les choix concrets. Ensuite, il rassure tous ceux qui ont un intérêt dans l'affaire : les penseurs, leurs disciples et les vulgarisateurs. Ceux qui voient triompher ces idées peuvent revendiquer une part de leur gloire. Ceux qui n'ont pas cette chance peuvent espérer qu'un jour, leur tour viendra.
C'est donc la masse de ceux qui veulent croire à ce scénario familier qui donne tellement d'importance à la bataille des idées. S'il est vrai que les événements à venir sont déterminés par les idées dominantes de la génération qui suit, alors quiconque souhaite voir sa vision du monde l'emporter doit exercer son influence dès maintenant. Si c'est la propagation des idées auprès des leaders d'opinion cultivés qui pousse les politiciens à l'action, celui qui souhaite les voir agir dans un certain sens se doit de les convaincre de la justesse de ses thèses.
Une guerre de positions
Voilà donc fondamentalement pourquoi la bataille des idées est menée à deux niveaux par ceux qui veulent déterminer la forme de la société à venir. Les deux niveaux sont liés ; c'est en s'assurant l'adhésion des étudiants d'aujourd'hui que les partisans du changement radical espèrent influencer les leaders d'opinion de demain. L'un des principaux avantages de cette accent mis sur l'éducation est qu'il peut faire boule de neige. Un petit nombre de professeurs peut influencer un grand nombre d'étudiants, et quand ces derniers seront à leur tour devenus professeurs, ils pourront en influencer un nombre bien plus important encore. Il se peut même qu'en fin de compte, la domination soit si forte que toute une génération en restera imprégnée.
Les disciples et compagnons du grand penseur intriguent pour infiltrer le monde universitaire et peser sur lui ; pour influencer aussi bien les publications que les enseignants. La bataille fait rage dans les manuels d'enseignement, ceux qui veulent éliminer totalement le paradigme en vigueur s'efforçant de contrôler le contenu des cours. La presse révèle souvent les tentatives, souvent grossières, faites pour endoctriner de jeunes enfants. Autrement plus âpre est la bataille qui se livre pour mettre la main sur ce qu'on enseigne au niveau supérieur11.
A mesure que cette activité se développe, les départements d'université et les lycées prennent de plus en plus des allures de colonies. Une personne bien placée sera utile pour recruter les plus jeunes et les plus prometteurs. Les diplômés seront attirés ou orientés vers les lieux d'enseignement qui professent les idées nouvelles. Au bout d'un moment, certains départements se seront faits connaître pour leur dévouement à tel paradigme. Les convertis s'y inscriront, et seront accueillis à bras ouverts ; les autres n'auront qu'à aller ailleurs.
La "bataille" pour les idées porte bien son nom, car la métaphore militaire est bien appropriée. On peut envisager cette lutte pour conquérir la génération d'intellectuels à venir comme une guerre de positions, ponctuée çà et là par des escarmouches, des manœuvres stratégiques et une répartition judicieuse des troupes pour renforcer les positions cruciales ou récemment acquises. De temps à autre la bagarre, occulte dans sa permanence, fait surface à l'occasion de la conquête d'une institution importante. Démissions fracassantes et protestations solennelles donnent alors au spectateur un aperçu de l'âpreté du combat.
La "traversée du désert"
La "traversée du désert" se caractérise notamment par la loyauté tribale des troupes dans leur ensemble. Vu leur statut minoritaire, on pourrait s'attendre à ce qu'elles cherchent à consolider leurs bases en s'assurant des alliés qui acceptent certains éléments de la nouvelle doctrine. En fait, c'est souvent l'inverse qui se produit, car on est bien résolu à ne pas laisser se diluer la doctrine, à ne pas la laisser polluer par des idées déviantes. Il arrive que cela mène à une attitude exclusive, dans laquelle seuls ceux qui acceptent les idées du maître sans compromis ni discussion seront tolérés. On fera usage d'expressions clés codées et d'un jargon spécifique qui donnera à l'observateur l'impression que tout cela n'est pas sans rapport avec les incantations d'un rituel religieux.
Ceux qui se sont chargés de vulgariser auprès des leaders d'opinion et de la communauté intellectuelle, mesurent la réussite en termes de couverture médiatique. Les chiffres de diffusion des écrits prennent alors une importance cruciale. Les ventes de livres sont assidûment décomptées, non pour les droits d'auteur qu'elles rapportent, mais pour l'influence qu'elles traduisent. La publication d'un article de presse sur un intellectuel ou sur ses idées dans un journal ou un magazine important constitue un événement marquant. Les photocopies de l'article en question, diffusées par des partisans, auront probablement plus de lecteurs que l'article original lors de sa publication.
Les émissions sérieuses de radio ou de télévision qui mentionnent les idées en cause sont célébrées comme des victoires majeures, car on les jugeait victimes d'une sorte de conspiration du silence, les commentateurs informés refusant de les prendre au sérieux. Une émission de radio ou de télévision représente une véritable brèche dans cette conspiration, quel que soit le taux d'écoute de l'émission ou la chaîne sur laquelle elle est diffusée.
Les enjeux matériels
Comme dans les révolutions scientifiques, il y a toujours ceux dont la carrière est directement liée au résultat de la bataille. Dans les institutions universitaires, il en est dont les occasions d'avancement dépendent de la victoire des idées nouvelles. D'autres, qui n'ont pas pu se faire un nom dans le cadre du paradigme en vigueur, ont une chance de se faire reconnaître dans le petit cénacle qui s'efforce de le renverser. Car les directeurs des instituts de recherche, tout en travaillant pour faire avancer la cause, gagnent aussi leur vie. Les deux groupes écrivent, ils donnent des conférences, ce qui représente autant de sources de revenus supplémentaires, et d'occasions de participer à des rencontres et séminaires à l'étranger12.
Les enjeux intellectuels
Ceux qui se rebellent contre l'orthodoxie dominante sont souvent animés par trois convictions bien claires. En premier lieu, ils sont persuadés que les idées originales dont ils se font les avocats sont, par essence, justes. C'est-à-dire qu'ils sont parfaitement conscients des défauts d'analyse qui inspirent le statu quo, comme du fait que leur raisonnement à eux en détruit les fondements. En conséquence, ils sont véritablement habités par leurs principes et, comme la plupart de ceux qui sont dans ce cas, prêts à supporter privations et rejet pour la cause qu'ils estiment juste.
Deuxièmement, ils sont encouragés par la conviction qu'un jour, leur façon de voir finira bien par être reconnue. Pour eux, ce n'est qu'une question de temps et d'efforts pour que les vérités qui leur paraissent évidentes ne se révèlent aux autres. Dans ce désert aride, leur aliment est donc celui de l'espoir. Ils se nourrissent de la conviction qu'un jour viendra, de préférence de leur vivant, où la communauté intellectuelle au sens large reconnaîtra la justesse de ce qu'ils affirmaient depuis le début.
La troisième raison d'agir est peut-être aussi la moins contestée. Elle consiste à penser que, une fois la bataille des idées remportée, les événements feront immédiatement suite à cette victoire. Ils présument que, grâce à la mise en pratique de leurs idées, une victoire dans le monde intellectuel entraînera automatiquement, et peu de temps après, des avancées équivalentes dans le monde réel. Etant convaincus de la justesse de leurs opinions, et certains de gagner un jour la bataille intellectuelle, ils sont également persuadés que leurs efforts finiront bel et bien par changer la vie des gens.
La source de cette troisième conviction n'est pas bien difficile à pressentir. Tous ceux qui prennent part à la "bataille des idées" sont eux-mêmes des hommes d'idées13. Ce sont les idées qui les font agir, qui les occupent, qui savent les enthousiasmer. Pour de telles personnes, il est bien naturel de supposer qu'en fin de compte, ce sont les idées qui déterminent toute chose, et que gagner la bataille des idées revient à gagner la bataille des faits.
Une idée d'intellectuels
Les intellectuels ont toujours exalté le rôle et l'influence de l'intellect. On ne sera pas surpris que les ouvrages les plus importants attestent ce rôle, puisque ce sont des intellectuels qui les ont écrits. La plupart des hommes et des femmes d'idées ne doutent guère que leurs pareils soient à l'origine des progrès majeurs de l'histoire humaine. Ils déprécient la contribution des industriels et des marchands, des explorateurs et des soldats, des paysans et des bâtisseurs.
Consciemment ou non, nombre d'intellectuels partagent cette vision des choses. Ce sont ces mots de John Maynard Keynes, homme d'idées autant que d'influence, qui l'expriment le mieux :
"Les hommes de terrain, qui se croient libres de toute influence intellectuelle, sont généralement les marionnettes de quelque économiste défunt. Les fous qui sont au pouvoir, et qui entendent des voix dans le ciel, tirent leur frénésie de ce qu'un intellectuel a scribouillé voici quelques années."
Ces mots-là ont donné des ailes aux intellectuels, la principale raison en étant qu'ils exaltent leur condition. S'ils fascinent tellement, c'est largement parce qu'ils abaissent ceux qui paraissent exercer le pouvoir et maîtriser les événements. Elle présente, cette fameuse citation de Keynes, la puissance temporelle comme une illusion. Elle affirme, ni plus ni moins, que ceux qui paraissent exercer le pouvoir ne font que pousser à maturation la graine semée avant eux par un intellectuel. L'homme de pouvoir peut bien brandir le sceptre, c'est l'intellectuel qui dirige sa main.
Trop beau pour être vrai ?
Le charme keynésien est enivrant : il trouble et rassure à la fois ceux qui passent leur vie cloîtrés dans le monde universitaire. Il dit aux intellectuels ce qu'ils ont envie d'entendre, et dont Keynes était persuadé, à savoir qu'ils sont les véritables puissants de ce monde. Il contribue, en quelque sorte, à expliquer pourquoi les intellectuels ne se demandent jamais si une victoire dans le monde des idées se traduira vraiment par une victoire dans le monde réel.
Cependant, aussi séduisante et agréable qu'elle soit pour la communauté des penseurs, la doctrine keynésienne ne va pas de soi, loin s'en faut. Rien ne prouve que ceux qui exercent le pouvoir ne soient que les jouets sans volonté des scribouillards d'autrefois. Le scénario familier que nous avons écrit pour la victoire dans la bataille des idées, ce scénario manque un peu de consistance sur sa fin. On a le droit de douter que ce soit sur le champ de bataille idéologique que se décide l'avenir d'une société. Si l'on veut défendre cette idée, alors il faut apporter la preuve du lien entre la victoire intellectuelle et la victoire pratique. Il faut démontrer qu'il existe un processus liant de façon nécessaire et suffisante l'adoption des idées par les intellectuels et la mise en œuvre des politiques.
Or, il est tout à fait possible d'accepter le rôle de l'intellectuel novateur et de ses années de lutte, de reconnaître l'importance de ce qu'ont accompli les disciples, les partisans et les vulgarisateurs, et malgré tout de douter que tout cela suffise vraiment pour influencer les événements eux-mêmes. Même si l'on admet que le processus que nous venons de dépeindre décrit correctement la victoire ou de la défaite dans certaines batailles intellectuelles, il reste un hiatus crucial entre l'idéologie et la réalité.
Les combattants ne doutent pas que les idées soient suffisantes : une fois qu'elles auront gagné à la fois le respect du monde savant et le soutien du public, les politiciens pourront les mettre en œuvre. Or, c'est là que le bât blesse. En effet, il ne s'agit là que d'une supposition, et non d'une affirmation raisonnée, appuyée sur des preuves et des arguments.
On peut donc toujours prétendre que les changements qui interviennent en politique ne découlent pas directement des victoires remportées dans le monde des idées, et que la relation entre les idées et la politique est plus complexe que le modèle simple que nous venons de considérer.
2 La théorie et la pratique
Dans tous les domaines des affaires humaines, la pratique précède de loin la science : la recherche systématique de tous les modes d'action des pouvoirs de la nature est le produit tardif d'une longue suite d'efforts pour asservir ces pouvoirs à des fins pratiques.
John Stuart Mill
The Principles of Political Economy
L'utopie... au pouvoir
La République de Platon est l'un des plus anciens classiques de la science politique. Bien que prenant la forme d'un dialogue ostensiblement destiné à la recherche de la justice, une grande partie du livre décrit comment on pourrait constituer la société idéale, quelles seraient ses règles, ainsi que son éducation et ses mœurs, et même ses mythes.
La conception platonicienne de la société parfaite paraîtra sans doute quelque peu austère, voire brutale au goût moderne. Il en était sans doute de même pour son public athénien. Il fallait élever les enfants tous ensemble, sans qu'ils sussent jamais qui étaient leurs parents naturels ; les exposer dès leur plus jeune âge aux duretés de la vie, afin de leur inculquer les vertus martiales. On ne devait leur autoriser qu'un vêtement des plus grossiers, qu'une alimentation des plus simples. Le pain noir devait suffire aux habitants de ce monde idéal. Une censure stricte devait les empêcher de lire aucun écrit susceptible de les distraire ou de les écarter des chemins de la vertu et de la force. On n'aurait autorisé aucune pièce de théâtre qui dépeigne la faiblesse ou l'abandon sentimental. Même la musique devait être sévèrement réglementée : seules auraient été autorisées les harmonies susceptibles d'entretenir un courage convenable. Tous les aspects de la vie auraient été contrôlés, de telle sorte que l'Etat soit mieux servi par ses citoyens.
Les citoyens auraient vécu en communauté, mangeant à la table commune, ne jouissant d'aucun luxe à l'exception de celui qui, à l'occasion et discrètement, leur permettait d'accomplir leur devoir, c'est-à-dire engendrer la génération suivante. La surveillance de ces règles serait échue à ce que l'on appellerait aujourd'hui une police secrète, mais à laquelle Platon avait trouvé un nom plus philosophique.
Gardiens, Auxiliaires et Travailleurs devraient connaître leur place et l'accepter, soutenus en cela par le "noble mensonge" selon lequel ils descendaient respectivement de l'or, de l'argent et du bronze. On imagine que c'est seulement faute d'une technique adéquate que Platon manqua de faire la même suggestion que Huxley : une voix qui, pendant le sommeil des enfants, leur aurait récité : "je suis bien content d'être un gamma ; les alphas doivent réfléchir tout le temps, et les bêtas ont tellement de soucis..."
La société idéale, celle qui engendre (et entretient) le philosophe-roi, est décrite avec une minutieuse précision. Il s'agirait d'un véritable tour de force de l'imagination, si une telle société n'existait pas déjà, au moins dans ses principes fondamentaux. Car ce que Platon décrit est, pour sa plus grande part, l'Etat totalitaire des Spartiates. Lorsque l'on sait que pendant presque tout le début de la vie de Platon, Sparte était l'ennemie d'Athènes, cela nous en dit long sur la tolérance qui régnait dans cette ville, puisqu'il y eut le loisir d'exalter un tel mode de vie et de le présenter comme un modèle de perfection.
Dans son texte, Platon brode et embellit les choses, mais on ne peut s'y tromper : son modèle de base est la vie spartiate. La censure, l'interdiction du luxe, la rudesse des conditions de vie : tout est là. Même chose pour les "éphores" chargés de faire la police des lois. A Sparte, comme dans la République de Platon, les citoyens sont censés vivre, dans le moindre détail, la vie que l'Etat a décrétée pour eux. Sparte existait depuis plusieurs générations lorsque Platon s'avisa de lui offrir le brillant d'une justification intellectuelle. En pratique, ses règles étaient censées gouverner et diriger la vie des citoyens bien avant que Platon n'en eût analysé le fonctionnement et fait une théorie. La pratique était donc première, et c'est la théorie qui a suivi.
Ce qu'avait fait Platon, c'était traduire au niveau théorique la forme essentielle d'une société qui existait déjà, et qu'il trouvait à son goût. Sparte était sans doute brutale, ses citoyens frustes et mal léchés, mais on y pratiquait ce que Platon considérait comme de simples vertus, pas encore corrompues par le luxe, comme l'était Athènes, et elle gagnait les guerres. En fait, toute la société était organisée dans ce seul but. Tout ce que l'on peut considérer comme spécifiquement humain, y compris les arts, la science et la recherche intellectuelle, était subordonné à cette fin, et Platon approuvait ce choix, jugeant que le culte de la vertu devait largement suffire à satisfaire les plus hautes aspirations humaines.
Sparte existait avant que Platon n'écrive. Il ne l'a pas inventée, il n'a pas édicté ses lois. Il se contenta de les décrire et de les justifier, à quelques modifications près. La République de Platon est une rationalisation ex post de l'Etat spartiate. Il décrivit sous une forme théorique ce que les hommes avaient déjà accompli dans la pratique.
La révolution des idées... après la révolution dans les faits
Jusqu'à ce jour, on considère le Traité du gouvernement civil de John Locke comme la théorie classique des limites imposées à l'absolutisme du pouvoir. Ceux qui, avant sa publication, ne disposaient pas des arguments nécessaires pour limiter les pouvoirs d'un Etat trouvèrent dans Locke le support intellectuel qui leur faisait défaut. Locke établit une série de principes selon lesquels le pouvoir découle d'un contrat, et doit être assujetti à des bornes et à des contraintes.
Pour sa part, la défense du pouvoir souverain ne se trouvait pas non plus à court de justification théorique. Depuis les serments d'allégeance des temps féodaux jusqu'à Thomas Hobbes et la nécessité de contrôler la bête chez l'homme, en passant par le pouvoir de droit divin, toutes les rationalisations étaient à portée de main pour les gouvernants en quête de pouvoir absolu. Avec les idées de Locke, l'initiative intellectuelle passait de l'autre côté. Locke proposait des arguments soigneusement pesés et développés, déduits de principes fondamentaux qui niaient la légitimité du pouvoir absolu. Dans le système de Locke, il fallait non seulement contrôler le pouvoir, mais le diviser pour le mieux contenir. En outre, les lois devaient reconnaître sa place à la dissidence, voir à la résistance, qui auraient en d'autres temps passé pour un véritable outrage au représentant de Dieu ou pour la trahison d'un serment solennel. Après Locke, résister devint un choix justifiable en cas de rupture de ses engagements par le souverain.
Cependant, Locke était comme Platon : il décrivait dans ses principes quelque chose qui existait déjà, ne faisant que fournir un cadre intellectuel pour le justifier. La théorie du pouvoir absolu pouvait bien être la doctrine officielle sous la monarchie des Stuart, les Anglais n'avaient pas attendu les "scribouillards" pour lui régler son compte. Car la "Glorieuse Révolution" s'était déjà produite au moment où Locke écrivit son traité1. Il existait déjà une monarchie constitutionnelle, acceptant que l'on oppose des limites à son pouvoir, et dont la mise en place avait succédé au renversement d'un souverain légitime que l'on jugeait avoir abusé de ses prérogatives.
Locke ne faisait donc que rationaliser par la théorie ce que la pratique avait déjà réalisé. Les Anglais avaient réussi leur Révolution, et voilà que Locke se faisait son théoricien et porte-parole. Il fournit les concepts et les argumentaires nécessaires pour justifier ce qui était déjà achevé. En glorifiant Locke, les véritables acteurs se justifiaient eux-mêmes. Ce qui aurait pu être interprété comme l'intérêt personnel d'une classe sans légitimité particulière devenait ainsi la défense d'un grand principe, assis sur la nature morale de l'homme et les fondements de la société civile.
La réalité d'abord, les livres ensuite
Dans une large mesure l'œuvre de Locke, comme celle de Platon, s'inspirait d'actions qui avaient déjà eu lieu. Comme celui de Platon, c'est sur un modèle existant que son idéal de société était fondé2. La réalité d'abord, les livres ensuite.
La prophétie marxiste
C'est à Vladimir Ilitch Lénine que revient le mérite, si l'on peut dire, d'avoir fondé le premier Etat marxiste. Ayant pris la tête de la révolution bolchévique en Russie en 1917, on le considère généralement comme celui qui a donné son incarnation pratique à la théorie marxiste. Il donnait ainsi quelque crédit aux prétentions de Marx suivant lesquelles ses théories seraient une description scientifique du progrès humain, capables de prédire le devenir historique.
Toutefois, pour mesurer l'étendue de son pouvoir de prédiction, il n'est pas sans intérêt de rappeler quelques-uns des éléments-clés de la prophétie marxiste. Marx affirmait que l'évolution et le développement d'une société étaient déterminés par des facteurs économiques et matériels, notamment les moyens de production disponibles. "Le moulin à blé nous a donné le seigneur féodal, la machine à vapeur l'industriel capitaliste."
A l'en croire, les organisations économiques et sociales découlaient étroitement des types de production. Toutes les institutions de la société, y compris son type de gouvernement, son droit et son idéologie, dépendaient de son mode de production et toutes, au bout du compte, étaient à son service.
Les sociétés étaient censées progresser par l'intermédiaire des conflits. Des changements dans le mode de production créaient des tensions dans les institutions apparues pour s'adapter au mode de production précédent. Ces dernières étaient donc devenues inadaptées aux nouveaux procédés. Chaque étape de l'histoire portait en elle le germe de sa remplaçante. Par exemple, les usines exigeaient une concentration de la main-d'œuvre, et cette concentration engendrait la conscience et les antagonismes de classe. A chaque étape une crise violente finissait par opposer l'état précédent (en termes hégéliens, "la thèse") à son concurrent ("l'antithèse"). De ce conflit devait émerger le nouvel état ("la synthèse"), puis le cycle devait recommencer. Le cours de l'histoire devait cesser le jour où les économies auraient atteint le stade où le conflit ultime aurait conduit à une société sans classes.
Cette théorie, de sa conception à nos jours, a engendré nombre d'interprétations plus ou moins ingénieuses du passé. Ses partisans sont contraints à des déformations dignes de Procuste pour essayer de lui faire rendre compte de toutes les étapes de l'histoire humaine. Et ils y sont contraints, parce que la théorie l'exige absolument3.
Si son principe central est exact, alors l'histoire humaine suit un cours inéluctable, vers une société sans classes. Plus une économie est avancée, et plus elle est proche de ce but. Nous avons là une prédiction capitale. Marx envisageait l'histoire comme un parcours, et présumait que les sociétés avancées seraient les premières à achever le cycle de développement pour atteindre la phase finale. Une des affirmations essentielles de la théorie marxiste est que la révolution se produira d'abord dans les économies qui ont le plus progressé.
La réfutation par le succès
Or, à l'époque de Lénine, la Russie ne pouvait guère figurer au nombre des économies avancées. On n'en était encore qu'aux premiers stades de l'industrialisation, assistant tout juste à l'installation des premières usines en vue d'une production de masse, avec toutes les mutations que cela implique. Si les circonstances avaient été différentes, la Russie aurait très bien pu devenir une société libérale bourgeoise, et la monarchie absolue des Tsars laisser place à un système constitutionnel. Si cela s'était produit, elle se serait conformée, dans une large mesure, au modèle marxiste du progrès économique et social. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé.
Si Lénine avait réellement voulu appliquer la théorie marxiste, il se serait d'abord attaqué aux économies les plus avancées, s'efforçant de les amener jusqu'à la phase terminale de la révolution de classe, comme le prévoyait le modèle de Marx. S'il avait voulu réussir en Russie, il aurait été obligé soit d'attendre que le pays ait atteint une étape économique ultérieure, soit d'essayer de le pousser vers la société libérale industrialisée. Ainsi aurait-il hâté le jour où, à en croire les prédictions de Marx, tensions et conflits devaient inévitablement éclater et aboutir à la révolution finale.
Or, Lénine ne fit rien de tout cela. Ce qu'il fit contredisait totalement la théorie marxiste à laquelle il professait son allégeance. Révolutionnaire activiste, il fit tout ce qui était nécessaire pour renverser d'abord le pouvoir tsariste, et ensuite le gouvernement Kerensky afin de s'emparer du pouvoir avec ses complices. C'était un homme d'action. Au lieu d'appliquer la théorie marxiste, il déduisit de son expérience pratique qu'un groupe d'hommes restreint mais déterminé et sans scrupules, pouvait se rendre maître d'un grand pays et y conserver le pouvoir.
Il a fallu réécrire la théorie
L'histoire nous montre qu'il a réussi. Il ne s'agissait pas d'une application de la théorie de Marx ; c'était la mise en place d'une clique imposant son monopole du pouvoir. Lénine fit ce qu'il avait à faire, et réécrivit la théorie après l'événement. Ses "apports" à la théorie marxiste vont si loin qu'on l'appelle aujourd'hui "marxiste-léniniste" en son honneur. Il ne s'agit plus d'une théorie prédisant l'évolution du progrès économique et social, mais d'une théorie qui explique aux élites révolutionnaires comment s'emparer d'une société, et comment la forcer pour pérenniser la dictature exclusive du Parti.
Certes, on trouve de nombreux termes marxistes dans la nouvelle version. La "dictature du prolétariat" est toujours là, ainsi que la "société sans classes". Aucune de ces expressions familières ne suffit à camoufler la réalité nouvelle que Lénine avait créée. Avoir établi ce qui devait passer pour un Etat marxiste dans une économie relativement sous-développée imposait de modifier sérieusement la théorie du départ.
La fonction de ces amendements est d'expliquer, après les événements, pourquoi la révolution ne s'est pas d'abord produite dans les économies les plus avancées, celles dont la prophétie affirmait qu'elles étaient les plus proches de leur inéluctable destin. La théorie de "l'impérialisme" fait partie de ces explications-là. La révolution de Marx se serait d'abord produite dans les pays les plus avancés, si ceux-ci n'avaient pas constitué des empires coloniaux. L'exploitation de ces empires a suffi pour consolider le système capitaliste, en rapportant aux classes inférieures assez de satisfactions supplémentaires pour les maintenir en-deçà de leur potentiel révolutionnaire. Les travailleurs, au lieu d'"exproprier les expropriateurs", étaient en fait devenus leurs complices pour arracher aux travailleurs des colonies le produit de leur travail4.
La fonction de ce type d'explication et Lénine lui-même n'en était pas avare était de forcer la théorie à s'ajuster aux faits. Jamais on n'a appliqué la théorie pour changer les choses. Les choses ont commencé par bouger, et c'est ensuite seulement qu'on a refait la théorie pour donner à ces changements leur "superstructure" théorique et leur justification intellectuelle.
Le dernier pays au monde pour une révolution marxiste-léniniste
Si la Russie tsariste de 1917 était un candidat peu vraisemblable pour une révolution marxiste, la Chine d'après-guerre l'était encore moins. La Russie, au moins, avait atteint les premiers stades de l'industrialisation. Elle possédait déjà ses concentrations urbaines, ses ouvriers d'usine, ses dockers, son prolétariat urbain. Elle possédait le premier élément de la force qui allait porter les brandons de la révolte et élever les barricades. La Chine à qui Mao Tsé Toung5 porta la révolution était avant tout une société paysanne, caractérisée par une agriculture primitive. Elle n'avait même pas les concentrations industrielles dont Lénine avait pu tirer parti. Si l'on avait suivi à la lettre la théorie marxiste, jamais la Chine n'aurait pu engendrer la conscience de classe nécessaire pour une action collective. Elle n'était en aucune manière un candidat plausible à la révolution marxiste. En termes de développement économique, elle avait des siècles de retard par rapport aux pays avancés. Les "lois de l'histoire" avaient donc bien du chemin à parcourir avant qu'elle n'atteigne l'ère révolutionnaire.
Même d'après la théorie léniniste, la Chine n'était certainement pas le pays rêvé pour que les cadres du Parti s'emparent du pouvoir et le gardent. Il lui manquait la plupart des instruments que Lénine avait utilisés. Outre les concentrations de travailleurs en usine, qui lui faisaient défaut, sa société rurale était dépourvue de moyens de communication, et il n'y existait pas non plus de classe d'intellectuels aigris pour prendre la tête de la lutte des travailleurs.
Si Mao avait appliqué la théorie marxiste, ou même marxiste-léniniste, il aurait agi bien autrement qu'il ne l'a fait. Et, bien sûr, il aurait très certainement manqué son coup. Il partit au contraire des circonstances existantes. Il agit selon l'opportunité, adaptant sa lutte aux conditions locales. Sa guerre fut donc une guerre rurale ; les militants étaient "comme des poissons dans l'eau" dans les villages, attaquant l'ennemi là où il était faible, et se fondant dans la nature là où il était le plus fort.
Ses tactiques eurent l'effet désiré sur la Chine, en donnant la victoire à son armée. Sa révolution communiste ne pouvait correspondre ni au modèle marxiste ni au modèle léniniste. Mais elle s'adaptait très bien au modèle maoïste car, comme Lénine l'avait fait avant lui, il avait fait sa révolution, et réécrit la théorie après coup. Le communisme marxiste, qui était au départ "le-produit-inéluctable-des-économies-industrielles-avancées-à-leur-dernier-stade-de-développement", n'était plus que le procédé qui avait permis à une clique avant-gardiste de s'emparer du pouvoir sur la plus vaste société rurale du monde6.
La théorie après les faits
Dans le scénario qui se dessine à partir de ces exemples, l'action a tout l'air de précéder la théorie. Alors que l'évolution des idées était censée déterminer les événements, c'étaient en fait les événements qui s'étaient produits les premiers. Quant aux idées qui les ont rationalisés, elles sont venues après. Au moment où on l'exprimait, la théorie ne faisait que décrire une pratique ; et à dire vrai, elle n'en proposait aucune.
L'histoire de Che Guevara est particulièrement instructive, car elle marche aussi bien dans les deux sens. Après une formation de médecin, Che Guevara se lança dans la lutte avec la bande de Fidel Castro pour prendre le pouvoir à Cuba au nom des masses. L'histoire est aujourd'hui célèbre, de la poignée de partisans qui demandèrent aide et abri aux malheureux paysans opprimés des hauts plateaux, et qui virent leurs effectifs grossir face à un ennemi incapable de résister à leur tactique de coups de main.
Mais ce n'était pas une application du marxisme, du léninisme ni du maoïsme. On y voyait un groupe habilement mené, assez astucieux pour profiter des circonstances locales et pour trouver le moyen de réussir dans la société qu'il voulait soumettre et sur le terrain où il combattait. Le régime de Batista, voyant grandir la force de l'ennemi, comprit que la volonté de résistance de ses forces était sapée par son incapacité à affronter ces insaisissables agresseurs. Prenant la fuite pendant qu'il était encore temps, il laissa aux forces castristes le loisir d'imposer et de verrouiller la loi du Parti, comme en Russie et en Chine.
Guevara était l'intellectuel, le porte-parole, et aussi l'homme d'action. Il reste l'un des mythes accoucheurs de notre époque, car il représente le profond désir d'action de tous les intellectuels, ceux qui ne l'ont jamais connue et ne la connaîtront jamais. Il remue le point faible identifié par Samuel Johnson quand il disait : "Tout homme qui n'a jamais été soldat se sent quelque peu coupable."
Ce fut Guevara qui, à son tour, réécrivit la théorie pour l'adapter à ce qui s'était produit dans la réalité. Et nous voilà donc avec une version latino-américaine du marxisme, à côté de la version russe et de la chinoise. En outre, la marque latino-américaine, comme les deux précédentes, était exportable.
L'échec de la théorie préconçue
Voilà où l'histoire de Guevara devient très instructive : comme tous les véritables héros, il eut de la peine à s'installer dans la routine de la vie quotidienne. Après un bref passage au sein du gouvernement cubain, il partit pour la Bolivie, où il voulut lancer une révolution de type castriste. Mais là, au lieu d'agir comme à Cuba, il voulut appliquer la théorie. Il était en Bolivie, et ce qu'il voyait c'était Cuba. Son petit groupe alla trouver les peones dans les collines, et voulut réitérer l'expérience cubaine. Mais la société et le terrain n'étant pas les mêmes, ils exigeaient des tactiques différentes.
Si Guevara n'avait pas été obnubilé par sa théorie, fournie a posteriori pour justifier la révolution cubaine, il aurait pu discerner un ferment révolutionnaire chez les mineurs boliviens. Voilà une classe à qui l'on pouvait parler d'exploitation, et qui aurait pu gonfler les rangs de son armée. Mais il ne devait pas en être ainsi. Pour les paysans des collines, qu'il prétendait sauver et dont il attendait de l'aide, Che Guevara et sa lutte n'étaient qu'un danger de plus dans une existence déjà difficile. Ils le dénoncèrent contre récompense, et il fut exécuté par des rangers boliviens formés aux Etats-Unis.
Cela avait marché à Cuba parce que les exigences pratiques l'avaient emporté sur toute préoccupation théorique. La bande de Castro fit ce qu'elle avait à faire sans trop se soucier de ce que disait la théorie. Cette dernière fut réécrite après coup, comme c'est toujours le cas après une réussite. L'échec survint en Bolivie parce que c'était la théorie qui dominait. Au lieu de s'adapter aux circonstances et aux conditions locales, on avait voulu mettre en pratique une théorie de la lutte révolutionnaire écrite pour une société et une topographie différentes. En outre, elle avait été écrite rétrospectivement, en sachant fort bien après coup quels étaient les procédés qui avaient marché.
La théorie ? On peut toujours l'écrire quand le succès est venu
La théorie que Guevara aurait pu appliquer en Bolivie, au lieu d'en faire une transposition du modèle qui avait réussi à Cuba, est que la réussite dépend du sens de l'opportunité. Les hommes d'action saisissent le bon moment pour faire ce qui permet de réussir, dans les conditions qu'ils rencontrent. Leur réussite ne repose pas sur l'analyse, ni sur l'application d'une théorie ; elle consiste à savoir saisir les chances quand elles se présentent, à savoir tirer parti de tout événement. Bien souvent, ils apprennent au fur et à mesure, de façon empirique. Parfois leurs écarts leur sont presque fatals, voyez Castro. Le succès leur vient de ce qu'ils savent tirer les conséquences de leurs erreurs, et ne pas les refaire.
Quant à la théorie, on peut toujours l'écrire quand le succès est venu. Une fois que la situation concrète a changé, il est toujours intéressant de s'entendre raconter pourquoi et comment cela s'est produit. Parce que la théorie explique les circonstances de la réussite, qu'elle est écrite dans ce but précis, elle force l'attention des intellectuels en fournissant une rationalisation aux événements.
Le rôle de la théorie dans les événements que nous venons d'évoquer nous intéresse ici dans la mesure où son statut est vraiment mis en cause. Car la théorie est toujours celle qui, si elle avait été mise au point et connue à l'avance, aurait expliqué ce qui s'est effectivement produit. Cependant, au lieu de prédire ce qui se produira, elle fournit seulement une rationalisation ex post de ce qui s'est passé. Sa tâche se borne donc en fait à interpréter les événements une fois qu'ils se sont produits7.
Un système de rationalisations
Curieusement, il existe une version antérieure à l'approche marxiste qui permet la coexistence des hommes d'action et d'une logique des idées. G. Friedrich Wilhelm Hegel est un des penseurs qui ont le plus influencé Karl Marx. Une génération plus tôt, il avait affirmé que l'histoire humaine suivait un certain trajet vers "l'Emergence de la Raison". Il ne parlait pas de la raison humaine, mais d'une sorte de déterminisme logique qui guiderait l'évolution de l'humanité, lui faisant traverser les étapes inévitables du développement social vers une fin prédéterminée. C'est lui qui énonça la dialectique du progrès, dans laquelle du conflit de la "thèse" et de "l'antithèse" naîtrait la "synthèse" de l'étape suivante.
Marx adopta une bonne partie du système hégélien, en l'adaptant à une conclusion différente, et en y greffant une base de déterminisme économique. Alors que le système de Marx laissait bien peu de place à la volonté individuelle, Hegel avait reconnu le rôle joué dans l'histoire par les grands hommes. Dans sa version, il y avait place pour le "Personnage Historique Mondial" qui a l'honneur de faire passer à l'étape suivante de l'Histoire quand le moment est venu. Ainsi Alexandre, César et Napoléon eurent-ils tous pour fonction d'amener la phase suivante. Qu'il s'agisse de la fin des cités-Etats de la Grèce, de la République de Rome ou de l'émergence de l'Etat moderne.
La version de Hegel a l'intérêt d'être une théorie des déterminations sous-jacentes, tout en laissant à des opportunistes la possibilité de remporter des victoires en son nom pour la réécrire après coup. Hélas pour nous, elle est complètement rétrospective. Il n'y a aucun moyen de prédire quand ces "Personnages Historiques" feront leur entrée, qui ils seront, et lesquels réussiront. Ils ne seront identifiés et reconnus qu'après leur succès. En d'autres termes, la théorie de Hegel est comme celle de Marx : elle est là pour qu'on la change chaque fois qu'il s'est produit quelque chose d'important dans l'histoire. Comme celle de Marx, elle ne permet qu'une rationalisation a posteriori, après que les événements critiques se sont déjà produits.
Et si, en politique, c'était la pratique qui précède la théorie ?
L'analyse qui précède implique une conséquence très claire : c'est que les principaux progrès de la théorie politique ne se font pas avant que la pratique n'ait commencé par établir dans les faits ce qu'ils affirment en principe. Le théoricien qui semble vouloir avancer une innovation radicale est peut-être bien en train de décrire les fondements intellectuels d'un changement qui a déjà eu lieu. Dans ces conditions, ce serait la pratique qui précède la théorie. Les textes ne feraient que décrire une situation existante, même si poser des normes est ce qu'ils prétendaient faire.
Il n'y a rien d'irrationnel à faire cette suggestion. Elle est parfaitement en accord avec cette opinion respectable, suivant laquelle on en apprend plus sur le monde par une succession d'essais et d'erreurs, qu'en imaginant des formules complexes et en les mettant en application. Les formules codifient et assemblent ce qu'on vient d'apprendre. Elles unifient ce qui, sans elles, semblerait n'être que des éléments de savoir disparates et indépendants les uns des autres.
Notre connaissance des progrès de la théorie politique nous suggère qu'en la matière, le processus est comparable. Les intellectuels, qu'ils écrivent ou qu'ils pensent, donnent une forme analytique à ce que l'on sait déjà du monde réel. Mais cette conception soulève une question cruciale : si nous acceptons la primauté de la pratique sur la théorie en tant que source des innovations politiques, où cela place-t-il la lutte pour les idées ?
Si les idées théoriques sont en fait issues de changements pratiques déjà réalisés et qu'elles interprètent, alors gagner la "bataille des idées" perd de son importance en tant que moyen d'influencer les événements. Elle passe du statut de lutte pour déterminer l'avenir de la société, à celui d'une dispute pour savoir comment interpréter les changements. La bataille porte sur des explications, et non sur des projets concurrents.
Ce sont les passions ordinaires qui font agir les hommes politiques
Les événements eux-mêmes se produisent lorsque les hommes saisissent les occasions qui se présentent d'atteindre leurs objectifs. C'est seulement par la suite que la théorie vient replacer ces victoires dans le contexte d'un nouveau cadre analytique. Donner aux raisons d'agir des hommes le nom de "théorie politique" est les placer trop haut. Il peut ne s'agir de rien d'autre que des passions ordinaires qui les animent, comme la cupidité, la volonté de puissance et le goût des honneurs, voire le souci d'aider son prochain ou de construire un monde meilleur. Pour l'heure, il nous suffira de savoir que certaines personnes agissent de façon novatrice, produisant une nouvelle réalité. Ce sont les événements résultants qu'il s'agit de comprendre et d'expliquer.
Reconsidérer le rôle de l'intellectuel
L'intellectuel solitaire, qui dans son désert moral s'efforce de faire connaître l'idée nouvelle et encore inacceptable, est peut-être davantage en train de préparer une base théorique pour interpréter des événements récents, que de proposer un bond dans un avenir inconnu. Il est plus probable que les événements récents ont pris de court les explications et les interprétations existantes. Le chercheur s'en est rendu compte, et il produit une théorie inédite qui s'adapte à ces événements.
La bataille intellectuelle n'en n'est pas moins amère et la lutte, intense et implacable. Cependant la victoire, quand on la remporte dans le monde des idées, ne peut être considérée comme directement responsable des faits. La lutte dans le monde de la réalité a été menée et remportée sur le terrain de la pratique. Or, ce que les intellectuels affirmaient, s'exprimant en cela par la bouche de Keynes, est que lorsque les idées triomphent, les gouvernants leur obéissent automatiquement et sans discuter.
Il est possible que ce soit exactement l'inverse. Il n'est pas impossible que les intellectuels qui se croient vierges de toute influence, soient en réalité les esclaves inconscients de quelque homme d'action défunt. Les intellectuels qui s'imaginent entendre dans le ciel des voix qui leur dictent des idées nouvelles sont peut-être bien tout simplement en train de distiller l'expérience pratique de ceux qui ont mis leur marque sur le monde réel.
==3 Exemples démocratiques
Le modèle conventionnel pourrait être applicable à la démocratie
Il ne suffit pas d'observer qu'un grand nombre de changements politiques se produisent avant la théorie qui leur succède et les explique, pour en déduire ne serait-ce qu'une tendance générale. En effet, rien n'empêche de penser que cette succession est absente des sociétés démocratiques. On pourrait soutenir que les hommes d'action conservent l'initiative des événements lorsque l'opinion publique a peu de poids mais que, si les gouvernements ont besoin de l'assentiment populaire pour obtenir les moyens d'exercer le pouvoir, alors il leur faut remporter d'abord la bataille des idées.
Prenons par exemple Platon : il s'était fait le chantre du gouvernement oligarchique de Sparte, mais c'est en Athènes qu'il vivait, démocratie limitée, et ses idées n'y furent nullement adoptées. Idéalisant une forme d'organisation sociale déjà existante, ses écrits ne purent convaincre ses propres concitoyens de l'imiter1.
Platon s'efforça bien d'influencer une société réelle en devenant conseiller de Denys, puis de Dion de Syracuse. Cependant, dans les deux cas, c'est par une influence directe sur le tyran, et non en tentant de convaincre des citoyens, qu'il essaya de modeler la société en cause. Ses tentatives pour fonder sa République dans l'univers temporel et pas seulement dans le monde des idées échouèrent à ces deux occasions, et il s'en fallut de bien peu que Platon ne subisse le sort dévolu à Che Guevara, et qui guette ceux qui abordent la société avec une théorie préconçue.
La "Glorieuse Révolution" elle-même, qui institua la monarchie constitutionnelle britannique et à laquelle Locke fournit sa justification, n'avait pas été faite non plus par des moyens démocratiques. C'était en fait un coup d'Etat, provoqué par ceux qui craignaient les projets d'un roi catholique prétendant à un pouvoir absolu. L'opinion était divisée. En fait, on dut même inventer la fable suivant lequel Jacques 1er, ayant été contraint de fuir, avait "abdiqué", pour justifier de donner son trône à un autre ; et ce trône, Guillaume III, le monarque constitutionnel protestant, dut en outre le partager avec sa femme Mary, qui était plus proche de la lignée des Stuart. Ces deux précautions n'avaient d'autre but que de calmer les appréhensions suscitées par le coup d'Etat.
Les événements menés par Lénine, Mao et Castro eurent tous lieu dans des sociétés non démocratiques, où il n'était pas nécessaire de l'emporter dans la bataille des idées. Il fallait tout simplement conquérir le pouvoir, puis mettre en place les moyens de le garder, sans égard aucun pour l'opinion publique2.
Que se passe-t-il quand il faut compter avec l'opinion publique ?
Tous les cas précités ne concernent que des sociétés où l'opinion comptait peu. Si bien que notre formule, selon laquelle l'action précède sa rationalisation, n'est peut-être pas applicable à une société "vraiment" démocratique. Il reste donc possible de soutenir que la victoire dans la bataille des idées est une condition préalable et nécessaire du changement, chaque fois que l'opinion publique est une chose qui compte.
Voire. Quand la Constitution américaine fut adoptée, en 1789, la société avait de solides bases démocratiques, et l'opinion éclairée y comptait certainement. Or, le document qui émergea de la convention constitutionnelle n'était pas, pour sa plus grande part, un texte dont les articles auraient été les conclusions d'un débat préalable. Une bonne partie des délégués n'avaient même pas reçu le pouvoir de faire ce qu'ils firent.
Tout comme la guerre d'indépendance contre l'Angleterre avait été menée et remportée par une minorité d'Américains, ce fut une minorité qui transforma les Articles de Confédération en Constitution fédérale. Là encore, l'affaire eut bien des caractères d'un coup de force, une petite faction poussant le projet d'une Constitution fédérale pour installer aux Etats-Unis un pouvoir puissant et centralisé. Comme dans les autres cas que nous avons examinés, la théorie et sa justification ne vinrent qu'après son succès. Les Federalist Papers ne furent pas écrits pour persuader l'opinion de donner son assentiment ; ils furent écrits après les faits, et pour leur fournir une rationalisation rétrospective. A cet égard, ils entretiennent avec les événements le même rapport que le Traité du Gouvernement Civil de John Locke. Comme à l'époque de Locke, la discussion fit rage après coup, et l'on put assister à une bataille d'idées. Mais, là encore, l'enjeu était tout théorique ; il ne s'agissait que de justifier un fait accompli.
Deux expériences cruciales : Thatcher et Reagan
Deux phénomènes récents, observés dans des sociétés démocratiques, méritent une attention toute particulière. Ce sont le gouvernement de Margaret Thatcher au Royaume-Uni et celui de Ronald Reagan aux Etats-Unis. Tous deux trouvent bien leur place dans notre discussion, car chacun est censé illustrer à merveille la manière dont la victoire préalable sur le terrain idéologique aurait permis une prise de pouvoir et la mise en application d'une politique.
Trop de différences séparent la Constitution et l'organisation sociale de ces deux pays pour que l'on néglige tout ce qui sépare ces deux expériences ; mais ce qui les rassemble est par ailleurs si frappant qu'un moderne Plutarque n'aurait eu aucun mal à les dépeindre comme des "vies parallèles". La coïncidence dans le temps invite d'elle-même à la comparaison, Margaret Thatcher ayant été élue en 1979 et Reagan en 1980.
Mais il existe un autre parallèle à faire, plus fondamental et plus instructif. C'est que, dans les deux cas, nos deux impétrants avaient eu des prédécesseurs : des représentants du même parti, élus pour faire à peu près la même chose3.
===Nixon et Heath, tous deux élus dans les mêmes conditions
Il est intéressant de rappeler que Nixon et Heath avaient été élus pour faire ce pour quoi Reagan et Thatcher le furent à leur tour. La différence, c'est que ni l'un ni l'autre ne l'ont fait. Que leurs vies aient ou non été assez proches pour permettre un parallèle à la Plutarque, ni l'un ni l'autre n'appliquèrent le programme pour lequel ils avaient été choisis. Chacun d'entre eux connut quelques réussites notables, et même durables, mais on se souvient davantage de l'un et de l'autre pour leurs échecs que pour leurs succès.
Si l'on examine un peu la rhétorique de leurs campagnes électorales et les manifestes qui leur servaient de programme, on constate des ressemblances étonnantes. Nixon avait clairement pris position contre le tout-Etat ; il s'agissait de libérer les entreprises américaines des réglementations qui les paralysaient. Le fardeau de l'Etat, énormément gonflé par la "Grande Société" de Lyndon Johnson, devait être allégé. Quant à la politique étrangère, elle serait remise au service des seuls intérêts nationaux4.
Encore aujourd'hui, il est frappant de constater à quel point le discours de Nixon était à droite pendant sa campagne de 1968. On est plus surpris encore quand on examine le manifeste conservateur de Heath lors de la campagne de 1970, ou celui de Selsdon Park, qui le précédait immédiatement. On y retrouve les appels bien connus au retrait de l'Etat des affaires privées, à la dénationalisation des entreprises publiques, à la réduction des charges de l'Etat et son désengagement de l'activité productive. Au souffle de la libre entreprise, qui avait inspiré le programme de Nixon, répondait l'esprit qui dominait l'élection britannique qui suivit.
Nixon aux Etats-Unis et Heath en Grande-Bretagne furent tous deux élus sur un programme éminemment hostile au collectivisme et favorable à une plus grande liberté d'entreprise, à moins de réglementation, et à un allégement du fardeau fiscal. Nixon fut élu douze ans avant Reagan, et Heath neuf ans avant Thatcher. Toutes ces années n'avaient donc en rien été nécessaires pour convaincre les électorats américain et britannique des beautés de cette doctrine. Dans les deux pays, elle avait été plébiscitée à la première occasion.
Le fait significatif est que Nixon, aussi bien que Heath, avait gagné les élections. Les électeurs étaient suffisamment anti-étatistes et partisans de la libre entreprise pour porter au pouvoir ceux qui s'étaient réclamés de ces idées. Si une lutte idéologique avait été nécessaire pour en arriver là, elle était déjà gagnée en 1968 aux Etats-Unis et en 1970 en Grande-Bretagne.
Etant donné le programme qui les avait fait élire, la claire formulation de leurs idées et le mandat sans ambiguïté confié par leurs électeurs, la manière dont les deux gouvernements se sont conduits par la suite nécessite une sérieuse explication. Car il est de fait que ni l'un ni l'autre n'a fait ce qu'il avait promis. Tous deux, dans une certaine mesure, ont aggravé les politiques qu'ils condamnaient pendant la campagne électorale.
Nixon et Heath ont fait le contraire de ce pour quoi ils avaient été élus
Aux Etats-Unis, Nixon rajouta des entraves à la liberté des marchés, en imposant des contrôles des salaires et de prix aux étapes 1, 2 et 3 de son programme économique. Les ingérences réglementaires furent accrues tout au long de son mandat. L'activisme judiciaire des institutions étatiques, comme l'intégration raciale forcée dans les écoles imposée par le Ministère de la Justice, sous prétexte de lois sur l'"égalité des droits", se poursuivit en étant largement étendu aux villes des états du Nord. Une nouvelle institution fut même créée pour "fournir des services juridiques", c'est-à-dire en fait financer sur fonds publics un accroissement de la réglementation par voie jurisprudentielle.
La taille de l'Etat et son fardeau s'accrurent, et avec eux la pression fiscale totale. L'inflation fit passer nombre de ménages dans les tranches supérieures d'un impôt sur le revenu qui, au départ, n'était censé s'en prendre qu'aux très riches. Bien plus troublant encore, surtout pour ceux qui avaient soutenu les thèses proclamées par Nixon lors de sa campagne, on vit s'aggraver le processus qui permet à des institutions fédérales de légiférer pratiquement sans en référer au Congrès, en interprétant des lois assez vagues par des réglementations très détaillées. Individus, entreprises et sociétés se virent assaillir par une kyrielle de lois édictées par la Food and Drug Administration ou l' Occupational Health and Safety Administration, sans parler de la langue de bois pseudo-juridique qui avait accompagné l'éclosion des institutions fédérales susmentionnées.
Pendant que tout cela se produisait aux Etats-Unis, l'équivalent avait lieu en Grande-Bretagne. Le gouvernement Heath s'était engagé à réaliser de nombreuses dénationalisations. Il se débrouilla pour vendre la brasserie Carlisle, acquise par l'Etat au cours de la première guerre mondiale dans l'espoir de décourager l'alcoolisme chez les ouvriers des arsenaux ; il réussit aussi à brader une agence de voyage d'Etat. Ces dénationalisations ridicules furent largement compensées par la reprise par l'Etat du chantier naval de l' Upper Clyde, pour cause de déficit chronique, et de Rolls Royce, fabricant de moteurs d'avions.
Le gouvernement Heath imposa lui aussi ses contrôles de salaires et de prix. Réorganisant les administrations régionales, il en fit de gigantesques bureaucraties complètement coupées de la population, écartant complètement les personnalités reconnues, avec les attachements personnels qu'elles avaient su mériter. Il démolit la livre sterling par une formidable augmentation de la masse monétaire, soi-disant pour financer un "coup de fouet pour la croissance", ce qui permit à des spéculateurs de se précipiter pour amasser des fortunes de papier. L'expression "tourner casaque" fit son entrée dans le vocabulaire politique, pour désigner un gouvernement qui prenait une direction diamétralement opposée à celle qu'il avait prise au départ.
Ces échecs nécessitent une sérieuse explication
A l'évidence, la grande question est de savoir pourquoi ces deux équipes gouvernementales, qui avaient obtenu lors de leurs campagnes un soutien majoritaire pour un programme de droite limitant le pouvoir et l'influence de l'Etat, non seulement s'abstinrent d'appliquer ce programme, mais en outre firent exactement le contraire. La bataille idéologique était gagnée ; elle s'était traduite par un soutien majoritaire. Alors, pourquoi diable les événements n'ont-ils pas tout naturellement suivi cette victoire ?
Peut-on soupçonner leurs convictions ?
On a mis en avant plusieurs explications, avec des degrés de raffinement variés, pour expliquer que ces deux phénomènes se soient produits en même temps dans deux pays importants. La plus simple, est aussi la moins plausible, est la duplicité. Cette explication sous-entend que Nixon et Heath n'ont jamais cru aux idées qui les avaient fait élire, et n'avaient jamais eu la moindre intention de les mettre en application. Bien au contraire, à en croire cette interprétation, constatant que les partisans d'une non-ingérence de l'Etat et de la libre entreprise avaient gagné la lutte idéologique, ils auraient fait semblant de se rallier à ces thèses dans le but exclusif de se faire élire.
Cet argument n'est guère plausible car dans les deux cas, les chefs de gouvernement avaient essayé, au tout début, d'appliquer quelques bribes de leur programme électoral. C'est seulement plus tard qu'ils ont tourné casaque. Cette constatation nous amène également à démentir la deuxième explication, un peu plus subtile néanmoins que la première, qui consiste à dire que Nixon et Heath appartenaient indécrottablement à la classe dirigeante, dont ils ne pouvaient se défaire ni des valeurs ni des conceptions.
Tout en jouant avec la rhétorique du changement radical, ils auraient été en fait bien résolus à conserver le type de politique qu'attendait la communauté économique et financière, et avec laquelle eux-mêmes se trouvaient plus d'affinités. Cependant, cette version, même si elle est un peu plus raffinée que la première, n'explique pas vraiment pourquoi tous deux avaient commencé par prendre un certain cap, pour en changer ensuite du tout au tout. Car s'il s'agissait de "rassurer" les dirigeants financiers et économiques, n'est-ce pas plutôt au début de leur mandat qu'ils auraient dû le faire ?
===Des "poules mouillées" ?
Une troisième explication qui remporte souvent les suffrages des anciens militants frustrés dans leurs aspirations, consiste à dire qu'en fait ni l'un ni l'autre n'était assez résolu. La critique s'accompagne souvent de la conviction qu'ils auraient dû frapper plus tôt, et plus fort, dès le lendemain de leur élection. Peut-être ; mais si l'on examine la personnalité et le passé des deux hommes, tous deux révèlent bel et bien une force de caractère peu commune.
Nixon fit preuve d'une capacité de résistance considérable au cours des dix-huit mois interminables que dura l'enquête sur le Watergate, face aux agressions des médias. Un faible aurait craqué beaucoup plus vite. Quant à Heath, il a prouvé à plus d'une reprise sa force de caractère, montrant parfois une telle volonté qu'il semblait capable de ne jamais céder dans aucun domaine. Il est donc parfaitement injustifié de prétendre qu'ils manquaient de courage. Ce type d'argument est souvent utilisé par des partisans déçus de ce que le Paradis libéral ne soit pas descendu du ciel dès la première semaine de "règne" de leur candidat. On l'a également opposé, sans plus de justification, à Reagan et à Thatcher.
===La "révélation du pouvoir"
Une quatrième explication a au moins pour elle l'avantage que M. Heath, entre autres, y souscrit apparemment volontiers. Elle consiste à affirmer que les choses apparaissent sous un jour différent quand on est dans l'opposition. A l'écart du pouvoir, on peut bien avancer des idées, échafauder des projets. Cependant, l'exercice du gouvernement est lui-même un processus d'apprentissage, où les dirigeants s'aperçoivent assez vite de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. En d'autres termes, il ne faudrait pas prendre trop au sérieux les promesses faites par les dirigeants de l'opposition, car elles ne vont guère au-delà des déclarations d'intention. Une fois au pouvoir, pense-t-on, les dirigeants devront modifier leurs projets afin de se plier aux nécessités du pragmatisme.
Si l'on en croit cette interprétation, Nixon et Heath auraient eu tôt fait de constater qu'une bonne partie de leurs promesses ne pouvaient tout simplement pas être tenues. Il auraient tous les deux compris qu'à notre époque moderne, il n'était pas réaliste de penser en termes de "moins d'Etat". Avec la complexification du monde et de la société, l'Etat se devait d'acquérir davantage de prérogatives. Avec l'intensification des interactions entre pays et leur interdépendance, les Etats ne pouvaient plus se permettre de rester à l'écart des activités nationales.
A suivre ce genre de discours, nous arrivons bien vite à un univers mental où il n'est tout simplement "pas réaliste" d'attendre que des programmes conservateurs comme ceux de MM. Nixon et Heath réussissent à s'imposer dans notre monde moderne. Cette théorie était largement partagée par l'Administration de ces deux pays, et les médias de l'époque, qui se voulaient éclairés, n'étaient pas en reste. Cette explication resta la plus plausible, et sans doute la plus généralement admise, jusqu'à ce que Thatcher et Reagan fissent la preuve qu'une bonne partie des programmes de droite étaient en fait réalisables, de sorte qu'on n'avait plus d'excuses pour traiter par-dessus la jambe ce type de promesses électorales.
L'hostilité des intellectuels
Une version plus complexe de l'explication ci-dessus est que, si la bataille idéologique avait été gagnée, ce n'était pas au bon endroit. Même si les idées étaient suffisamment partagées par le peuple pour permettre à leurs partisans de remporter les élections, la bataille était loin d'être gagnée auprès des leaders d'opinion. Les efforts faits pour les mettre en application, si l'on en croit cette version des faits, se seraient heurtés à la résistance acharnée des intellectuels incrédules, dont le soutien était en fait indispensable au gouvernement.
Ainsi, même si le public et les chefs de partis étaient convaincus, la communauté intellectuelle ne l'était pas. Les politiques de droite étaient rejetées par le monde universitaire, par les hauts fonctionnaires de même que les commentateurs politiques influents dont les administrations buvaient les paroles. Même avec le peuple derrière eux, les gouvernements Heath et Nixon ne pouvaient s'opposer à ce qui passait pour l'élite de l'opinion éclairée. La bataille était encore à gagner sur ce terrain-là pour que le succès fût possible.
L'explication peut séduire parce qu'elle semble confirmée par le divorce complet qu'on pouvait observer entre le peuple, qui soutenait Nixon et Heath, et l'intelligentsia "éclairée". En Grande-Bretagne, John Braine avait pu remarquer un fabuleux contraste entre le mépris où le public cultivé de la BBC tenait les opinions du commun, et les sondages révélant le nombre de ceux qui avaient voté pour elles. Aux Etats-Unis, le vice-président Spiro Agnew fustigeait "la caste décadente du snobisme intellectuel" et les "philosophes sans c...".
===Thatcher et Reagan n'étaient pas mieux lotis
Malgré ce fondement de vérité, cette disparité entre l'opinion publique et les intellectuels ne peut être considérée comme une explication satisfaisante de l'échec de Nixon et Heath, car la situation était restée la même du temps de leurs successeurs. La communauté intellectuelle et universitaire n'était pas davantage acquise aux idées conservatrices lorsque Thatcher et Reagan furent élus. Les 364 "économistes" britanniques qui écrivirent au Times pour dénoncer la politique économique de Mme Thatcher, traduisent parfaitement l'opposition des intellectuels de l'époque à ses politiques. Aux Etats-Unis, les sondages reflétaient une différence éclatante entre la popularité phénoménale dont Reagan jouissait auprès des citoyens moyens, et le mépris tout aussi phénoménal dans lequel ses conceptions étaient tenues chez les commentateurs "évolués".
Si l'hostilité de la communauté intellectuelle avait été assez puissante pour mener Nixon et Heath à l'échec en dépit du soutien populaire dont ils jouissaient, comment se fait-il qu'elle n'ait pas suffi à arrêter Reagan et Thatcher? La lutte idéologique, qui avait été gagnée dès 1968 et 1970 auprès des citoyens ordinaires d'Angleterre et d'Amérique, ne l'était toujours pas auprès des classes intellectuelles lors des élections de 1979 et 1980.
Le modèle conventionnel n'explique pas l'échec de Nixon et de Heath
L'histoire des administrations Nixon et Heath est extrêmement révélatrice pour quiconque s'intéresse à la lutte idéologique. D'après le modèle conventionnel, si attirant, l'avènement de Reagan aux Etats-Unis et de Thatcher en Angleterre était la victoire tant attendue. Toutes ces longues années passées au sein d'une minorité méprisée avaient fini par payer ; les efforts patients, diligents, avaient finalement atteint leur but. Les idées dont on se gaussait étaient désormais devenues monnaie courante, et les dirigeants qui les partageaient avaient enfin été portés au pouvoir par un authentique mouvement populaire. Ce n'est qu'à ce moment qu'il était devenu possible d'agir.
Tout cela nous semble illustrer de façon classique la nécessité absolue de faire accepter les idées à tous les niveaux, et l'émulation que cette idée peut engendrer chez les autres ; mais cette impression est hélas démentie lorsque l'on examine les faits de plus près. En effet, si la lutte idéologique n'avait pas été gagnée au niveau populaire en 1968 et en 1970, comment Nixon et Heath avaient-ils pu se faire élire sur un programme inspiré par ces idées mêmes ? Et si la lutte n'avait pas été remportée chez les intellectuels en 1968 et 1970, en quoi la situation était-elle différente en 1979 et 1980 ?
Il manque donc à notre recette un ingrédient fondamental. Nixon et Heath sont élus avec un mandat populaire, à la barbe de l'opinion "éclairée", sur la foi d'un programme qui veut minimiser le rôle de l'Etat et promouvoir la libre entreprise ; et ce programme, ils essaient à peine de le mettre en œuvre. Dix ans plus tard environ, Reagan et Thatcher sont élus de la même façon. Leurs programmes sont semblables, mais ils réussissent à en appliquer une grande partie. S'il est impossible d'expliquer cette contradiction par des différences de personnalité ou de principes, s'il est également impossible d'invoquer ce qui était ou n'était pas réaliste à une époque donnée, alors l'explication reste à trouver.
Qu'est-ce donc que Nixon et Heath ne savaient pas ?
Pour remplir ce "trou" dans l'explication, on pourrait explorer l'hypothèse suivante : imaginons que Nixon et Heath n'aient pas eu les outils intellectuels nécessaires pour faire ce que leurs partisans attendaient d'eux. On pourrait alors supposer qu'ils étaient sincères dans leurs déclarations d'intention et dans leurs programmes et que la force de caractère ne leur a pas fait défaut, mais que ni l'un ni l'autre n'a su apprécier l'ampleur et la complexité de la tâche qu'il allait affronter.
L'opinion dominante à l'époque entretenait la supposition implicite que les changements réels se produisent automatiquement, dès lors que les idées ont changé. Nixon et Heath pensaient tous deux, sans aucun doute, que les réformes se feraient, puisque les gens les souhaitaient, et les avaient votées. Leur programme ayant obtenu l'assentiment général, ils pensaient qu'une fois au pouvoir, ils pourraient l'appliquer en faisant voter les lois nécessaires pour réaliser les changements désirés. Quand ils virent qu'il n'en n'était rien, ils conclurent que leurs idées étaient inadaptées à la réalité, et se mirent à la recherche de stratégies de rechange susceptibles, elles, de réussir.
Tous deux furent les victimes, d'une certaine manière, de notre fameuse théorie de la "bataille des idées", présumant qu'il était suffisant de recueillir l'adhésion générale à la libre entreprise et l'opposition au tout-Etat. Ils souhaitaient tous deux sérieusement rompre avec les pratiques passées et ce, dans un climat général extrêmement favorable à ce projet. Et pourtant en réalité, ni l'un ni l'autre ne savait quoi faire.
Le hiatus entre la théorie et la politique concrète
L'origine du problème est que c'est sur le terrain des généralités que la lutte idéologique se déroule. On oppose des concepts à d'autres concepts, comme le "marché libre" contre le "tout-Etat". Le débat a lieu au royaume de la théorie et de l'abstraction. On ne va chercher les faits matériels dans le domaine de l'expérience pratique que pour affermir ou attaquer des positions prises dans la théorie.
On peut, par exemple, mener des études scientifiques sérieuses pour démontrer que les résultats d'une sidérurgie d'Etat sont plus médiocres que ceux d'une sidérurgie privée. Les chiffres montreraient que l'acier produit par l'Etat coûte plus cher à produire, que le personnel y est employé de façon moins productive, que les délais de livraison n'y sont pas respectés, que le contrôle de la qualité n'y est jamais aussi bon que dans le privé. D'autres savants pourraient prouver par A plus B pourquoi il doit nécessairement en être ainsi, en mettant à jour les causes essentielles des résultats observés.
Une telle entreprise pourrait constituer un véritable argumentaire contre toute sidérurgie nationalisée. Naturellement, des travaux empiriques et théoriques avaient été réalisés en Grande-Bretagne à la fin des années soixante, contre le principe des nationalisations. Aux Etats-Unis, des travaux comparables avaient démontré les effets néfastes de la réglementation sur la production des richesses, et la destruction des activités par la concurrence déloyale des financements publics.
Toutes ces théories peuvent emporter la conviction de l'opinion publique ainsi que des dirigeants politiques, et les pousser à vouloir changer les choses ; mais elles ne leur disent en rien ce qu'il faut faire. Savoir qu'une sidérurgie étatisée est moins rentable et plus mal gérée est une chose ; savoir ce qu'il faut faire dans cette situation en est une autre.
La réponse du libéral de base est de dire : "Y'a qu'à se débarrasser de la sidérurgie d'Etat." Il ne pense pas qu'une telle tâche est difficile et complexe, qu'elle requiert la connaissance approfondie de techniques élaborées. Il vote alors pour un gouvernement qui propose de mettre fin à la nationalisation de la sidérurgie, et s'impatiente de voir les mois et les années passer sans qu'il se produise rien. Il veut savoir pourquoi, et soupçonne faiblesse et duplicité. Il décide que la prochaine fois, il votera pour quelqu'un de plus décidé, qui se lancera dans la bataille dès le premier jour et ira jusqu'au bout.
Pendant ce temps, le gouvernement qu'il a élu désespère de trouver la solution aux problèmes de la sidérurgie. Toutes les propositions semblent ne faire qu'aggraver la situation. Les chiffres des services statistiques montrent qu'il coûterait moins cher de subventionner encore la sidérurgie nationalisée, que d'assumer la charge de milliers de personnes au chômage. On met sous le nez des Ministres des scénarios-catastrophe, dans lesquels les plus grosses usines seront obligées de fermer leurs portes. On leur prédit un effet de "dominos", une cascade de faillites et de fermetures. Le gouvernement hésite, tergiverse, réexamine ses positions.
Le "passage en force"
La stratégie du sevrage brutal préconisée par les plus durs de ses partisans ne lui dit rien qui vaille. Cette stratégie affirme qu'en politique, rien d'important ne se fait sans avoir d'abord des conséquences déplaisantes qui nuisent à la popularité. Selon cette théorie, un gouvernement frais émoulu aurait intérêt à foncer dès le départ, sous le nez d'une opposition furieuse, puis à se barder contre les foudres de l'impopularité et les éventuelles violences. A la longue, les effets bénéfiques à long terme de la nouvelle liberté d'entreprendre auront eu le temps de se produire, et feront connaître au peuple la sagesse des actes de ses gouvernants ; avec un peu de chance, si le programme du gouvernement n'est pas retardé par l'opposition et les processus constitutionnels, cela arrivera avant qu'il soit temps de penser aux prochaines élections.
Ce n'est pas très équitable de la part des partisans de Nixon et de Heath, que de leur reprocher de ne pas avoir adopté une telle stratégie. Tout d'abord, il leur fallait une certaine expérience du pouvoir pour prendre la mesure du problème. Il leur a aussi fallu du temps pour comprendre qu'il leur manquait une certaine technique ; il était alors trop tard pour choisir le "passage en force". Ensuite, il faut dire que dans les sociétés démocratiques, on a mis en place des systèmes de blocage et de contrepoids aux pouvoirs séparation des fonctions, droits de l'opposition qui sont précisément censés empêcher l'utilisation d'une telle tactique.
Savoir pourquoi ne signifie pas savoir comment
Si les gouvernements Heath et Nixon ont laissé plus de souvenirs de leurs échecs que de leurs réussites, ce n'est pas faute d'avoir voulu appliquer leur programme, ni parce qu'ils manquaient de soutien populaire, mais parce qu'ils ne savaient pas comment mettre ce programme en œuvre. Ils pouvaient bien savoir que la liberté des marchés est une bonne chose, ils ne savaient pas comment l'instaurer. Ils avaient beau être persuadés que l'ingérence abusive des hommes de l'Etat est nuisible, ils ne savaient pas comment la réduire.
En somme, il faut acquérir une technique particulière pour combler la brèche entre les ambitions et les réalisations. Apprendre comment appliquer les mesures qui permettront d'atteindre des objectifs politiques n'est pas moins important que de choisir les priorités. D'après cette interprétation, si Reagan a largement réussi dans des domaines où Nixon avait échoué, n'est pas parce que l'opinion avait été convaincue entre-temps, ni que les années quatre-vingts étaient plus favorables que les années soixante-dix. C'est parce que le gouvernement Nixon ne savait pas comment faire, alors que l'équipe de Reagan, elle, le savait.
De même, de l'autre côté de l'Atlantique, les volte-faces du gouvernement Heath auraient été dues à la méconnaissance des techniques capables d'assurer la mise en œuvre de la politique souhaitée. Entre l'élection de Heath et celle de Thatcher, le climat de l'opinion n'avait pas tellement changé, pas plus dans le peuple que chez les intellectuels. Dans les années qui séparèrent ces deux législatures, aucun événement local ou international n'était intervenu qui puisse modifier les attitudes pour ou contre le centralisme autoritaire. La différence était que le gouvernement Thatcher connaissait déjà l'importance des détails. Il savait ce qu'il fallait faire, comme le gouvernement Heath, mais il avait aussi appris comment le faire.
En somme, la différence cruciale entre Nixon et Reagan, entre Heath et Thatcher, était la politique suivie elle-même. Ces gouvernements des années soixante-dix, très ouverts aux principes de l'économie de marché, furent obligés de leur tourner le dos, faute de connaître précisément les moyens de leur mise en œuvre. En revanche, le début des années quatre-vingts vit revenir au pouvoir des gouvernements bien mieux formés aux détails techniques de l'application des principes.
Cela marche, lorsqu'on s'y prend comme il faut
On vit cette différence se manifester dans la prise en compte explicite de l'importance de la technique par les équipes gouvernementales. Les premiers, se voyant incapables d'appliquer leurs programmes, étaient vite retombés dans l'ornière. Leurs successeurs, confrontés aux premiers échecs, essayèrent de nouvelles techniques pour atteindre les mêmes objectifs. A mesure que se révélaient succès et échecs, ils ne firent pas demi-tour face aux obstacles ; ils apprirent à abandonner les procédés qui s'étaient montrés inefficaces, pour adopter ceux qui marchaient le mieux.
Ce qui fait la différence entre l'échec de Nixon et de Heath et la réussite de Reagan et de Thatcher ne tient donc pas à la personnalité des protagonistes, ni à l'évolution des idées, ni aux circonstances de la période, mais à la manière d'appliquer le projet en question. Les nouvelles équipes ont systématiquement mis au point une véritable batterie de techniques politiques, techniques par ailleurs très attentives à ce qui était politiquement acceptable.
De l'avantage d'avoir échoué une fois
Il reste encore à nous demander pourquoi les premiers gouvernements conservateurs n'ont pas su découvrir les techniques qui leur auraient permis d'appliquer leurs programmes, alors que pour leur part, les gouvernants les plus récents avaient ces techniques à leur disposition. L'explication pourrait, dans une certaine mesure, tenir à une relation inverse de cause à effet. Les échecs de Nixon et de Heath auraient suscité chez leurs successeurs un refus farouche de voir se répéter le même processus. Alors, peut-être sont-ce les échecs du début des années soixante-dix qui ont conduit à développer ces techniques, celles qui devaient mener les équipes suivantes à la réussite dans les années quatre-vingts.
L'explication ne peut pas être écartée. A côté de ceux qui, constatant l'échec des premières tentatives pour instaurer un marché libre, en ont conclu que ces idées n'étaient plus valables, d'autres en auraient tiré une tout autre leçon, décidant d'essayer des méthodes différentes à la première occasion.
Il existe peut être une autre raison, liée ou non à la première. Au début des années soixante-dix, on manquait probablement aussi d'une théorie cohérente de la mise en œuvre des politiques ; peut-être pensait-on seulement que la mission des dirigeants politiques était d'"appliquer les idées". A un moment quelconque de cette décennie, sous l'aiguillon des expériences Heath et Nixon, on s'est probablement aperçu qu' il ne s'agissait pas d'appliquer des idées, mais des politiques, et qu'il existait une différence essentielle entre l'idée elle-même et la politique qui permettra sa mise en application.
En d'autres termes, on a commencé à remettre en question le principe fondamental selon lequel les idées, en elles-mêmes, auraient des conséquences. On a compris que la bataille des idées n'est qu'un élément de la démarche et qu'à elle seule, il lui manquera toujours la puissance nécessaire pour changer les choses. Entre la première tentative faite pour appliquer les idées libérales et la seconde, on a donc saisi que les idées et les politiques entretiennent une relation plus complexe et plus interactive qu'on ne le pensait. Si on ne met pas au point, dans le détail, les programmes qui leur permettront d'être mises en œuvre avec succès, les idées pourront peut-être transformer notre manière de penser, mais elles seront impuissantes à changer le monde.
4 Les professionnels du projet politique
A quoi sert un inventeur
Imaginons une société où, des savants ayant découvert des lois fondamentales de l'univers, tout le monde s'attendrait ensuite à ce que les applications pratiques de ces découvertes tombent toutes seules du ciel. On verrait donc Isaac Newton venant d'inventer la mécanique céleste et les lois de l'optique, et le public croyant qu'il suffira de diffuser ses écrits, de faire connaître ses conclusions, pour que les télescopes à miroir, ou les fusées interplanétaires, apparaissent tous seuls. Ou alors on verrait Kelvin venant de découvrir la thermodynamique, et Boyle le comportement des gaz, et tout le monde s'asseyant tranquillement en cercle pour attendre que les locomotives, automobiles et autres engins à moteur, veuillent bien descendre du firmament. Et de commenter, d'admirer, de diffuser ces découvertes, et d'attendre, attendre encore, attendre toujours en s'étonnant que rien ne vienne.
Un tel manège nous troublerait peut-être plus qu'il ne nous ferait rire, car nous le comprendrions à peine : nous savons bien que c'est à un autre type d'inventeur que nous devons tout ce qui marche aujourd'hui. C'est à James Watt que nous devons la machine à vapeur, à James Stephenson que nous devons la locomotive, comme à Isambard Kingdom Brunel le pont suspendu et le paquebot à vapeur. Je dis bien "inventeurs", parce qu'il leur a fallu non seulement comprendre les lois découvertes par ces purs savants, mais encore imaginer ce qu'on pourrait en faire de nouveau. Ils n'étaient en rien de simples exécutants. C'étaient des créateurs, tout aussi géniaux et imaginatifs que les savants eux-mêmes. Et quant à leur importance pour la société, elle n'était pas moins grande, loin de là. Pourrait-on seulement dire que nos savants seraient aussi connus aujourd'hui, si la créativité des inventeurs n'avait pas permis à leurs découvertes de transformer la vie des gens ?
Tout cela est fort connu. Et pourtant... Pourtant, c'est encore largement ce que nous faisons quand c'est la société qui est en cause. Alors que, d'Aristote à Hayek en passant par John Locke, les progrès de la science morale nous permettaient de toujours mieux comprendre comment la société fonctionne, nous n'avons pas toujours reconnu le praticien de la politique comme le créateur qu'il est forcément1.
En effet, il est un fait dont nous avons de la peine à tirer les conséquences, c'est qu'une politique doit être créée, au même titre qu'une théorie sociale. Une politique réussie n'est pas seulement la récompense d'un travail ou la contrepartie d'un risque assumé, c'est aussi le produit d'un processus d' innovation. L'homme politique peut être un grand homme, voire passer pour un génie. Mais y reconnaissons-nous un inventeur à part entière, titre que nous accorderions d'emblée au plus petit candidat du concours Lépine ?
C'est aux praticiens de changer le monde
Il est pourtant évident que les progrès réalisés au niveau théorique ne se transforment pas comme par magie en une législation qui bouleverse le monde2. Pour le faire bouger, un autre type d'activité, totalement différent, est indispensable. Il doit exister des professionnels qui sauront comment interpréter la réalité, s'assureront des faits, et décideront d'agir. Et s'il faut que la société se conforme à une nouvelle norme, il faudra que ces spécialistes de la technique politique se forment, s'organisent, étudient les situations concrètes, et se mettent à élaborer des programmes d'action.
En somme, on aura toujours besoin d'une fabrique de politiques publiques, d'un laboratoire de projets pour faire la jonction entre la réflexion et la pratique, en mettant au point des instruments capables d'agir sur la réalité.
L'enjeu, c'est de gagner ou de perdre le pouvoir
Les intellectuels, comme les politiques, qui sont passés à côté de cette nécessité essentielle ont toujours abandonné le pouvoir concret d'influencer les choses à ceux qui l'avaient plus ou moins perçue. Les intellectuels, parce que leurs discours résonnaient dans le vide ; les politiques, parce qu'ils se laissaient manoeuvrer par des adversaires ayant mieux réfléchi. Les uns et les autres, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Pourquoi est-il encore nécessaire de le souligner3 ?
Ce défaut apparaît d'autant plus regrettable lorsqu'on s'est rendu compte que le rôle de la technique dans la mise en oeuvre de la théorie sociale, politique et économique est peut être plus important que son équivalent dans les sciences naturelles4.
Le réalisme politique
En effet, l'innovateur politique est justement celui qui aura su faire bouger les choses dans son sens ; et pour cela, il lui aura fallu appréhender le réel au plus juste, en lui appliquant les interprétations les plus pertinentes. C'est donc aussi celui qui aura su adopter l'attitude la plus réaliste, c'est-à-dire la plus intellectuellement active à l'égard du réel. Celui qui aura d'abord recherché la correspondance avec le réel et qui, à la différence de l'intellectuel pur, l'aura d'autant mieux accepté avec ses "imperfections", qu'il aura compris que cette acceptation est la condition nécessaire pour le changer.
D'où la prépondérance des cas, en matière politique, où c'est le praticien qui précède le théoricien, alors que c'est généralement l'inverse en sciences de la nature5.
L'exemple des économistes
Un exemple contemporain permettra de prendre la mesure du phénomène. De tous les praticiens des sciences sociales, les économistes, du fait qu'ils s'occupent d'abord de la production et des échanges, sont ceux qui ont le plus mis l'accent sur l'autonomie des personnes et la complexité des interdépendances sociales.
Cependant, jusqu'à une période récente, ils en sont restés à une approche théorique qui ne permettait absolument pas de guider des politiques publiques. Ils n'utilisaient pas seulement une abstraction mécaniste au-delà de son domaine d'application valide6 ; ils avaient aussi une vision de l'Etat incroyablement angélique, et qui a curieusement survécu dans leurs jugements normatifs, alors qu'ils l'avaient abandonnée dans leurs études descriptives.
Ainsi, alors qu'ils décrivaient déjà les décisions publiques de façon réaliste, comme le résultat d'interactions entre des décisions personnelles largement intéressées, on a encore vu les économistes demander pendant des années aux hommes de l'Etat de se conduire d'une manière dont ils avaient eux-mêmes démontré qu'elle était intenable dans ce cadre institutionnel.
Le résultat de cette contradiction était que dans les faits, ils abandonnaient le soin d'élaborer les politiques publiques aux fonctionnaires, qui n'ont jamais utilisé de la théorie économique que les abstractions dont ils pouvaient se servir pour rationaliser l'extension de leur pouvoir.
Les économistes n'étaient pas en faute : c'étaient leurs recherches elles-mêmes qui les avaient conduits dans cette impasse. Toujours soucieux de réduire les gaspillages, ils ne pouvaient que recommander une certaine politique, alors qu'en étudiant les processus de la décision publique, ils avaient dû admettre que les institutions représentatives poussent en permanence vers la politique inverse. Comme nous le verrons, ce sont les praticiens qui ont résolu le dilemme, parce que la nécessité leur a donné l'idée de tirer parti de l'analyse économique des choix publics pour concevoir leurs projets de réforme7.
Thatcher et Reagan avaient des projets tout prêts
La manière dont la Grande-Bretagne et les Etats-Unis8 sont sortis de cette ornière vaut la peine d'être décrite. Si les gouvernements Thatcher et Reagan se sont distingués de leurs prédécesseurs, ce n'était pas, nous l'avons vu, parce que leurs idées étaient mieux reçues, ni parce qu'ils avaient plus mauvais caractère. C'est parce que les équipes de l'un et de l'autre avaient déjà préparé toute une série de propositions pratiques destinées à vaincre certains des obstacles rencontrés par leurs prédécesseurs.
Une réaction de bon sens
La chose s'était faite pour des raisons pratiques : Nixon et Heath s'étaient heurtés à des difficultés insurmontables pour faire passer des propositions qui leur tenaient à coeur, comme la baisse des impôts ou la dénationalisation. A cette occasion, leurs partisans s'étaient aperçus qu'il ne suffisait pas qu'une politique fût bonne, ni approuvée par la majorité, pour l'emporter dans le processus politique.
Ils reconnurent que la société politique était plus complexe que ne l'impliquaient les conceptions officielles de la démocratie, et qu'un projet de réforme rencontrerait toujours des oppositions concrètes bien différentes de ce qu'avaient prévu les institutions. Ces oppositions, il fallait les imaginer à l'avance et concevoir des démarches capables de les neutraliser, si l'on voulait disposer à temps d'une réforme susceptible d'être adoptée.
Raccourcir les délais
L'une des premières raisons de cette nouvelle activité de recherche était la longueur des délais que l'on avait observés entre l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement et la présentation de ses projets de réforme. Le processus pouvait très bien prendre une année entière, plus une année encore pour venir à bout des atermoiements et de l'obstruction des fonctionnaires. Au moment où la législation était enfin prête pour l'application, le mandat du dirigeant touchait à sa fin, et le gouvernement en place rechignait à prendre des risques en adoptant des politiques controversées.
Il s'agissait donc, pour raccourcir tout cela, de mettre au point des politiques clés en mains, de sorte qu'un nouveau gouvernement puisse immédiatement les mettre en oeuvre. On pensait que les plus dures batailles auraient lieu dès le départ, et que le gouvernement devait avoir assez de munitions pour les affronter victorieusement.
Une source de renseignements indépendante et fiable
Une autre idée qui suscita cette recherche pratique fut le souci de mettre fin au monopole virtuel de la connaissance pratique qu'on avait abandonné dans les faits au corps des fonctionnaires. En effet, s'il était toujours possible de se fournir en-dehors des administrations pour ce qui est des idées générales, ce n'était qu'en leur sein qu'on pouvait trouver la connaissance des dossiers et l'expérience nécessaires pour réaliser les réformes. Cette exclusivité avait pour conséquence que les conceptions de l'Administration s'imposaient à tout coup. Le Ministre le plus volontaire, le plus convaincu de ce qu'il fallait faire, se retrouvait isolé en face d'une phalange homogène de professionnels qui prétendaient tous que c'était impossible.
Pour échapper à cette emprise, il était nécessaire que des groupes de recherches indépendants s'emploient à élaborer concrètement les politiques elles-mêmes. En s'y prenant à l'avance et en faisant appel à des experts, ils purent enfin offrir aux Ministres une autre source d'inspiration et d'initiative, lui permettant de passer outre le veto de fait dont disposaient ses subordonnés présumés.
Des alternatives réalistes
Fort lié au précédent, le troisième objectif de cette recherche plus concrète était de franchir la barrière de la crédibilité. Rien de plus facile en effet, que de rejeter un principe seul comme "abstrait", "dogmatique" ou "simpliste", qualificatifs fort utiles à qui est à court d'arguments. En revanche, un programme de réformes concrètes force ses adversaires mêmes à l'examiner plus attentivement. Une fois que l'on a présenté des projets détaillés, avec des procédures capables de les mettre en œuvre, il devient virtuellement impossible de prétendre que certaines mesures sont irréalisables. Ainsi les Ministres, qu'on aurait pu persuader que le paradigme en vigueur était seul valable, se sont vu offrir des alternatives réalistes qui permettaient de prouver le contraire. De sorte que le détail de la mise en œuvre donnait toute sa crédibilité à l'idée directrice elle-même.
Découvrir ce qui marche
L'un des principes essentiels compris par les promoteurs de cette nouvelle démarche était qu' il y a des manières de procéder qui ont plus de chances de réussir que d'autres. Une réflexion systématique, pensaient-ils, permettrait sûrement de découvrir lesquelles. Ayant abandonné l'idée que la victoire électorale serait suffisante pour garantir le succès, ils se mirent à la recherche de méthodes susceptibles de réussir. Il mobilisèrent pour cela toute la connaissance théorique disponible sur les politiques publiques, et imaginèrent des programmes spécifiques pour neutraliser les obstacles qui se allaient se présenter.
Cette approche expérimentale conduisait tout naturellement à mettre plusieurs propositions pratiques en concurrence entre elles, et nos chercheurs en politiques publiques se mirent donc à tester des scénarios hypothétiques, essayant de découvrir à l'avance quelles propositions seraient le mieux acceptées, et lesquelles s'aliéneraient l'opinion. Ils purent ainsi ajuster le tir et affiner les détails.
Ainsi vit-on, au cours de la décennie, apparaître toute une série de propositions concrètes, qui tranchaient avec les défenses et illustrations de la libre entreprise qui, dans les années soixante, s'en étaient tenues aux seuls principes généraux.
Les professionnels du projet politique
Nous voyons donc enfin quel tournant stratégique fut à l'origine de l'innovation politique la plus importante des années quatre-vingts. Des groupes, des associations et des instituts continuaient à convertir les incrédules au marché libre, à ouvrir les yeux de ceux qui nourrissaient encore quelque illusion sur le collectivisme.
Mais à côté, il y avait de véritables mutants. Des idéologues, mais qui manifestaient un intérêt jamais vu pour les détails de la politique elle-même. Des praticiens, mais qui jonglaient aussi bien avec les théories qu'avec les situations concrètes, et qui fascinaient par leur capacité d'illuminer la compréhension des unes par les détails des autres : c'étaient les nouveaux chercheurs en politiques publiques. Et ces gens attiraient aussi bien par leur optimisme, imperturbable et communicatif, que par cette impression qu'ils donnaient d'avoir découvert un secret passionnant avec la certitude de ne pas échouer. Armés des dernières découvertes de l'économie théorique, ils avaient commencé à examiner dans le détail comment les politiques proposées pourraient fonctionner ; ils apprenaient à les affiner et à les polir pour leur donner les plus grandes chances de succès.
Aux Etats-Unis comme en Grande-Bretagne, on vit donc apparaître des instituts ayant pignon sur rue [9], et dont la fonction n'était plus de plaider pour la libre entreprise, mais de chercher, et de mettre au point dans le détail, les politiques concrètes qui la réaliseraient vraiment dans tous les domaines de l'activité publique.
Ce sont eux qui ont fait la différence entre les années soixante-dix et les années quatre-vingts.
===La véritable innovation politique des années quatre-vingts
Car il semble bien, avec l'avantage du recul, que ce soient les détails de la mise en œuvre qui ont été déterminants. Il est exact que Reagan et Thatcher donnaient à leurs partisans l'impression d'être plus déterminés et plus réalistes que leurs prédécesseurs ; mais cela est dû en grande partie à ce qu'ils ne furent pas, pour leur part, obligés d'abandonner leurs projets, voire de faire machine arrière. C'est l'accumulation des succès qui a conduit Reagan et Thatcher à tenir leurs engagements initiaux dans une mesure que leurs prédécesseurs n'avaient pas connue.
Ce n'est donc pas parce que les chefs étaient plus énergiques que les politiques ont pu s'imposer. C'est parce que les nouveaux professionnels du projet politique avaient su leur donner ce dont ils avaient besoin : des politiques réalistes capables de réussir, que l'on pouvait réutiliser et développer, et qui leur permit d'acquérir cette image de personnages plus solides.
DEUXIEME PARTIE : LE SECTEUR PUBLIC
La théorie des choix publics
L'école de Virginie
En 1986, le prix Nobel d'économie fut décerné à l'américain James Buchanan. Depuis des années, avec le professeur Gordon Tullock et bien d'autres1, le Professeur Buchanan travaillait à mettre sur pied la théorie des "choix publics". D'abord installés au Virginia Polytechnic Institute puis, plus récemment, à l'Université George Mason en Virginie, ces théoriciens du secteur public ont publié une masse impressionnante de monographies, d'articles de recherche et d'articles dans des revues d'économie. Le thème constant commun à tous leurs travaux était que, dans la vie politique, les hommes ne se conduisent pas très différemment de la vie économique.
La nouvelle économie politique
Les années soixante-dix ont permis d'assister à la montée en puissance de plusieurs écoles de théorie économique, non sans rapport les unes avec les autres, et qui réfutaient les thèmes centraux du système keynésien, lequel commençait d'ailleurs à être sérieusement discrédité par la pratique.
Il y avait, tout d'abord, un retour à la respectabilité pour l'économie de marché en général, et une renaissance des idées néo-classiques. La montée de l'école "monétariste" de Chicago avec Milton Friedman, se poursuivit imperturbablement pendant une décennie, mettant l'accent sur la relation qui existe entre la hausse des prix et la création de monnaie par les hommes de l'Etat. Friedman, lui-même prix Nobel en 1976, était un critique précis et éloquent de l'interventionnisme économique d'Etat.
Moins spectaculaire fut l'émergence progressive de l'Ecole "autrichienne" d'économie2, dont le représentant moderne le plus connu, Friedrich A. Hayek, avait reçu le prix Nobel en 1974. Cette école mettait l'accent sur l'économie non plus en tant que succession d' équilibres, mais en tant que processus, principalement menés par les pensées et les actes de personnes singulières. Un des traits caractéristiques de l'économie autrichienne est son rejet de la macro-économie et sa concentration sur le fait que la réalité économique consiste toujours en des actions particulières et localisées.
D'autres écoles, et leurs rejetons, ont introduit de nouveaux concepts dans l'analyse économique. Les "anticipations rationnelles"3 furent un temps à la mode ; entre-temps, la sacro-sainte "courbe de Phillips" sombrait dans les marécages de la "stagflation", à mesure que les différents pays s'arrangeaient pour cumuler chômage et inflation élevés, alors que d'après cette courbe, on n'avait jamais à choisir qu'entre l'un et l'autre.
Une révolution scientifique
Cette époque était, et elle est peut-être encore, caractéristique d'une révolution scientifique à la Kuhn. Le paradigme dominant s'était effondré sous le poids de ses anomalies et contradictions, et les intellectuels cherchaient quelque chose pour remplacer le consensus keynésien. Pour Kuhn, ces périodes sont les plus favorables à la créativité. Ce fut certainement le cas en économie politique.
"Science économique" et économie politique
Dans ce bouillonnement intellectuel, l'école des choix publics montait lentement en puissance, à mesure que la qualité de ses travaux et la cohérence de sa pensée venaient à être reconnues. Ceux-ci ne furent jamais vraiment populaires et, avec tout le respect qu'ils inspiraient, on les tenait pour marginaux par rapport aux autres progrès de la discipline. Il y a une raison à cela : c'est que la théorie des choix publics n'est pas fondamentalement une théorie de l' économie, mais de la politique. Elle serait tout à fait à sa place dans les études d'"économie politique" à l'ancienne, mais elle est mal à l'aise dans des classes de "sciences économiques" modernes. Elle applique la théorie économique aux décisions dites "publiques" et montre comment on peut se servir de certains principes économiques pour expliquer et interpréter les choix faits dans l'arène politique.
La politique et l'économie sont officiellement distinctes. C'est-à-dire que, pour la plupart des chercheurs, les deux disciplines sont censées concerner des domaines d'activité essentiellement différents. Quand on fait de l'économie, on fait une chose. Quand on fait de la politique, on est censé en faire une autre. Or, les théoriciens des choix publics ont su rappeler que ces deux activités ont bien davantage de points communs, et notamment que les gens, en politique, ne sont pas autres qu'ils ne sont dans l'économie.
Dans l'"économie", les gens agissent au service de leurs objectifs propres. Conformément à leur propre échelle de valeurs, ils renoncent à certains avantages pour en obtenir d'autres. Ils peuvent par exemple échanger du temps de loisir, qui a de la valeur pour eux, contre un revenu supplémentaire, auquel ils donnent une plus grande valeur à cette occasion. Ils achètent et vendent sur les marchés. Les entrepreneurs s'affairent sur la scène, qui établissent le contact entre investisseurs et producteurs, acheteurs et vendeurs. L'information a son prix : on l'achète et on la vend. La rareté augmente la valeur, de même que la proximité de temps et de lieu. Quand un grand nombre de personnes veulent des marchandises dont la quantité est limitée, les prix grimpent en conséquence.
Cet univers est familier ; il a donné naissance à d'innombrables travaux qui s'efforçaient d'expliquer ses régularités apparentes, et de parvenir à une construction intellectuelle capable d'apporter une cohérence à ce qui paraissait au départ être un chaos aléatoire. Pour ce qui est de la politique, elle relevait d'un autre type de recherche, les penseurs la tenant pour une activité totalement différente. Dans sa version moderne, elle repose sur le postulat que les "décideurs publics" agissent dans un cadre "collectif", devant rivaliser entre eux pour obtenir l'assentiment de "la majorité". Les décisions sont prises périodiquement à l'occasion des élections, et les minorités s'inclinent devant la volonté majoritaire, sauf dans les domaines protégés par la Constitution.
===L'action humaine présente partout les mêmes traits fondamentaux
Un des apports fondamentaux l'école des choix publics a justement été de faire comprendre qu'en réalité, l'action politique a beaucoup de traits communs avec l'activité économique. Là aussi, les gens cherchent à réaliser leurs propres projets, en quoi qu'ils puissent consister. Ils n'y subordonnent pas moins leurs décisions aux objectifs qu'ils ont choisis, et n'y sont pas moins forcés de faire des arbitrages. Plutôt que des décisions majoritaires prises par intermittence à chaque élection, ce que nous avons en réalité, c'est une succession incessante de soutiens accordés ou retirés, c'est-à-dire de décisions personnelles, faites par des gens qui intriguent pour influencer le processus politique.
===Il y a un marché dès lors que les personnes choisissent de coopérer
Les théoriciens des choix publics ont établi qu'il existe une sorte de marché pour les suffrages, avec des lois assez comparables : quand les suffrages se font plus rares, ils comptent davantage et se vendent plus cher. Quand certains ont vraiment beaucoup plus de valeur que les autres, eh bien ils s'achètent vraiment beaucoup plus cher. Bref, le soutien politique a une valeur économique variable, et s'échange comme tel. Il est pratiquement inopérant de se borner à dire que "la majorité domine la minorité". Dans la réalité, il n'y a au départ que des minorités, et toutes négocient leur soutien en échange d'une contrepartie acceptable. Peut-être ne s'en rendent-ils pas compte, mais en soutenant qui leur a fait certaines promesses, les gens "vendent" en quelque sorte leur suffrage en échange d'autre chose et celui-ci a donc, nécessairement et qu'on le veuille ou non, une valeur économique. Et s'ils le font, cela veut dire que pour eux, ce qu'ils ont reçu en échange vaut encore davantage. Il y a donc réellement un marché des influences politiques et, du point de vue de la valeur et de l'échange, rien n'empêche d'utiliser les mêmes outils d'analyse que pour le marché de la production.
Une description réaliste de la décision politique
Tout ceci vous paraît peut-être encore bien abstrait, voire tiré par les cheveux. Cela ressemble davantage à une interprétation particulière du comportement politique qu'à une véritable contribution à l'analyse des faits. Et pourtant, l'expérience a justifié cette approche, car elle peut prédire le comportement des groupes dans le processus politique bien plus exactement que n'importe lequel des modèles conventionnels. Nous allons voir que si l'on tient pour acquis que les principes économiques décrivent des lois universelles de l'action humaine et s'appliquent donc également à l'activité politique, on peut obtenir une image bien plus réaliste de la vie politique qu'en y plaquant l'image traditionnelle d'une suite de décisions prises "en commun".
La dictature des groupes de pression
Loin que ce soient les minorités qui cèdent toujours à la volonté majoritaire, la théorie des choix publics nous explique pourquoi, le plus souvent, c'est bien le contraire qui se produit, les minorités dans leur ensemble obtenant ce qu'elles veulent aux dépens des majorités. La fermeture d'une usine en difficulté a beau ne mettre en jeu qu'un petit nombre de suffrages, pour ces électeurs-là, l'enjeu est primordial. Leurs représentants sont prêts à payer très cher pour obtenir une aide dans des circonstances aussi graves. Ils donneront alors leur soutien pour obtenir en échange celui des autres. C'est ainsi que l'on réunit des coalitions, qui s'arrangent pour donner gain de cause à l'ensemble des groupes de pression minoritaires sur les sujets qui leur tiennent à cœur, même si tout cela se fait au détriment du bien de tous.
Aider ou subventionner une minorité lui rapporte beaucoup, mais coûte peu aux autres. Pour chaque enjeu, par conséquent, les bénéficiaires potentiels sont prêts, pour défendre leur cause, à payer un prix plus élevé que ceux qui finiront par en supporter la charge : la chose a bien plus d'importance pour les premiers que pour les seconds. La réalité politique ne se fonde donc pas sur les bonnes ou mauvaises raisons de faire ceci ou cela, mais sur l'addition des suffrages négociés. Les gens agissent pour optimiser les avantages qu'ils retirent du système, exactement comme dans les échanges productifs. La récompense n'est d'ailleurs pas nécessairement matérielle ; il suffit qu'elle consiste en quelque chose d'important pour eux.
De quoi est faite une "majorité"
Appliquant cette conclusion fondamentale à l'étude des faits, la théorie des choix publics redécompose en leurs éléments constitutifs les coalitions majoritaires que nous voyons à l'œuvre. Elle montre comment elles ont été formées à partir des groupes, qui renoncent à ce qui leur importe le moins pour obtenir ce qui compte davantage à leurs yeux. Elle montre comment, sur un sujet donné, les minorités échangent leurs suffrages avec les autres dans un réseau de contrats à plus ou moins long terme qui, à bien des égards, ont le goût et la couleur du marché et de l'entreprise.
On constate que certains termes, d'ailleurs familiers des connaisseurs du Congrès des Etats-Unis, tels que le marchandage, l'"échange de bons procédés" ou le "renvoi d'ascenseur", s'appliquent également aux groupements politiques, tout comme aux élus. Chaque élection offre des "paquets" de mesures, des ensembles de décisions politiques à prendre en bloc ou à laisser ; une bonne partie de l'activité politique consiste à définir ces "paquets", dont on rendra les avantages les plus voyants possibles pour le plus grand nombre des électeurs, et dont on occultera les inconvénients. Notons que cette activité ne cesse nullement en-dehors des périodes électorales.
Même entre deux élections, les groupes échangent le suffrage les uns des autres, soutenant certains projets, s'abstenant pour d'autres, en combattant certains. Parfois, l'opposition est suffisamment puissante pour valoir la peine d'être achetée. Ces marchandages sont présentés comme une part importante de la réalité politique, ce qui permet de la comprendre bien mieux que si l'on se contentait des interprétations plus simples, qui mentionnent plus volontiers la "rationalité publique" que des échanges quasi-marchands.
Les vrais intérêts au pouvoir
La théorie des choix publics, et nous en verrons maints exemples, s'est avérée un outil extraordinairement efficace pour prévoir le comportement des différents groupes d'acteurs du secteur public, ainsi que les résultats de leur interaction. Elle envisage notamment toujours les fonctionnaires, non comme de purs esprits qui appliqueraient impartialement les décisions des élus, mais comme une ou plusieurs associations de personnes bien concrètes, et qui ont pour ou contre ces mesures des intérêts puissants et identifiables.
On se rend bien compte que les gens en place dans les entreprises nationalisées ou les "services publics" forment des groupes suffisamment bien placés pour influencer fortement la quantité et la qualité des productions, et qu'ils se soucient énormément du niveau de leur financement. Ceux qui gèrent les services administratifs trouvent un enjeu considérable dans la taille de l'organisation, ses effectifs et l'étendue de ses activités.
Même les parlementaires cessent de n'être que des représentants élus au service du public. Ils sont, eux aussi, un groupe d'intérêts particulier, avec ses priorités propres et ses avantages à conquérir. Les activités qui apportent aux parlementaires une popularité visible auprès de groupes d'électeurs, par exemple, sont plus intéressantes pour eux que des actions qui ne leur rapportent rien, quand bien même ces dernières seraient plus méritoires.
L'intérêt des chefs syndicalistes du secteur public n'a rien à voir avec la production du meilleur "service public" possible au coût le plus bas. Il est d'obtenir le plus d'influence possible, ce qui implique généralement de maximiser le nombre de leurs adhérents. C'est bien ainsi qu'il faut interpréter la "défense du service public" qu'ils ont sans cesse à la bouche, alors qu'il est évident que le service du public en pâtira plus souvent qu'à son tour.
Les incitations perverses de la décision publique
En conséquence, une fois l'électorat décomposé en groupes d'intérêts dont chacun poursuit des objectifs propres, on s'explique bien mieux certaines caractéristiques de la fourniture des "services publics" dans les sociétés démocratiques, qu'il s'agisse de produire des objets ou des services. Dans un tel cadre, entre autres, chacun a normalement intérêt à développer au maximum sa propre consommation des produits financés collectivement. Des électeurs peuvent faire pression sur le système politique pour accroître la quantité des services rendus, les bénéficiaires constituant un groupe de pression bien plus visible et plus puissant que la masse des contribuables qui paiera la facture. La tendance des sociétés démocratiques à développer les financements "publics" en excès peut alors se comprendre à partir des rapports de forces internes au système.
Le "piège du financement public"
Un exemple de ce piège du financement "public" : imaginons que dans un village, il y ait dix personnes qui veulent que la route qui passe devant chez elles soit mieux entretenue. Dix personnes, ce n'est pas un groupe politique bien puissant, mais il doit en exister d'autres qui aimeraient bien, elles aussi, avoir de meilleures chaussées dans leur propre quartier. Elles constituent donc un bon point de départ pour coaliser ceux qui voudraient un meilleur entretien de leur route et sont prêts pour cela à réclamer un financement accru des voies publiques en général. Les politiciens peuvent alors négocier l'appui de ce groupe s'ils s'engagent à améliorer la voirie. Même ceux dont les routes n'ont besoin d'aucune amélioration ne s'opposeront pas très fortement au principe des travaux, car les coûts tels qu'ils les perçoivent ne leur paraîtront généralement pas assez élevés pour qu'ils s'y opposent effectivement. L'effet cumulatif de cette agitation pourra bien être un niveau d'investissement routier plus élevé qu'il n'est réellement nécessaire, et sans aucun doute plus coûteux que ce que les gens débourseraient si le paiement était direct et non collectivisé.
Entrepreneurs et projets politiques
Le principe général de la théorie des choix publics est d'étudier l'activité politique comme une activité économique, y reconnaissant les mêmes lois. Dans un tel contexte, il est très fécond d'envisager les groupements politiques comme des entreprises, travaillant dans un milieu économique. Si l'on tient pour acquis que chacun s'efforce de maximiser son propre avantage (de quoi qu'il puisse s'agir) dans le cadre des règles en vigueur, on dispose d'un outil de prédiction extrêmement efficace. Comme des entrepreneurs, ces groupes guettent les occasions, essaient de pousser leurs avantages, rivalisent pour des parts de marché, et cherchent toujours à réduire les efforts et sacrifices nécessaires pour obtenir un résultat donné.
Tout comme les sociétés commerciales luttent entre elles pour conquérir leurs parts de marché, les bureaucrates des différents ministères sont en concurrence pour l'attribution des crédits. De même, les jeux de pouvoir auxquels on assiste au sein des entreprises, où l'on voit les cadres supérieurs se battre pour leur avancement et leur prestige, ne sont que le pendant ce que l'on peut observer dans les administrations, où les chefs et sous-chefs de service intriguent pour obtenir de l'avancement. Une étude des administrations publiques qui ne se soucierait que des objectifs politiques proclamés et des opinions affichées à leur égard, passerait à côté d'un facteur essentiel, l'implication personnelle dans les décisions de personnes dont la vie et la carrière en dépendent de fait.
Si la manière dont les entreprises poursuivent leurs objectifs exerce un impact capital sur les résultats généraux de l'économie, le comportement des entrepreneurs politiques ne le leur cède en rien : son rôle est véritablement déterminant sur les résultats observés. Les fonctionnaires peuvent favoriser ou freiner l'action du gouvernement. Ils peuvent même la saboter, pour peu qu'elle menace l'un ou l'autre de leurs intérêts vitaux. Les agents du secteur public peuvent menacer de grève ceux qui font la loi — ou la faire — pour faire pression sur eux. Or, la complainte d'une population privée de services essentiels est une des élégies auxquelles les politiciens sont les plus sensibles, car la popularité est leur fonds de commerce.
Les chefs syndicalistes peuvent brandir la menace de l'hostilité de leurs membres pour obtenir le plus possible d'emplois et les meilleures conditions de travail pour leurs affiliés. Certaines fractions de la population, lorsqu'elles cherchent à obtenir des avantages particuliers précis, peuvent organiser des protestations pour peser sur les décisions législatives, et manifester pour entraîner les médias à leur suite.
On ne peut se permettre d'ignorer ces contraintes
Les dirigeants politiques qui veulent se faire réélire doivent guetter tous les signes indiquant que leur action, ou leur inaction, face à certains problèmes, attirera sur eux la colère de l'électorat. A leur tour, ils feront pression sur l'exécutif, et influenceront sa résolution à poursuivre ou abandonner certains éléments de son programme, ou encore à entreprendre de nouvelles initiatives.
Toutes ces pressions sur le système politique sont parfaitement réelles. La volonté des gouvernements, quant à elle, n'est qu'un frêle roseau. Le gouvernement annoncera un programme dans sa plate-forme électorale et entreprendra de le réaliser, mais il n'a pas le choix de tenir compte ou non des pressions qui s'exerceront sur lui. Une bonne partie de l'art de gouverner consiste peut-être justement à savoir ce qu'il est possible de faire, et à percevoir les moments où la résistance est trop forte pour que l'entreprise réussisse. Après tout, n'a-t-on pas dit que la politique est l'"art du possible"4 ?
Un excellent moyen d'explication
L'idée que la politique est un lieu d'échanges est donc un excellent outil de recherche. Comme bien des théories économiques explicatives, elle donne les meilleurs résultats lorsqu'on s'en sert pour interpréter les événements passés. Grâce à elle, nombre d'événements trouvent bientôt leur explication. Nous pouvons commencer à comprendre pourquoi certains programmes politiques ont échoué, alors que d'autres réussissaient. Bien souvent, cela se résume au fait que les groupes qui devaient en profiter n'y voyaient pas un grand avantage, alors que les perdants potentiels risquaient de perdre gros, ce qui les disposait à sacrifier beaucoup pour leur faire barrage5.
Entre autres, la théorie des choix publics nous permet de comprendre ce qui, autrement, ne serait qu'un fait étrange, un mystère irrésolu : que ce sont les minorités qui l'emportent sur les majorités. Dans le paradigme politique conventionnel, on s'attendrait au contraire à ce que la majorité impose ses intérêts propres, aux dépens des minorités. Or, avec le modèle des choix publics, on se rend compte que, pour donner un privilège à une majorité, il faut prendre bien davantage à la minorité. En termes plus crus, si l'on veut donner un franc à tous les membres de la majorité, il faut prendre bien plus d'un franc à chacun des membres de la minorité. Et ladite minorité en couinera d'autant plus fort. A l'inverse, pour favoriser la minorité, il n'est pas nécessaire de prendre autant à la majorité. Quand le grand nombre entretient le petit, le petit nombre reçoit beaucoup alors que le grand ne donne que peu chacun. Les reproches de la majorité sont faibles, forte est la reconnaissance de la minorité.
Ce processus explique pourquoi, alors que depuis un siècle la proportion des agriculteurs dans la population a considérablement diminué, les hommes de l'Etat leur distribuent des monceaux de subventions. Dans tous les pays avancés, les agriculteurs sont aujourd'hui une petite minorité, et ils reçoivent de gigantesques subsides aux frais des contribuables citadins, lesquels sont bien plus nombreux6. En revanche, dans les économies moins avancées où l'agriculture emploie encore une majorité de la population, il est caractéristique que ce soient les agriculteurs qui sont taxés, ou forcés de vendre leurs produits à des prix artificiellement bas, pour permettre aux minorités citadines de vivre sur leur dos. A mesure que le nombre des agriculteurs baisse, leur capacité à pétitionner augmente de façon manifeste.
Ce cas illustre bien cette conclusion générale de la théorie des choix publics, qu'il est plus facile de satisfaire des minorités que des majorités. Cela coûte moins cher, et les minorités donnent assez de valeur à ce privilège pour que les législateurs y trouvent leur avantage.
Ce qui donne du poids à une minorité
Cependant, toutes les minorités ne pèsent pas du même poids, et ce n'est pas non plus le nombre de leurs membres qui constitue leur élément le plus important. Logiquement, pour la théorie des choix publics, la valeur qu'elles attribuent à un avantage les dispose à payer à due concurrence pour l'obtenir. Un groupe, même d'effectif réduit, peut donner tellement d'importance à ses objectifs qu'il sera prêt à payer cher pour les atteindre ; c'est-à-dire qu'il peut être prêt à offrir un soutien puissant aux alliés potentiels qui l'aideront à obtenir satisfaction.
Pour être efficace, une minorité doit être visible. Dans certains cas, une minorité a énormément à tirer d'une certaine décision, mais elle est incapable de l'influencer parce qu'elle ne constitue pas un groupe suffisamment spectaculaire pour pouvoir offrir en échange un soutien appréciable. Par exemple, si une école est menacée de fermeture, les parents d'élèves constitueront un groupe très visible. Ils pourront se réunir, protester, écrire à leur député, organiser des manifestations de rue, passer à la télévision. En revanche, lorsqu'il s'agit d'ouvrir une nouvelle école, le groupe des futurs parents d'élèves qui pourraient vouloir qu'elle ouvre sera moins spectaculaire et aura moins de poids politique, parce que son soutien est plus difficile à échanger.
Un autre facteur qui donne de l'importance aux groupes minoritaires est leur capacité de nuire. Peut-être y a-t-il plus d'assistantes sociales que de techniciens EDF, je ne sais ; mais ce qui est certain, c'est qu'une perturbation éventuelle dans l'assistance sociale fera moins de dégâts que l'interruption des fournitures d'électricité. Ce qui veut dire que les agents d'EDF ont bien davantage de poids, sans commune mesure avec la valeur objective de leurs contributions personnelles à la société, en comparaison avec les travailleurs sociaux.
Si elle veut bien s'en tirer sur le marché politique, une minorité doit acquérir la conscience politique d'elle-même. Elle doit pouvoir reconnaître les intérêts que ses membres ont en commun, ainsi que sa position de minorité en mesure d'utiliser le système pour en tirer un avantage particulier. Les "défenseurs de l'environnement" qui essaient de bloquer la construction d'un nouveau lotissement dans leur quartier forment une minorité claire et identifiable. Ils savent qui ils sont, et où se trouve leur intérêt7. Ils peuvent faire savoir ce qu'ils veulent aux élus, faire parler d'eux, et causer bien des ennuis à beaucoup de gens.
Les minorités latentes sont défavorisées
Ceux qui pourraient bénéficier de la construction d'une nouvelle résidence sont peut-être plus nombreux, mais ils n'ont aucune conscience de l'être. Ils ne savent même pas qui ils sont. Peut-être sont-ils, au moment présent, dispersés dans l'ensemble du pays, sans pouvoir apprécier l'avantage direct qu'ils pourraient tirer de cette construction. La théorie des choix publics nous annonce que le premier groupe, conscient de sa position comme de ce qu'il a à perdre et à gagner sera, à cet égard, plus efficace que le second pour ce qui est de négocier sur le marché politique.
Un modèle américain ?
Rétrospectivement, il est facile de distinguer ce qui, dans la vie politique américaine, donnait à la théorie des choix publics de meilleures chances d'émerger là-bas plutôt qu'en Europe. La société américaine est plus fragmentée ; bien davantage que chez nous, elle est composée de gens qui considèrent eux-mêmes appartenir à des sous-groupes de la société. Cela ne signifie pas que la théorie des choix publics ne soit pas applicable en Europe8, ni que sa capacité explicative y soit moindre : simplement, et notamment en Grande-Bretagne, ses racines y sont moins visibles. Dans ce pays, c'est plutôt d'après d'origine professionnelle que se rassemblent les acteurs de la politique9. Toujours est-il que cette analyse donne une image beaucoup plus précise que l'ancienne conception, suivant laquelle les minorités soutiennent les partis et les candidats parce qu'elles pensent qu'ils sont leurs "représentants".
===La théorie des choix publics est la seule à pouvoir traiter certaines questions
Elle fournit aussi une classification bien plus efficace, car elle ne considère pas seulement les groupes traditionnellement permanents, ceux dont tout le monde parle. Même si on ne peut cesser d'être "noir" ou "hispano-américain", on peut dans le même temps appartenir à plusieurs minorités à la fois, qui varieront suivant les enjeux. Selon son lieu de résidence, on pourra faire partie d'un groupe qui réclame une subvention pour l'entretien du réseau routier, ou la construction d'un nouveau pont. Selon sa profession, on pourra faire partie d'un groupe partisan d'octroyer des subventions à tel ou tel type d'industrie, par exemple contre la concurrence étrangère. Tel locataire fera partie d'une association pour le contrôle des loyers et tel propriétaire, d'un groupe pour la réduction des impôts fonciers. Entre dans le domaine d'étude de la théorie des choix publics tout ce qui concerne les choix faits par ces groupes changeants et versatiles à l'occasion des transformations politiques. Il en est de même des élus à tous les niveaux de l'Etat lorsqu'ils réagissent aux pressions, et marchandent avec les groupes suffrages et influence.
Autre avantage : certains des effets des sociétés politiques démocratiques nuisent tellement à la population qu'ils paraissent totalement irrationnels et incompréhensibles quand on essaye de les expliquer à l'aide du modèle politique traditionnel. Les analystes qui s'en tiennent à ce cadre de référence restent encore bien souvent perplexes face à l'apparente impuissance de ces sociétés à corriger ce qui, à l'évidence, ne fonctionne pas. Or, l'approche des choix publics, et c'est une de ses plus grandes vertus, nous fournit un mode d'analyse dans lequel ces comportements trouvent tout naturellement leur place, une fois que l'on a appris à les interpréter en termes de commerce des influences politiques. Ses meilleures recherches nous ont valu des découvertes essentielles sur la structure et le mode de fonctionnement du domaine économique qui relève directement du pouvoir des hommes de l'Etat.
Le secteur public
===La théorie des choix publics est indispensable pour comprendre le secteur public
La théorie des choix publics explique particulièrement bien les caractéristiques du domaine économique où les biens et services sont financés par l'impôt et produits sous la domination directe des hommes de l'Etat. Par ailleurs, certains aspects de ce secteur semblent quasiment impossibles à comprendre ou à expliquer si l'on s'en tient aux modèles conventionnels de la politique.
La tendance à la surproduction
Il y a, par exemple, la tendance à surproduire qui subsiste dans le secteur public. Quand c'est par une procédure collective que les gens financent leurs biens et leurs services, ils consomment davantage que si chacun devait payer ce qu'il a reçu. La théorie des choix publics nous donne le fin mot de l'affaire : c'est que, dans ces conditions, il subsistera toujours une demande pour un accroissement du service.
S'il n'existe aucune contrainte, les gens vont préférer que l'autocar passe deux fois par jour plutôt qu'une, que l'éclairage public soit amélioré, qu'il y ait davantage de routes, et mieux entretenues. En l'absence de contraintes, cette demande s'exprime sans égard pour ce qui est consommé ; elle est donc potentiellement infinie. Dans les cas extrêmes, on pourrait imaginer que les gens ne soient pas opposés à ce que des autocars vides passent toutes les demi-minutes, pour le cas où il leur prendrait l'envie d'en attraper un. Quand il n'y a pas de limites, une telle préférence est parfaitement naturelle.
Or, au risque d'avoir à contester un des mythes fondateurs du "service public", il faut rappeler que la "gratuité" n'existe pas et ne peut jamais exister. Il faut donc nécessairement qu'il y ait des contraintes, et les plus évidentes sont celles qu'imposent les prix de revient. Quand les gens paient directement leurs marchandises et leurs services, ils sont obligés de tenir compte de ce qu'ils dépensent, et de limiter en conséquence les quantités demandées. Dans le secteur public de l'économie, ces contraintes sont moins efficaces parce qu'elles sont moins fortement ressenties, et qu'elles sont liées de façon moins évidente à la fourniture des produits.
Supposons que, dans un domaine donné, une minorité réclame une amélioration des services. Elle peut s'être rendue compte elle-même de leurs insuffisances, ou alors quelque candidat à une élection lui aura fait miroiter les avantages d'une amélioration. Ces derniers sont donc bien mis en valeur, alors que leur coût supplémentaire est de moindre conséquence pour chacun. Ce peut être un petit groupe, mais ses desiderata peuvent rejoindre ceux d'autres groupes qui ont aussi leurs fournitures à faire améliorer. Ainsi peut naître une demande générale pour un développement du service, sans qu'il y ait beaucoup de pression pour le limiter. La coalition de ces groupes finit par représenter un potentiel politique bien réel, à échanger contre des produits sur le marché politique, alors qu'aucun soutien équivalent n'aura pu être constitué par ceux qui sont hostiles à cet accroissement des dépenses.
C'est ainsi que l'on peut observer ce phénomène étrange : les biens et services "publics" sont en fait produits en plus grande quantité que les citoyens ne l'auraient voulu si la décision leur avait été laissée à titre individuel. Cela n'implique en rien, bien au contraire, que ces produits soient de plus grande qualité, ni qu'ils répondent mieux aux exigences et aux besoins des consommateurs. Cela signifie seulement que l'irresponsabilité automatiquement induite par la procédure politique conduit les gens, collectivement, à dépenser davantage qu'ils ne le feraient de leur propre chef. S'ils doivent payer directement le service, ils en demandent moins que lorsqu'il leur est fourni par le secteur public. Le secteur public est donc, par sa seule existence, la cause d'une mauvaise allocation des ressources ; phénomène qui échappera toujours à la compréhension de quiconque méconnaît le point de vue adopté par la théorie des choix publics.
Tout le monde est poussé par son intérêt vers ce résultat indésirable
Il n'y a pas que les consommateurs qui soient poussés à la surproduction des biens et des services dans le secteur public. De leur côté, c'est bien naturel, ceux qui gèrent cette production en tirent un pouvoir et un prestige proportionnels à l'importance du service. Les employés, quant à eux, y trouvent des occasions de monter en grade et de se faire augmenter. Ceux qui font la loi gagnent eux-mêmes le soutien des groupes qui reçoivent les services produits en excès, sans pour autant perdre celui des contribuables dans leur ensemble, qui financent toutes ces belles dépenses. Le résultat est un soutien massif et unilatéral à tout projet de développer le service, avec une opposition pratiquement inopérante.
Réduit au statut d'usager, le consommateur perd tout pouvoir de décision
Le service, même produit en plus grande quantité que des clients individuels n'accepteraient d'en financer sur un marché privé, ne répond par ailleurs en rien à leurs besoins particuliers ni à leurs exigences spécifiques. Bien au contraire, c'est aux pressions du processus politique qu'il obéit. Sur un marché privé, le consommateur peut choisir son fournisseur. Par ailleurs il lui suffit, pour en borner la quantité, de limiter sa dépense, dont il a la maîtrise directe. En somme, l'offre est contrainte parce que le client choisit son fournisseur, la somme qu'il est disposé à payer (ou peut se permettre de payer). Dans le secteur public, rien de tout cela : le consommateur ne contrôle ni le choix de son fournisseur ni la quantité produite, et pas davantage ce que tout cela va lui coûter (dût-il se passer du nécessaire pour entretenir ces excès).
Naturellement, dans le privé, le client peut aussi choisir les biens et services particuliers qui correspondent à ses exigences, et refuser ceux qui ne lui servent à rien. C'est ainsi qu'en assez peu de temps, les biens et les services finissent par se conformer aux préférences des consommateurs. Les producteurs qui s'en moquent font faillite lorsque leurs clients vont chercher ailleurs.
C'est à des influences totalement différentes que le secteur public est soumis. Les consommateurs n'ont pas le choix : ils sont bien obligés de payer ce que le secteur public produit. Car cette production est, pour sa plus grande part, financée par l'impôt. Les consommateurs n'ont aucun autre choix possible, d'abord parce que le "service public" est le plus souvent un monopole (ne serait-ce que parce que le financement public, reposant sur l'usage de la force, est en lui-même une forme de concurrence déloyale), ensuite parce que, étant généralement obligés de financer sa production, rares sont ceux qui peuvent se permettre, en plus, de se payer un fournisseur privé. Cela signifie que les consommateurs n'ont aucune possibilité d'imposer leur rationalité propre au secteur public. La procédure politique leur permet épisodiquement de formuler un vœu, mais — nous en avons vu un exemple — celle-ci ne traduit pas leurs véritables préférences, et ils sont de toutes façons soumis à la "carte forcée" : on ne leur donne à choisir (sans garantie aucune d'obtenir celui qu'ils veulent) qu'entre des "lots" composites extrêmement vastes, dans lesquels une dépense particulière pour tel bien ou telle marchandise fournie par le secteur public est totalement noyée dans la masse.
La surproduction s'entend à qualité du service égale
Cet écart entre produit désiré et produit fourni peut d'ailleurs conduire à cette situation paradoxale : en dépit de la tendance inhérente à la surproduction dans le secteur public, il arrive souvent que pour le même type de service, la population soit prête à payer beaucoup plus lorsque les producteurs sont privés. C'est notamment ce qu'on observe en matière de santé, où les Américains, avec leur médecine encore largement privée, dépensent davantage par habitant que les Britanniques assujettis au monopole pseudo-gratuit du Service National de Santé, ou en matière d'enseignement, où les Japonais dépensent plus que les autres, parce qu'une part substantielle de leurs dépenses en la matière va à des écoles de préparation privées.
Un statisticien imprudent — ou malhonnête — en conclurait même que l'observation réfute la théorie des choix publics, puisque, en contradiction apparente avec ses prédictions, une même activité conduit à moins de dépenses dans un pays où elle est collectivisée, que dans un autre où elle ne l'est pas autant. C'est là qu'il faut se rappeler que la tendance à la surproduction existe nécessairement, dès lors qu'un financement public a institué l'irresponsabilité financière pour ceux qui décident de la production du service.
Ce qui se passe, c'est que le service pseudo-gratuit, financé par les hommes de l'Etat, perd tellement de valeur aux yeux de la population qu'elle en vient à en demander moins que s'il était normalement financé, en dépit du déterminisme qui conduit par ailleurs chacun à pousser à une dépense inconsidérée. L'observation ne réfute donc pas la théorie des choix publics : elle traduit en fait la combinaison de deux des effets qu'elle décrit. D'une part, la tendance à dépenser trop, d'autre part l'effondrement de la valeur du service, tous deux imputables à des formes de financement et de gestion par nature irresponsables.
La domination par les producteurs
Ainsi, l'observation montre bien à quel point les consommateurs sont impuissants à influencer la production des biens et services du secteur public. Le système politique favorise la surproduction et se moque du consommateur-contribuable, ce cochon de payant. Les producteurs, en revanche, voilà qui peut exercer sur le service une influence considérable. Or, ceux qui le gèrent au niveau de la direction, et les employés qui participent directement à sa production, ont pour leur part un fort intérêt personnel dans la nature du service, et dans la manière dont il est produit.
L'administration d'un "service public" place son intérêt dans un service qui soit facile à gérer, et maximise les perspectives de carrière des administrateurs et des gestionnaires. Le personnel, pour sa part, a intérêt à ce que le service lui donne le moins de travail possible et le dérange encore moins, tout ceci avec la meilleure garantie d'emploi et les meilleures rémunérations possibles. Quant à la position de ces deux groupes pour influencer le système, elle est excellente. Contrairement aux usagers qui n'ont pas le choix, et sont obligés de prendre ce qu'on leur donne, eux ont un pouvoir à monnayer. Car l'un et l'autre peuvent rendre la vie vraiment difficile aux élus.
La bureaucratie peut entraver, ralentir, et faire échouer tout changement susceptible de menacer son statut et sa position. Le personnel peut interrompre le service, ou menacer de le faire, et livrer ainsi les élus à la vindicte du public. Le résultat, inéluctable, est que les "services publics" tendent tous à être "capturés" par les producteurs. Cela signifie que ces services, au bout d'un certain temps, sont bien davantage au service des producteurs qu'à celui des consommateurs. Ce sont les producteurs qui ont le vrai pouvoir à l'intérieur du système, les consommateurs n'en ayant aucun. C'est, tout simplement, que les premiers ont davantage de poids politique à faire valoir que les seconds.
===Seule la théorie des choix publics rend compte de la confiscation du pouvoir par la bureaucratie
Avec les années, progressivement, le service cesse de servir les besoins et les demandes du public, et ne produit plus que pour satisfaire les préférences du petit groupe des producteurs. Cette "capture par les producteurs", la théorie des choix publics lui donne tout naturellement son explication, n'étant même pas loin de la juger inéluctable1 ; mais elle aussi serait bien difficilement explicable par les représentations traditionnelles de la politique. Pourquoi les citoyens, majoritaires et réputés rationnels, choisiraient-ils d'instituer un service pour qu'il échappe à leur contrôle en aspirant leurs ressources, dans le seul but de satisfaire le groupe des gens qui y seront employés ? Cela semblera inconcevable, faute des outils intellectuels permettant de comprendre comment les règles de procédure en question donnentun pouvoir de négociation exceptionnel à certaines personnes aux dépens du public dans son ensemble.
Les résultats de la capture par les producteurs sont bien visibles dans tous les domaines du secteur public. Les services, qui sont en principe là pour servir le public, sont de plus en plus asservis aux convenances de ceux qui sont payés pour les produire. La Poste est un modèle parfaitement typique : le deuxième passage du facteur le samedi disparaît ; il n'y a plus de levée le dimanche. Les bureaux de poste ferment le samedi après-midi ; le service des pneumatiques a été supprimé. De tous ces changements, aucun n'est la réponse à un vœu des consommateurs ; bien au contraire, on peut supposer qu'ils souhaiteraient exactement l'inverse. En revanche, ceux qui produisent le service ont la vie plus facile s'ils ne sont pas obligés de travailler le week-end.
Un processus constant de dégradation
Dans l'ensemble du secteur public par conséquent, la tendance est à ce que les besoins et les convenances des producteurs aient résolument le pas sur ceux du consommateur. En réalité, rien de tout cela ne se produit immédiatement. C'est un scénario qui se déroule au fil des années, à mesure que jouent les déterminismes et apparaissent leurs effets. par exemple, en Grande-Bretagne, les éboueurs passent tôt le matin et réveillent tout le monde avec le bruit qu'ils font. Les accords qu'ils ont réussi à négocier spécifient qu'ils doivent être payés pour un travail défini, le nombre de tâches correspondant à une journée de travail "normal" n'étant calculé qu'ensuite. Le calcul est remis en cause et débattu chaque année, jusqu'à ce qu'il soit tel que le personnel commence tôt le matin, et termine sa "journée" de travail... à midi. Cette particularité serait virtuellement impossible dans le secteur privé, parce que l'entreprise verrait ses prix refléter ses coûts, et que le public s'adresserait à des concurrents moins chers. Cependant, le secteur "public" accorde rarement au public le luxe de choix concurrents, et on ne peut même pas espérer qu'il fasse faillite comme il devrait normalement le faire avec une gestion pareille. Le résultat est que, année après année, on constate que les négociations remettent de plus en plus le soin de définir le service aux mains de ceux qui le produisent. Encore un mystère élucidé : les conventions collectives, dont un bon nombre de clauses seront incompréhensibles pour qui n'a pas analysé les pressions qui s'exercent dans le système. Les accords qui caractérisent le secteur public ne trouvent aucun équivalent dans le secteur privé, sauf peut-être dans la production des journaux ou des programmes de télévision2.
Il serait inconcevable qu'une clinique privée réveille ses malades avant six heures du matin, simplement parce que le personnel trouve plus commode de faire le ménage à l'aube. Il ne serait pas davantage plausible qu'on y fasse attendre des malades plusieurs heures dans les couloirs pour une radiographie ou d'autres examens, pour les faire encore lanterner avant de les ramener à leur chambre, tout cela parce que les brancardiers ont imposé certaines règles pour se faciliter le travail. Et pourtant, ces pratiques sont monnaie courante dans nos hôpitaux publics. La différence ne vient pas du fait que les cliniques privées auraient davantage d'argent. Elle vient de ce qu'elles n'ont pas été capturées par les producteurs, et donnent par conséquent la priorité à la satisfaction des désirs et besoins de leurs clients.
La tendance aux sureffectifs
Si le pas donné aux employés est une caractéristique du secteur public, la tendance aux sureffectifs en est une autre. Car l'organisation publique est bien souvent moins efficace que son homologue privée, et nécessite davantage de ressources pour obtenir le même produit. Cette différence est mesurable par comparaison ; rien n'empêche de mettre les prix de revient unitaires de la fourniture publique en regard de ceux d'entreprises ou de services équivalents dans le secteur privé. Il est parfois possible de les comparer à ce qu'ils étaient avant que le service en question ne soit absorbé par le secteur public. On peut aussi mettre en contraste la production publique dans un pays et son homologue privé dans un autre.
La comparaison montre un coût plus élevé pour un résultat équivalent, chaque fois que les biens et services sont produits par le secteur dit "public". Toutes choses égales par ailleurs, il faut davantage de personnel au secteur public pour produire des soins médicaux, de l'acier ou des transports, qu'il n'en faut dans le secteur privé. La théorie des choix publics nous explique pourquoi.
Personne, dans un "service public", n'a intérêt à économiser les postes de travail
Que la main-d'œuvre soit employée de façon économique est normalement dans l'intérêt des producteurs, comme dans celui des consommateurs. Sur un marché concurrentiel, les producteurs s'efforcent de maintenir des coûts à un niveau raisonnable en utilisant plus efficacement la main-d’œuvre. Ils peuvent ainsi augmenter directement leurs bénéfices, ou bien maintenir des prix avantageux pour attirer la pratique et accroître leurs parts de marché. Quant au consommateur, il profite de prix plus bas. Or, le secteur public fonctionne forcément dans un contexte moins concurrentiel, puisqu’il est assis sur des impositions — fiscales et réglementaires — qui privent automatiquement ses clients d’une partie de leur liberté de choix. Les incitations normales, qui conduisent à une utilisation rationnelle de la main-d'œuvre, sont absentes, et d'autres valeurs prédominent donc.
C'est l'intérêt des dirigeants que d'avoir un personnel plus nombreux sous leurs ordres. La responsabilité supplémentaire que cela leur impose leur apportera des rémunérations plus élevées. Le personnel, pour sa part, voit son intérêt dans un excès d'embauche. Cela semble vouloir dire : "moins de travail pour chaque employé, davantage de postes disponibles, et ainsi une plus grande sécurité de l'emploi". Pour ceux qui négocient en leur nom, cette perception est aussi une réalité. Il n'est pas dans l'intérêt des militants syndicalistes d'accepter des baisses de personnel, même si cela devait aboutir à une affectation plus efficace du travail fourni. Moins de personnel, c'est automatiquement moins d'adhérents. Dans le secteur public, les négociations sont caractérisées par une répugnance certaine de la part des syndicats à accepter les nouveaux équipements ou les nouvelles méthodes de travail, s'ils doivent conduire à des réductions de postes.
Même s'il existe dans le gouvernement et l'administration du secteur public un désir authentique d'efficacité, il faut en général prendre des mesures draconiennes pour l'obtenir. Combien plus facile est de céder aux exigences de ceux qui ont le pouvoir, et de sacrifier ceux qui n'en n'ont pas ! Ce qui veut dire, dans le secteur public, donner toujours plus aux producteurs, aux dépens des consommateurs. Lors de la conférence annuelle de l'Association Nationale Américaine des Entreprises de Traitement des Déchets, un responsable fit savoir qu'à Londres, la véritable curiosité touristique n'était pas la famille royale ni les monuments historiques, mais la vision de cinq hommes accrochés derrière une benne à ordures, ramassant les sacs à la main et les y lançant. Ce spectacle-là, il le trouvait pour sa part plus "historique" que les monuments du même nom.
Un pur gaspillage, quasiment palpable
On peut mesurer le degré de sureffectifs et les pertes qu'ils imposent au public des consommateurs au moment où un contrat est passé avec une entreprise privée pour la charger d'une tâche auparavant remplie par un "service public". L'entreprise privée s'acquitte de la même tâche à meilleur marché, et avec moins de monde. Et elle n'impose pas un travail plus dur à son personnel ; elle se contente de mieux l'utiliser. Cela peut passer par un nouvel équipement ou, plus souvent, par de meilleures méthodes de gestion.
Si l'entreprise privée est capable d'obtenir ces conditions de travail, c'est parce qu'elle est en concurrence avec d'autres entreprises, et qu'elle risque la faillite si elle perd sa part de marché. Le personnel accepte ces conditions dans le secteur privé, parce que son emploi en dépend. Un aspect intéressant du passage d'un statut public à un statut privé est que le personnel qui passe à la nouvelle entreprise privée y est en général plus satisfait de son travail que dans le secteur d'Etat, pourtant dominé par les producteurs. Même si son travail est affecté et géré plus rigoureusement, et si la main-d'œuvre est moins nombreuse, il a la possibilité, qu'il n'avait pas auparavant, de gagner des primes en travaillant davantage, et de nouvelles chances d’être promu à des postes plus importants, avec de plus grandes responsabilités.
La décapitalisation chronique
Un autre trait essentiel de la fourniture publique des biens et des services qui ne peut être ni prévue ni expliquée par la théorie politique conventionnelle, est aussi sa décapitalisation chronique. En effet, il n'y a apparemment aucune raison pour que les citoyens de la théorie officielle, toujours aussi rationnels et majoritaires, aient envie de se faire fournir des services par des organisations dépourvues du capital nécessaire pour ce faire. Etant donné que l'allocation donnée à chacun des services ne représente qu'une petite somme pour le contribuable, il est a priori difficile de comprendre pourquoi ils sont sous-capitalisés à ce point. On a déjà observé une nette tendance à la surproduction ; pourquoi n'existe-t-il pas, de la même façon, une tendance à la surcapitalisation?
La myopie de l'Etat
La réponse nous apparaît une fois que nous avons examiné les pressions qui s'exercent respectivement sur les dépenses courantes et les dépenses de capital. Le financement de chaque service est limité par ce que les législateurs sentent que les contribuables peuvent tolérer. Même si tout bénéficiaire d'un service lui donne plus de valeur qu'à la somme marginale qu'on lui fait payer en échange, il existe un intérêt diffus mais certain au sein du public pour maintenir le niveau d'imposition à l'étiage où la pression de ce service l'a fait monter.
Or, au sein de l'enveloppe globale, il existe une pression plus forte du côté des dépenses courantes. Les dépenses courantes financent la fourniture de services aujourd'hui, et paient les personnes en cause aujourd'hui. A l'inverse, les dépenses de capital préservent la capacité de produire les services dans l'avenir. Alors, ce qui tire l'argent vers les dépenses courantes, ce sont d'une part la population, qui protestera si on réduit les services aujourd'hui, et de l'autre le personnel, qui interrompra le service si ses exigences ne sont pas suffisamment prises en compte. La même pression n'existe pas du côté du capital, parce que les bénéficiaires futurs du service ne sont pas là, aujourd'hui, pour l'exercer de la même façon. Ils constituent un groupe diffus et impossible à identifier, qui ne ressent pas directement sa perte lorsque l'investissement est sacrifié.
Pour illustrer la dispersion et l'impuissance relative de ce que Mancur Olson appelle des groupes d'intérêt latents3, nous avions pris l'exemple d’une l'école existante contre une école en projet. Une de ses conséquences est que, en l'absence d'un groupe de pression constitué, personne ne défend l'avenir face à ceux qui privilégient le présent : les parents d'élèves d'une école existante menacée de fermeture peuvent exercer une pression échangeable sur le marché politique, alors que les parents à venir, qui pourraient profiter d'une dépense faite aujourd'hui pour construire une nouvelle école, ne le peuvent pas. Pour la plupart, ils ne se connaissent même pas, et ne perçoivent pas non plus le rapport qui existe entre la dépense d'investissement faite aujourd'hui et l'avantage qu'ils pourraient en tirer demain.
Etant donné le déséquilibre des forces qui s'exercent sur le financement global, il est toujours plus facile pour les élus et les gestionnaires de faire des économies sur l'entretien ou les investissements, plutôt que de réduire les dépenses courantes. Politiquement, il en coûte moins de retarder l'achat d'équipements nouveaux ou la construction de nouveaux locaux, que d'opposer un refus à des revendications salariales ou d'imposer des réductions dans la fourniture des services. Au fil des ans, cette pression inégale conduit à un déclin constant de la part du financement consacrée aux dépenses de capital dans le secteur public.
"Richesse du privé, misère du public" ?
On peut voir les effets de ce déterminisme dans la tendance qu'ont les "services publics" à posséder un équipement typiquement démodé et sous-entretenu4. Les industries privées ne peuvent pas se permettre de se laisser distancer dans la course à la modernisation et à l'emploi du matériel le plus récent. Les entreprises qui s'y refusent se feront battre sur le marché. Sur le marché politique, en revanche, on peut gagner à réduire les dépenses de capital, qui ont peu de bénéficiaires conscients de l'être, pour financer les dépenses courantes, lesquelles en ont beaucoup.
L'expression "richesse du privé, misère du public" a été inventée par Galbraith, pour se plaindre de ce que les biens et des services privés trouvaient toujours suffisamment d'argent, alors que, prétendait-il, il n'y en avait jamais assez pour les biens et services "publics". Nous avons vu pourquoi sa conclusion est passablement sophistique en ce qui concerne les dépenses, mais l'expression reste tout à fait applicable à l'état de l' équipement, car le secteur public a toujours tendance à la décapitalisation, quel que soit le niveau global de son financement. Même si, pour une raison ou pour une autre, il devenait tout à coup politiquement possible de justifier et d'abonder un vaste financement supplémentaire pour des dépenses d'investissement, ces sommes n'atteindraient vraisemblablement pas non plus leur cible affichée. On pourrait s'attendre à ce que la plus grande part aille aux dépenses courantes, à mesure que s'exerceraient les mêmes pressions qui s'étaient faites sentir sur les financements précédents.
Une conséquence de cet état de fait est que nous pouvons tous contempler un secteur privé moderne et pimpant, à côté d'un secteur public souvent miteux et démodé. Dans les "services publics", les équipements servent plus longtemps qu'ils ne le devraient. Les nouveaux achats sont sans cesse repoussés, et les consommateurs doivent se contenter de services qui semblent avoir des années de retard sur la technique et l'équipement du jour. On serait bien en peine de rendre compte de ce fait à l'aide des théories politiques traditionnelles. En revanche, tout devient lumineux dès lors qu'on étudie l'arène politique sous l'angle économique : les dépenses courantes y ont tout simplement plus de poids politique que les dépenses en capital.
En somme, s'il est un groupe qui n'a rien à marchander sur le forum de la politique, c'est bien la génération qui vient. Elle n'apporte aucun avantage actuel en termes de soutien politique, et ne peut conclure aucun accord. Il existera donc toujours une forte tendance à offrir des avantages à la génération actuelle aux dépens de celle qui suivra. En persuadant les électeurs d'aujourd'hui que leurs avantages seront payés par les contribuables de demain, on s'acquiert leur soutien aujourd'hui, alors que celui de demain ne compte pas.
La faillite programmée des systèmes "sociaux"
Un autre exemple de ce phénomène dans les sociétés démocratiques est la tendance marquée à verser des pensions et prestations "sociales" sans rapport aucun avec les versements des bénéficiaires. Le cas type est celui où une nouvelle échelle de prestations est inaugurée dans sa prodigalité, "justifiée" sur la base de versements plus importants dans l'avenir. Les bénéficiaires immédiats, naturellement, y sont entièrement favorables. Ceux qui doivent payer plus cher l'acceptent dans l'espoir que les bénéfices qu'on leur promet pour l'avenir seront plus élevés encore. Ces derniers seront à leur tour financés par leurs enfants et leurs petits-enfants qui, à l'heure présente, n'ont pas voix au chapitre.
Un calcul démographique élémentaire suffit largement pour montrer que le système ne pourra être conservé, et les promesses tenues, qu'en exerçant une lourde pression sur les contribuables de demain, lesquels ont toutes des chances de la refuser purement et simplement, étant devenus les plus nombreux. La morale est celle de la chaîne de lettres, où ceux qui payent aujourd'hui espèrent qu'après eux on pourra enrôler dans ce jeu un nombre suffisant de gogos supplémentaires pour les payer en retour.
Les exploiteurs des générations à venir
John Maynard Keynes disait : "à long terme, nous sommes tous morts." Il avait raison en ce qui le concerne (il est mort en 1945), mais s'il est une pierre de touche du système public de retraites et d'assurances sociales, c'est bien cette mentalité-là. C'était la conception même de ceux qui ont tiré avantage à le mettre en place et à le développer. Ils ont empoché leurs profits hier sur le marché politique, et aujourd'hui, maintenant que la génération actuelle (qui était hier, pour ainsi dire, la "génération de demain") commence à se rendre compte qu'elle est le dindon de la farce, les hommes de l'Etat du départ sont hors de portée, tranquillement installés dans leur rôle de prétendus "sages". Et pour que la comédie soit complète, il arrive qu'on aille jusqu'à leur demander conseil maintenant qu'il n'est plus possible de camoufler la faillite, qu'ils avaient installée dans le système dès le début.
Par ailleurs, tout homme politique essayant de s'attaquer au problème avant qu'il n'atteigne son point critique se heurtera aux intérêts et aux exigences des prétendus ayants droits ; car la formule consistant à demander aux gens de reconnaître qu'il faut payer davantage maintenant pour percevoir moins plus tard n'a que fort peu de chances de l'emporter sur le marché politique. Les observateurs ont depuis longtemps noté la myopie des élus et leur incapacité à formuler des plans à long terme, même alors que l'on voit nettement se dessiner les tendances. La réponse des théoriciens qui étudient les choix publics est que l'avenir n'y a aucune importance. La seule valeur qu'il puisse avoir aujourd'hui vient du souci que se font les électeurs d'aujourd'hui de laisser un monde au moins tolérable à leurs enfants et petits-enfants ; mais il est bien difficile de bâtir quoi que ce soit sur cette fondation, avec des politiciens tellement décidés à concentrer exclusivement les préoccupations des gens sur les choix à court terme.
Le comportement des administrations
Il est un autre phénomène que la théorie des choix publics sait particulièrement bien expliquer, c'est le comportement de la bureaucratie. Le modèle traditionnel présente l'Administration comme l'instrument du Gouvernement, qui lui-même, d'une manière ou d'une autre, reflète la Volonté du Peuple. Sur ce socle se dresse la noble figure d'un Service Public dévoué et impartial, dont la Fonction est de mettre en œuvre les Politiques conçues par ses Dirigeants, qui sont tous des hommes d'Etat.
Même s'ils est possible que les fonctionnaires soient zélés, et constituent un élément essentiel de l'appareil d'Etat, en aucun cas la théorie des choix publics n'accepte de les considérer comme des machines. Ce sont des êtres humains, mus par des projets et des aspirations semblables à ceux qui font agir les autres personnes. Ils constituent un groupe de pression bien distinct, avec un certain nombre d'actifs à faire valoir sur le marché politique. Si nous les considérons comme des entrepreneurs qui cherchent à pousser leur avantage, nous obtenons une image bien plus fine de leur réaction à certaines situations, et un compte rendu bien plus compréhensible de leur comportement général.
"Je dépense, donc je suis"
Dans la bureaucratie, la rémunération vient pour une part de l'ancienneté, et pour l'autre de l'étendue du pouvoir. Chacun a intérêt, pour sa carrière, à augmenter ses prérogatives et améliorer son statut. Personne ne tire avantage à diriger un service que l'on doit réduire, à moins d'y trouver d'autres satisfactions pour compenser la baisse de pouvoir que cela entraîne.
Au contraire, la bureaucratie proposera plus volontiers la création de nouvelles activités pour ses services, qui impliqueront une expansion tant en budget qu'en personnel. Le financement supplémentaire ne lui coûte évidemment rien et, comme elle fournit généralement ses services à un prix inférieur à celui qui ajusterait la demande à l'offre (quand ils ne sont pas "gratuits"), elle multiplie partout les pénuries artificielles, ce qui lui permet d'y voir autant de "besoins non satisfaits". Nous avons vu que le statut même du "service public" fausse systématiquement la perception de ses coûts et que, dans ces conditions, la demande peut en principe aller jusqu'à être illimitée.
Il peut arriver qu'une mesure donnée soit réellement née de l'initiative d'une fraction donnée du public. Un candidat l'aura peut-être proposé en échange de voix aux élections ; le groupe en question pourra avoir attiré l'attention du gouvernement par les clameurs de ses manifestants, ou bien la question aura été poussée par les médias. A un moment donné, elle aura été reprise par les législateurs, lesquels auront à leur tour fait pression sur le gouvernement pour qu'il remédie au problème.
C'est à ce moment-là que le fonctionnaire entre en scène. On lui demandera d'étudier le problème en question, et de proposer des solutions. Il est tout à fait dans l'intérêt d'un bureaucrate d'ajouter de nouveaux programmes à son domaine d'attributions, et même de se battre avec les autres services pour se les voir attribuer à lui. C'est ainsi que se "construisent les empires" au sein du "service public", processus par lequel les fonctionnaires s'efforcent d'accroître leur champ d'activités, la taille des équipes dont ils sont maîtres et le niveau des salaires auxquels ils ont accès5. Les fonctionnaires peuvent être dévoués et objectifs, mais on décrit plus efficacement leur façon d'agir en faisant l'hypothèse qu'ils se conduisent comme des entrepreneurs, offreurs et demandeurs sur le marché politique, qu'ils ont choisi de préférence à celui de la production.
L'Administration comme groupe d'intérêts
L'apport de la théorie des choix publics est donc qu'elle considère toute administration comme un groupe d'intérêts, et invite à prendre en compte ses raisons d'agir propres. Au lieu de l'imaginer, comme le font les théories traditionnelles, dans le rôle d'un arbitre se tenant au-dessus de la mêlée, exclusivement soucieux d'appliquer les règles d'une manière juste et impartiale, elle la traite comme un joueur à part entière, comme un groupe de plus parmi ceux qui négocient leur influence sur le marché politique. Elle reconnaît les intérêts de ses membres en tant que parties prenantes, tout autant que leur rôle d'administrateurs.
===Innombrables sont ceux qui croient bénéficier de la redistribution publique
La tendance constante à l'expansion du secteur public dans les sociétés démocratiques ne s'explique pas seulement par l'intérêt qu'il trouve à étendre ses prérogatives. Il ne suffit pas non plus de dire que les bénéficiaires perçoivent davantage ses avantages que ses coûts. Le "secteur public", c'est bien davantage que l'administration des transferts directs, profitant aussi bien à ses gestionnaires qu'à ses bénéficiaires supposés. En réalité, tous ceux qui dépendent de l'argent "public" pour leurs moyens d'existence font ipso facto partie du secteur dit "public".
La liste comprend automatiquement tous les membres des forces armées et la Police. Elle comprend tous les employés de la santé et de l'enseignement publics. Elle inclut non seulement ceux qui sont employés par des entreprises nationalisées mines, chemins de fer, fabriques d'automobiles mais aussi tous ceux qui travaillent pour des entreprises dont la prospérité dépend des financements de l'Etat.
La liste ne s'arrête pas là. Il faut aussi y ajouter tous ceux qui sont employés à divers niveaux des collectivités publiques, qu'il s'agisse des Départements ou des municipalités. Du balayeur à l'architecte, du gardien de square à l'avocat, tous les professionnels qui travaillent pour l'Etat au sens large font partie, d'une certaine manière, du secteur public. Tous ont intérêt à ce que les dépenses, dans leur domaine propre, s'accroissent ou du moins se maintiennent. Si tous peuvent trouver à redire à la fiscalité qui leur est imposée parce que l'on augmente d'autres budgets qui ne les concernent pas, tous en revanche auront tendance à se battre plus farouchement pour leur propre secteur qu'ils ne lutteront contre les dépenses dans d'autres domaines. Collectivement, ils constituent une force puissante qui pousse à l'expansion régulière des activités du secteur public.
De rusés politiciens avaient déjà compris, des siècles avant que n'apparaisse la théorie des choix publics, qu'il serait possible de constituer des majorités à partir de tels groupes. Pour un élu, il est très avantageux que plus de la moitié de ses électeurs soient matériellement dépendants de l'Etat. Qu'il s'agisse de fonctionnaires, d'employés ou de bénéficiaires des "services publics", s'ils sont assez nombreux pour constituer une majorité, ils auront tendance à élire des politiciens qui s'engagent à distribuer davantage de privilèges politiques.
===La théorie explique comment et pourquoi les systèmes politiques contemporains poussent chacun à agir contre son propre intérêt
Sans doute le processus s'entretient-il de lui-même, peut-être même est-il auto-accéléré, alors même qu'il va probablement contre l'intérêt même de la plupart des parties en présence. Comment qualifier autrement un procédé qui provoque, pour la plupart des services, le maintien d'un niveau de consommation trop élevé, pour un produit qui ne peut pas traduire leurs préférences, en plus des charges supplémentaires imposées à ces services par la domination des producteurs, la décapitalisation et les sureffectifs ? Si l'on ajoute le fardeau du contrôle bureaucratique, il devient évident que lorsque les gens votent, ce procédé leur impose de payer davantage de services que nécessaire, et à un prix outrageusement gonflé. Mais là encore, la perte que chacun peut associer à chaque programme est infime, si on la compare aux énormes gains que son propre privilège lui rapporte. Le système d'incitations propre aux échanges de la politique aboutit donc à ce que les gens, individuellement, y agissent d'une manière contraire à l'intérêt de tous, y compris le leur propre.
Les traits caractéristiques du secteur public de l'économie, qui semblent à la fois incompréhensibles et absurdes à ceux des observateurs qui n'ont à leur disposition que le paradigme conventionnel, se laissent prévoir et expliquer dès lors que le modèle des choix publics vient à leur être appliqué. Le fait que, sans le savoir ni l'avoir voulu, les gens agissent à l'encontre de leur propre intérêt s'explique, parce qu'ils donnent à leurs propres privilèges bien plus de valeur qu'à ceux reçus par les autres. Le fait que les gens, par leur comportement collectif, engendrent une situation qu'ils auraient refusée par leur propre choix, s'explique par la manière dont le marché politique détermine la valeur des suffrages et des influences.
Le modèle des choix publics ne se contente pas de rendre plus clair le système actuel. Il nous offre aussi un schéma de fonctionnement détaillé et limpide qui nous explique pourquoi et comment ce système a pu résister à tant de tentatives faites pour le réformer ou pour l'améliorer.
Réponses de la bureaucratie
Des tares depuis longtemps répertoriées
Cela fait déjà longtemps que l'on connaît les caractéristiques du secteur public qui sont contraires au bien commun. Son médiocre rapport qualité-coût, son inefficacité, et même sa carence fréquente en capital, ont fait l'objet de bien des études. Son incapacité à répondre aux exigences et aux besoins des consommateurs, le temps considérable qu'il lui faut pour réagir, en traînant les pieds et à reculons, ont également été observés, à l'occasion d'anecdotes ou d'études statistiques plus sérieuses.
De même, la tendance de la bureaucratie à adopter certains comportements a été copieusement décrite. La "construction des empires" à laquelle on assiste à l'intérieur des services, la lutte entre ces derniers pour accaparer les attributions, et la pression constante vers l'expansion du secteur d'Etat, sont non seulement connus de la science politique, mais encore mis en scène par l'humour populaire. Yes, Minister1, une des séries les plus appréciées de la télévision britannique, a pour thème le comportement et les tics de la fonction publique, étant bien entendu que le public reconnaît sans faute quelles vérités fondamentales se cachent sous le masque de la caricature.
L'approche naïve des défauts du secteur public
Avant l'analyse des choix publics, on pouvait encore penser que les problèmes constatés dans le secteur public et son administration n'étaient que des accidents, et non des traits essentiels du système. Ainsi, ses aspects indésirables passaient pour être des cas singuliers, où l'élément public de l'économie avait erré, et fait des choses qu'on n'avait jamais voulu lui faire faire. Ce n'était pas littéralement faux, mais supposait que ces phénomènes étaient le résultat de choix contingents, réformables, et non des tares inhérentes au système lui-même.
A première vue, et avec une conception relativement simple de la rationalité, on peut imaginer que ces défauts puissent être identifiés, et réformés par les mesures correctrices appropriées. S'il y a trop de personnel dans le secteur public, alors il faut réduire les effectifs. Si le secteur public utilise des équipements vétustes et délabrés, on peut toujours le rééquiper avec du matériel neuf. S'il est inefficace, avec un médiocre rapport coût-qualité, il suffit, pour l'améliorer, de lui appliquer de nouvelles méthodes de travail et de gestion. S'il ne répond pas de façon satisfaisante aux besoins et aux exigences des consommateurs, il faut instaurer des procédures qui porteront ces défauts à la connaissance des responsables, afin qu'ils puissent y apporter les changements appropriés.
On suppose donc constamment, ce qui est à première vue raisonnable, que s'il y a des défauts, rien n'empêche d'y remédier. Le même raisonnement s'applique à l'appareil d'Etat lui-même. Là encore, il y fort longtemps que l'on identifie les dysfonctionnements, et présume tout naturellement qu'il sera suffisant de mettre en œuvre des mesures correctrices. L'effectif des fonctionnaires a tendance à dépasser celui d'un service privé équivalent ? Alors il faut réduire leur nombre. Il y a évidemment trop de paperasseries et de doubles emplois ? Dans ce cas, instituons de nouveaux types d'organisation afin de les éliminer. Si les bureaucrates ont tendance à se constituer des empires, alors on doit créer un cadre juridique qui le leur interdira. Si un service ne cesse de pousser pour étendre son domaine d'attributions, rien n'empêche, pense-t-on, d'adopter des mesures pour le contrecarrer.
Les remèdes proposés ne marchent pas, parce que l'interprétation est fausse
Ces réactions partent d'un postulat fort louable, à savoir que ce qui va mal peut être amélioré. Pourtant, s'il n'y avait pas une erreur sur le fond, on pourrait s'attendre à ce que le secteur public se porte beaucoup mieux qu'il ne se porte aujourd'hui. Après tout, il y a belle lurette que l'on a identifié les défaillances du secteur public et de la bureaucratie. Maintes études ont été publiées à leur sujet, les décrivant même comme des caractéristiques bien connues du système. Elles prétendaient d'ailleurs souvent y porter remède. On peut alors se demander pourquoi, depuis si longtemps qu'on les étudie et classifie, avec tant de propositions de réforme, ces pratiques malfaisantes continuent imperturbablement de caractériser l'économie du secteur public.
La réponse est tout simplement que ces remèdes ne peuvent pas marcher. Uniquement conçus pour corriger des défauts particuliers, ils y échouent dès lors qu'on les applique. La cause de leur déconfiture est en soi instructive, et c'est pourquoi il vaut vraiment la peine de décrire ce qui leur advient à ce moment-là.
Il ne faut pas être grand clerc pour reconnaître qu'une bonne partie du secteur public emploie trop de personnel. Il suffit de comparer avec des équivalents du secteur privé. Or, que constate-t-on ? Que les tentatives faites pour limiter les effectifs se heurtent à une résistance bien plus forte dans le secteur public. Sur l'entreprise privée plane toujours la menace ultime de la fermeture ; il y a des limites que les travailleurs ne peuvent franchir, sous peine de tout perdre. Les entreprises privées devant rester compétitives, il leur faut de temps à autre procéder à des "dégraissages". Le personnel s'y oppose, mais son intérêt, comme celui de la direction, conduit les uns et les autres à la table des négociations, où les licenciements inévitables finissent par être acceptés.
Rien de tout cela n'est vrai du secteur public. On n'y est en temps normal exposé à aucune fermeture ou faillite, ni à aucune obligation d'être compétitif. Accepter des réductions d'emplois n'est l'intérêt ni des travailleurs ni de la hiérarchie. Les employés apprécient la sécurité de l'emploi du secteur public, d'autant qu'elle est assortie de bénéfices annexes bien plus avantageux que le privé ne peut se permettre d'en offrir. Il n'ont aucune raison d'accepter quelque licenciement que ce soit. Les dirigeants syndicaux cherchent toujours à maintenir le niveau des effectifs, c'est-à-dire des adhérents en puissance, à son maximum. Les directeurs, qui sont rémunérés à proportion des pouvoirs qu'ils exercent, savent ce qu'ils perdraient à devoir diriger un service réduit.
La capacité qu'ont les employés, les chefs syndicalistes et la hiérarchie de bloquer tout effort fait pour supprimer des postes, est à proprement parler phénoménale. Le service, ils en sont les maîtres ; et pour accéder aux médias, il leur suffit de se plaindre et de manifester. Le public sera directement touché et, à travers lui, le législateur s'ils font, ou menacent de faire grève. Dans les faits, le degré de résistance qu'ils opposent aux réductions d'effectifs est si fort que l'on doit en faire énormément pour en obtenir très peu. Ceux qui font la loi apprennent vite à leurs dépens que le coût, en termes politiques, l'emporte le plus souvent sur l'avantage des économies qu'ils pourraient faire.
Leurs efforts pour traiter la dégradation du capital s'en sortent un peu mieux, mais jamais assez pour éliminer le problème. C'est à la structure même des forces en présence que l'on doit cette facilité perverse qu'il y a à piller les budgets d'équipement pour satisfaire les revendications de dépenses courantes, pour fournir les services et payer les salaires immédiatement exigés. Après le temps nécessaire pour que la dégradation devienne bien visible, ce seront de nouvelles alarmes et d'autres appels à "l'investissement". Tout cela, naturellement, vient de ce qu'on prétend aborder le problème comme s'il tombait du ciel, sans considérer qu'il a une cause précise.
On ne peut pas traiter le problème si on refuse d'envisager ses causes
Chercher à résoudre le problème en apportant de nouveaux crédits au compte de capital, c'est vouloir guérir une maladie en ne traitant que ses symptômes. Car, bien entendu, les rallonges budgétaires sont soumises exactement aux mêmes tensions que les allocations qui les ont précédées. A la suite des pressions exercées, la dotation en capital supplémentaire se transmue en augmentations de la masse salariale. A son tour, elle finira par ne plus être qu'une source de financement comme les autres, de l'huile dans les rouages de la négociation. A un moment critique de celle-ci, pour dégager l'argent nécessaire à la sortie de l'impasse, les syndicats proposeront d'eux-mêmes que l'on retarde d'un ou deux ans l'achat du nouvel équipement, ou la construction du nouveau centre.
Pour pallier l'absence totale de pouvoir des usagers, on crée des institutions censées défendre leurs intérêts. Dans l'économie privée, les consommateurs n'ont besoin que d'acheter ou de refuser de le faire pour faire connaître leurs souhaits et leurs exigences. Exigences auxquelles les entreprises se plient, faute de quoi les clients iront trouver un autre fournisseur qui, lui, saura les écouter. Nul besoin, par conséquent, d'institutions particulières pour avertir les industriels de ce que les clients pensent de leurs services. Ils le leur font savoir directement par leurs actes d'achat, après quoi l'entreprise en cause pourra toujours mener ses propres études de marché si elle veut savoir quoi produire.
Dans le secteur public, les consommateurs étant privés du Droit de s'exprimer par leurs achats ou leurs refus d'acheter, on invente des "chiens de garde du consommateur", soi-disant pour "représenter leurs intérêts". Quand la Poste décide d'augmenter le tarif "urgent", l'organisme officiel censé représenter les usagers prétend lui communiquer "ce que le public pense de cette idée". Le véritable public n'a guère l'occasion d'exprimer son opinion, puisqu'on interdit de lui proposer d'autres services de courrier2. Entre-temps, la Poste détermine bien entendu toute seule ce qu'elle décide de penser, ou de ne pas penser, du Comité d'usagers. Ce dernier type d'organisme n'a en fait aucun pouvoir sur les événements. Leurs membres ne sont pas élus par le public, dont ils ne sont certainement pas représentatifs. S'ils l'étaient, ce serait probablement pire, car cela donnerait l'illusion d'un "contrôle démocratique" là où il n'en existe, et ne peut en exister aucun.
Plus grave encore, ces organisations sont elles aussi "capturées" par les entreprises et les services qu'elles sont censées surveiller. Elles suivent l'organisation depuis des années, négocient avec elle, et en viennent à mieux comprendre ses difficultés et ses problèmes que celles des usagers eux-mêmes. Très subtilement donc, leur rôle dérive d'une "représentation" du public auprès des organismes, à celui de porte-parole des organismes en question auprès de ce même public. Après avoir dîné depuis des années à la même table que l'intrus contre lequel il était censé aboyer, le "chien de garde" est devenu un gentil toutou. Or, dans une économie normale, le public réel n'a pas à se soucier, et se moque complètement, des problèmes et autres difficultés d'organisation qu'une entreprise, disons par exemple Honda, pourrait bien rencontrer. Ce n'est pas son affaire. Si Honda ne fournit pas la bonne qualité au prix qu'il faut, eh bien il achètera Hyundai3 à la place. Honda le sait, et ne fait pas tout un cinéma pour l'accepter.
On traite les problèmes de l'Administration de la même façon que ceux des entreprises et des "services publics". Les tentatives faites pour les résoudre souffrent des mêmes insuffisances, c'est à dire qu'on les aborde comme s'il s'agissait de phénomènes contingents : des caractéristiques regrettables qui, pour une raison X, seraient apparues dans le système, et dont il suffirait de le débarrasser. Les règles et les procédures courantes de la bureaucratie ont donné naissance aux pratiques immortalisées par C. Northcote Parkinson dans ses célèbre lois. Mais ces ouvrages ne seraient pas devenus des classiques de l'humour, sans la trame de vérité profonde qui les sous-tend. Il en est de même de la série télévisée que nous évoquions plus haut. En fait, les spectateurs étrangers se demandent souvent si ces œuvres doivent être considérées comme une manifestation d'humour ou comme un genre de documentaire social.
La ronde éternelle des rapports et des propositions
Connaître les pratiques est donc une chose ; les rectifier en est une autre. Même si les procédures des "services publics" sont plus complexes et plus contraignantes que celles de l'activité privée, on pourrait envisager, en guise de solution, d'étudier les procédures du secteur privé et de les appliquer à l'administration de l'Etat. Dans nombre d'économies avancées, la manière dont fonctionnent les administrations du secteur public a fait l'objet d'étude sur étude, et dans le moindre détail. On a appelé en renfort tous les spécialistes du privé possibles, pour évaluer l'efficacité de sa gestion. On a vu des experts en en gestion du temps, voire en ergonomie, se pencher sur ses règles et ses procédures. L'"analyse critique des processus", la "gestion par objectifs", la "rationalisation des choix budgétaires", l'"évaluation (!) des politiques publiques", autant de tartes à la crème qu'on a pu mentionner suivant les caprices de la mode, sans que cesse pour autant la sempiternelle succession des études et des rapports.
Les recommandations sont faites, les déclarations d'intention exprimées. Et les pratiques, de continuer imperturbablement, avec peut-être, dans quelques domaines, une amélioration symbolique et temporaire. On peut bien regrouper certains services, en supprimer d'autres, et transférer leurs fonctions ailleurs. Au bout du compte, on retrouve toujours une bureaucratie où des fiefs se constituent, où les ingérences prolifèrent, et dont le domaine d'intervention s'étend sans arrêt. La réforme de l'Administration ressemble à la marée : elle avance, puis se retire, mais les rochers sont toujours là chaque fois que la marée redescend.
On n'appelle pas un médecin pour soigner une vache
L'erreur fondamentale de cette manière d'observer les défaillances pour essayer de les corriger est qu'elle suppose le secteur public capable de se conduire de la même façon que le privé. C'est en comparant son fonctionnement avec celui du secteur privé que l'on met à jour la plupart de ses pratiques défectueuses. En d'autres termes, l'activité privée est le modèle de référence pour juger les résultats du secteur public. Quand le second est à la traîne de la première, on s'efforce de transplanter les méthodes de l'une dans les procédures de l'autre : on demande à l'organisme public de se comporter plus ou moins comme son homologue concurrentiel.
Or, il n'y a aucune raison de penser qu'il en soit capable. L'animal est complètement différent. L'erreur est là : croire qu'on peut lui faire faire la même chose qu'au privé, sans aucune des forces qui conduisent ce privé-là à se conduire comme il le fait. Le secteur public est soumis à des contraintes, internes et externes, qui n'ont rien à voir avec celles qui s'exercent dans le privé. Et c'est pour cela qu'il se comporte différemment.
===La théorie des choix publics étudie spécifiquement les conséquences du statut public sur les décisions personnelles
Une bonne partie des études et des analyses de l'école des choix publics consiste en un examen très précis de ces influences, ainsi que des conséquences qui en découlent. Il se peut fort bien que les raisons qui font agir les gens, aussi bien dans le public que dans le privé, soient les projets et aspirations ordinaires que la plupart des hommes ont en commun. Le désir d'obtenir l'avantage le plus grand et d'améliorer leur situation, leurs conditions de travail, et les récompenses qu'ils peuvent espérer, tout cela peut bien être commun aux deux secteurs ; mais les règles et les conditions qui dominent l'un et l'autre sont tellement opposées, que les mêmes motifs d'action produiront immanquablement des résultats différents.
C'est l'incapacité à tenir compte des différences de structure qui est la source de l'erreur. Si le secteur public est autre, c'est parce que les pressions qui s'y exercent en font quelque chose de différent. Personne ne l'a conçu pour cela ; ce sont les intérêts des groupes et les forces résultantes qui en sont la cause. Le secteur privé non plus n'est pas la création rationnelle d'un seul. Il a évidemment été construit par l'homme, mais pas suivant un plan préparé à l'avance. Ce qu'il fait, et la manière dont il le fait, résulte de l'interaction d'une foule d'actions et de projets personnels. Les caractéristiques qui en ont fait ce qu'il est sont des règles telles que la liberté du choix, la libre concurrence, la possibilité de suivre ses préférences en affectant ses ressources, et de limiter sa consommation à ce que l'on a vraiment décidé de payer.
===La logique politique est celle du profit à sens unique
Dans le secteur public, nombre de ces caractéristiques sont soit totalement exclues, soit très amorties dans leurs effets. Le résultat n'y a donc rien à voir avec celui qui émerge de l'économie privée. Les caractéristiques mentionnées ci-dessus jouent un rôle important dans l'organisation du secteur privé, en ce qu'elles limitent la capacité de chaque individu à soumettre le système à son intérêt exclusif. C'est parce que la possibilité de choisir existe que les prix sont contraints. C'est parce que les consommateurs peuvent refuser d'acheter, que l'organisation ne peut pas être exclusivement au service des producteurs. C'est parce que la dépense se limite exactement à la somme dont les gens ont volontairement accepté de se séparer, que la qualité offerte doit être suffisante pour les attirer.
A l'inverse, c'est un aspect caractéristique du secteur dit "public", que les facteurs qui imposent contraintes et limites à la poursuite des avantages unilatéraux n'y sont en rien aussi efficaces. On pouvait donc tout à fait s'attendre à ce que le secteur public se caractérise par la recherche, et l'obtention effective, d'avantages personnels au profit de ses membres, aux dépens de la population dans son ensemble. Si le secteur économique d'Etat se comporte comme il le fait, cela ne tient donc pas à des traits accidentels qui s'y seraient glissés par hasard au cours de sa croissance, mais à des caractéristiques structurelles qui lui sont inhérentes.
L'irresponsabilité qui découle du statut public dispense de produire efficacement
La raison pour laquelle les tentatives faites pour transplanter dans le secteur public certaines procédures du secteur privé ne "prennent" pas, est que les contraintes qui maintiennent ces pratiques en sont tout simplement absentes. Si la production publique des biens et des services contrôle moins bien ses coûts que l'industrie privée, c'est parce que le secteur public n'a pas besoin de le faire. Les pressions qui poussent à ce type d'efficacité sont faibles comparées à celles qui conduisent à la prolifération des postes et aux pratiques restrictives de la production.
Le souci de consacrer davantage de ressources à l'investissement, aux équipements modernes et aux nouvelles installations est bien timide, comparé aux pressions qui aspirent les fonds disponibles vers le côté des dépenses courantes. La vague opinion qu'il faudrait, Dieu sait comment, tenir compte des intérêts des consommateurs et les défendre, ne dépasse guère le stade du vœu pieux dans un système où la plupart des règles conduisent à satisfaire, aux dépens de ces derniers, les désirs et les besoins des producteurs.
Un schéma similaire se répète dans l'administration de l'Etat. A la base se trouve le fait que si une administration publique ne se conforme pas aux normes de la gestion privée et n'atteint pas son niveau d'efficacité, c'est tout simplement parce que son statut même est fait pour l'en dispenser. Elle n'affronte aucune des pénalités qui, dans le secteur privé, sanctionnent l'inefficacité ; en leur lieu et place, elle est confrontée à des règles et des contraintes qui conduisent inéluctablement à multiplier les personnels et à développer les fonctions.
Il est possible que les cadres supérieurs du privé rivalisent de la même manière pour acquérir de l'influence et essayer d'étendre le domaine de leur propre pouvoir. La différence est que, dans le privé, le juge ultime se trouve dans le marché. Si, de toutes ces manœuvres, il résulte que les ventes s'améliorent, ou que la société devient plus compétitive, les choix faits seront maintenus. Sinon, les contraintes à l'œuvre y mettront rapidement fin. Dans l'Administration, il n'existe aucune norme, aucune contrainte d'efficacité approchant ces disciplines propres au marché libre. Le fait est qu'elle n'a jamais été instituée pour cela. Les règles administratives, par nature, sont destinées à contraindre le public et non à le servir.
Les défauts du secteur public sont inhérents à sa nature
Quels enseignements peut-on en tirer ? Les multiples tentatives faites pour améliorer le secteur public et pour éliminer ses aspects nuisibles ont en commun, nous l'avons vu, de s'inspirer des résultats du secteur privé, et de supposer que les défauts du secteur public sont de purs accidents susceptibles d'être éliminés. Or, d'après l'analyse des choix publics, les tentatives inspirées par de telles conceptions n'ont guère de chances de réussir. Tout d'abord, en l'absence des règles qui, dans le privé, entretiennent les caractéristiques recherchées, il n'y a aucune raison pour que celles-ci subsistent dans le secteur public. Deuxièmement, en examinant les groupes de pression et en tirant les conséquences de leurs raisons d'agir, on est forcé de conclure que les principaux inconvénients du secteur public ne sont pas accidentels mais nécessaires, c'est-à-dire qu'ils sont une conséquence presque inévitable de la manière dont le secteur public a été institué, et de son mode de fonctionnement.
Pour reprendre les termes de la théorie des choix publics, les problèmes de la production publique sont un produit secondaire du marché politique. Sur le marché de la production, l'échange des biens et des services conduit à un certain type de résultat. Sur le marché politique, l'influence et les suffrages échangés en assurent un autre, substantiellement différent. On ne trouve pas, sur le marché politique, les traits fondamentaux du marché productif qui mettent automatiquement ce dernier au service des autres. En leur lieu et place, on trouve des caractéristiques garantissant qu'il servira bien les intérêts des groupes de pression minoritaires qui s'y échangent leurs influences aux dépens de tous les autres.
Les règles du secteur public qui permettent aux groupes d'intérêt minoritaires d'y rechercher leur avantage aux dépens du bien commun sont donc celles-là mêmes qui leur permettent également de résister avec succès aux tentatives faites pour enter sur son fonctionnement les méthodes et les procédures du secteur privé. Pour dire les choses plus crûment, il est contraire à leur intérêt de se soumettre à ces procédures et à ces disciplines, et ils ont le pouvoir de faire échec à toute tentative pour les appliquer.
Un scénario type
Là encore, on peut faire appel à un exemple fictif pour repérer les procédés et les pratiques utilisés contre toute tentative faite pour amener le secteur public à plus de ressemblance avec les entreprises privées. Qu'ils soient appliqués consciemment par les acteurs, ou résultent de leur désir inconscient de défendre des positions privilégiées, cela importe peu. Ce qui compte est qu'ils sont bel et bien employés, et qu'ils fonctionnent.
L'exemple pourrait être ce serpent de mer que l'on voit apparaître de temps à autre dans la gestion administrative, une étude qui révèlerait la possibilité de faire des économies pour une production équivalente ou même meilleure, tout en économisant les ressources utilisées. La décision politique de faire des économies substantielles est le signal déclencheur pour une bataille entre les différentes Directions, chacune s'efforçant d'obtenir que les restrictions budgétaires tombent chez le voisin. Même si certaines d'entre elles sont finalement désignées pour supporter l'essentiel des économies de coûts, il se produit encore, entre leurs différents services, une bagarre où chacun s'efforce de faire avaler la pilule à l'autre.
Comme toutes les Directions se battent pour conserver ou augmenter leur dotation budgétaire, les pressions qu'elles exercent sur le gouvernement militent collectivement contre la réalisation d'économies importantes. Les hauts fonctionnaires de chaque service produisent des projections pour dépeindre les conséquences atroces qui résulteraient de coupes budgétaires vraiment significatives. Au sein du gouvernement les Ministres, armés des rapports préparés par leurs subordonnés, se battent à leur tour pour défendre les budgets de leurs ministères. Et comme les autres membres du gouvernement en savent encore moins que le Ministre sur le fonctionnement des autres ministères que le leur, ils sont plutôt mal placés pour juger des chiffres qu'on leur présente.
Ce qui n'était au départ qu'une simple tentative pour réduire les gaspillages s'est désormais transformé en une dispute entre les Ministres au niveau du Conseil, la surenchère résultante ne pouvant déboucher que sur des compromis réduisant l'ampleur de l'économie projetée à l'origine. Le processus se répète à plus petite échelle à l'intérieur de chaque ministère, les Directions consacrant leurs efforts à justifier leur propre attribution budgétaire plutôt qu'à rechercher des occasions de faire des économies. Les bureaucrates savent parfaitement qu'il n'ont aucun intérêt à ce que leur Direction dépense moins d'argent, pas plus qu'à une réduction du budget global de leur ministère.
Deux réformes, également vouées à l'échec
Deux méthodes ont été essayées pour désamorcer le mécanisme qui pousse chaque Direction et chaque ministère à défendre l'intégralité de son budget intact pour faire tomber les réductions sur les autres. L'une est d'imposer des réductions uniformément proportionnelles, en exigeant par exemple que chacun réduise ses dépenses de, disons, cinq pour cent. L'autre consiste à attribuer une enveloppe budgétaire globale à chacune des Directions, en la laissant libre de déterminer comment appliquer ces limites.
Ces deux méthodes tiennent compte du fait que les fonctionnaires vont se démener pour défendre leur propre budget, et pour essayer de trouver un moyen de vider le projet de son contenu. Si tout le monde était forcé d'accepter une réduction uniforme, cela pourrait éliminer la tendance de chaque service à se repasser le bébé, et à vouloir faire porter ailleurs le poids de la restriction. En théorie, cela devrait empêcher les luttes au niveau ministériel, les Ministres n'ayant plus besoin de jouer les porte-voix pour leurs fonctionnaires, ni de s'opposer les uns aux autres pour maintenir leur propre budget.
De même, la limitation globale de l'enveloppe pour chaque Direction est censée confiner les luttes à l'intérieur du ministère. La théorie est que chaque section devra lutter contre les autres pour conserver son budget, le plafond budgétaire global imposé étant le total définitif. Au lieu que l'on voie chaque service défendre sa dotation personnelle, envoyant ensuite le Ministre se battre pour obtenir la somme résultante, la règle de l'enveloppe globale est censée permettre de prédéterminer ce total, en maintenant la bagarre à l'intérieur.
===On sous-estime les déterminismes pervers du système
Derrière ces deux stratégies se cache le présupposé selon lequel si les dépenses inutiles et le gaspillage peuvent être identifiés, alors on pourra les éliminer, ou du moins les réduire, pour peu qu'il soit possible d'imposer une certaine discipline. L'idée est que ces deux méthodes imposent un plafond global qui ne peut pas être dépassé, et avec lequel les services devront bien apprendre à vivre. Ainsi, ils seront obligés de réduire les doubles emplois et la paperasse, pour continuer à travailler à moindres frais.
La réalité est bien différente. Dans la réalité, les fonctionnaires découvrent qu' il est plus facile de repousser les limites que de faire des économies sous leur contrainte. Les Ministres réagissent à la proposition de réductions globales en disant que l'idée est bonne en général, mais qu'elle ne saurait être appliquée aux services essentiels de leur propre ministère. On ne peut pas faire de réductions dans ces domaines essentiels que sont par exemple la santé, l'éducation, les retraites ou la sécurité sociale. Ce serait une fausse économie, n'est-ce pas, que d'essayer de réduire le budget de l'environnement. La sécurité serait compromise par des réductions dans le budget de la Défense. Accompagnée d'une grande publicité, la défense des "services publics essentiels" de chaque ministère transforme ce qui devait être une réduction également subie par tout le monde en une image plus familière, celle d'un conflit de priorités au sein du gouvernement. Voilà un scénario qui met le fonctionnaire plus à son aise, sachant parfaitement en tirer les ficelles.
Dans la variante de l'enveloppe budgétaire globale, la réponse est double. Pour commencer, les fonctionnaires s'opposent directement à la limite imposée pour chaque Direction. Ils produisent des chiffres budgétaires "prouvant" l'impossibilité absolue de les respecter. Ensuite, après qu'un certain plafond a été accepté par le gouvernement, les fonctionnaires entreprennent de faire pression pour casser ces limites. A mesure que l'on examine les mérites éminents de chacune des dépenses individuelles, s'accumulent les raisons pour lesquelles la dotation initiale finira par être dépassée.
Imaginons, par exemple, que les plafonds servent à fixer une augmentation salariale inférieure au chiffre que peut accepter un type de personnel indispensable, disons les enseignants. Le conflit qui en résulte fait pression sur le gouvernement, et quand un compromis se présente qui semble acceptable aux fonctionnaires, le Ministre demande au Conseil la permission de dépasser la limite imposée à son ministère pour financer cet accroissement exceptionnel. C'est ainsi qu'il est possible de bousculer les plafonds établis, à l'occasion d'une série d'incidents distincts, dont chacun permet d'invoquer la force majeure. Imaginer que le financement supplémentaire pourrait être obtenu par des économies faites ailleurs au sein du même ministère n'est pas une voie praticable ; cela ne ferait que transférer la pression ailleurs. La seule manière de l'éviter est de piller le budget d'équipement pour financer les accroissements de dépenses courantes.
Même si l'idée qui inspire les réductions budgétaires uniformes et la fixation d'enveloppes globales est de réduire le gaspillage administratif, les pressions sont telles qu'il est plus facile de renoncer au projet que de faire les économies en question. Des exceptions sont faites à la politique globale en faveur de certains ministères ; on attribue un financement supplémentaire à ceux dont les situations les forcent à dépasser les limites budgétaires. L'expérience des bureaucrates est telle qu'ils n'ont aucune peine à fomenter des situations qui obligeront à le faire.
Les économies proposées porteront en priorité sur les services les plus appréciés, dans les domaines où le gouvernement est le plus vulnérable
Si on prenait pour argent comptant la vision théorique des fonctionnaires telle que la présente le modèle politique conventionnel, on pourrait peut-être s'attendre à ce qu'ils cherchent à faire des économies afin de fournir un meilleur rapport qualité/coût. Ainsi, on attendrait d'eux qu'ils économisent l'argent public en adoptant des règles et des méthodes de travail plus rationnelles. On pourrait fermer certains bureaux, leur personnel servant à compenser les défaillances dans d'autres. On pourrait traquer les activités inutiles ou improductives, et les éliminer. Le résultat serait que le ministère continuerait à rendre ses services, mais à moindres frais, ce qui serait une amélioration de l'efficacité.
Lorsqu'on adopte l'analyse des choix publics, et considère les participants comme des marchands d'influence sur le marché politique qui cherchent, comme des entrepreneurs, à s'assurer le plus grand profit personnel, on s'attend à un schéma tout à fait différent, et qui correspond beaucoup mieux à la réalité de l'expérience. Quand les coupes sont imposées, les plans présentés envisagent de les obtenir, non par des économies sur la paperasse, mais par des réductions sur les services. Au lieu que ce soient les bureaux qui subissent l'essentiel des économies, ce sont les bénéficiaires des services qui les subissent de plein fouet. Pire, les réductions proposées vont souvent porter sur des domaines sensibles et perçus comme importants, et dont les cibles sont un type de public particulièrement revendicatif, ayant la langue bien pendue et la visibilité médiatique à l'avenant.
Quand on annonce les réductions envisagées, c'est immédiatement un concert de protestations chez ceux dont les services sont menacés. Les médias suivent naturellement, et le cabinet du Ministre commence à prendre la mesure de ses ennuis. A son tour, le gouvernement ressent une impopularité croissante, et ses membres commencent à se soucier des retombées politiques. Les parlementaires reçoivent des missives hostiles, les sondages montrent quel attachement le public voue aux services menacés. L'économie espérée paraît alors dérisoire par rapport au risque politique. Le gouvernement calcule qu'il ne peut se permettre de perdre qu'un certain niveau de soutien si l'entreprise doit être rentable, et bientôt son enthousiasme pour les économies diminue. Ce qui était bien sûr l'effet escompté par les fonctionnaires qui proposaient les réductions en question.
L'analyse des choix publics suggère donc fortement que c'est dans les services rendus que les réductions seront proposées, et non dans le traitement administratif, et qu'on proposera d'abord de couper dans les services soutenus par les groupes de pression les plus puissants4. Faire des économies dans les services de santé conduira donc sans doute à fermer des hôpitaux, ou à cesser de faire certaines opérations qui sauvent des vies. Couper dans le budget de l'enseignement pourrait porter sur le nombre des professeurs de mathématiques. Des réductions dans le budget de la Marine diminueront le nombre des bateaux.
Le scénario est le même partout, et peut se résumer ainsi : les réductions proposées porteront en priorité sur les services les plus appréciés, et dans les domaines où le gouvernement est le plus vulnérable. C'est pour cela que les campagnes d'économies ont rarement duré très longtemps, et qu'elles n'ont presque jamais engendré des réductions importantes de charges administratives. En termes d'effort et d'impopularité, leur coût se révèle en général plus important que leurs résultats ne le justifient aux yeux de ceux qui s'efforcent de les mener à bien. Une montagne de luttes féroces et épuisantes contre des professionnels de l'obstruction accouche laborieusement d'une souris de dépenses en moins.
Un des épisodes de Yes, Minister, la série télévisée qui décrit les mœurs des fonctionnaires, montrait à quoi avaient mené les réductions budgétaires dans le service de santé5. Un hôpital flambant neuf avait un service administratif de cinq cent personnes, parfaitement affairées, mais n'avait pas un seul patient. Aucune réduction de postes administratifs n'avait été possible, alors même que le service était toujours entièrement fermé. Quiconque suppose que les fonctionnaires ne se conduisent ainsi qu'à la télévision peut toujours prendre connaissance de ce qu'a fait le service américain des Douanes et de l'Immigration. A l'annonce d'une réduction de 10% dans son budget, le directeur réagit par la mise à pied de tous les fonctionnaires chargés d'empêcher l'importation de drogue dans les aéroports. On n'avait proposé aucune économie d'administration, mais sacrifié le service le plus apprécié, et celui où le gouvernement était le plus vulnérable. Cela fut quand même considéré comme un abus, et le fonctionnaire en question perdit son poste. Il ne fut pas renvoyé, rassurez-vous : seulement muté à un autre service.
TROISIEME PARTIE : LA MICROPOLITIQUE
De la critique à la créativité
La théorie des choix publics explique la croissance de l'Etat
La théorie des choix publics est une critique. C'est un outil d'analyse qui permet de comprendre et d'expliquer pourquoi certains phénomènes se produisent dans le secteur public, et pourquoi ils le font ainsi. Elle nous invite à rechercher les intérêts des différents groupes impliqués dans la conception et l'exécution des politiques publiques, ceci nous permettant de prévoir et d'expliquer les réactions que celles-ci vont engendrer.
Grâce à cette approche, il devient possible de comprendre certains phénomènes qui, sinon, nous sembleraient inexplicables, voire irrationnels. Elle nous montre immédiatement pourquoi il est inévitable que les programmes politiques conservateurs s'épuisent dans des difficultés du genre de celles qu'ils ont rencontrées. L'essence de la formule traditionnelle de "la droite" est de diminuer le rôle joué par les hommes de l'Etat dans la vie économique, et la charge qu'ils imposent à leurs concitoyens. Elle essaie de réduire l'importance et l'étendue de leurs actions, et de diminuer le fardeau réglementaire qu'ils imposent aux entreprises ; elle voudrait qu'ils cessent de confisquer une si grande partie de l'argent des individus et des entreprises, leur interdisant de le dépenser suivant leurs lumières propres.
Evidemment, ces projets se heurtent directement à l'intérêt de la plupart des groupes associés aux ambitions étatiques. Ils pourraient bien favoriser l'ensemble de la société, permettre enfin la création de richesses, et par conséquent améliorer le sort d'une majorité écrasante de la population, mais rien de tout cela ne suffit à les faire passer dans le domaine de la politique pratique. Toutes les conceptions "de droite" du pouvoir, et les projets qu'on leur prête, s'opposent dans une certaine mesure à ce que les groupes de pression perçoivent comme leur intérêt vital. N'importe quelle minorité peut se laisser démontrer qu'elle y perdra des plumes si les dépenses totales sont réduites. Alors qu'elle pourrait, dans l'abstrait, soutenir le principe d'une diminution générale des dépenses publiques, chacune se battra pour maintenir sa part du butin, et bien plus âprement que d'autres n'essayeront de la réduire.
La bureaucratie comprend immédiatement qu'un programme "de droite" constitue une menace réelle pour ses perspectives d'enrichissement et de pouvoir. Ce qu'elle veut, c'est accroître le domaine de ses prérogatives et le nombre de ses subordonnés. Son intérêt en tant que classe est qu'il y ait davantage de programmes publics, et de plus vastes encore. Toute annonce d'un projet de réduction de l'activité et de la dépense publiques devrait suffire à la mobiliser contre lui, jusqu'à la faire capoter si besoin est.
On a donc maintenant les moyens identifier la raison d'un phénomène majeur dont tous les adversaires du socialisme ont eu l'occasion de se plaindre. Ils ont souvent observé que le pouvoir et les dépenses des hommes de l'Etat se développaient rapidement sous les gouvernements collectivistes et centralistes, et seulement moins vite sous un gouvernement de "droite". Ils parlent d'un "cliquet socialiste", qui ne tournerait que dans un sens : celui de l'augmentation de la taille de l'Etat. Si un gouvernement de tendance libérale parvenait à obtenir un arrêt temporaire, empêchant l'accroissement du pouvoir étatique au cours de son mandat, on considérait cela comme le maximum de ce qu'il était possible d'espérer.
Pour leurs partisans, et pour tous ceux qui avaient pris part à ces gouvernements, le phénomène était aussi confondant qu'exaspérant. ¨Privés de l'éclairage de la théorie des choix publics, ils ne savaient où chercher son origine. Grâce à ce nouveau type d'analyse, en revanche, il nous est désormais possible de comprendre pourquoi les choses devaient se passer ainsi. Quand l'on considère l'opposition de tous les groupes qui bénéficient d'un privilège d'Etat, et les agissements d'une Administration directement opposée aux objectifs essentiels du programme de "la droite", on découvre tout de suite l'explication. Ce n'est pas parce que les politiques proposées seraient "incompatibles avec notre monde moderne", voire "inapplicables dans le monde réel" ; c'est parce qu'elles sont politiquement trop difficiles à imposer par la seule volonté du gouvernement, face au bunker des intérêts en place qui se mobilisent contre elles.
Nixon et Heath dans l'ornière
Reprenons donc notre tentative d'explication des échecs relatifs des gouvernements de Richard Nixon aux Etats-Unis et d'Edward Heath au Royaume Uni. Ni l'un ni l'autre ne disposaient d'une technique efficace face aux phénomènes que nous venons de voir, et qui s'opposent à toute mesure de désétatisation. Dans un climat en principe plutôt favorable à une diminution du rôle et des ponctions de l'Etat, ni l'un ni l'autre n'avaient pressenti les difficultés pratiques qu'impliquait la mise en œuvre de ce type de projet, a fortiori les tactiques nécessaires pour les surmonter. Pensant apparemment que les événements succèdent naturellement à l'adoption des idées, ni l'un ni l'autre n'avait l'avantage de connaître l'analyse proposée par la théorie des choix publics. Celle-ci existait, mais n'en était qu'aux premiers stades de son développement, et n'avait pas encore suffisamment attiré l'attention.
Or, cette dernière permet de beaucoup mieux apprécier leurs échecs, aussi bien que de juger la variété des explications qu'on leur a trouvées. D'un côté, on trouvait les gouvernements avec leurs intentions et leurs programmes, et de l'autre, les forces réelles inhérentes au système, et auxquelles ils voulaient s'attaquer. Résultat, aussi bien sous Nixon que sous Heath : le pouvoir réglementaire des hommes de l'Etat et leur rôle dans l'économie furent accrus. De même, bien entendu, que ce qu'il en coûtait aux autres.
Sans théorie valide permettant de rendre compte des comportements du secteur public, aucun des deux gouvernements ne pouvait imaginer ce qui l'attendait. Les conseillers et autres experts sur lesquels ils comptaient pour appliquer leurs politiques, étaient ceux-là même dont ces politiques menaçaient les intérêts. Les deux gouvernements, par exemple, se rendirent compte que les salaires et les prix montaient plus vite qu'ils ne le souhaitaient, sans comprendre les pressions qui poussaient dans cette direction. Tous deux imposèrent des contrôles administratifs aux salaires et aux prix, étendant ainsi considérablement le pouvoir d'ingérence de la bureaucratie1.
En somme, ni l'administration Nixon ni le gouvernement Heath ne connaissaient vraiment les contraintes qui pèsent sur l'action publique, et qui sont imposées par les conduites égoïstes de ceux qui y participent. S'ils avaient compris quelle force d'opposition serait mobilisée par les groupes de pression voyant leurs privilèges mis en cause, ou par la bureaucratie craignant pour ses perspectives de carrière, peut-être auraient-ils essayé des politiques totalement différentes, et obtenu un autre résultat. A tout le moins, l'échec de leurs programmes affichés aurait été justement attribué à leur compétence insuffisante pour traiter avec le système politique.
Alors, on se résigne ?
L'approche des choix publics explique aussi bien la croissance irrépressible du secteur public année après année, que les échecs des tentatives faites à diverses occasions pour inverser ce processus. Elle explique même le fatalisme de ceux qui, tout en le considérant comme pervers et en s'y opposant en principe, pensent néanmoins que personne n'y peut rien. Cependant, c'est là tout ce qu'elle fait. L'école des choix publics a proposé une nouvelle méthode d'analyse. Elle fournit une critique ; elle nous montre ce qui ne va pas. La question reste de savoir s'il est possible de construire quelque chose sur ces découvertes.
La nouvelle analyse a du moins le mérite de faire connaître leurs limites aux politiciens. Elle leur permet de prévoir quelles sont les politiques qui n'ont que peu de chances de réussir. Si l'on ne pouvait en tirer que ce résultat, ce serait déjà fort précieux. Cela nous épargnerait de nourrir de faux espoirs, pour les voir ensuite déçus. En comprenant comment les groupes d'intérêt vont réagir à l'intérieur du système, les dirigeants politiques pourraient au moins éviter les mesures qui sont condamnées à se les mettre à dos. Ainsi, l'analyse des choix publics, même si elle n'est qu'une critique, offre déjà au politique un moyen de filtrer à l'avance, de retenir les réformes qui ne peuvent qu'échouer. Elle permet par conséquent de s'épargner des affrontements inutiles, sources de discorde et d'affaiblissement, et offre aux hommes politiques le moyen de restreindre leurs ambitions pour se fixer des objectifs plus réalistes. Ces résultats sont déjà appréciables en eux-mêmes, mais ils se bornent à signaler aux hommes politiques ce qu'il ne faut pas faire. Aucun n'indique aux gouvernements comment mettre en œuvre les politiques qu'ils jugeraient devoir appliquer.
Simple critique ou point de départ ?
Raisonnons, cependant : si la théorie des choix publics est une critique, pourquoi n'impliquerait-elle pas, de façon latente, des propositions créatives symétriques de ses conclusions ? Si le système politique dominant agit de manière à bloquer certains types de réformes, alors savoir lesquels et comment ne pourrait-il pas aider à en imaginer d'autres ? Des réformes qui, au lieu d'essayer de forcer les contraintes du système, essayeraient de s'en servir pour parvenir à leurs fins. Ces déterminismes, nous les connaissons maintenant : nous savons à quoi ils conduisent, nous savons d'où ils viennent. Alors pourquoi ne pourrait-on pas créer des politiques qui sauraient s'en servir, s'en jouer ou même les neutraliser ?
Mission impossible
A première vue, cela ressemble à "Mission impossible". L'intérêt des groupes minoritaires est de recevoir des privilèges particuliers sur le dos de tous les autres. Et comment imaginer que les hommes de l'Etat puissent trouver leur intérêt ailleurs que dans un secteur public bien gras et bien étouffant ? Il faudrait vraiment des politiques bien paradoxales pour retourner ces intérêts-là contre les privilèges et autres prébendes accordés par les systèmes publics, ou pour réduire la part des biens et des services produits par leur secteur d'activité. A priori, ces politiques devraient amener ces gens à agir directement contre leur propre intérêt.
Eh bien justement, l'analogie avec "Mission impossible" est exactement appropriée : comme dans la série télévisée américaine, quelques spécialistes, décidés à consacrer leur ingéniosité et leur expertise à la résolution de ce problème apparemment insoluble, ont finalement découvert certaines manœuvres et procédés techniques capables de surmonter cette contradiction apparente. En fait, il est même possible d'imaginer un grand nombre de façons d'aborder les gens, et qui les persuaderont bel et bien d'accepter certaines politiques, voire de les soutenir, alors même que leur effet sera de réduire le volume d'ensemble des privilèges accordés aux minorités dominantes et de diminuer globalement le pouvoir et les dépenses des hommes de l'Etat.
===Comment persuader les gens d'abandonner leurs privilèges ?
Une des possibilités envisagées est que les gens abandonnent leurs privilèges actuels, si on peut trouver un autre type d'avantage pour les dédommager. Pour conserver leur privilège, les gens sont prêts à se battre à concurrence de sa valeur perçue, celle-ci étant plus grande pour eux que les autres ne perçoivent ce qu'elle coûte. Cependant, rien ne leur interdit de renoncer à cet avantage particulier à l'occasion d'un échange où ils se sentiraient gagnants. Cela suppose qu'ils reçoivent en l'échange de leur privilège d'origine une chose qui ait plus de valeur, et surtout pour eux.
S'il en est ainsi, ne pourrait-on pas supprimer tous ces privilèges d'un seul coup, par exemple en les échangeant contre la liberté retrouvée ? Après tout, il est fort vraisemblable que, si l'on supprimait tout l'appareil de la redistribution politique, l'immense majorité des gens s'en trouveraient mieux, puisque la plus grande partie de ce qui leur est donné d'une main leur est repris de l'autre, avec le poids mort des hommes de l'Etat à entretenir en sus. Cependant, il faut se rendre à l'évidence : c'est une politique qui ne marcherait pas, parce que cet avantage net pour chacun serait beaucoup trop difficile à faire voir concrètement. Quiconque reçoit un privilège de l'Etat ressent fortement cet avantage, alors que son coût est presque insignifiant pour les autres.
Par conséquent, s'il doit y avoir une politique qui offre une compensation, il ne suffit pas que le nouvel avantage soit en fait plus important : il doit apparaître évidemment comme tel au bénéficiaire visé. Cette précision est essentielle parce qu'en politique justement, les gains et les charges sont rarement perçus pour ce qu'ils sont. C'est une des perversions constantes de l'intervention de l'Etat que d'inspirer à toutes les parties prenantes, profiteurs supposés, victimes réelles et nuisibles bien intentionnés, des illusions qui empêchent de la mettre en cause. C'est d'ailleurs pourquoi il est si fréquent que les réformes doivent d'abord être entreprises pour que les opinions changent.
Conclusion : il n'y aura de gain politique à l'échange proposé que si l'on s'arrange vraiment pour que les gens aient effectivement l'impression de s'en tirer à leur avantage. Il suffira donc de mettre sur pied des politiques d'échange, conçues pour que les substituts qui remplaceront les privilèges soient perçus comme plus importants. Ce système revient-il à donner un nouveau tour au "cliquet socialiste", en accroissant le volume de la distribution des prébendes ? Pas nécessairement. Car justement, le nouvel avantage peut être de nature totalement différente.
Des avantages d'une autre nature
On peut par exemple imaginer des politiques qui conduiraient les gens à accepter de perdre un privilège d'Etat en échange d'un avantage privé qui leur semblerait plus grand. Alors, le système prébendier des hommes de l'Etat serait progressivement érodé par la substitution de droits privés en leur lieu et place.
Il peut y avoir des cas où les gens sont prêts à abandonner un privilège permanent et à long terme, en échange d'un avantage immédiat qui vaudrait plus à leurs yeux... et mettrait fin au système. Dans ce cas, les politiques à créer proposeraient aux gens un gain substantiel et immédiat en échange de leur privilège perpétuel. S'ils donnent plus de valeur au bénéfice immédiat, et si cette proximité dans le temps leur permet de l'emporter sur la valeur actuelle cumulée du privilège permanent, alors il y aura une bonne base pour faire l'échange.
Si des gens acceptent de perdre un privilège d'Etat parce que la politique choisie leur remet un avantage privé plus important en contrepartie, alors cette politique peut bel et bien diminuer le rôle des hommes de l'Etat. Si les gens pensent qu'un gain immédiat remplacera avantageusement la perpétuation d'un privilège politique, alors la politique qui en fait l'offre pourra, petit à petit, diminuer à terme le fardeau de l'Etat, même si elle doit l'alourdir dans le court terme immédiat. Aucune de ces deux conclusions ne devrait nous surprendre. Une fois que l'on adopte l'approche des choix publics, et considère que le système politique comporte un véritable marché, alors des transactions normales de ce genre devraient passer comme allant de soi.
===Il ne s'agit que de rendre explicite une pratique qui existe déjà
Sur les marchés privés, les gens s'échangent tous les jours des profits marchands, abandonnant une chose à quoi ils donnent moins de valeur contre une autre à laquelle ils tiennent davantage. C'est la raison d'être de l'échange volontaire. C'est aussi une banalité quotidienne de l'économie privée, que les gens vendent du long terme contre du court terme. Certains vont renoncer à une partie de leur pouvoir d'achat aujourd'hui pour s'assurer un revenu régulier plus tard. D'autres abandonnent leur revenu futur en échange d'une somme liquide à dépenser dans l'immédiat. De telles transactions sont de pure routine dans une économie de marché ; il n'empêche, dans un contexte politique, l'idée de les intégrer à une approche systématique prend un air de nouveauté.
En réalité, tout ce que feraient les politiques en question serait de rendre explicites les principes de l'échange qui existent et fonctionnent déjà sur le marché politique. Il ne s'agit que de reconnaître le marché qui existe qu'on le veuille ou non, et s'y engager pour y passer des contrats. Au lieu d'essayer, sans autre arme que la seule autorité du gouvernement, de s'opposer aux forces et aux contraintes qui dominent ce marché, on utilise ces déterminismes mêmes pour obtenir des résultats plus acceptables.
===Accepter l'existence du marché politique est la clé qui ouvre les portes
Les deux approches que nous venons d'examiner ne sont que les premières pièces d'une batterie de techniques que l'on peut déduire des mêmes principes. Dès lors que l'on aura accepté l'existence et le fonctionnement d'un marché politique, on aboutira à une gamme complète de politiques spécifiquement conçues pour ce marché. Le conflit idéologique, sur le mode conventionnel de l'activité politique, sera alors relayé par le jeu des groupes d'intérêts, et l'on mettra au point des politiques faites sur mesure pour la situation de chacun sur le marché. Au lieu d'affronter bille en tête l'opposition des différents groupes qui s'accrochent à leurs privilèges étatiques, les nouvelles politiques iront chercher la transaction et proposer, chaque fois que c'est possible, d'offrir un avantage dont la valeur perçue sera supérieure, et qui permettra néanmoins de réduire la taille et les prérogatives de l'appareil d'Etat.
Bien sûr, il existe des cas où la situation d'un groupe lui donne un pouvoir tel qu'il puisse exiger davantage que tout ce qu'il est raisonnablement possible de lui offrir en échange. Ce type de situation inspire une autre gamme de politiques. Peut-être pourra-t-on constituer un nouveau groupe qui sera plus puissant que le premier. Une politique qui aura décidé de s'en prendre au groupe d'origine y trouvera un partenaire potentiel. L'hostilité de l'ancien groupe sera alors plus que compensée par le soutien du nouveau. Forts de ce soutien, les législateurs seront alors en mesure de supprimer les privilèges de l'ancien.
On pourrait aussi imaginer que des politiques réussissent à contourner, puis à neutraliser le pouvoir du groupe dominant, avant de s'attaquer au privilège dont il jouit aux dépens de la société. Une fois son pouvoir amoindri, il en ira de même de sa capacité d'exiger et de conserver un privilège de cette taille. Sa capacité de nuire ayant diminué avec son pouvoir, il aura moins à échanger, et recevra donc moins en échange.
Ces politiques portent en filigrane la marque d'une origine commune : chacune d'elles transcrit, dans le domaine de l'action créatrice, une des conclusions critiques de la théorie des choix publics. S'il est vrai qu'il existe un marché politique, où les gens font des échanges, ce fait doit limiter ce qu'un gouvernement peut espérer obtenir par le moyen classique de l'autorité. Mais il lui donne aussi l'occasion de trouver, pour préparer ses politiques, de nouvelles approches qui pourront réussir parce qu'elles seront en prise avec ce marché et utiliseront ses lois propres, là où les autres échouaient pour s'y être opposées.
Quelle procédure suivre ?
Puisqu'il existe une approche commune, quelle est la procédure générale qui pourrait la traduire ? A supposer qu'on puisse la mettre en œuvre, ce type de politique prendrait comme point de départ la critique des choix publics. D'abord comprendre, pour en tirer les leçons, pourquoi les politiques précédentes ont échoué. Démonter, par l'analyse des choix publics, le processus qui a conduit les groupes d'intérêt à mettre en échec les politiques de type traditionnel, ce qui donne la bonne base de départ pour en refaire d'autres. La nouvelle politique visera à créer de toutes pièces des situations où les groupes d'intérêt chercheront d'eux-mêmes à saisir les nouveaux objectifs mis à leur portée, ou se trouveront neutralisés par des groupes plus puissants créés exprès pour les mettre sur la touche, ou encore verront rogner le pouvoir qui garantissait leurs privilèges. En théorie, toutes ces tactiques pourraient permettre de réduire le rôle des hommes de l'Etat comme distributeurs d'avantages particuliers sur le dos des autres.
La révolution du réalisme politique
On voit évidemment que cela implique un style de politique radicalement différent. Car ce dont il s'agit maintenant, c'est de prêter une attention extrême aux détails pratiques. Il faut, armé de la théorie des choix publics, identifier tous les avantages acquis par les différents groupes d'intérêt, tout comme les influences et les soutiens qui s'échangent sur le marché. Ce ne sera qu'après avoir parfaitement compris la situation existante, que l'on pourra se mettre à préparer des politiques jouant avec les forces en présence pour changer la situation. C'est le travail d'un créateur. Il est aussi, bien entendu, fait pour les "bûcheurs", car il n'y a pas de formule idéologique toute faite qui produise automatiquement les bonnes réponses. En fait, il se peut même qu'il n'existe pas de "bonnes" réponses, mais uniquement des solutions meilleures et d'autres moins bonnes.
La caractéristique la plus spectaculaire, si l'on peut dire, de ce type de création politique, c'est l'échelle à laquelle on la pratique. Il faudra faire descendre l'analyse jusqu'au niveau où les individus expriment leurs préférences sur le marché politique, et c'est aussi à ce niveau-là qu'il faudra négocier. La différence est aussi grande que celle qui sépare la macro-économie de la micro-économie. La première traite de grands agrégats et autres statistiques qui représentent ou ne représentent pas — les événements réels. La seconde traite des actes voulus par des personnes qui cherchent à réaliser leurs projets. Elle tient compte des raisons d'agir concrètement présentes, et elle se soucie de savoir quels arbitrages seront faits lorsque les conditions du choix auront changé.
===La politique, comme l'économie, doit s'aborder comme un réseau d'interactions entre les personnes
Nous avons déjà observé que nombre d'économistes, alors qu'ils reconnaissent l'importance primordiale des facteurs micro-économiques, n'appliquent pas cette sagesse au domaine de la politique. Il est courant d'entendre des économistes, dont l'analyse s'inspire pourtant de la micro-économie, appeler à des politiques telles que "l'abolition des entreprises d'Etat" ou "la suppression de toutes les subventions". Ils conseillent aux Premiers Ministres britanniques d'"en finir avec la médecine d'Etat", aux Présidents américains de "supprimer la sécurité sociale". Les politiques savent très bien qu'on ne peut pas obtenir ces résultats par un simple acte de la volonté, et considèrent par conséquent des avis aussi désinvoltes comme étrangers à toute réalité politique. La théorie des choix publics donne à penser qu'ils ont raison.
Si bon nombre d'économistes considèrent que l'étude au niveau micro-économique est indispensable à une vision réaliste de l'économie, alors disons qu'il ne serait pas inutile non plus d'appliquer ce type de raisonnement au domaine politique. S'il est exact que les gens font des offres et des demandes sur les marchés politiques comme ils en font sur les marchés de la production, alors il se pourrait bien que l'approche de la politique à l'échelle "micro" en donne une image bien plus claire et conduise à des solutions bien plus applicables.
===Il existe une micropolitique, qui est à la politique ce que la microéconomie est à l'économie
Voilà donc la nouveauté théorique que je propose dans ce livre : il doit exister une "micropolitique", qui sera à la politique ce que la microéconomie est à l'économie. La microéconomie examine la conduite des personnes et des groupes sur les marchés économiques ; la micropolitique l'étudiera sur les marchés politiques. En outre, de même que la microéconomie est plus proche du niveau où les décisions sont prises et les actions entreprises sur les marchés économiques (ce qui veut dire qu'elle est plus proche des événements réels), il en sera de même de la micropolitique sur les marchés politiques.
Il est facile de parler, en termes "macro", de mettre un terme à l'étatisation, ou d'abolir toutes les subventions, mais les gouvernements ne sont pas près de suivre ces conseils-là, parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Quand les gouvernements connaîtraient tous les défauts de la médecine étatisée ou de la sécurité sociale, cela n'empêcherait pas qu'ils soient impuissants à y changer quoi que ce soit. La macropolitique propose les solutions globales et drastiques que personne n'applique, et qui ratent quand d'aventure on les essaie quand même. Elles échouent parce qu'elles ne tiennent pas suffisamment compte de la réalité politique, celle des décisions prises par les individus et les groupes qui négocient leurs avantages sur le marché politique.
La micropolitique, à l'inverse, va conduire à formuler des programmes qui prennent en compte les conclusions de la théorie des choix publics, et s'en servir pour réorienter la conduite des personnes et des groupes concernés. Au lieu d'essayer d'agir à grande échelle contre les privilèges dont les groupes de pression bénéficient aux dépens de tous les autres, la micropolitique s'attachera à créer des politiques qui modifieront les choix que font les gens, en transformant les conditions de ces choix.
===L'intérêt personnel l'emporte le plus souvent sur les principes
Nous restons encore au niveau théorique, et pourtant nous avons déjà fait bon nombre de découvertes, annonçant une manière de concevoir les politiques publiques bien différente de l'approche traditionnelle, dans le style comme dans le contenu. En premier lieu, on trouve le postulat implicite que l'action politique ne concerne pas seulement la bataille des idées. La micropolitique, forte des conclusions de la théorie des choix publics, partira au contraire du présupposé que l'intérêt personnel joue un rôle prédominant dans la manière dont les gens réagissent aux politiques publiques.
Etant établi qu'il existe un marché politique, et que les gens y font des échanges, c'est à la lumière de leurs effets éventuels sur la valeur de ce qui est échangé qu'ils jugeront les politiques en cause. Il est donc tout à fait possible qu'un groupe soutienne dans l'abstrait une idéologie donnée, et qu'on le voie dans la pratique saboter toute tentative faite pour appliquer ses principes à son cas particulier. Même s'il arrivait que les employés du secteur public se mettent à penser que l'Etat est trop gros, il s'en trouvera bien peu pour accepter que l'on fasse maigrir leur petit morceau d'Etat à eux.
===On ne persuadera pas les gens de renoncer à leurs privilèges parce qu'ils sont injustes
Une deuxième différence essentielle réside dans l'attitude adoptée par la micropolitique face aux multiples privilèges que les groupes minoritaires reçoivent des hommes de l'Etat. L'attitude libérale classique consiste, les tenant pour illégitimes, à vouloir les éliminer. Etant donné que les gens défendent leurs fromages, et qu'il y a peu de soutien à attendre de ceux qui doivent les payer, cette ambition ne conduit jamais qu'au ressentiment et à l'hostilité des groupes dont les privilèges sont menacés ; d'où l'échec qui s'ensuit généralement.
L'attitude de la micropolitique consiste à s'accommoder du fait que le privilège existe, et qu'il sera défendu, quoi que puisse valoir sa prétention à être légitime. Si l'on veut que les gens acceptent son élimination, il faudra leur offrir quelque chose de plus intéressant en échange, ou alors commencer par réduire le pouvoir qui leur permet de conserver cet avantage. Ce qu'on oublie dans l'analyse traditionnelle est que le statu quo lui-même est considéré comme une source de légitimité. Si un privilège existe depuis longtemps, ses bénéficiaires vont le considérer comme un droit acquis, un élément "à part entière" de la société établie. Ils se battront pour le défendre, se sentant agressés par l'initiative qui le menace, et n'étant certes pas en peine de trouver l'idéologie adéquate pour justifier leur attitude. Telle était d'ailleurs — en gros — la situation fondamentale pendant la lutte pour l'indépendance américaine ; si on se battait, c'était pour préserver des avantages déjà acquis2 contre de nouvelles prétentions, et non pour réclamer des privilèges inédits.
Il ne manque sans doute pas de bonnes raisons pour contester la légitimité des privilèges particuliers. Ces arguments peuvent être importants pour les principes, mais il n'y a aucune raison d'en attendre qu'ils réussissent à éliminer les avantages en question. On a bien plus de chances d'obtenir un changement en ayant recours à des politiques d'échange de ces privilèges, qu'à l'occasion d'une confrontation directe visant à les abolir. Ce n'est pas que la micropolitique refuse de tenir compte des principes moraux ; simplement, elle va mieux comprendre le point de vue de ceux dont l'assiette est beurrée par les hommes de l'Etat. En descendant au niveau où les décisions sont prises par les personnes et les groupes, et en examinant leurs raisons d'agir, elle est naturellement amenée à envisager la manière dont ils perçoivent la situation. Sans l'accepter le moins du monde pour autant, elle va tenir compte de leur prétention à faire de l'usage une source de légitimité, et rechercher des politiques leur offrant compensation pour ce qu'ils doivent perdre.
Adieu au "grand soir"
La micropolitique ne sera pas seulement moins agressive que les méthodes conventionnelles, elle sera aussi moins globale dans ses ambitions. Elle abandonne l'idée d'appliquer la vision d'une économie de liberté immédiatement et dans tous les domaines. A la place, elle va partout chercher des politiques qui permettront de faire des brèches, puis des incursions dans la forteresse de l'Etat ; elle veut créer une situation dans laquelle les privilèges redistributifs des hommes de l'Etat seront peu à peu négociés en échange de droits qui paraîtront avoir plus de valeur. En somme, le coup de balai est remis aux Calendes grecques, et la micropolitique propose des coups de pinceau ; il s'agit d'étudier attentivement chaque situation, et d'imaginer d'une politique qui devra réussir dans ce domaine-là. Elle est donc plus détaillée et plus progressive.
Pour réussir, au lieu de prendre à rebrousse-poil les groupes d'intérêts en place, elle propose de leur tenir la main. Il lui arrivera d'envisager une augmentation temporaire des dépenses publiques, afin de pouvoir enclencher un processus de diminution par la suite. Parfois, elle offrira à un groupe particulier ce qui a tout l'air d'être une faveur injuste, pour l'inciter à abandonner un privilège plus détestable et plus durable encore.
Un opportunisme d'apparence
Non seulement elle est moins globaliste, mais elle semble aussi moins cohérente. Elle n'entend pas appliquer le principe simple d'une société libre, débarrassée dans tous les domaines des subventions et des ingérences des hommes de l'Etat. Ce principe-là est davantage un objectif à long terme qu'un guide pratique pour la formulation d'une politique. La micropolitique produira des politiques différentes dans presque tous les cas, parce qu'elle sait que chaque activité pose des problèmes particuliers. Chacun des groupes d'intérêt, les caractéristiques de son privilège, et son mode de fonctionnement initial varient d'un secteur à l'autre. Il n'existe pas de formule simple. Si les problèmes sont différents dans chaque domaine, les solutions doivent l'être aussi.
La micropolitique a bel et bien une cohérence, mais celle-ci tient à l'unité de son approche. Politiques et recommandations vont changer d'un domaine à l'autre, mais la méthode qui les aura produites sera toujours celle que la théorie commune a imaginée. Tout commence par une analyse détaillée du statu quo ; différents privilèges et rentes obtenus, nature des groupes d'intérêts concernés, pouvoir et pressions qu'ils peuvent exercer. De là, on imagine les politiques d'échange des avantages, pour modifier la structure des incitations et changer les rapports de pouvoir entre les différents groupes. Ces réformes créeront une nouvelle situation qui, pour ainsi dire par construction, devra être acceptée par les personnes et les groupes et conduire, à terme, à diminuer les rentes de redistribution et à réduire la part des biens et services fournis par le secteur d'Etat.
===Peut-on mettre en place un processus d'évolution spontanée ?
L'approche micropolitique est plus conservatrice que les politiques libérales classiques, précisément parce qu'elle est plus graduelle et plus progressive. Il est rare qu'elle propose des politiques faites pour obtenir un changement soudain et un impact immédiat. Elle essayera plutôt de déclencher une suite de décisions qui, au bout du compte, mèneront aux objectifs désirés.
Ce processus exige du temps. Il prend la société comme elle est. Il introduit çà et là des réformes qui la feront changer progressivement, mais inexorablement, dans le sens d'une diminution des subventions et de l'influence des hommes de l'Etat dans l'économie. Le résultat cumulé de cette approche politique sera d'accroître le degré d'autonomie au sein de la société, d'élargir les domaines de décision qui échappent au contrôle étatique et relèvent du choix des particuliers et des associations volontaires. Alors qu'il est le contraire d'un programme révolutionnaire, il vise cependant à susciter un mouvement massif, régulier et cohérent, dans une seule direction.
C'est une chose de se faire une image de ce que pourrait être une société meilleure. C'en est une autre d'analyser le fonctionnement de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Le rôle de la micropolitique sera de se placer sur le terrain intermédiaire, et d'imaginer les politiques qui, prenant le monde tel qu'il est, le rapprocheront de ce qu'il pourrait être. Le rêve est que les hommes de l'Etat cessent d'intervenir dans les choix économiques, de réglementer et de confisquer l'argent des gens au mépris de leurs préférences. La réalité est qu'il ne suffit pas de le vouloir, ni même d'en persuader les autres pour y arriver. Seules des politiques peuvent le faire, si elles conduisent les gens à renoncer aux privilèges et au pouvoir de dominer les autres que leur donnent les hommes de l'Etat, d'une manière qui rapportera plus de sympathie que d'hostilité au gouvernement qui les mène.
La réforme micropolitique n'est pas conçue pour être tolérée, mais préférée à la situation existante
Il y a une distinction très nette à faire entre cette approche et le simple gradualisme. Ce dernier implique une politique des petits pas, pour ainsi dire à un train de sénateur. Ces petits pas peuvent très bien aller à l'encontre des intérêts de la société, supposant que s'ils sont suffisamment modestes, ils ne déclencheront pas d'opposition assez forte pour les empêcher de s'imposer. Le fabianisme3 en est un bon exemple, dont l'idée de base était d'instaurer le socialisme — qui à l'époque était totalement rejeté — à travers une série d'étapes dont chacune serait assez minime pour "passer" sans rencontrer l'opposition que l'objectif final aurait immanquablement suscitée.
La micropolitique n'est pas gradualiste. Les politiques conçues à l'intérieur de ce cadre ne sont pas faites pour être tolérées, mais pour être préférées à l'état actuel de la société. Certaines de ses réformes pourront être massives si un nombre suffisant de groupes et de personnes adopte la solution proposée à la place. Elle n'a pas non plus la moindre conception d'un projet terminal pour la société ; elle ne se soucie que d'instaurer un processus qui réduira les transferts forcés et autres ingérences des hommes de l'Etat. Quel que soit le type de société qui émergera de ce processus, ce sera le produit spontané du jeu réciproque entre des millions de décisions et d'actions différentes, et non un ordre social déclaré "supérieur" par on ne sait quelle autorité planificatrice. En outre, son approche s'appuie essentiellement sur les forces établies de la société, s'efforçant seulement de créer les conditions nécessaires pour les réorienter.
La micropolitique n'est pas un programme : c'est un mode d'emploi
Par conséquent, s'il est possible que ses réformes se fassent progressivement, elle n'est pas gradualiste. Elle ne cherche pas à faire les mêmes choses que les politiques classiques, en se contentant de les réaliser plus lentement. Elle cherche à créer des politiques nouvelles, pour faire des choses différentes. Plus précisément encore, elle cherche à les faire d'une autre façon. Elle ne part pas avec une liste de mesures à prendre, pour s'y atteler ensuite tout doucement. Elle part en ignorant ce qu'il faut faire, armée seulement d'une technique qui lui permettra de faire naître des politiques en réponse aux différentes situations qu'elle rencontre. C'est une approche et non un ensemble de priorités. Au lieu d'un programme à mettre en œuvre, on trouve un mode d'emploi pour la fabrication des politiques.
Du rêve à la réalisation
Notre projet est donc complet. L'analyse des choix publics nous a permis de comprendre pourquoi la réaction aux politiques traditionnelles prenait la forme qu'on lui connaît : elles méconnaissent le marché politique qui est à l'œuvre, ou ne savent pas s'y adapter. Alors apparaît cette idée d'un système qui concevrait les politiques publiques en se fondant sur cette analyse même, et contre lequel ces obstacles seraient inopérants, parce qu'il tiendrait compte du marché politique et fonctionnerait dans son cadre de référence. Un tel système, semble-t-il, permettrait de créer des politiques à la demande, chacune en réponse à une situation différente. Son unité serait au niveau de la méthode, et non plus du contenu.
Alors, voilà la question qui se pose maintenant : cette belle théorie, peut-elle s'incarner dans une pratique, et produire un tel système ? Existe-t-il dans les faits une approche "micropolitique", qui réaliserait ce que la théorie affirme être possible ? La réponse est oui. L'approche existe bel et bien, et qui plus est, elle est déjà à l'œuvre. Conformément à notre thèse, suivant laquelle en politique la théorie explique la pratique, et la précède rarement, tout ce que nous venons d'envisager décrit quelque chose qui existe déjà. La pratique micropolitique est déjà à l'œuvre, et ne compte plus ses succès. Les programmes issus de cette pratique ont déjà permis d'obtenir ce que les tentatives précédentes n'avaient pas su réaliser. Les gouvernements de droite qui l'ont utilisée ont pu faire aboutir une bonne partie de leurs projets initiaux. Qui plus est, à mesure que ses résultats concrets devenaient visibles, elle a déclenché une cascade de changements dans le monde entier.
===C'est le choix d'une approche micropolitique qui a déterminé les succès de Thatcher et Reagan
Cette fameuse différence entre les gouvernements Nixon et Heath dans les années soixante-dix, et les gouvernements Reagan et Thatcher dans les années quatre-vingts, rien ne nous empêche plus de la reproduire, connaissant désormais tous ses secrets. Aucune nouvelle victoire notable dans la bataille des idées, pas de différences de caractère suffisantes entre les protagonistes ; aucun changement dans le monde rendant subitement viables des politiques impraticables dix années plus tôt. C'est dans les politiques elles-mêmes que se trouvait le changement. Et ce changement, nous lui avons donné un nom et une explication théorique : ce changement, c'était la micropolitique.
Les propositions de réforme dont les gouvernements récents s'étaient pourvus provenaient d'une approche micropolitique. Comme les précédents, ils savaient ce qu'ils voulaient. Cependant, à la différence de ces derniers, ils avaient dans leur sac un certain nombre de programmes qui, eux, permettaient effectivement de l'obtenir. L'émergence, dans le courant des années soixante-dix, d'une méthode radicalement nouvelle pour formuler les politiques, avait mis une panoplie complète d'applications détaillées à la disposition de ces gouvernements. Au lieu de se jeter tête baissée dans le piège d'un affrontement avec les groupes d'intérêt mis en cause, ils surent alors proposer à ces groupes des politiques qui leur offraient l'occasion d'obtenir, en échange, des avantages supérieurs.
Les programmes conservateurs des années soixante-dix ont échoué. Ceux des années quatre-vingts ont largement réussi. La différence résidait dans la technique politique. Elle tenait directement à l'assimilation du concept de "marché politique" par les professionnels de la mise au point des réformes.
Problèmes, leurres et solutions
Deux domaines où la micropolitique a renouvelé l'approche des problèmes
Poursuivons l'analyse de la micropolitique en comparant les propositions concrètes de la politique conventionnelle avec celles qui sont nées de la vision de la politique comme lieu d'échanges. Le meilleur moyen de percevoir leurs différences peut être de montrer en quoi elle s'opposent sur la solution de certains problèmes particulièrement tenaces.
Les "services publics" locaux
Parmi les nombreux domaines de la société et de l'économie qui méritent la critique des gens "de droite" ou des "libéraux", on peut citer les prestations offertes par les "services publics" locaux : l'essentiel du problème est que les collectivités ont progressivement pris le contrôle d'un grand nombre de services locaux, ce qui a largement politisé la vie économique, avec tous les problèmes qu'entraîne la production de type "public".
Typiquement, un "service public" local est directement contrôlé par les élus de la collectivité locale, qui gère ses services et emploie directement son personnel. Le service est financé par les recettes publiques locales, qui proviennent d'impôts sur les entreprises, sur les propriétaires fonciers locaux ou les particuliers, et aussi par des subventions de l'Etat qui constituent une part croissante du total. Le financement et la production des "services publics" locaux sont donc fournis par le secteur "public" de l'économie.
Excès de dépenses et dégradation du service
Comme l'a montré l'étude du fonctionnement des services étatisés, tout cela force le public à payer sans qu'il puisse contrôler le niveau de la production ni la qualité du service. A long terme, le service tend à être produit en excès, le rapport efficacité/coût diminue, avec un personnel en surnombre et un capital dégradé, et le service est capturé par les producteurs, méprisant entièrement les préférences des consommateurs. Les finances publiques locales n'échappent pas à la loi du genre et sont délibérément redistributives ; les charges élevées constituent un handicap réel pour les entreprises locales, et la forte imposition foncière tombe de façon discriminatoire sur certaines catégories de propriétaires immobiliers qui, dans bien des cas, ne représentent qu'une petite minorité de l'électorat.
Les lois du marché politique qui devaient y conduire sont faciles à retrouver : la petite proportion de ceux qui font l'acte de payer les taxes locales est moins nombreuse que ceux qui pensent en profiter à leurs dépens. Les entreprises locales n'ont pas de suffrages à échanger, et le système n'impose guère de sanctions aux élus dont les excès affaiblissent leur propre base d'imposition, parce que le système compense la différence par une dotation de l'Etat central. Les candidats aux élections locales ont donc intérêt à offrir le plus possible de services, car ils sont quasiment perçus comme "gratuits" là où ils sont reçus.
La réforme technocratique
Le paradigme conventionnel a inspiré deux propositions de réforme. La première, qui ne mérite qu'un bref examen, entendait refondre l'ensemble du système des collectivités locales. L'amalgame en unités plus grandes était censé permettre des économies d'échelle, conduisant à de nouveaux sommets dans l'efficacité productive des services. Cette solution, qui fut appliquée en Grande-Bretagne au début des années soixante-dix, engendra exactement le contraire de ce que l'on avait prétendu souhaiter. Les nouvelles entités étaient trop grandes et trop éloignées des électeurs pour subir la moindre influence de leur part, ce qui, bien sûr, réduisait d'autant l'intérêt qu'ils pouvaient y trouver. Ils ne trouvaient pas du tout à leur goût ce nouveau gigantisme, ni ces administrations trop grosses, trop puissantes et trop lointaines pour qu'on puisse se faire entendre d'elles.
L'inefficacité et le gaspillage se développèrent en conséquence, et les abus devinrent rapidement endémiques. Certains élus locaux s'étaient rendus compte que le nouveau système mettait à leur disposition des ressources supplémentaires, littéralement pour acheter les suffrages de groupes minoritaires dans leur région. Ils se mirent à distribuer force subventions à toutes sortes de causes, dont le principal point commun semblait être leur dépendance vis-à-vis des politiciens qui les leur avaient octroyées.
La "macro"-politique libérale
Une autre proposition fut avancée à plusieurs reprises. Elle proposait de pallier l'impuissance du consommateur en lui permettant de ne payer le service qu'au moment de sa fourniture. Les services continueraient à être fournis par les autorités locales, mais seraient réglés directement par les consommateurs au moment où ils les recevaient, au lieu d'être financés par l'imposition générale1. Cette proposition visait à faire ressentir aux consommateurs le coût de chacun des services, ce qui n'était pas possible lorsque le financement avait lieu par l'impôt. Contraints à un paiement direct, sonnant et trébuchant, les citoyens prendraient la mesure du coût réel de chaque service, et feraient pression sur les autorités locales afin d'en avoir pour leur argent.
L'avantage supplémentaire offert par ce système était la possibilité pour le consommateur de limiter la quantité du service à ce qu'il était effectivement prêt à payer. On tenait pour acquis que le tarif à la fourniture devrait couvrir la plus grande partie du prix de revient, et que la quantité fournie s'ajusterait donc progressivement à ce que le consommateur était prêt à dépenser. Par exemple, si les coûts du ramassage des ordures étaient directement facturés à l'usager, peut-être serait-il prêt à accepter une seule collecte hebdomadaire au lieu de deux, et peut-être même une tous les quinze jours. La fourniture serait alors ajustée à cette demande.
A première vue, ce système offrait au consommateur un pouvoir de décision considérable, là où il n'en avait eu aucun. Devant payer directement, il apprécierait le coût de chaque service, d'une manière que le financement centralisé interdit de réaliser, et deviendrait maître de sa propre consommation. Economiquement, c'était un avantage indiscutable. Le citoyen ferait sentir au "service public" le poids de son porte-monnaie. Faute d'avoir le choix du fournisseur, il pourrait au moins décider de la quantité de service demandée.
On aurait continué à subir les tares de la fourniture publique
Or, du point de vue des marchés politiques, ce système est beaucoup moins intéressant. Pour commencer, il laisse la production du service intégralement entre les mains des personnages publics, ne transférant que son financement à des mains privées. Ce qui veut dire que tous les effets de la fourniture publique se perpétuent imperturbablement. L'inefficacité relative, les sureffectifs, la décapitalisation, l'absence de choix et la capture par les producteurs, autant de caractéristiques de la production par un monopole public, et transférer son financement au secteur privé n'en atténue pas forcément les effets.
On négligeait les illusions que l'intervention publique engendre systématiquement
Non moins importante est l'objection qu'au départ, la plupart des usagers perçoivent les avantages du service bien plus qu'ils ne perçoivent la charge de son coût. Même si l'objectif — fort louable — est de faire en sorte qu'ils perçoivent ce dernier, ils n'ont aucune raison de désirer en prendre conscience. Nombre d'entre eux s'imaginent que ce sont "les autres" qui paient la plus grande partie des services reçus, et ne se rendent pas compte de ce qu'ils paient eux-mêmes, par l'imposition directe et surtout indirecte. Par conséquent, alors même que leur liberté de choisir en serait évidemment accrue, envisager une tarification directe pour leur faire payer l'intégralité du service risque en fait de provoquer leur opposition furieuse à un tel projet.
Bien sûr, le corollaire du système de la tarification directe est que l'impôt servant généralement à financer les services locaux et nationaux serait réduit en conséquence. Les gens pourraient alors disposer de l'argent pour acheter ou non les services, comme ils l'entendent. Cependant, rendre aux gens leur argent en lieu et place de services (pseudo-)gratuits ne s'accorde pas avec les conclusions de l'analyse des choix publics, suivant lesquelles un groupe donne davantage de valeur aux services qu'il reçoit que les autres ne souffrent d'avoir à les payer. En d'autres termes, passer de la pseudo-gratuité à la tarification directe en matière de "services publics" méconnaît les réalités du marché politique au lieu de les prendre en compte.
jeu continuel des pressions politiques aurait progressivement érodé les disciplines envisagées
A propos de l'impact politique, autre chose mérite d'être noté : ce système de tarification exige que le prix des services soit fixé par les autorités locales. Il se peut bien qu'à l'origine, le tarif soit établi d'après le prix de revient réel, mais il faudra bien qu'il soit révisé périodiquement par l'assemblée locale, ne serait-ce que pour tenir compte des accroissements des coûts de production. Ce qui signifie que les élus devront envisager des augmentations de tarifs, et prendre leurs responsabilités en la matière. C'est à ce stade qu'ils sont exposés à des pressions extrêmement fortes de tous les groupes minoritaires qui pensent que leur cause est juste, ou dont les porte-parole et autres "conseillers en communication" ont jugé qu'elle pouvait l'emporter. On leur demandera d'exempter les chômeurs de ces augmentations, et aussi peut-être les personnes âgées et les bénéficiaires de l'aide sociale. S'ils refusent, on fera connaître à l'opinion la dureté de leur cœur de pierre.
Les groupes de pression pourront alors être abordés sur le marché politique par des candidats qui proposeront de leur offrir les mêmes services à des tarifs spéciaux subventionnés, et la pression s'exercera partout pour réduire l'impact des augmentations de prix. Au bout d'un certain temps, il n'est pas impossible du tout que ce qui avait démarré sous la forme d'un financement intégral par l'usager termine sa carrière sous la forme d'un paiement de plus en plus symbolique, le déficit étant couvert par la subvention pour entretenir certains groupes clés de la population. C'est ainsi que les pressions politiques peuvent conduire le principe du paiement direct à se détruire lui-même, les élus qui voudraient imposer un système de vérité des prix s'exposant inutilement aux inconvénients électoraux d'une impopularité que d'autres auront su éviter.
Pour éviter cela, peut-être faudrait-il que le Parlement vote une loi pour abolir le pouvoir discrétionnaire de fixer les tarifs publics. Mais une telle décision engendrerait à son tour une tempête d'opposition de la part des élus locaux dépouillés de leurs prérogatives, ainsi que des groupes minoritaires menacés dans leurs privilèges. Son incapacité à reconnaître la force des marchés politiques condamne donc vraisemblablement le système du paiement direct à l'échec. Il est de fait qu'on ne le voit guère fonctionner au niveau local.
La proposition micropolitique : privatiser non pas le financement, mais la fourniture des services publics locaux
Voyant peut-être mieux que d'autres les ouvertures et les impasses de cette configuration politique, les tenants de la micropolitique ont, à la place du paiement direct des services, mis au point la proposition symétrique, qui consiste à faire appel aux entreprises privées pour fournir les services habituellement fournis par le secteur public. C'est ce qu'on appelle la "convention", transfert par contrat de la fourniture des services au secteur privé. Cette démarche laisse les autorités locales responsables des services, qu'elles continuent à financer à l'aide des fonds publics locaux et nationaux. La différence est qu'au lieu d'employer son propre personnel et ses propres cadres, la collectivité locale paie des entreprises privées pour exécuter la mission de fournir les services, les ayant mises en concurrence pour l'obtention des contrats.
Le système du paiement par l'usager envisageait de confier le financement au secteur privé, tout en laissant la production entre des mains publiques. Le système de la convention, à l'inverse, transfère la production au secteur privé, tout en lui conservant un financement public. Cela ne donne aux usagers aucun contrôle direct sur la consommation, comme l'aurait fait le système du paiement direct, et ils n'ont pas davantage le choix de leurs fournisseurs qu'avec le système du paiement direct ou de la régie2 locale. Ce que fait la convention, c'est créer une concurrence entre les candidats pour la fourniture des services.
Des contraintes qui poussent à l'amélioration du service
Avec le système de la convention, les entreprises doivent surenchérir pour les contrats de service local. C'est ainsi que l'on introduit la concurrence, les fournisseurs devant maintenir les coûts les plus bas possibles pour une qualité élevée. S'ils ne le font pas, le contrat ira à d'autres entreprises. En général, les conventions seront de courte durée, par exemple trois ans, cela dépend du type de service. Les entreprises qui répondront aux appels d'offre doivent rester efficaces, et se maintenir à niveau en matière d'équipement et de technique. Celle qui n'y parviendrait pas verrait le contrat passer à des entreprises restées compétitives.
Le résultat est que la plupart des traits caractéristiques de la fourniture publique disparaissent. Avec la fourniture privée, l'inefficacité, les sureffectifs et le manque de capital ont beaucoup moins de chances de persister, pour la raison bien simple que les entreprises qui se laissent aller à ce genre de pratiques savent qu'elles perdront leur marché au profit de celles qui savent s'en garder. La capture par les producteurs y est également beaucoup plus difficile, parce que les contrats peuvent être repris par des concurrents capables de satisfaire le consommateur, et que ceci entraîne un risque de faillite pour celles qui ne le feraient pas.
Il en résulte que la collectivité bénéficie d'un service meilleur et moins cher. Les économies ainsi réalisées sont estimées entre 20 et 40 %, selon le type de service et le pays. En Grande-Bretagne, les premières économies calculées par l'Institut des Etudes Fiscales étaient de 22 % en moyenne. Ce chiffre est probablement en-deçà de la réalité, car les économies sont généralement moindres la première année. Les chiffres représentent la différence entre le prix de revient des services municipaux et celui d'un équivalent privé, y compris les bénéfices de l'entreprise et les impôts qu'elle doit payer.
Bien ménager les intérêts tels que les groupes les perçoivent
Il y a donc là un gain possible pour les élus locaux, qui n'ont pas toujours tout l'argent nécessaire pour leurs projets, comme pour le public, qui n'aime pas payer plus cher que nécessaire. Le système conventionnel offre potentiellement un avantage net s'il est possible de le mettre en place en prenant en compte les contraintes du marché politique. C'est loin d'être une tâche facile, et cela exige que les projets s'inspirent de l'analyse des choix publics, les différents groupes d'intérêt devant tous être pris en considération.
Le public est surtout sensible à la qualité du service. Par conséquent, tout transfert à un contractant extérieur doit essayer d'obtenir une qualité au moins égale. Ce qui peut se faire si les contrats sont rédigés avec rigueur, comportant clauses de pénalité et garanties d'exécution. Le public souhaite aussi qu'on tienne compte de ses besoins, et nombre d'entreprises, dès qu'elles ont remporté un contrat avec une collectivité locale, prennent la peine de faire des études de marché pour se tenir au courant de ce que désire le public.
La bureaucratie locale risque de perdre position et avantages si ses tâches sont dévolues au secteur privé. Il faut donc que les élus qui passent les conventions forment leurs équipes d'encadrement à la tâche de suivi et de police des contrats. Cela leur donnera une occasion de remplacer les responsabilités perdues par un travail plus intéressant encore.
C'est le personnel des "services publics" qui est le plus menacé, et par conséquent le plus susceptible de s'opposer fortement à ce qu'on remette les tâches au secteur privé. C'est pourquoi les collectivités locales stipulent souvent que leur personnel aura priorité pour les nouveaux emplois créés dans le privé. Nombre d'entre elles neutralisent aussi l'opposition potentielle par une politique évitant toute perte d'emploi forcée. Elle consiste à recaser leur personnel en lui offrant les emplois qui, sinon, auraient été occupés par des nouveaux venus. Une autre politique est encore de leur offrir des indemnités de départ à des conditions suffisamment généreuses pour amener assez d'employés à les accepter volontairement.
Les dirigeants syndicaux sont les plus difficiles à traiter, car on ne peut pas leur offrir de poste qui puisse se comparer au pouvoir dont ils jouissaient dans leurs fonctions antérieures. En conséquence, il faut habituellement offrir au personnel des conditions suffisamment intéressantes pour passer par-dessus la tête des chefs syndicalistes et obtenir un accord direct des employés.
Les salariés satisfaits
L'expérience pratique de l'appel aux entreprises privées pour les services locaux en Grande-Bretagne a montré que les services pouvaient fonctionner avec 15 à 20 % de personnel en moins. Les salariés en surnombre peuvent être affectés ailleurs, éventuellement après recyclage. Ceux qui sont engagés par le contractant privé y trouvent des emplois plus qualifiés et des conditions d'avancement plus favorables. La sécurité de l'emploi est moindre dans le privé, et les systèmes de retraite moins avantageux, dans une large mesure parce qu'aucune entreprise privée ne peut se permettre d'indexer les retraites comme le fait le secteur public. En revanche, le salaire est aussi bon, et les avantages sont les mêmes. Le travail n'est pas plus dur, mais il est utilisé de façon plus efficace, et beaucoup de salariés se félicitent d'avoir sauté le pas.
La satisfaction de l'usager dépendra des procédures prévues pour garantir la qualité des services
Cependant, si l'élu, soumis à tant de pressions, est fort sensible aux économies de coûts, il ne faut pas en attendre trop de satisfaction de la part du consommateur. Il n'est pas contre l'abaissement des coûts et des impôts locaux qu'apporte la convention, mais nous savons qu'il perçoit le service lui-même beaucoup plus directement que ce qu'il lui en coûte. C'est pourquoi le contrôle de la qualité est si important pour le succès de cette politique. Si l'on peut mettre en place un nouveau service qui sera plus efficace et attentif à ses besoins, le consommateur verra vraiment la différence avec le service déplorable et souvent hautain qui résulte de la capture par les producteurs dans le secteur public.
Ceci, à son tour, exige la mise en œuvre d'un certain nombre de techniques détaillées. Beaucoup de collectivités locales "pré-qualifient" les soumissions, examinant soigneusement les offres pour éliminer celles qui n'atteindraient pas les normes de qualité requises. La sélection finale se fait à partir d'une liste des entreprises jugées suffisamment compétentes et expérimentées. Nombre d'élus font appel à des consultants extérieurs pour mettre au point les contrats, et presque tous exigent des garanties d'exécution, de sorte que si l'entreprise fait défaut, ou faillite, le service n'en pâtisse pas. Une autre procédure prévoit des pénalités pécuniaires au cas où le service ne correspondrait pas aux normes fixées, chose qu'aucune collectivité ne pourrait se permettre d'exiger de ses propres services. Bien sûr, la corruption demeure possible dans le système d'octroi des contrats mais, avec un appel d'offre largement public, elle est bien moins développée que dans les services locaux, qui échappent largement à la vigilance des citoyens.
Une réforme typiquement micropolitique
Les méthodes de la micropolitique transparaissent à toutes les étapes du processus. L'analyse identifie tous les groupes du marché politique en question, et repère l'avantage particulier de chacun. Puis une politique est mise au point, qui offrira un avantage supérieur au plus grand nombre possible. Toutes les oppositions sont envisagées, la politique étant faite pour en neutraliser la plupart à l'avance. Le résultat est une politique qui marche, et dont le succès inspire tellement confiance qu'il permettra de l'appliquer ailleurs.
La convention n'est pas la solution libérale pour les "services publics" locaux. C'est un succès parce qu'elle conduit à de meilleurs services, et pour moins cher. Elle introduit des éléments de liberté en soustrayant la production au secteur public pour la restituer au secteur et à l'entreprise privés. Elle introduit la concurrence, aussi bien pour la qualité des services que pour la détermination des prix, et encourage l'innovation et la performance.
Les macro-politiciens la critiqueront et la critiquent parce qu'elle ne va pas assez loin. La vraie liberté, font-ils valoir, serait que les habitants d'une circonscription quelconque décident eux-mêmes directement à quelle entreprise ils feront appel pour les fournir, et quelle quantité de service ils vont recevoir. La critique est parfaitement juste ; faire appel à des contractants privés n'est pas la libre entreprise. Le financement est toujours collectivisé, et refuse sa place au choix personnel. Le problème se pose lorsque, voulant mettre en place un système totalement libre, la théorie des choix publics annonce que vous vous heurterez à un mur du fait des pressions des groupes d'intérêt concernés, alors qu'un système de contrats serait accepté. Le résultat ? Alors que les partisans d'une solution complète s'efforçaient encore de gagner la bataille des idées, en Grande-Bretagne les micropoliticiens se sont entre-temps débrouillés pour porter le système de la convention à un niveau de réussite tel que le gouvernement, bien assuré sur ses arrières, a rendu obligatoire l'appel à des entrepreneurs privés par les collectivités locales.
Le contraste entre la solution micropolitique et celles du paradigme conventionnel (comme le paiement direct par l'utilisateur), montre à quel point extrême la première s'implique dans le monde réel. Elle veut tellement transformer l'idée en réalité sur le marché politique qu'en mettant au point ses techniques, elle recherche le moindre détail lui permettant de contourner les obstacles éventuels. Son souci n'est donc pas de chercher une solution passe-partout, mais de tailler sur mesures une politique pour chaque situation. Et elle réussit souvent parce que, lorsqu'elles sont faites sur mesure, les politiques sont évidemment mieux ajustées.
Deuxième exemple : l'enseignement étatisé
Un autre exemple de problèmes sérieux engendrés par la production étatisée est l'enseignement public. En Grande-Bretagne, environ 93 % des enfants dépendent du secteur public et de lui seul pour leur instruction primaire et secondaire. Il existe un substitut théorique sous la forme d'écoles entièrement payantes, mais comme tout le monde doit payer l'impôt au système d'Etat, seule la minorité des gens qui peuvent se permettre de payer deux fois a effectivement accès à ces écoles privées. En conséquence, les écoles payantes apparaissent trop chères, alors que leurs tarifs ne font que correspondre en gros à ce que coûte l'enseignement public, si l'on y inclut les dépenses administratives au niveau local et national.
L'inversion classique du "service public" : impuissance des bénéficiaires prétendus, tyrannie des employés officiels
La plupart des parents n'avaient aucune option réelle dans le cadre du système d'Etat. Leur enfant était affecté à l'école la plus proche, et bien qu'on ait prévu une possibilité de choisir, il suffisait aux autorités locales d'invoquer les "intérêts de l'éducation" pour la faire annuler. La plupart des tares de l'offre publique y apparaissaient au grand jour. Les parents étaient mécontents de la qualité de l'enseignement, et pouvaient constater qu'on répondait à la baisse du niveau en essayant d'empêcher qu'on le mesure, au lieu de chercher à l'améliorer.
A toute occasion, on se heurtait aux effets de la capture par les producteurs . La "qualité du service" par exemple, n'était pas appréciée d'après les résultats, mais d'après les ressources utilisées. Ainsi, ce n'était pas le niveau de connaissances des enfants qui était censé compter, mais l'effectif des classes et le niveau de qualification supposé des enseignants. Le coût et la taille des services administratifs prenaient une part énorme, et croissante, du budget global. Les tentatives pour faire des économies n'affectaient en rien le gaspillage, mais touchaient en revanche le capital et l'équipement, ainsi que les services essentiels.
Les parents étaient forcés par l'impôt de payer une somme qu'ils ne pouvaient pas contrôler, pour financer un enseignement où ils n'avaient aucun choix et aucune possibilité de faire connaître leurs préférences. En somme, ils payaient cher une ration imposée. L'uniformité était reine, sans variété ni choix, et les priorités "pédagogiques" étaient bien sûr dictées par les producteurs. Quelle idée, de demander leur avis aux consommateurs ! Ces priorités comprenaient évidemment ce que nombre de parents comprenaient comme un endoctrinement politique, n'ayant rien à voir avec de l'enseignement3.
Comment privatiser les décisions sans toucher au mythe de la "gratuité" ?
Réintroduire dans le système éducatif des disciplines de marché pour laisser un peu de place aux besoins des consommateurs, posait aux législateurs un double problème. Aussi mécontents qu'ils aient été du produit fourni, les gens avaient pris l'habitude d'un service d'enseignement "gratuit" lors de sa consommation.
Faciliter l'inscription aux écoles privées ?
Un type de solution envisagé consistait à se tourner vers les écoles privées, en cherchant les moyens d'en ouvrir l'accès à un plus grand nombre de parents ordinaires, pour accroître le nombre des enfants qui leur étaient confiés.
L'une des mesures proposées consistait à permettre de déduire des impôts les frais de scolarité privée, ce qui en réduisait le coût en termes réels, et donnait à davantage de gens les moyens d'accéder aux écoles payantes. Une variante similaire proposait d'offrir un abattement fiscal à ceux qui quitteraient l'enseignement d'Etat pour choisir une école privée. Ces solutions s'appuyaient sur l'idée que ces parents épargnaient à "l'Etat" le coût de l'éducation de leurs enfants, et que peut-être une petite incitation en encouragerait d'autres à les imiter. Si l'abattement était bien calculé, l'"Etat", en n'ayant pas à instruire ces enfants, pourrait épargner davantage qu'"il" n'y perdrait en impôts non versés.
Il fallait trouver une solution pour tout le monde
Toutes ces propositions souffraient de cette faiblesse fondamentale que le nombre des bénéficiaires éventuels du secteur privé serait de toutes façons trop restreint. On a de bonnes raisons de penser qu'il existe dans les classes moyennes un groupe de pression latent qui ne demande qu'à s'exprimer, pour avoir davantage les moyens d'accéder aux écoles privées. Les sondages ne montrent aucune hostilité de la part de la majorité des parents, lesquels semblent plutôt enclins à laisser le libre choix à ceux qui peuvent se le permettre. Politiquement parlant, il semble donc tout à fait possible de faciliter l'accès au privé. Le problème est que, même si l'on y doublait le nombre de places, cet événement improbable laisserait quand même quelque 86 % des parents piégés dans le système public. Par conséquent, pour la plupart des parents, la réforme devait passer par l'amélioration du secteur public.
===La "macro"-solution semi-libérale : le "bon scolaire"
Les partisans des solutions de liberté prônent depuis longtemps la mise en place d'un système de bons scolaires. Dans un système de bons, on ne donnerait plus aux parents une place (pseudo-) gratuite dans une école publique. Ils recevraient à la place un bon, de valeur équivalente à ce que coûterait cette place, et seraient libres de le donner en paiement à l'école de leur choix. Le bon prendrait la place de l'argent. Plutôt que de leur rendre leur argent, avec obligation de le consacrer à l'école, les hommes de l'Etat donneraient aux parents un coupon de papier qui fonctionnerait comme lui, avec cette différence importante qu'ils ne pourraient pas le "détourner" à d'autres fins. Ce système répond ainsi à l'objection selon laquelle, si on laissait aux parents la possibilité de payer directement, ils iraient dépenser l'argent au jeu ou alors le boire.
Le système du bon scolaire ne vise en rien à instituer un système de liberté authentique. Subventions et transferts persistent, les contribuables qui n'ont pas d'enfants sont toujours forcés de payer des bons qu'ils ne reçoivent pas, de sorte que les parents se font entretenir par les non-parents. En outre, le montant du bon impose une somme minimum à consacrer à l'école, interdisant aux parents d'y dépenser moins. On pourrait envisager l'apparition d'un marché noir, d'un commerce illégal où les bons s'échangeraient contre de l'argent, de sorte que les gens pourraient en fait choisir ; mais cela se ferait contre la législation du bon scolaire, et non sous son égide.
L'objectif de ce système est d'introduire un élément de discipline marchande. En choisissant où dépenser leurs bons, les parents choisiraient le type d'école qu'ils préfèrent. Les écoles considérées comme "mauvaises", ne recevant plus assez de bons pour payer leurs frais, devraient réduire leurs activités, voire envisager la fermeture. Les écoles bien cotées, attirant une demande supplémentaire, obtiendraient grâce aux bons suffisamment d'argent pour prendre de l'extension. En outre, elles serviraient de modèle aux autres. Petit à petit, l'éducation prendrait la forme que les parents souhaitent pour leurs enfants. Elle se dégagerait de l'emprise des producteurs, et se retrouverait aux ordres des consommateurs, désormais admis à faire prévaloir leurs choix.
Il existe plusieurs variantes du système de bons, mais la plupart d'entre elles permettent aux parents d'ajouter de l'argent à la valeur de leur bon pour acheter une place dans une école plus chère. Ce qui implique que les parents pourraient choisir une école privée s'ils le souhaitent, en compensant la différence entre le prix de l'école et la valeur du bon. Ceci implique également que certaines écoles d'Etat choisiraient de proposer une éducation plus coûteuse que les autres. L'effet net serait d'apporter davantage de ressources au système éducatif, tout en rapprochant encore davantage le niveau de sa production de ce que les parents souhaitent, et sont prêts à financer par leurs bons et leur argent.
Les obstacles politiques
Le système des bons présente bien des aspects intéressants et pourrait, s'il pouvait être réalisé, constituer une amélioration bien réelle par rapport au quasi-monopole des hommes de l'Etat dans le domaine de l'enseignement. Malheureusement, l'expérience semble montrer que le système des bons ne peut pas être mis en application. Malgré ses indubitables atouts économiques, il présente des faiblesses politiques qui le font gravement déconseiller. Sous sa forme moderne, cela fait plus de soixante ans qu'il fait l'objet de débats. Il a été sérieusement examiné par les gouvernements conservateurs anglais, mais jamais introduit. Même une conjoncture exceptionnelle, où l'on comptait à la fois le Ministre et le secrétaire d'Etat à l'Education parmi ses partisans, n'a pas suffi pour le mettre en pratique.
Pour commencer, il y a une opposition très forte de la part de ceux qui produisent l'enseignement. Les syndicats d'enseignants résistent parce qu'ils ne veulent pas que leurs adhérents soient exposés aux disciplines du marché. Les bureaucrates des ministères sont absolument fanatiques dans leur opposition. Ils comprennent bien, et avec juste raison, que ce système rendrait aux parents le pouvoir, qu'ils ont confisqué, de contrôler ce qui est enseigné. Les parents eux-mêmes se laissent facilement inquiéter par la perspective de perdre la place (pseudo-)gratuite qui leur est garantie à l'école locale. Ils craignent d'être obligés de payer davantage pour assurer à leurs enfants une éducation correcte.
La peur de l'inconnu
En outre, il n'est pas vraiment possible de mettre en place ce projet de façon progressive. On peut bien parler d'expériences limitées, ce système ne peut pas être vraiment efficace ni offrir la diversité et le choix, s'il ne concerne pas l'ensemble des écoles, et sur un espace assez large. A cette échelle, il est exposé au sabotage de ceux qui refusent de perdre leur pouvoir abusif sur l'enseignement. C'est donc un projet globaliste, où tous les changements doivent se produire d'un seul coup. Les parents recevraient une feuille de papier par la Poste, au lieu d'une place "gratuite" dans une école. Les écoles, aussi bien que les parents, se trouveraient tout-à-coup plongées dans l'incertitude. Rien n'est plus facile que de présenter tout cela comme un projet de théoriciens, jamais vraiment essayé, et qui ferait courir un danger à l'éducation des enfants. Plusieurs gouvernements ont essayé d'imposer des systèmes de bons, mais ont dû à chaque occasion battre en retraite face à l'opposition politique des groupes d'intérêt.
Le triptyque des micropoliticiens
Une proposition de remplacement, qui doit beaucoup à l'analyse micropolitique et à sa manière de faire, propose trois réformes indépendantes, dont chacune peut en soi être justifiée, mais dont la combinaison forme un nouveau système.
Supprimer la "carte scolaire"
Tout d'abord, elle prétend que les parents aient un véritable Droit de choisir, et propose en conséquence que l'entrée soit totalement libre dans le système d'Etat, de sorte qu'un enfant puisse être envoyé à toute école qui l'acceptera.
Cette politique-là est calculée pour faire plaisir aux parents. Nombre d'entre eux sont piégés par leur lieu de résidence dans la zone d'affectation d'une mauvaise école. La liberté de choisir l'école doit leur permettre de s'échapper. Le Droit de choisir, en présence d'une sectorisation de droit ou de fait, est réservé à ceux qui ont les moyens de déménager à proximité d'une bonne école. Il n'est pas rare, d'ailleurs, que des maisons situées du "bon" côté de la rue affectées à la bonne école vaillent plusieurs milliers de livres de plus que leurs vis-à-vis, physiquement identiques. La politique du libre accès laisse toujours les parents se débrouiller avec les problèmes de transport. Elle doit aussi conduire les bonnes écoles à un excédent d'inscriptions, les obligeant à refuser des candidats. Il n'empêche que ce serait un mieux, et un mieux apprécié.
===Rapatrier la responsabilité au niveau où les problèmes se posent
Le second pilier de la réforme est une politique qui rend les écoles beaucoup plus indépendantes dans leur fonctionnement. Dans chaque école, un Conseil où le vote des parents serait fortement représenté, prendrait en charge l'ensemble des décisions. Il aurait le pouvoir de choisir son directeur, et de lui donner l'autorité nécessaire pour embaucher le personnel et le renvoyer, avec approbation du Conseil. L'école déterminerait sa propre politique en ce qui concerne la discipline et les programmes, avec une inspection régulière des résultats de ses élèves dans un tronc commun minimum.
Avec une telle réforme, les écoles sont enfin autorisées à offrir davantage de diversité, de même que des approches différentes de l'enseignement et de la pédagogie. A son tour, cette diversité permettra de donner un contenu concret au choix entre les écoles exprimé par les parents. Les parents apprécient cette politique, qui leur promet voix au chapitre dans les orientations de l'école. Elle reçoit un accueil mitigé de la part du personnel, les directeurs y étant globalement favorables pour le meilleur statut et le pouvoir qu'elle leur donne, et les enseignants étant plus divisés. Certains y reconnaissent des possibilités d'avancement et de rémunérations accrues, d'autres craignent pour la sécurité de leur emploi. Des garanties précisant la durée de l'emploi et les motifs de licenciement pourraient faire beaucoup pour calmer de telles inquiétudes.
===Subordonner étroitement le financement de l'école à la présence de l'élève
Le troisième pilier de la réforme impose un financement direct des écoles sur la base du nombre d'enfants inscrits. Notre système les finance actuellement par l'impôt, par l'intermédiaire de l'administration du Conseil Local de l'Enseignement. La réforme court-circuitera la bureaucratie installée, autorisant les écoles à choisir de quitter son orbite, en étant financées directement par le centre, en fonction des effectifs. Bien sûr, cette solution déplaît fortement aux Conseils en place, mais ces derniers sont tout petits, et n'auront plus grand-chose à offrir sur le marché politique. Notre administration centrale y est plus favorable, car elle voit peut-être davantage d'ouvertures pour ses membres dans la supervision d'un tel projet, sans pour autant avoir à envisager des pertes d'emploi ou de statut.
On propose que le financement pour chaque élève soit calculé d'après le coût de l'enseignement pour chaque classe d'âge, avec peut-être des exceptions vers le haut pour les établissements urbains où les problèmes de langue sont importants, ainsi que pour les écoles de campagne isolées qui ont davantage de charges fixes par élève. Deux groupes qui auraient pu se sentir menacés par la réforme sont donc pris en charge. Les parents, dans l'ensemble, n'ont rien à perdre à un financement direct des écoles, et ils y gagnent l'économie qui résulte de ce qu'on supprime toute une strate de l'administration, ce qui en laisse davantage pour financer le service.
===Un quasi-marché pour les services d'enseignement
Une fois ces trois piliers de la réforme mis en place, il deviendra évident que leur effet combiné est de créer un marché de l'enseignement. Comme les écoles sont désormais contrôlées par leurs propres Conseils, elles suivent leurs propres priorités pédagogiques, et diffèrent par la qualité et le type des formations. Comme les parents ont la liberté d'accès, ils choisissent pour leurs enfants le type d'enseignement qu'ils préfèrent. Comme les écoles sont directement financées d'après le nombre d'élèves, celles qui reçoivent une demande accrue reçoivent aussi plus d'argent. Les écoles mal vues des parents se réforment, ou doivent fermer.
===Le changement se fera exactement au gré des personnes directement concernées
Un des grands avantages de cette réforme micropolitique est que chacune de ces étapes peut être appuyée indépendamment par des groupes différents, et le changement résultant de la synthèse de leurs effets. On n'impose aux parents aucun bouleversement soudain contre leur volonté, car pour ceux qui n'en demandent pas davantage que de disposer de la place "gratuite" à l'école du quartier, celle-ci est toujours là pour eux. La liberté de choisir n'est offerte qu'à ceux qui en veulent, personne n'y est poussé contre son gré. Bien sûr, à mesure que ce système se développe, un nombre croissant de parents va profiter du choix offert. Il faudra donc y intégrer de nouvelles techniques pour permettre de créer de nouvelles écoles publiques là où il existe une demande, et attirer d'autres sources de financement de la part du secteur privé.
Cette politique n'institue pas un marché complètement libre. A cet égard, elle en fait même moins que le système de bons, car elle ne concerne que les écoles publiques. Elle laisse les écoles payantes telles qu'elles sont ; celles-ci ne sont pas touchées par le nouveau système, et n'y prennent aucune part. Elle vise directement le système public qui concerne tout de même 93 % des élèves, et cherche à l'améliorer en transférant le pouvoir des producteurs au consommateur. Les écoles sont toujours des écoles d'Etat, toujours pour l'essentiel financées par l'impôt. Les nouvelles écoles fondées par les parents et les enseignants restent aussi des écoles de l'Etat, directement financées par lui.
===Une "micro-révolution"
Malgré ces lacunes, le nouveau système est un véritable bouleversement. Les écoles publiques sont gérées de façon indépendante, alors même qu'elles restent dans le secteur public. Les parents ont une possibilité de choisir, qui détermine l'endroit où ira l'argent pour financer l'éducation de leur enfant. Les écoles doivent répondre à la demande pour attirer les effectifs dont leur budget dépend. La frontière très nette qui existe, dans l'ancien système, entre le secteur public et les écoles privées devient, avec le nouveau système, un peu plus floue. Des forces et des pressions sont libérées, qui poussent à l'amélioration progressive du niveau d'éducation à atteindre dans le secteur d'Etat. Elles ont été voulues par ces réformes, calculées pour s'attirer le soutien d'une bonne partie des groupes qui ont un intérêt direct dans l'enseignement public.
===Invisible, le bon scolaire "passe" mieux
Il existe des différences clés entre le système des bons et la nouvelle approche. Une d'entre elles est que la nouvelle méthode obtient les mêmes résultats qu'un système de bons, tout en dispensant de les utiliser. Car l'argent peut tout aussi bien suivre l'enfant, une fois que ses parents ont fait leur choix parmi toute une gamme d'écoles.
Une autre différence est que la proposition est une politique praticable, qui va dans le sens du marché politique. On peut la mettre en place par étapes et, petit à petit, en tirer un système d'enseignement plus souple, plus varié et plus en phase avec les besoins et les désirs des parents. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais c'est une solution viable à notre problème. Et il est significatif, alors que le bon scolaire est rejeté depuis des années, que le nouveau système ait figuré dans le programme conservateur pour l'élection de 1987 ; ses éléments ont été présentés dans le discours de la Reine consécutif à la nouvelle victoire des conservateurs, des propositions comparables étant faites pour l'Ecosse plusieurs mois plus tard.
Détails pratiques
Le détail des programmes conservateurs des années 1980
Nous savons désormais ce qui, au-delà de leur inspiration commune, distingue historiquement les programmes conservateurs des années 70 et ceux des années 80 : les professionnels du projet politique s'emparant de la théorie des choix publics avec sa critique de la conception traditionnelle du changement politique, pour en faire un outil de création systématique. Cette créativité érigée en principe, nous allons maintenant voir à quel point elle caractérise les nouvelles politiques par opposition aux anciennes1.
Avant tout, un état d'esprit différent
La différence essentielle, on ne le rappellera jamais assez, était avant tout une différence d'approche. Le présupposé initial était que, pour inverser la dérive vers le socialisme, on allait imposer les solutions de liberté, même si cela devait conduire à provoquer la fureur des groupes de pression susceptibles d'y perdre. La nouvelle approche mettait au contraire l'accent sur la recherche de techniques nouvelles, applicables dans la pratique, donnant aux personnes visées un avantage net par rapport à leur situation antérieure.
Les privilégiés du logement "social"
Prenons les choix qui furent faits en matière de logement "social". A l'époque, quelque 35 % de la population vivaient dans des logements publics, aux loyers en général fortement subventionnés, et qui, dans certains cas, coûtaient plus cher à entretenir qu'ils ne rapportaient. Naturellement, toute redistribution profite d'abord aux gens bien placés, et les locataires des municipalités (la Ville étant propriétaire dans la plupart des cas) avaient, comme partout en pareil cas, un revenu moyen plus élevé que celui des locataires du secteur privé. Les Conservateurs voyaient une injustice évidente dans le fait d'obliger ceux qui s'efforçaient de se loger par leurs propres moyens, allant jusqu'à se priver pour s'acheter un logement, à payer un surcroît d'impôts et de taxes pour permettre à d'autres, éventuellement plus riches qu'eux-mêmes, de ne payer que des loyers de faveur.
Imposer le retour à un loyer "normal" ?
Les candidats conservateurs aux élections locales et nationales avaient préconisé de réévaluer les loyers au niveau du marché ; mais ils se rendirent vite compte que, pour sa part, le locataire moyen des HLM préférait un loyer subventionné à un loyer de marché. Ainsi, le milieu des HLM formait un bloc d'opposition résolue à la réforme du système, alors que celui-ci paralysait l'offre de logement et entravait la mobilité des locataires. Ces derniers rechignaient à déménager, par crainte de perdre leur place s'ils habitaient déjà un logement subventionné, ou leur tour sur la liste d'attente s'ils l'attendaient encore.
Comme dans bien d'autres cas d'avantages réservés aux minorités, les bénéficiaires du privilège lui donnaient plus de valeur que ses victimes ne trouvaient à s'en plaindre. Les bureaucraties locales s'étaient constitué de véritables empires sous prétexte d'administrer ces logements "sociaux", lesquels avaient aussi permis aux élus locaux de "bétonner" leurs majorités électorales. Bref, les intéressés étaient tous acquis au système en place, et toute proposition de réforme vouée à une hostilité unanime.
Permettre aux bénéficiaires de racheter leur logement à un prix de faveur
La nouvelle politique, sans laisser tomber l'idée de la vérité des prix, fit tout pour faciliter aux locataires l'achat de leur logement, s'efforçant en outre d'attirer toute l'attention sur elle. Les locataires HLM étaient tout acquis à l'idée que les autres soient forcés de leur payer le logement, mais il s'en trouva un bon nombre pour apprécier encore davantage la perspective de devenir propriétaire. Pour s'assurer leur appui, le gouvernement fit bien en sorte que les logements leur fussent vendus à un prix inférieur à celui du marché. Celui qui habitait son logement depuis deux ans avait une réduction de 20 % sur la valeur vénale, le rabais pouvant atteindre 50 % pour ceux qui étaient là depuis vingt ans. Si grand que fût leur goût pour le parasitisme locatif, on découvrit que la perspective de posséder leur propre maison, en faisant au passage un bénéfice de plusieurs dizaines de milliers de francs, était encore plus alléchante pour une bonne partie des locataires HLM.
Bouleverser, comme en se jouant, les données du problème
Que s'était-il passé? c'est bien simple : en faisant une nouvelle offre sur le marché politique, on avait créé une situation nouvelle, à laquelle les groupes de pression avaient tout naturellement adapté leur position ; et pour certains, l'offre proposée avait décidément plus de valeur que la subventionnite. Les municipalités se virent alors ardemment pressées de vendre leurs logements. Certaines essayèrent de résister, utilisant tous les moyens pour faire obstruction, mais les partisans de la réforme étaient devenus suffisamment nombreux pour permettre au gouvernement d'instituer un "droit d'acquisition", qui obligeait les autorités locales à vendre si les locataires le demandaient. Les rabais furent d'abord relevés à 60 %, pour passer ensuite jusqu'à 80 %.
Une force irrésistible
En septembre 1986, sur les cinq millions de locataires "municipaux", un million avait déjà acheté sa maison, et une loi était en préparation pour disposer de même des appartements. Le groupe des nouveaux propriétaires formait déjà une force considérable dans l'arène politique. Le parti travailliste, qui s'était toujours prononcé contre les ventes, dut, à son corps défendant, reconnaître la nouvelle situation et brûler ce qu'il avait adoré. Il lui fallut non seulement renoncer à toute idée de renationaliser les logements vendus mais encore, mangeant son chapeau jusqu'au bout, s'engager à poursuivre la politique de ventes à des prix de faveur.
Impuissants, les bureaucrates locaux assistèrent à l'écroulement de leurs empires, et quant aux élus, ils virent leur échapper les électeurs qu'ils avaient cru tenir captifs pour toujours. La pression exercée par le nouveau lobby était irrésistible. Pour la première fois, le gouvernement avait domestiqué la force du marché politique en surenchérissant sur ses acteurs habituels2. Le transfert de pouvoir et de propriété qui en résulta fut considérable. Rappelons que, de 1979 à 1986, un cinquième des locataires HLM avaient déjà choisi de devenir propriétaires de leur maison. Dans l'intervalle, la recherche micropolitique s'était ingéniée à trouver d'autres moyens pour accroître le nombre de ceux qui pourraient être persuadés de le faire à l'avenir.
La magie de la nouvelle approche
Alors que le gouvernement précédent avait échoué à imposer les disciplines du marché libre, le gouvernement Thatcher réussit à en introduire quelques-unes, simplement parce que ses propositions avaient pris le marché politique tel qu'il est. L'ancienne approche cherchait à passer outre aux intérêts des locataires HLM, en les privant du privilège des subventions locatives dont ils jouissaient depuis longtemps ; la nouvelle essayait de leur offrir en échange quelque chose qui valait davantage. Le résultat fut qu'on vit les opposants farouches de l'ancienne méthode se métamorphoser, comme par magie, en ardents partisans de la nouvelle. Elle avait permis non seulement de rapatrier un grand nombre de logements dans le secteur privé, où ils étaient soumis à des prix et des charges d'entretien réels, mais aussi d'assurer au gouvernement un soutien électoral substantiel.
Le logement locatif privé paralysé par la politique
Les problèmes du logement locatif en Grande-Bretagne ne se bornent pas au secteur public. Il existe encore un logement locatif privé, mais l'intervention des hommes de l'Etat l'a rendu bien malade. En fait, il ne représente plus qu'un faible pourcentage du marché. La concurrence déloyale du logement d'Etat subventionné en est certainement responsable, mais le coup de grâce lui a été porté par deux politiques dont l'effet est immanquablement de détruire le parc immobilier : le contrôle des loyers, associé à un "droit à" un maintien dans les lieux. Les locataires avaient su former un groupe de pression puissant, bien plus nombreux que les propriétaires, et qui multipliait les prétextes à l'ingérence des organisations "humanitaires" et autres lobbies intéressés3.
Les premières victimes : les locataires à venir
Le résultat est que les locataires en place ont reçu des privilèges, non seulement aux dépens des propriétaires — c'était voulu -, mais aussi des locataires à venir. Car la politique en question a naturellement eu pour effet de tarir presque complètement l'offre de nouveaux logements à louer. Là encore, la main invisible du marché politique est à l'œuvre : pas plus que les propriétaires, les futurs locataires ne peuvent former un groupe de pression efficace. Les propriétaires sont trop peu nombreux, et quant aux locataires à venir, ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils perdent à l'affaire4.
Qui serait volontaire pour se faire voler ?
La loi a donc fixé les loyers bien au-dessous de leur prix de marché, tout en refusant, bien sûr, aux propriétaires le droit de récupérer leur bien, même pour y habiter eux-mêmes ou en cas de risque grave de cessation de paiement. Comme les locataires sont autorisés à occuper le logement d'un autre pour un loyer moindre que le propriétaire ne l'accepte, voire inférieur aux coûts d'entretien, il est difficile de voir en quoi cela se distingue d'un vol pur et simple, à cela près que ce vol-là est reconnu par la loi. Naturellement, les propriétaires rechignent à louer dans ces conditions. Ceux qui, par exemple, ont hérité de leurs parents un logement supplémentaire se refusent à le louer, par crainte de le perdre au profit des "locataires".
Les privilégiés ont bien appris à se servir des pauvres
Comme on a tout de même besoin d'un secteur locatif privé en état de marche, les gouvernements conservateurs ont essayé de faire avancer les choses dans le sens d'une suppression du contrôle des loyers et du "droit" au maintien dans les lieux. La seule évocation de cette idée a toujours provoqué une réaction indignée non seulement des locataires, mais plus encore de ceux dont le fonds de commerce est de les représenter, ou dont l'idéologie est hostile à la propriété privée. Elle a toujours donné l'occasion de manifester, ou d'écrire article sur article dans les média sur les souffrances qu'une telle réforme ne manquerait pas d'occasionner aux malheureux locataires. Quant aux tourments des propriétaires, ils ne feront jamais couler d'encre, parce que ceux-ci sont piégés dans la caricature du riche-qui-exploite-le-désespoir-des-pauvres-sans-logis. Si l'on devait choisir un saint patron des propriétaires, Monsieur Vautour ferait un bon candidat aux yeux des média. Si bien que les timides tentatives faites pour libérer le marché n'ont jamais pu aller très loin.
Rétablir la liberté des contrats de location privée augmenterait immédiatement l'offre de logements sur le marché, et engendrerait probablement une stabilisation des prix en accroissant considérablement la construction. Malheureusement, comme dans bien d'autres cas, la solution la meilleure et la plus juste ne peut pas être réalisée par les moyens habituels. Les groupes qui profitent de ces privilèges se battront avec plus d'acharnement pour les conserver que d'autres pour les abolir.
Faire la part du feu
Les solutions mises en avant par la micropolitique ne prétendent certainement pas être justes. Elles consistent essentiellement à maintenir les privilèges de la génération actuelle des locataires, mais en précisant que tout nouveau bail échappera au contrôle des loyers et autres maintien dans les lieux. Le raisonnement est que les locataires en place n'auront aucune raison de s'opposer à cette mesure, puisque leurs propres avantages ne seront pas menacés. En revanche, une situation aura été créée, où toute nouvelle location sera libre de ces contraintes. Au départ ou au décès des locataires en place, les logements qu'ils occupaient seraient reloués à des loyers de marché. On pourrait même favoriser certains départs à l'aide de dessous de table. Le nombre de locations protégées diminuerait progressivement, jusqu'à ce que toutes les locations finissent par se trouver sur le marché libre.
Séparer les idéologues de leurs complices intéressés
Le résultat ne serait pas moins injuste pour les propriétaires actuels que le système en place, mais au moins, il empêcherait l'injustice à venir tout en amenuisant progressivement son étendue. C'est une politique réaliste, puisqu'elle est taillée sur mesure pour neutraliser l'opposition du groupe visé. Les lobbies idéologiques y seraient toujours hostiles mais, tout comme les propriétaires, ils sont peu nombreux. Sans l'armée des locataires pour défiler derrière leurs banderoles et jouer la comédie du mélodrame devant les caméras de télévision, ils sont parfaitement impuissants.
===Distinguer les "catégories" pour exorciser le fantasme
Une deuxième proposition tirée de ce type d'approche est de distinguer entre différentes catégories de propriétaires, chacune étant soumise à un type de contrôle différent. Par exemple, le petit propriétaire qui loue un ou deux logements à l'occasion n'appartiendrait pas à la même catégorie que le propriétaire établi comme tel et qui possède plusieurs immeubles de rapport. De même, un propriétaire institutionnel, comme l'Eglise d'Angleterre ou la Caisse des Dépôts en France, ainsi qu'une grande société immobilière, ne serait pas dans la même catégorie que le particulier qui loue quelques logements. Une fois de plus, l'objectif d'une telle subdivision est d'introduire quelques éléments de libéralisation dans le marché locatif actuel, même s'ils ne peuvent pas lui être appliqués dans son ensemble.
L'idée de départ est qu'il y a certains groupes qui ont plus d'influence que d'autres (ce pouvoir, rappelons-le, ne tient pas forcément aux seuls effectifs ; cela peut être leur visibilité, ou leur capacité de nuire, qui leur donnent du poids). Dans ce contexte, l'expulsion d'un logement a une puissance d'émotion difficile à parer. C'est un fantasme terrible que celle des malheureux-chassés-de-chez-eux-parce-qu'ils-n'ont-plus-les moyens-de-payer-le-loyer. Il n'y a pas un homme politique qui ne préférerait se casser une jambe plutôt que d'en être tenu pour responsable. Conséquence : on connaît des sociétés immobilières qui pourraient louer à des particuliers, et qui se l'interdisent résolument par crainte du dommage que subirait leur réputation si une telle situation se présentait.
Des baux à court terme ?
Une solution pourrait être trouvée dans des baux à court terme, parce qu'ils prévoient que le propriétaire récupérera les locaux vides à leur expiration. Il est toujours possible alors de négocier de nouveaux baux. Le bail à court terme n'évoque pas les mêmes images immémoriales de familles chassées de leur maison de toujours, avec un propriétaire rapace à montrer du doigt. Des variantes de ces idées ont été essayées, et d'autres encore sont à l'étude. L'idée fondamentale est que l'on renonce à libéraliser le marché pour imposer la justice à tout prix, et à braver la tempête en racontant aux parlementaires que toute cette agitation finira bien par se calmer. Au contraire, on tente de contourner l'hostilité des groupes en cause en s'assurant que la politique, telle qu'elle est conçue, ne sera pas une menace pour eux.
Les "canards boiteux"
Les changements de style qu'apporte l'approche micropolitique sont aussi visibles dans les méthodes employées face aux secteurs déficitaires des entreprises d'Etat. Lorsque l'accumulation des déficits attire l'attention du gouvernement sur des implantations ou des usines qui sont causes d'une proportion particulièrement importante du déficit total, l'évocation de la fermeture provoque une réaction trop prévisible. Les travailleurs défilent dans la rue, scandant des slogans et menaçant de faire grève. Dans les cas extrêmes, ils vont jusqu'à occuper les locaux. Les élus de la région font pression sur le gouvernement, qui se retrouve finalement confronté à une forte opposition, avec bien peu d'appuis. Comme toujours, les bénéficiaires de la subvention sont ceux qui militent avec le plus d'ardeur.
Des offres généreuses à la main-d'œuvre
Les gouvernements du passé ont souvent battu en retraite sous le feu, retirant leur projet de fermeture, prévoyant de moindre dégâts politiques en maintenant les subsides qu'en allant jusqu'au bout de leur choix de les supprimer. Or, l'approche a récemment changé en Grande-Bretagne : maintenant, l'effort consiste essentiellement à essayer d'obtenir le consentement de la main-d'œuvre. Les dirigeants et autres délégués syndicaux continuent à freiner des quatre fers ; cependant, en faisant des offres très généreuses, aussi bien en indemnités de licenciement qu'en primes de transfert, le gouvernement embellit fortement la proposition aux yeux des salariés.
Pour remplacer les subventions à l'emploi, en associant les aides de l'Etat à un capital substantiel, on propose aux employés une somme suffisante pour permettre à certains de créer une entreprise ou, pour les plus âgés, de s'assurer une retraite anticipée confortable. On compense parfois l'éventualité de perdre un emploi avantageux à un endroit par l'offre d'un reclassement ailleurs. Tout est fait pour minimiser le nombre d'emplois effectivement perdus : c'est une des zones les plus sensibles du marché politique, où il est vraiment nécessaire de faire des concessions.
Des indemnités de licenciement vraiment coquettes, parallèlement à des offres de reconversion parfois associées à des cours de recyclage, ou à des possibilités de reclassement dans l'entreprise elle-même, tout cela finit par désarmer la résistance rencontrée. Le résultat est qu'il devient désormais possible de fermer une partie des activités déficitaires. A court terme, cela peut coûter plus cher qu'une fermeture pure et simple, mais, lorsqu'on a réussi à le faire, cela représente une économie sur les subventions à venir, dont on est privé lorsque l'on a laissé les perdants potentiels empêcher la fermeture.
La réforme du droit syndical
La manière dont le droit syndical a été réformé illustre aussi excellemment la différence de style entre les deux approches. Les gouvernements précédents, travaillistes aussi bien que conservateurs, s'étaient rendus compte que la législation protectrice des syndicats leur avait accordé trop de pouvoir et d'immunités. La crainte que ce pouvoir ne finisse par détruire l'économie et la société s'il restait incontrôlé avait conduit Harold Wilson, en tant que Premier Ministre travailliste, et Edward Heath, quand il était Premier Ministre conservateur, à tenter des réformes pour les ramener sur le chemin du Droit. Or, tous deux avaient échoué. Le projet travailliste dut être retiré ignominieusement, et la loi d'origine conservatrice fut rendue inapplicable par la résistance massive des travailleurs ; elle fut d'ailleurs immédiatement révoquée par le gouvernement qui suivit.
L'administration Thatcher, pour sa part, a lancé une série de réformes dans le droit du travail qui ont transformé le climat social et l'activité syndicale en Grande-Bretagne. On la crédite d'avoir réussi là où ses prédécesseurs avaient échoué. Or ce qu'elle a obtenu en fait, c'est un résultat différent.
L'échec de la confrontation directe
Les deux tentatives avortées avaient pour l'essentiel essayé de priver de leurs pouvoirs les syndicats et leurs adhérents. L'une et l'autre étaient caractérisés par l'imposition de nouvelles entraves et de nouvelles restrictions à leurs activités, soutenues par des sanctions légales. Certains types d'action syndicale, auparavant autorisés, devenaient interdits. Les dirigeants et les membres des syndicats qui violaient la nouvelle législation devaient verser de lourdes amendes, le défaut de paiement étant puni d'emprisonnement. Dans chacun des cas, le Parlement avait pris la peine de donner à cette réforme la sanction d'une loi solennelle.
Le projet Wilson fut retiré au niveau du Conseil des Ministres, lorsqu'il devint évident que l'hostilité des syndicats, de leurs appuis au sein du gouvernement et des parlementaires dépendants de leur soutien, serait trop forte. La proposition Heath, quant à elle, fut votée, mais aussitôt impunément bafouée, le gouvernement reculant devant la perspective d'une confrontation majeure s'il avait vraiment essayé de l'imposer. Les deux tentatives de réforme firent contre elles l'unité du mouvement syndical. Les dirigeants syndicaux appelèrent à la résistance, et la base les suivit pour défendre ce qu'elle considérait comme ses droits. Les syndicats de Grande-Bretagne jouissaient donc d'une protection légale, voire d'une impunité judiciaire, qui étaient sans précédent et semblaient devoir s'accroître indéfiniment. Il était devenu possible, au cours d'un conflit du travail, de commettre des actions qui, dans un autre cadre, auraient été punies comme des atteintes au Droit, voire des délits purs et simples. Le groupe en cause défendait tout naturellement ses privilèges, et y réussissait fort bien.
Surtout pas de "grande" réforme
Les réformes Thatcher eurent un tout autre visage. Tout d'abord, elles ne prirent pas la forme d'une grande loi, mais d'une succession de petits amendements au droit. Lorsque le premier fut inauguré par James Prior, Ministre de l'Emploi, bien des gens s'imaginèrent que ce serait le seul. En fait, il l'a peut-être cru lui-même, jusqu'à ce que la pression des députés conservateurs de la base en impose une autre. Chaque mesure semblait très limitée dans sa portée, peut-être calibrée pour rester toujours en-deçà du seuil qui provoquerait une forte réaction protestataire. Chacune d'entre elles semblait relativement anodine... Ce fut l'accumulation de leurs effets qui constitua la véritable réforme. Ainsi, en l'absence de tout "grand projet" susceptible d'attirer l'attention et de coaliser les résistances, le public finit par s'habituer à l'idée qu'on continuerait à faire des réformettes, jusqu'à ce que l'effet désiré eût été obtenu.
Instituer une vraie représentation
La seconde différence importante est que le but officiel des réformes Thatcher n'était pas du tout de limiter le pouvoir des syndicats. Au lieu d'attribuer au gouvernement de nouveaux moyens pour s'imposer à eux, la plupart ne firent que donner aux camarades syndiqués le pouvoir... de contrôler réellement leurs dirigeants. Loin de supprimer ces pouvoirs, ces réformes se contentaient de les redistribuer, de manière à rendre obligatoire la consultation des salariés. Les militants ordinaires s'étaient habitués à voir leurs meneurs passer d'abord à l'action, et ensuite demander à "la base" de les soutenir lors des assemblées générales par le moyen — passablement intimidant — du vote à main levée. Or, les nouvelles lois obligeaient à les consulter, bien en amont dans le processus, grâce au vote à bulletin secret. Elles leur donnèrent également, par le même biais, le droit effectif de choisir leurs dirigeants. En d'autres termes, des forces qui œuvraient précédemment au profit exclusif des permanents étaient désormais employées pour donner le pouvoir au militant de base.
Agir au civil et non pas au pénal
Une autre différence essentielle est que réformes Thatcher les plus importantes étaient de droit civil et non de droit pénal. S'ils violaient les dispositions du code, les contrevenants n'étaient pas traînés en correctionnelle : on leur faisait un procès civil. Si par exemple un piquet de grève s'installait à la porte d'entreprises autres que celles impliquées dans le conflit, les entrepreneurs concernés pouvaient engager des poursuites, obtenir des astreintes, voire des dommages et intérêts. Si les grèves étaient déclenchées sans un vote à scrutin secret des travailleurs syndiqués, leurs responsables perdaient les immunités légales applicables aux ruptures du contrat de travail par fait de grève.
C'étaient là trois différences essentielles : les réformes étaient progressives, elles forçaient les dirigeants à laisser le pouvoir à la base, et aucune ne donnait l'occasion aux dirigeants ni aux militants de jouer les martyrs devant un tribunal répressif. C'est ce qui explique le succès des réformes Thatcher, par opposition aux échecs des tentatives précédentes.
Ce n'est pas le chômage qui avait affaibli les syndicats
On ne peut pas dire que ces réformes aient réussi parce que le gouvernement avait affaire à un mouvement syndical affaibli par le chômage. Personne n'a expliqué comment cette influence aurait pu s'exercer. Si une grève avait conduit à licencier les ouvriers pour les remplacer par des chômeurs, cela aurait pu être le cas ; mais qu'une entreprise ait pu s'en tirer en ayant recours à une tactique de ce genre était alors tout aussi impensable que par le passé.
Pas de quoi fouetter un chat
Les réformes Thatcher ont réussi parce qu'elles prenaient en compte les groupes d'intérêts concernés, et se donnaient un mal de chien pour éviter le type de confrontation directe qui avait garanti l'échec des projets précédents. Les dirigeants syndicaux avaient toutes les peines du monde pour mobiliser l'opposition de la base, parce que chacune de ces mesures était relativement indolore. Chacune n'était qu'un petit pas de plus par rapport aux précédentes, pas vraiment de quoi fouetter un chat. En outre, on ne pouvait guère compter sur le militant de base pour se mobiliser contre des mesures qui allaient lui donner davantage voix au chapitre. Les dirigeants syndicaux pouvaient grimper aux rideaux à l'idée de devoir se soumettre à un vote de leurs adhérents, mais ces derniers n'étaient pas près de réagir comme eux. Le gouvernement ne les privait d'aucun de leurs droits : il les répartissait différemment entre adhérents et activistes. Enfin, il n'y avait aucune répression pénale à braver, aucune possibilité d'évoquer le fantasme du Valeureux Leader ou du Camarade-Syndiqué-Traîné-en-Prison-en-Martyr-de-la-Cause-Ouvrière. Cette nouvelle législation n'offrait aucune prise aux meneurs pour Mobiliser contre elle la Solidarité des Masses Travailleuses.
Le triomphe de la micropolitique
Si ces réformes ont réussi, c'est parce qu'elles traduisaient un nouveau style politique, une manière nouvelle d'aborder la formulation des politiques publiques. Elles tenaient compte des forces réellement en présence dans l'arène politique, au lieu de considérer celle-ci comme une table rase attendant seulement que le Législateur y impose sa Marque Souveraine. Les tentatives précédentes commettaient toutes l'erreur fondamentale de la macropolitique : elles avaient étudié la situation existante, imaginé celle qui aurait dû régner à sa place, sans tenir le moindre compte des réalités intermédiaires. La nouvelle méthode avait soigneusement balisé le chemin à suivre pour passer de l'une à l'autre. C'est une de ses caractéristiques principales que d'agir de cette façon.
Le test décisif : la grève des mineurs
La grève des mineurs de 1984-1985 fut une bonne occasion de mettre à l'épreuve les méthodes que l'on avait mises au point pour traiter le problème des entreprises déficitaires du secteur public ou pour faire passer la réforme dans les relations de travail. C'était d'ailleurs une grève des mineurs qui avait fait tomber le gouvernement Heath, après avoir forcé le pays à vivre dans le noir et à ne travailler que trois jours par semaine. Or, sous le gouvernement Thatcher, la même grève fut un échec. Les différences sont pleines d'enseignements.
Seuls les activistes avaient vraiment intérêt au conflit
Alors que le président de la NUM, le Syndicat National des Mineurs, en avait pris personnellement la tête, la seconde grève ne fut jamais celle de l'ensemble du syndicat. A quelques mois près, la direction syndicale eût été contrainte d'organiser un référendum pour pouvoir déclencher la grève, et la base avait voté contre à deux reprises lors de consultations organisées dans les houillères. Comme il avait été déclenché sans vote préalable, plusieurs sections du syndicat, notamment les mineurs du Nottinghamshire, se sentirent en droit de ne pas suivre le mouvement. Le nouveau droit contre les piquets "de solidarité" empêchait en partie de faire pression sur les autres syndicats pour qu'ils soutiennent le mouvement. Les entrepreneurs pouvaient obtenir des tribunaux des astreintes contre les actions "de solidarité", et le syndicat des mineurs fut condamné pour outrage à magistrat pour avoir refusé de les payer. Ses dirigeants virent leurs comptes bloqués jusqu'à ce qu'ils eussent payé les amendes.
Alors que le syndicat des mineurs passait pour l'organisation la plus forte et la plus militante, il ne cessait de se heurter à la nouvelle donne que les réformes avaient instaurée dans les relations de travail. En outre, le combat lui-même était loin d'être tranché quant à ses enjeux essentiels. Les meneurs présentaient la grève comme une lutte pour sauver les emplois en empêchant les fermetures par la direction des houillères. Or, les propositions de la direction garantissaient qu'aucun mineur ne serait forcé de quitter son travail. Tous ceux qui quittaient les puits à fermer devaient être recasés ailleurs, avec de fortes indemnités de transfert à la clé. Ceux qui choisissaient de partir en retraite se voyaient offrir les primes de départ les plus somptueuses de toute l'Histoire britannique. Comme personne n'était forcé de perdre son emploi, et comme ceux qui choisissaient de partir plutôt que d'être recasés recevaient un énorme magot, il n'était pas très facile de voir où se trouvait le motif de la querelle. Il se réduisait à demander quelle devrait être la taille à venir de l'industrie, problème certes fort intéressant pour le syndicat, mais sûrement pas un souci majeur pour les salariés.
Contrairement à la précédente, cette grève fut un échec, échec qui provoqua l'éclatement du syndicat des mineurs. Un élément décisif de cette défaite avait été la nouvelle manière dont on avait traité les suppressions d'emploi et fait passer les réformes dans les relations de travail. Au lieu de jouer la confrontation directe pour aborder les deux questions comme l'avait fait le gouvernement Heath, le gouvernement au pouvoir une décennie plus tard utilisa des méthodes qui rassuraient les groupes d'intérêts et offraient des compensations en échange des privilèges mis en cause par le changement.
Les meneurs ne sont rien si la base ne suit plus
L'expérience des syndicats sous l'administration Thatcher permet d'évoquer une conclusion très importante de la micropolitique. A savoir que les dirigeants des groupes d'intérêts et des minorités ne représentent pas nécessairement le point de vue de la base. Cela peut se vérifier, même lorsqu'ils sont démocratiquement élus au cours d'élections honnêtes. Lorsque l'action politique passe par l'affrontement, avec des groupes qui se battent pour défendre leurs privilèges, l'intérêt de la base est de se choisir des dirigeants doués pour ce type d'activité. Elle aura souvent tendance à les choisir plus militants et plus agressifs qu'elle ne l'est elle-même : c'est cela qui en fait de bons dirigeants. La société sera confrontée à des cliques véhémentes, réclamant sans cesse et prêtes à employer la force au premier désaccord. Voilà quel type de chefs on choisit dans un tel climat, type dont les représentants syndicaux de l'époque constituaient un exemple véritablement achevé.
Lorsque l'on gouverne en ménageant les forces politiques en présence, l'atmosphère n'est plus à la confrontation. On ne supprime pas unilatéralement les avantages ; bien au contraire, on offre des compensations. A-t-on encore tellement besoin de meneurs agressifs ? Les membres d'un groupe de pression peuvent même en arriver à percevoir un conflit direct entre leur propre intérêt et celui de leurs dirigeants. Ces derniers sont peut-être bien arrivés au sommet grâce à leur aptitude à se battre, et peuvent encore chercher à justifier leur place par ce moyen, mais leurs adhérents ont quelque chance de gagner davantage à des compromis, plutôt que de continuer sur la voie des extrêmes.
Voici un scénario qu'on a vu se dérouler à maintes reprises sous le gouvernement Thatcher : la hiérarchie fait des propositions, et celles-ci sont immédiatement rejetées par la direction syndicale. Puis on organise le référendum prévu par la loi pour décider de l'action à mener... et voilà que les adhérents, désavouant leurs "représentants", votent contre la grève. L'expérience des syndicats illustre donc cette vérité plus générale sur les groupes d'intérêts, que leurs dirigeants n'en sont pas nécessairement représentatifs. La leçon à en tirer est que les politiques doivent être faites pour les membres ordinaires, et non pour les meneurs. Les permanents de la direction hurleront toujours pour en avoir plus et avoueront rarement que l'offre qu'on leur fait est bien davantage qu'un os à ronger ; c'est pour cela qu'on les paie. En revanche, la base peut trouver tout à fait à son goût les propositions en question. En pratique, cela pourra conduire à des cas où les dirigeants de groupes minoritaires lancent aux quatre vents protestations et insultes, tandis que les minorités, de leur côté, s'installent tout tranquillement dans le nouvel équilibre du marché politique.
Les événements sont plus importants que les mots qui les accompagnent.
La privatisation
Une proposition de la micropolitique
Le terme, comme l'idée de privatisation, sont venus relativement tard à l'équipe Thatcher. Le Manifeste électoral de 1979 mentionnait la vente de l'industrie aérospatiale, des chantiers navals et de la National Freight Corporation, mais ne précisait pas que l'on entendait aller au-delà de la "dénationalisation", présentée depuis longtemps comme un objectif de la politique conservatrice sans jamais y parvenir. Dans The Right Approach, ouvrage publié par le parti Conservateur en 1976, on lisait "dans certains cas, il peut aussi être désirable de revendre à l'entreprise privée des actifs ou des sociétés pour lesquelles on pourra trouver un repreneur". Le mot-clé est le préfixe re-, qui indique une volonté de défaire ce que des années de nationalisation avaient fait, même si on n'y arrivait qu'à petite échelle.
La privatisation n'est jamais un retour en arrière
La privatisation effectivement pratiquée n'a rien eu à voir avec le caractère symbolique de la petite brasserie et de l'agence de voyages que le gouvernement Heath était péniblement arrivé à vendre entre 1970 et 1974. Pas grand-chose non plus, en fait, avec le retour au secteur privé de certains éléments de la sidérurgie pendant la législature 1951-55. Dans les deux cas, il s'agissait de dé-nationalisation, terme qui implique que l'on dé-fait quelque chose qui a été fait auparavant. C'est en 1979 que l'on a commencé à employer le terme de "privatisation", lorsque tout le monde s'est aperçu qu'on avait affaire à un spécimen tout à fait inconnu. Car il ne s'agissait pas de revenir en arrière, mais de créer une situation radicalement nouvelle.
Jamais, après 1979, on n'a rendu les éléments du secteur étatisé à leurs anciens propriétaires. Dans chaque cas de privatisation, ils se sont retrouvés dans des mains également privées, mais à maints égards totalement différentes de celles des propriétaires précédents. La privatisation est une politique nouvelle, un pur produit de la micropolitique.
Un système intégré
Bien que le profane n'y voie généralement rien d'autre qu'une simple vente des actifs de l'Etat, la privatisation est en réalité un système intégré de mesures pour rétablir une gestion responsable, c'est-à-dire privée, dans des activités auparavant contrôlées par le secteur public. Il n'existe pas de formule ni de recette simple pour arriver à ce résultat. Bien au contraire, une grande diversité de techniques ont été mises au point, chacune conçue pour traiter une entreprise ou un "service public" particulier.
L'essentiel du savoir-faire est tiré de la pratique
Nous avons vu les raisons théoriques de la privatisation, aussi bien que les principes de la micropolitique qui la guident aujourd'hui ; mais prendre la mesure des rapports de force est une question empirique, et découvrir les politiques qui marchent ne peut se faire que par l'expérience.
C'est pourquoi une part considérable du savoir-faire désormais acquis en matière de privatisations l'a été grâce à la pratique. Le gouvernement, au cours de son mandat, a suivi un processus d'apprentissage, s'exerçant à distinguer les méthodes efficaces de celles qui ne le sont pas, et à traiter les divers groupes d'intérêts concernés pour s'assurer l'appui, ou du moins l'assentiment de puissantes factions qui auraient pu s'opposer à ses tentatives.
Quand on ne sait pas faire... et quand on a appris
On mesurera l'importance de ce processus en comparant l'échec de la dénationalisation des boutiques du Gaz en 1981-82 avec l'énorme succès rencontré par la privatisation de British Gas en 1986. La différence entre les approches suivies est une bonne illustration des progrès accomplis dans l'approche analytique.
Dans le premier cas, on avait voulu vendre le réseau de distributeurs en le détachant du reste de l'entreprise, parce qu'il était le seul à rapporter de l'argent. A première vue, cela semblait raisonnable, puisque les magasins en question n'avaient aucun lien organique avec la production ni la distribution du gaz lui-même : ce n'étaient que des boutiques, et si l'on y vendait ou réparait quelque chose, ce n'étaient jamais que des appareils ménagers.
Or, ce modeste projet s'attira immédiatement les foudres de la direction de l'entreprise. Son président, Sir Dennis Rookes, se lança à la tête d'un groupe d'action pour s'opposer au "démantèlement" de son empire, avec le soutien unanime de l'équipe de direction. Le personnel menaça de faire grève si on "lui" retirait "ses" points de vente pour les brader aux capitalistes. On fit circuler des histoires d'horreur sur les "cow-boys" qui allaient débouler sur le marché, ne songeant qu'à faire un profit facile au mépris de la sécurité. Les usagers se mirent à exprimer leurs craintes à voix haute : est-ce qu'on n'allait pas leur couper le gaz, ou leur installer des appareils dangereux ? Les parlementaires sentaient croître la pression des opposants, et le gouvernement se rendit compte qu'en face d'une telle campagne, le soutien du député de base se faisait de plus en plus rare. Le projet fut retiré, ayant trouvé le moyen de s'aliéner l'Administration, la direction de l'entreprise, son personnel, ses usagers, et les parlementaires eux-mêmes.
Le contraste entre cette débâcle et la mise en vente publique de British Gas de 1986 n'aurait pu être plus marqué. La privatisation de 1986 obtint l'adhésion de l'ensemble des principaux groupes impliqués, et fut un immense succès pour le gouvernement. La différence, bien entendu, c'est dans la politique proposée qu'on pouvait la trouver. On en avait beaucoup appris en cinq ans...
S'assurer le soutien des dirigeants
Les dirigeants s'étaient opposés de toutes leurs forces au "démantèlement" qu'impliquait la première proposition. La seconde version conserva l'entreprise en un seul morceau, et obtint le soutien de sa direction. L'austère Sir Dennis lui-même se mit en quatre pour promouvoir la privatisation (même si on ne l'a tout de même pas vu sourire à cette occasion). Le soutien de la hiérarchie d'entreprise semble bien être une condition nécessaire pour qu'une privatisation réussisse. En effet, celle-ci a le pouvoir de faire énormément de dégâts, réduisant les résultats anticipés et, partant, le prix que l'on pourra tirer de la vente. Elle dispose également d'un pouvoir de pression efficace dans le débat public, surtout vis-à-vis des adversaires du secteur privé. La première tentative, avec démantèlement, et vente des magasins d'appareils à gaz, avait donné l'occasion à un lobby rusé et entreprenant de faire triompher ses intrigues au Parlement même. A la deuxième tentative, en gardant l'entreprise intacte, on avait créé la possibilité d'un échange : les dirigeants avaient pris goût au pouvoir et à l'autorité en dirigeant une grande entreprise publique, mais ils allaient encore mieux aimer se trouver à la tête d'une grande entreprise privée, puissante... et rentable.
Privilégier les salariés en place
Les salariés, qui avaient menacé de se mettre en grève et même organisé un arrêt de travail symbolique contre la première tentative, appuyèrent la seconde. Parmi les actions émises, une bonne partie était d'ailleurs réservée aux employés du gaz. Chacun reçut son petit lot gratuit, avec le privilège de pouvoir en réserver un grand nombre sans devoir participer au tirage au sort. Comme l'optimisme était très grand sur les perspectives de la vente et la valeur future de l'entreprise, plus de 90 % des salariés se portèrent acquéreurs. Ainsi, ils réalisèrent deux objectifs importants à leurs yeux : ils devinrent co-propriétaires de leur entreprise, avec un intérêt personnel dans ses résultats à venir, et firent par-dessus le marché un gain en capital substantiel, de plusieurs milliers de livres dans certains cas. En outre, les acheteurs potentiels aiment bien les entreprises dont les salariés sont devenus actionnaires ; cela veut dire qu'ils travailleront vraiment pour elle, au lieu de la traiter comme une puissance étrangère.
Rassurer les groupes d'usagers
Les utilisateurs du gaz, auquel l'idée d'un personnel non qualifié voire prêt à rogner sur la qualité avaient fait craindre toute privatisation la première fois, ne furent pas les derniers à participer au rachat de British Gas. Ils avaient droit à l'attribution d'actions privilégiées s'ils en faisaient la demande, obtenant un traitement favorable dans tout tirage au sort d'actions en cas de souscription excédentaire. On leur offrit en outre, s'ils conservaient leurs actions, le choix entre des bons de réduction sur leurs factures de gaz et l'attribution d'actions gratuites.
Enrôler le grand public
Pour encourager une participation maximum du grand public, les actions furent mises en vente avec des facilités de paiement, la mise de fonds initiale ne dépassant pas cinq francs et le solde étant réglable par la suite. Enfin, l'émission fit l'objet d'un matraquage publicitaire complet, avec un budget de communication dans les centaines de millions de livres. Le succès se mesura au très fort afflux de premiers actionnaires, dont la plupart choisirent de conserver leurs actions malgré une plus-value initiale de plus de 30 %.
Un succès politique considérable
Le gouvernement et ses partisans l'avaient emporté parce qu'ils avaient su faire gagner aussi les autres groupes. Le succès de l'aventure profita à tous. Plus précisément, le gouvernement pouvait à présent compter un nombre record d'actionnaires-capitalistes, plus de cinq millions de propriétaires de British Gas qui s'opposeraient à toute renationalisation par un gouvernement mal intentionné. Il récoltait aussi les fruits d'une campagne de publicité qui vantait les mérites de la privatisation et du capitalisme tout en faisant l'article pour les actions vendues. Certains observateurs l'avaient bien noté, c'était "la campagne politique la plus chère de l'histoire".
===Privatiser, c'est le rêve fou du politicien : pouvoir distribuer de l'argent sans devoir le voler à qui que ce soit
Encore un autre avantage pour le gouvernement : les cinq milliards de livres que la vente avait rapportées. Il put les reverser dans son budget courant pour réduire les impôts ou satisfaire les revendications de dépenses. Bien que cette pratique ait fait et fasse encore l'objet de critiques, elle est parfaitement licite. Dans le budget britannique, il n'existe pas de compte pour le capital, qui n'y est pas non plus correctement amorti. L'argent dont on s'était servi pour acheter les entreprises au secteur privé avaient dû être prélevé sur les dépenses courantes ; rien ne s'opposait donc à ce que les sommes tirées d'une vente y soit reversées. Par ailleurs, présenter la privatisation comme un "gaspillage de la richesse nationale" est foncièrement inexact. La richesse ne cesse pas d'être "nationale" quand elle passe dans des mains privées, et en fait, la privatisation lui donne même bien meilleure allure.
===Si l'on échoue, ce n'est jamais que parce qu'on s'y est mal pris
Les leçons à tirer de ces deux tentatives ? Naturellement, qu'il vaut mieux ménager les groupes d'intérêts, et réussir, que se les aliéner pour aller à l'échec : en l'occurrence, satisfaire les divers groupes impliqués dans les entreprises publiques, leur offrir des compensations acceptables pour leurs avantages acquis. Cela, les hommes politiques pragmatiques s'en laisseront volontiers persuader. Ce qu'ils risquent de méconnaître en revanche, c'est cette leçon très importante : que l'échec d'une politique de libéralisation ne signifie jamais que le projet soit mal inspiré ; mis en œuvre, il ne saurait qu'améliorer les choses. Il signifie seulement qu' on s'y est mal pris. Rien n'empêche de réussir. Ce qu'il faut, c'est être intellectuellement armé aussi bien pour conserver le cap que pour tirer profit de l'expérience acquise.
Un transfert d'expérience
Car le procédé employé pour la vente de British Gas était un pur produit de cette expérience même : il avait été testé lors de la vente deux ans plus tôt, en 1984, de British Telecom, l'ancien "service public" du téléphone et des télécommunications. Ce n'était en aucun cas une dé-nationalisation, puisque cette industrie appartenait au secteur public depuis sa création, ayant toujours fait partie de l'administration des Postes. British Telecom fut le premier grand "service public", par opposition à une entreprise nationalisée, à être privatisé. C'était donc une première.
Lors de sa privatisation, British Telecom était la plus grande entreprise à jamais faire l'objet d'une introduction en bourse, tout comme British Gas devait l'être deux ans plus tard. Avec une valeur de plus de trois milliards, elle doublait la vitesse à laquelle on pouvait estimer la vente des entreprises d'Etat au secteur privé. Dans le cas de British Telecom, la pratique des contreparties offertes aux groupes d'intérêts en cause, connue de tous après la vente de British Gas, fut justement mise en œuvre avec une précision implacable.
Privatiser d'abord
Pour commencer, la direction fut autorisée à vendre l'entreprise en un bloc au privé. Les puristes de la concurrence menèrent un combat d'arrière-garde pour que British Telecom soit divisée en plusieurs entreprises rivales, ou du moins en sociétés régionales dont les performances auraient alors pu être comparées. Il ne semblait pas leur être venu à l'esprit que, si cela pouvait être la solution idéale, ce n'était pas celle qui était possible. Insister pour que British Telecom soit privatisée par morceaux revenait à opter pour une politique qui ne "passerait" jamais. La direction de British Telecom soutenait certes la privatisation de l'entreprise, mais seulement dans les termes où elle avait été proposée.
Les syndicalistes neutralisés
Les dirigeants syndicaux donnèrent l'ordre aux salariés de s'opposer à la manœuvre, et une campagne fut mise sur pied. Elle avait fait faire un logo représentant un fil téléphonique coupé par des cisailles, qui était censé symboliser le destin qui attendait le "service public" après son passage au capitalisme. C'est pourquoi la direction avait réservé pour les employés de British Telecom un bon paquet d'actions mises de côté pour la circonstance ; cela en faisait des co-propriétaires de l'entreprise et leur donnait la possibilité de réaliser des plus-values si la valeur en Bourse augmentait. En l'occurrence, 96 % des salariés se portèrent acquéreurs. C'est ainsi que le personnel, qui aurait pu s'opposer à la vente, fit aussi partie de l'équipe.
Le public séduit
Le grand public fut autorisé à acheter les actions à tempérament, n'ayant à verser comptant que cinq francs par action. On offrit aux nouveaux actionnaires le choix entre une émission d'actions gratuites et des réductions sur leur facture de téléphone. A la fin de l'introduction en Bourse, quelque deux millions de personnes possédaient ces actions, la demande ayant largement dépassé l'offre, et deux tiers des acheteurs choisirent de les conserver, alors même que leur cours avait immédiatement monté de près de 100 %. C'est à l'occasion de la vente de British Telecom que fut organisée la première grande campagne de publicité, laquelle obtint du public la réaction voulue.
Traiter systématiquement les oppositions possibles
British Telecom servit ainsi de banc d'essai pour les techniques de privatisation d'un grand "service public". La moindre objection éventuelle de tous les groupes concernés avait été prévue, et traitée, chaque fois que c'était possible. Comme on avait évoqué la crainte que ce "service public stratégique" ne passe aux mains de l'Etranger, on intégra dans la vente une action spécifique (une "golden share") pour le gouvernement britannique, qui lui conférait un droit de blocage dans le cas d'une tentative de rachat étranger. Comme on avait aussi raconté qu'un British Telecom privé ne trouverait pas rentable d'exploiter et d'entretenir les cabines téléphoniques rurales, il fut précisé que l'entreprise serait tenue de conserver un nombre donné de cabines. Cette obligation, malgré son faible impact, était largement connue des acheteurs potentiels.
Et la concurrence ?
On avait beaucoup mis en cause le "monopole de fait" dont British Telecom allait jouir dans le secteur privé, exprimant la crainte qu'il n'"abuse de sa position dominante". Naturellement, jamais on ne mettait ce "monopole" et ces "abus" en parallèle avec ceux qui découlent nécessairement du statut de "service public". Pour traiter ce problème, outre les obligations intégrées dans le projet de loi, on fit appel à deux méthodes. L'une consistait à susciter une "concurrence à la marge" dans laquelle British Telecom, sans avoir en face de soi un concurrent de sa taille et de sa puissance, serait confronté à des concurrents plus petits sur chacun de ses marchés. Il fut ainsi confronté à Mercury pour les télécommunications d'affaires, à Racal/Vodafone pour le radiotéléphone cellulaire, à d'autres concurrents pour la fourniture d'équipements, la transmission de données informatiques et pour la plupart de ses autres activités. Aucun de ces concurrents n'était bien gros, mais pris ensemble, ils faisaient ressentir à British Telecom le risque de perdre ses clients sur bon nombre de ses marchés.
On créa aussi un organisme chargé de surveiller l'industrie et de promouvoir la concurrence. Plutôt que de suivre l'exemple des Etats-Unis, où les organismes réglementaires font obstacle à l'entrée des nouveaux venus sur le marché1, l'OFTEL fut expressément chargé de la promouvoir. Lorsque Mercury demanda l'autorisation d'étendre ses services à la clientèle des particuliers, l'OFTEL la lui accorda, puisqu'il était là pour ça.
La combinaison utilisée pour contenir les "abus du monopole" associe donc des contraintes légales, la concurrence à la marge et un organisme de promotion de la concurrence. Elle a été faite sur mesures pour British Telecom, et ne serait pas nécessairement instituée sous la même forme pour d'autres entreprises. Elle contient une bonne dose d'empirisme, et le souci d'accumuler de l'expérience pour les projets à venir.
Encore heureux que le Parlement puisse toujours revenir à la charge, si le premier essai n'était pas concluant. En 1987, la qualité du service offert par British Telecom après sa privatisation avait provoqué un mécontentement certain, et ceci amena l'OFTEL à faire des propositions de réforme. Critiqué aussi bien par ses actionnaires que par ses clients, le président démissionna en septembre 1987, et l'on parla d'imposer de nouveaux contrôles si British Telecom ne s'en tirait pas mieux que cela. Voilà une autre leçon très importante à tirer de ces événements : s'il ne parvient pas à obtenir un résultat satisfaisant du premier coup, le Parlement peut toujours remettre son ouvrage sur le métier. Si la vente de British Telecom avait dû attendre que l'on trouve un système parfait, elle attendrait encore.
"Brader le patrimoine national" ?
On a reproché au gouvernement d'avoir "bradé" British Telecom. Après tout, une plus-value de 100 % laissait penser que la vente aurait pu obtenir le double. Or, cette interprétation est presque certainement fausse. Il était important, pour que la première vente d'un "service public" réussisse, que l'émission d'actions soit entièrement souscrite. Il était également important d'impliquer les usagers, et de donner envie au plus grand nombre possible de devenir actionnaires. Il s'agissait de multiplier le nombre des détenteurs d'actions, afin de rendre plus difficile toute nationalisation éventuelle par un gouvernement ultérieur. Tout cela veut dire qu'il était vraiment nécessaire qu'il y eût une plus-value sur le prix de vente. Le prix d'émission était difficile à fixer, parce que personne ne savait ce que l'entreprise pourrait valoir. Nombre d'entreprises nationalisées, British Telecom inclus, avaient pendant des années connu des pratiques comptables qui auraient suscité l'hilarité, voire des poursuites pénales si elles avaient sévi dans le secteur privé.
Il faut souligner que le gouvernement n'avait pas cherché à établir lui-même le prix de vente. Il fit appel à des experts financiers de la City pour ce faire, de sorte que, s'ils se trompaient, la responsabilité fût partagée. De toute façon, une erreur dans la fixation du prix n'était pas dramatique. En effet, en ne vendant qu'un peu plus de 50 % de l'entreprise, le gouvernement conservait l'option de se débarrasser du reliquat à un prix bien plus élevé par la suite. Comme les entreprises deviennent généralement plus rentables et plus efficaces dans le secteur privé, la tactique consistant à ne mettre qu'un peu plus de 50 % des actions en vente au départ et à se défaire ensuite du reste par tranches permet au gouvernement d'obtenir davantage lors des ventes ultérieures. Ce fut le cas, entre autres, de British Telecom.
Privatiser... la privatisation
Une caractéristique de la vente de British Telecom était donc la forte participation des experts privés. Au cours du programme de privatisation, on s'était vite rendu compte qu'il n'y avait aucune bonne raison pour ne pas privatiser le processus lui-même. On fit donc de plus en plus appel à des entreprises de la City. Elles ont fourni des analystes, des banquiers d'affaires, ainsi que la compétence nécessaire en relations publiques. Le gouvernement ne s'est pas embarrassé d'apprendre comment on fait pour vendre des entreprises ; il a acheté les services de ceux qui le savaient déjà. Ces cabinets sont eux-mêmes devenus un groupe d'intérêt qui tire profit des privatisations, et ont eux-mêmes été à l'origine de nouvelles propositions dans ce sens, tant en Grande-Bretagne qu'à l'étranger.
Faire appel à des experts privés pour mener la privatisation à son terme présente un avantage, petit quoique important : le gouvernement et le Parlement peuvent ainsi se tenir à quelque distance du processus. Une fois entre les mains des spécialistes, il devient leur responsabilité. Ce n'est pas seulement un prétexte pour accuser les autres si les choses tournent mal. Le gouvernement assume de toutes façons la responsabilité de l'ensemble quand il engage les entreprises concernées. Ce que permet le recours à l'expertise privée, c'est de tenir les élus à l'écart du détail. Il ne serait pas souhaitable que ce soit le Parlement qui fixe la date de lancement de l'émission, le prix d'émission ni le nombre d'actions. Rien ne serait facilité non plus, si les parlementaires se sentaient pressés par leurs électeurs de rechercher quelque privilège à leur accorder au moment de fixer de telles modalités.
Fixer le prix de vente est des plus difficile
Un coup d'œil aux différents prix pratiqués lors de la vente des entreprises d'Etat montre à quel point ce terrain est semé d'embûches. Dans le cas d'Amersham International, petite entreprise de radio-sources qui fut l'une des premières ventes au public, il y eut une grosse plus-value sur le prix d'émission. Les adversaires de la privatisation accusèrent le gouvernement d'avoir vendu un "bien national" à un tarif de faveur, au bénéfice de ses "amis argentés" de la City. On entend ce genre d'accusation chaque fois qu'il y a eu un gain en capital.
La tactique qui consiste à garantir une vaste participation du grand public à la vente émousse l'accusation, mais ne l'élimine pas. Etre accusé de brader des richesses "nationales", au profit de "pékins" ordinaires est plus facile à assumer qu'un même reproche impliquant "les copains de la haute finance", mais cela veut tout de même bien dire qu'une faute a été commise. Lorsque le cours de l'action est fixé trop haut et qu'il n'y a pas suffisamment de souscripteurs, les actions perdent de la valeur dès qu'on les met sur le marché. Les opposants parlent alors d'échec. La demande est trop élevée ? C'est un échec. Trop faible, c'est toujours un échec. Apparemment, seule une faible marge d'écart pourrait passer pour un succès.
Soulignons tout de même que, lorsque la demande est faible et que les actions démarrent à perte, le gouvernement, et les contribuables, touchent tout de même leur argent. La pratique de la garantie d'émission auprès des banques d'affaires et des institutions financières a pour conséquence que la vente des actions sera de toutes façons assurée. La vente n'est interprétée comme un "échec", que dans la mesure où elle n'a pas réussi à attirer un nombre suffisant de souscripteurs au sein du public.
Même la vente des actions BP encore dans les mains de l'Etat, qui fut interrompue par la chute brutale des valeurs boursières du 19 octobre 1987, a rapporté la somme escomptée. Les banques qui garantissaient l'émission, et que l'on accusait depuis des années de "se sucrer à bon compte", se retrouvèrent dans l'obligation de reprendre à 120 pence des actions invendues, alors qu'elles étaient descendues à 70-80 pence. Elles payèrent. Le vent de panique se calma lorsque le Ministre des Finances Lawson garantit un prix de rachat de base de 70 p par action, mais en l'occurrence il n'y eut que 2 % des actionnaires à se défaire des leurs. Le gouvernement fit valoir, à juste titre, que c'était pour subir ce genre de risques que ceux qui garantissent les émissions étaient payés. Il doit bien arriver un jour que le risque se réalise.
En fait, on ne s'est pas trop mal tiré de ces évaluations, surtout si l'on tient compte de la nouveauté du procédé. L'absence d'une comptabilité décente et l'inexpérience en fait de vente des actifs de l'Etat ne facilitaient pas le choix d'un prix. Et pourtant, il y a eu peu de véritables erreurs. Le principe était que les actions devaient rapporter une plus-value, afin d'encourager les investissements futurs et d'obtenir l'appui politique des bénéficiaires. De toutes les privatisations par émission publique d'actions, seules celles liées au pétrole démarrèrent à perte. Etant donné l'inquiétude internationale quant à l'avenir de l'industrie, sa vulnérabilité aux événements à l'extérieur et les fortes fluctuations du prix du brut, c'était compréhensible.
===Il importe que le nouvel actionnaire fasse une bonne affaire
Dans d'autres cas, non seulement il y a eu plus-value le jour de la mise en vente, mais la valeur en Bourse des entreprises privatisées a ensuite dépassé régulièrement la moyenne du marché boursier. Ces deux effets doivent être délibérément recherchés au début du processus de privatisation. Ils apportent maintes satisfactions à bon nombre de groupes d'intérêt impliqués, notamment ceux qui viennent de se constituer. Tout le monde peut voir que la direction et les salariés y gagnent, par l'augmentation de la valeur des actions qu'ils détiennent et de la rentabilité de leur entreprise. Il est essentiel qu'ils tirent du nouvel état de choses plus d'avantages que de l'ancien. Cela encouragera les employés d'autres entreprises d'Etat à prendre fait et cause pour la privatisation lorsqu'elle leur sera proposée.
La nouvelle classe d'actionnaires, dont beaucoup achètent des actions pour la première fois ou sont de petits porteurs, doit pouvoir toucher du doigt ses gains en capital. En devenant propriétaire d'une partie du capital de la nation, elle devient intéressée à ce que le climat politique soit favorable aux entreprises productives. Si elle pense tirer des avantages personnels de politiques favorables à la libre entreprise, elle sera d'autant plus disposée à les soutenir. En outre, plus elle possède de richesse sous la forme d'actions des anciennes entreprises d'Etat, plus il sera difficile à un gouvernement futur de comploter pour les lui confisquer. Déjà, les adversaires de la privatisation qui souhaitent un retour en arrière ne parlent plus de reprendre leurs actions aux petits porteurs. Ils parlent maintenant de "ramener l'entreprise dans le secteur public", mais tout en laissant les actions à des particuliers. Il reste à voir si les entreprises obtiendraient d'aussi bons résultats sous le contrôle des hommes de l'Etat qu'elles en ont avec des dirigeants privés et surtout, comment les électeurs-actionnaires vont estimer cette perspective au moment de voter. En tous cas, lorsqu'on leur en a donné le choix en 1987, c'est une option qu'ils ont rejetée2.
===Privatiser ne supprime pas toute l'irresponsabilité institutionnelle ; mais le progrès à en attendre vaut bien qu'on s'en donne les moyens
Face à la privatisation, il existe une grande différence d'attitudes entre ceux qui prônent des solutions de pur laissez-faire et ceux qui, partant de l'analyse des choix publics, envisagent les politiques en tenant compte des marchés politiques existants. Le premier groupe reproche constamment au gouvernement d'être incapable d'instituer la pure liberté des contrats, et considèrent les échanges de privilèges avec les groupes de pression comme une marque de faiblesse et un manque de résolution. Ils n'ont pas l'air de saisir que ce sont justement ces compromis qui permettent l'opération. Ils ne comprennent pas non plus qu'en l'absence de telles mesures, la réforme ne survivrait pas à son passage dans les remous de la politique.
Certains partisans de l'économie de marché ont l'air de supposer que l'objectif unique de la privatisation doit être d'exposer les entreprises d'Etat à tous les vents de la concurrence. A moins que la privatisation n'aboutisse à une situation de concurrence pure, ils la considèrent comme un échec. C'est une erreur de conception : l'objectif premier de la privatisation n'est pas de développer la rivalité au sein du secteur d'Etat, mais d'abord de le privatiser. La concurrence est indiscutablement souhaitable et doit être recherchée chaque fois que cela est possible, mais la privatisation présente encore des avantages, même lorsque le degré de concurrence atteint est loin d'être parfait.
Une entreprise "publique" est une entreprise politisée
L'analyse des choix publics est parvenue à la conclusion — peu surprenante — que les activités du secteur d'Etat appartiennent au domaine politique. Elles ne sont pas confrontées à des disciplines marchandes et concurrentielles, mais soumises aux pressions de la politique. Se trouvant directement sous la coupe du "législateur", elles sont asservies aux contraintes qui déterminent les choix de ce "législateur". Les choix faits dans le secteur public relèvent donc d'un marché politique, et non pas économique.
Quelques exemples tirés de la vie de tous les jours : si les entreprises d'Etat ont besoin d'argent pour s'agrandir ou faire des investissements, cela peut être enregistré comme un emprunt "public". De telles décisions se retrouvent alors soumises aux contraintes imposées au Besoin en Financement du Secteur Public3, et cette demande se retrouve alors en concurrence avec d'autres priorités du gouvernement. Si ce dernier a décidé de réduire l'endettement total, on n'aura pas l'argent, aussi justifié que soit son emploi. A l'inverse, dans le secteur privé, une entreprise attire toujours les financements si elle prouve qu'elle est capable d'en faire bon usage et de les rentabiliser. Il n'est pas possible de concevoir un financement public sur une base commerciale.
Les décisions prises dans les entreprises du secteur public sont soumises à l'influence politique jusque dans leurs moindres détails. La décision de construire une nouvelle usine dans le secteur privé est prise en fonction de critères commerciaux, d'après des facteurs tels que les prix de revient, ou la proximité des marchés. Dans des circonstances analogues, l'entreprise du secteur public est confrontée à des données politiques, avec des élus qui font pression pour faire venir l'usine dans leur circonscription. On a déjà vu à quelles extrémités on est conduit pour fermer une installation dans le secteur public. Le fait est qu'une entreprise d'Etat est comme un ballon de football, ballotté entre les groupe de pression et les politiciens qui les représentent. Elle ne prend pas plus ses décisions sur des critères commerciaux qu'elle ne collecte ses fonds à des conditions de marché.
A ces facteurs, il faut ajouter le fait que la gestion publique se caractérise souvent par le monopole d'Etat, avec tout ce que cela implique de capture par les producteurs, de sureffectifs et de mépris du consommateur. Si la privatisation peut remettre tous ces compteurs à zéro pour un nouveau départ dans le secteur privé, c'est indiscutablement un bon point pour elle. Si on ne peut effacer qu'une partie de l'ardoise, eh bien le jeu en vaut encore la chandelle ; et si, en nettoyant cette partie, on expose une entreprise à des conditions qui permettront finalement d'effacer le reste, il en vaut d'autant plus la peine.
De tous les désordres causés par l'intervention étatique, la politisation est bien pire que le monopole
Certains observateurs considèrent que si le monopole public est mauvais, c'est parce qu'il est un monopole. Or, le fait est qu'un monopole public combine deux inconvénients : le fait qu'il soit public, et le fait qu'il s'agisse d'un monopole. De ces deux maux, le plus grand est qu'il soit public. C'est une bien plus grande source de désordres et de gaspillages. Dans le cas où un monopole est privatisé en tant que monopole, on peut dire au moins qu'un monopole privé est préférable à un monopole public. Un monopole privé est plus vulnérable à l'innovation de ses concurrents. Il dépend moins de la politique que les monopoles d'Etat, et il n'a pas leur puissance politique. Alors que les monopoles privés finissent par disparaître avec le temps, les monopoles publics sont entretenus en permanence par de nouvelles lois, qui sont votées pour les protéger contre les nouvelles menaces de la concurrence.
Il n'était pas possible de donner à British Telecom un caractère suffisamment concurrentiel lors de son transfert au secteur privé. L'analyse micropolitique suggère que, si on avait essayé de le faire à ce moment, la privatisation elle-même n'aurait pu aller à son terme. Toutefois, British Telecom est exposée à bien plus de disciplines marchandes qu'auparavant, et se trouve confrontée à une plus grande concurrence. Ce sont deux avantages importants d'une solution réalisable, qu'il ne faut pas écarter au profit de solutions plus parfaitement concurrentielles, et qui ne marcheraient pas.
Privatisée, l'entreprise a moins d'influence politique
L'élément temps joue un rôle important. Avec le développement de nouvelles techniques, British Telecom n'aura plus le pouvoir de les faire interdire, ni de se les accaparer par la loi comme elle le faisait auparavant. On peut aussi envisager une action législative ultérieure pour augmenter la concurrence à laquelle il sera exposé. Dans ce cas, les entreprises, une fois privatisées, découvriront qu'elles ne bénéficient plus des appuis en haut lieu que leur apportait leur statut public. En tant qu'entreprises privées, on leur demandera de se passer de l'appui des gendarmes pour faire face aux pressions de la concurrence.
La privatisation institue immédiatement des disciplines permanentes
Au minimum, la privatisation soumet des entreprises d'Etat aux disciplines de la gestion commerciale. Au mieux, elle les transforme en organisations viables et compétitives, capables de réussir et de tenir leur rôle sur un marché ouvert. De nombreux cas de privatisation se situent entre ces deux cas de figure. L'important est que l'on mette en place les éléments qui conduiront progressivement au second scénario. Si on ne peut créer un cadre complètement concurrentiel dès le départ, on doit s'arranger pour qu'il le devienne davantage à l'avenir, et ne pas lui permettre de glisser en arrière.
Dans plusieurs entreprises, on a pu constater que les préparatifs de la privatisation induisaient d'importantes réformes, avant même le passage à l'acte. Savoir qu'une entreprise d'Etat va être vendue, comme de savoir qu'on sera pendu dans quinze jours, donne une merveilleuse puissance de concentration. L'efficacité s'améliore, on fait des économies. Quand arrive la date fixée, l'entreprise est devenue bien plus vendable qu'avant le déclenchement du processus. Avec cette politique de préparation, on a vu que des entreprises, au départ pléthoriques en effectifs et asservies aux producteurs pour cause d'appartenance au secteur public, étaient devenues efficaces et rentables au moment de leur arrivée sur le marché.
Comment une entreprise publique déficitaire devient privée et rentable
British Airways en est un exemple classique. Lorsque la décision de la privatiser fut prise en 1983, elle faisait d'énormes pertes, qui étaient prises en charge par les subventions de l'Etat. Elle avait trop de personnel, avec un relâchement certain dans tous les aspects de sa gestion. Au moment de sa vente en février 1987, elle était redevenue populaire, et bénéficiaire. Le nombre de ses salariés était passé de 59 000 à 39 000. Elle se souciait visiblement de ses clients, prenant soin de connaître et de prévenir leurs besoins. De nombreuses catégories de passagers la désignaient régulièrement comme la meilleure compagnie aérienne internationale. L'obèse paresseux et égrotant s'était transformé en une société commerciale, saine et très compétitive. Au moment de sa vente au public, British Airways était un bon placement financier. Et ce n'est pas pour avoir vécu dans le secteur privé qu'elle avait opéré cette transformation. C'est parce qu'elle avait dû se préparer à y vivre.
Comment avait-on pu le faire, alors que l'entreprise était encore dans le secteur d'Etat, soumise à toutes les pressions qui y règnent ? Ce qui avait rendu cela possible était l'ensemble des techniques employées, avec la carotte qui attendait tout le monde à la sortie. Personne n'a été mis à la porte ; on avait offert des conditions avantageuses pour partir volontairement à la retraite. Quant aux pensions de retraite indexées, on ne les avait pas supprimées, mais rachetées cash. Il a fallu beaucoup investir pour transformer British Airways, mais cet investissement a été plus que compensé par la nouvelle rentabilité de l'entreprise et la valeur que l'on a pu tirer de sa vente. La Compagnie avait tellement le moral que, comme des procès successifs retardaient la date de la mise sur le marché, les employés menacèrent de faire grève si l'on n'accélérait pas le processus.
Comme on l'avait fait si souvent dans d'autres entreprises, les salariés avaient choisi d'être partie prenante dans le rachat. On peut pour le moins douter que ces changements eussent pu avoir lieu dans une entreprise publique sans la perspective de sa privatisation. Sans la nécessité d'être compétitif et rentable dans le secteur privé, les intérêts des groupes impliqués auraient été autres, et la direction n'aurait pas réussi à améliorer la productivité.
La leçon tirée de l'expérience de British Airways est qu'une entreprise qui fonctionne à perte peut toujours être vendue. On vend tous les jours en Bourse des entreprises déficitaires. L'expérience de British Airways a démontré qu'on pouvait redresser une organisation qui est dans le rouge, et en faire une entreprise viable. Par ailleurs, les préparatifs de la privatisation peuvent en eux-mêmes constituer un système d'incitations suffisant pour la transformer dans ce sens.
Des résultats spectaculaires
Sur les marchés, on dit qu'une réputation est très difficile à récupérer une fois perdue. Facile ou non, British Airways a bel et bien récupéré en un temps record sa réputation de premier plan. En quelques années, elle est passée d'un rang très médiocre à une position lui permettant de disputer la première place. Et ce n'est pas un cas isolé. Les voitures Jaguar avaient perdu leur ancienne image de qualité après leur passage dans le secteur public. Elles avaient perdu du terrain en Amérique parce qu'à juste titre, on les tenait pour peu fiables. Le contrôle de la qualité avait cédé la place à des pratiques de "service public", où les considérations politiques prenaient le pas sur le souci du client. Après la privatisation, Jaguar retrouva son ancienne tradition d'excellence et de fiabilité à une vitesse incroyable. De ce fait, les actions achetées par les salariés à l'époque augmentèrent de 2 000%, ce qui n'est pas le moins important de l'affaire.
Et les travailleurs ?
Quel avantage le salarié trouvera-t-il à la privatisation ?
Un élément qui a beaucoup compté dans la réussite des privatisations était le soutien du personnel. Quand on privatise, il faut faire au salarié une offre qu'il perçoive comme au moins équivalente aux avantages dont il bénéficiait déjà. Il se peut, évidemment, que la valeur actuelle de ces avantages acquis implique une décote. Si, dans le secteur public, l'avenir de l'entreprise est compromis, le personnel peut donner moins de valeur à la garantie normalement associée à un emploi dans ce secteur. Il peut alors accepter la privatisation, même au prix d'une réduction sensible de ses avantages. Un emploi certain dans le secteur privé a beaucoup plus d'intérêt que la simple éventualité du maintien de l'emploi "garanti" dans le secteur d'Etat.
Dans ces cas-là, on a vu le personnel accepter la vente d'une entreprise d'Etat, même avec réduction d'effectifs, ayant compris que la seule autre solution était de cesser complètement l'activité. Le traitement réservé aux employés reclassés a été un facteur majeur du succès de ces tentatives. En effet, quand il n'est pas question de licenciements forcés, alors le nombre des gens réellement forcés de changer d'emploi tombe ipso facto à zéro. Dans les faits, cela réduit l'opposition aux seuls militants syndicaux, car ils sont les seuls à se soucier des effectifs en tant que tels.
L'offre faite aux mineurs dont les puits étaient condamnés à fermer montre bien comment on fait pour négocier les avantages acquis. On leur avait tout offert : un reclassement dans d'autres puits, une prime de déménagement ainsi que des cours de recyclage. Le montant des indemnités de préretraite, on l'a vu, était absolument sans précédent. Si le projet de fermeture était confirmé, un mineur risquait de perdre un emploi chez lui ; mais la certitude de pouvoir être embauché sur un autre site, associée à l'indemnité de déménagement, lui semblait être un substitut raisonnable, ayant bien compris qu'il n'était plus possible de maintenir tous les puits en activité.
Distribuer la propriété de l'entreprise
Le moyen habituel pour s'assurer le soutien du personnel en cas de transfert au secteur privé reste la distribution d'actions. Un bloc de titres est mis en réserve pour les salariés de l'entreprise, et ils peuvent en prendre s'ils le désirent1. Parfois, comme dans le cas de British Gas, un certain nombre d'actions sont offertes gratuitement. Il arrive même que les employés s'en voient offrir davantage qu'il n'en est mis à la disposition du grand public. Ce fut le cas aussi bien pour British Gas que pour British Telecom. On peut aussi autoriser le personnel à financer l'achat des actions sur son salaire en bénéficiant d'un prêt à long terme, généralement sans intérêt. C'est ce qui a été fait chez Jaguar et pour certains chantiers navals.
Tous capitalistes!
Le but de la direction est que le personnel participe au maximum à la vente de l'entreprise. C'est un moyen de s'assurer son adhésion au projet, et de neutraliser ce qui pourrait être une source d'opposition sérieuse. Cela va même encore plus loin. Quand le personnel a un intérêt immédiat dans l'entreprise, il identifie son avenir avec le sien. Cela permet d'en finir avec cette attitude de "nous" opposés à "eux" ; les ouvriers se reconnaissent dans l'entreprise au lieu de la considérer comme un adversaire. Cela améliore les relations de travail et diminue les conflits. Cela fait aussi monter le cours de l'action, toutes choses égales par ailleurs, dans la mesure où les acheteurs potentiels réévaluent à la hausse les résultats à venir de l'entreprise.
Pour le gouvernement, l'intérêt supplémentaire est qu'une société dont les ouvriers sont actionnaires risque fort de s'opposer aux prises de contrôle par les hommes de l'Etat, et autres charlataneries du centralisme que pourraient proposer les partis politiques concurrents. Il existera un préjugé général en faveur du capitalisme et de la libre entreprise si leurs avantages sont assez visibles et partout diffusés, et si le travailleur ordinaire, vu les bénéfices qu'il en tire, se considère lui-même comme appartenant au système.
La reprise par une autre société...
Néanmoins, toutes les privatisations ne se font pas par émission d'actions. Une fraction petite mais significative a lieu par reprise directe. En l'occurrence, comme dans les cas où l'on charge des entrepreneurs privés d'assurer un "service public", il importe de bien s'assurer que le personnel en place sera pris en compte dans la prise de contrôle. Il faut être sûr que les avantages dont ils bénéficiaient comme employés du secteur public seront remplacés par d'autres, tout aussi acceptables.
Il est arrivé que la reprise passe pour une occasion à saisir, comme par exemple lorsque, ayant commencé par annoncer la fermeture de l'entreprise d'Etat, on présentait ensuite sa vente à un industriel privé comme une chance de "sauvetage" permettant de la maintenir en activité. L'acheteur privé est souvent en mesure d'offrir un avenir plus brillant, intégrant l'activité dans un ensemble plus vaste avec le savoir-faire de gestion et la force de vente nécessaires pour la moderniser et la rééquiper. On peut en trouver de bons exemples dans certains chantiers navals de la Marine ou encore les ferries de la Manche.
Le rachat de l'entreprise par ses salariés
A l'autre bout de l'échelle, on trouve les cas où aucun acheteur extérieur n'intervient, mais dans lesquels la privatisation se fait par un rachat au nom de l'encadrement, du personnel ou des deux à la fois. La reprise transforme aussi bien le climat du travail que la viabilité économique des sociétés publiques. Quels qu'aient pu être les intérêts du personnel en tant qu'employés de l'Etat, ils deviennent radicalement autres quand ils sont devenus propriétaires de leur propre entreprise. L'ensemble de leurs priorités se transforme, et surtout ce qu'ils attendent du processus politique. C'est ainsi que bon nombre de rachats par les salariés ont valu un soutien accru au gouvernement.
L'exemple de la National Freight Corporation
L'un des premiers rachats par la direction et les employés fut celui de la National Freight Corporation, qui assure le transport routier du fret en Grande-Bretagne. Le rachat avait été lancé à l'initiative de la hiérarchie, initiative bien souvent imitée par la suite dans d'autres entreprises. Il est très fréquent que ce soit une idée de la direction, et que ce soit elle qui fasse l'offre. Dans le cas de National Freight, bien que la plupart des actions aient été rachetées par les cadres avec l'appui des banques, on fit son possible pour que le personnel y soit aussi associé. Ce fut une réussite, et aussi un précédent désormais classique.
Le personnel de National Freight : chauffeurs, chargeurs, vérificateurs et trieurs, tous achetèrent leur part de la nouvelle entreprise. Il y en eut pour hypothéquer leur maison afin d'acquérir des actions. D'autres mirent dans la cagnotte les économies de toute une vie. Ayant décidé que la nouvelle entreprise serait rentable, ils ne ménageait pas leur soutien. Plusieurs, interrogés par la Télévision, expliquèrent ce que cela représentait pour eux d'être propriétaires de leur entreprise2.
La nouvelle société connut une réussite immédiate. Elle s'avéra très rentable dans son statut privé, sa réussite commerciale traduisant une connaissance parfaite et un souci extrême des vœux de ses clients. Les employés actionnaires virent la valeur de leurs actions d'abord multipliée par quatre, puis par huit, dix, puis par cinquante-quatre. Tous les actionnaires, employés comme direction, avaient fait un gain de plusieurs milliers pour cent par rapport à leur investissement initial.
Il vint un jour où la National Freight dut procéder à une réduction d'effectifs. Elle le fit en douceur, bien que sans joie, pour des raisons — et sur des critères — de rentabilité. Ce qui, dans une entreprise publique, aurait engendré une tempête et occasionné des grèves, voire des occupations d'usines, passa comme une lettre à la Poste. L'entreprise est toujours rentable. Elle avait loué une salle de concert pour la première assemblée annuelle de ses actionnaires, ne sachant pas du tout, parmi les milliers qui existaient, combien se déplaceraient. Ils sont venus par milliers, et l'on considère les participants aux réunions annuelles des actionnaires comme l'un des auditoires les mieux informés de Grande-Bretagne, puisqu'ils travaillent tous aussi pour l'entreprise.
Des réussites un peu méconnues
Si National Freight est un modèle, on en a fait de nombreuses copies3. Les rachats par l'encadrement ont été les plus nombreux, même si ceux qui impliquaient une plus large participation du personnel ont eu plus de publicité. Aucun de ces deux types de rachat ne bénéficie d'autant de réclame qu'une émission publique d'actions ; c'est pourquoi ils comptent quelques-uns des succès les plus méconnus de la privatisation.
Tout faire pour mettre les salariés "dans le coup"
Dans les cas où les employés représentent une partie significative du consortium, on a recours à des méthodes inédites pour accroître au maximum le nombre des actions qu'ils pourront acheter. Celui qui ne voit dans la privatisation qu'une simple vente des actifs de l'Etat devrait étudier l'extraordinaire imagination et l'inventivité des techniques utilisées pour convaincre l'ensemble du personnel de s'engager dans ces opérations. Par exemple, les employés peuvent payer à crédit, par versements mensuels prélevés sur leur salaire. Parfois les actions sont immobilisées dans une caisse pour les salariés, et libérées à mesure qu'elles ont été payées. On peut aussi faire intervenir des banques locales, qui mettront au point des conditions de paiement sur mesure pour les salariés acquéreurs. Dans de nombreux cas, comme la majorité du personnel est néophyte en matière financière, on organise des programmes d'initiation aux opérations boursières, au rôle de l'investissement et à l'importance des bénéfices. Les observateurs pourront noter que c'est en soi un grand service rendu à la société, et qui ne vient pas trop tôt par dessus le marché.
La privatisation est une opération politique
Tout cela montre à quel point la privatisation est une opération politique, et pas seulement économique. Car elle vise aussi bien les marchés politiques que les marchés économiques. Associer les travailleurs à l'achat des actions permet de modifier profondément les termes de l'échange sur le marché politique.
Le rachat des chantiers navals Vickers par le consortium du personnel en 1986 mit en œuvre aussi bien les bonnes vieilles techniques essayées et éprouvées que des innovations en la matière. Son histoire illustre bien jusqu'à quelles extrémités les responsables de cette politique sont prêts à aller pour atteindre les objectifs souhaités. Dans ce cas précis, pour permettre à la masse des ouvriers des chantiers navals de participer, on associa des conditions de crédit inouïes à un programme de formation intensif. Comme c'était un groupe qui n'avait ni économies de quelque importance ni aucune connaissance en matière financière, il fallut tout monter à partir de zéro pour qu'il puisse vraiment participer. Outre les employés, l'encadrement, les banques et autres investisseurs, l'originalité de la vente Vickers fut que l'on offrit des actions à des tarifs avantageux non seulement aux ouvriers, mais aussi aux membres des communautés locales de Barrow et de Birkenhead, les sites des deux chantiers concernés.
L'événement le plus spectaculaire de la privatisation de Vickers fut que l'on ne vendit pas au plus offrant, mais au second enchérisseur. L'offre la plus élevée était celle de Trafalgar House, un conglomérat géant. Or, ce fut le consortium formé par la direction, les employés et les habitants des communes qui emporta l'affaire, bien que son offre d'argent eût été moindre. Avec un tel engagement personnel dans l'affaire, c'était à eux que l'on donnait le plus de chances de réussir. Certains commentateurs ont trouvé bon de critiquer ce choix, parce qu'il était politique et non purement économique ; en tous cas, voilà qui montre bien à quoi sert la privatisation.
L'équipe dirigeante installée est souvent la mieux placée pour reprendre l'entreprise
Le rachat par la direction ou le personnel a très bien marché pour privatiser des entités relativement réduites, par comparaison avec des colosses comme British Telecom ou British Gas. Lorsque la société est assez petite pour que s'y développe un véritable sens de la communauté, nous avons là un candidat potentiel pour le rachat direct. Il y a de fortes chances que la direction connaisse à la fois le potentiel et les problèmes de son outil de travail, ayant pu observer plusieurs années ses performances à l'intérieur du secteur d'Etat. Elle est bien placée pour savoir quelles améliorations l'on obtiendrait s'il était possible de modifier les procédures et d'obtenir du personnel une attitude différente. C'est pourquoi il est essentiel de la mettre dans le coup, quelle que soit l'ingéniosité comptable nécessaire pour y parvenir4.
On peut dire que la roue de la politique a vraiment bien tourné, quand c'est un gouvernement conservateur qui favorise la constitution de petites coopératives. Or, le rachat par la direction et les employés est l'une des techniques de privatisation qui ont le mieux réussi.
La privatisation déplaît généralement aux syndicalistes
Il existe une interrogation évidente sur le rôle des syndicats en tant qu'ils affirment représenter le personnel. La privatisation a bien montré que, s'il est possible de considérer les syndicats comme représentatifs des intérêts de leurs membres en matière de salaires ou de conditions de travail à l'intérieur de la structure existante, ce n'est plus le cas lorsque cette structure elle-même est en discussion. Dans bien des cas de privatisation, si ce n'est la plupart d'entre eux, on a pu observer une différence assez nette entre les intérêts de la base et ceux de la direction syndicale.
Les dirigeants syndicaux ont depuis longtemps un intérêt personnel attaché au secteur public en tant que tel. La participation syndicale, aussi bien chez les cols blancs que chez les cols bleus, a toujours été plus élevée dans le secteur d'Etat que dans le privé, surtout pour les premiers. Les syndicats du secteur public ont généralement pu établir des relations de travail douillettes avec la hiérarchie et l'encadrement, également publics. Chacun voyait bien l'intérêt qu'il avait à ménager ses autres partenaires, au mépris sinon des employés, du moins de la clientèle et de la population dans son ensemble5.
Les syndicats sont donc généralement hostiles à la privatisation, sachant pertinemment que le privé leur fera la vie moins belle. Les seules exceptions notables ont été les cas où, le gouvernement ou la direction ayant clairement affiché sa résolution de fermer une usine ou un secteur, la privatisation faisait figure de bouée de sauvetage. Par conséquent, la réaction syndicale a toujours été de s'opposer à la vente, sauf dans les cas où la seule autre possibilité était la fermeture immédiate. Alors, on peut se demander pourquoi leur riposte a été aussi inopérante, étant donné l'énorme pouvoir dont ils semblaient jouir en 1979.
D'où vient que l'énorme pouvoir syndical n'ait pu s'opposer à la privatisation ?
Une réponse envisageable est qu'une partie de cet énorme pouvoir ne tenait qu'à l'image qu'on s'en faisait. Tant que le gouvernement et les "responsables" syndicaux se rencontraient deux fois par semaine au 10, Downing Street pour débattre des Intérêts Supérieurs de la Nation, le pouvoir des syndicats semblait faire partie intégrante des institutions britanniques, comme les gardiens de la Tour de Londres, ou la Colonne de Nelson à Trafalgar Square. Leur pouvoir se serait évanoui le jour où le Premier Ministre eut décidé de ne plus les consulter sur autre chose que les relations de travail, parce qu'il n'avait jamais eu d'autre source que sa bonne volonté. Une autre explication serait que le pouvoir des dirigeants syndicaux avait tellement été érodé par l'action législative du nouveau gouvernement, qu'il était désormais trop faible pour faire obstacle à la privatisation. La première explication a quelque valeur, mais la seconde ne tient pas chronologiquement, dans la mesure où les syndicats échouaient déjà dans leur opposition, bien longtemps avant que les nouvelles mesures n'eussent commencé d'entamer le pouvoir de leurs dirigeants.
===Un effet de la micropolitique
En fait, l'explication la plus plausible est que, les propositions de privatisation ayant été soigneusement conçues pour neutraliser l'opposition syndicale, elles y sont effectivement parvenues. Un examen des tactiques auxquelles les dirigeants syndicaux durent avoir recours montre bien à quelles difficultés ils s'étaient brusquement heurtés.
Le rouleau compresseur de la publicité officielle
Certains s'étaient lancés dans de coûteuses campagnes de propagande. Ce fut le cas des fonctionnaires locaux qui ne voulaient pas que l'on sous-traite certains services municipaux à des entreprises privées, qui dépensèrent plus d'un million de livres en une année, et du syndicat des PTT6, qui dépensa un million et demi de livres pour une campagne de dix-huit mois. Dans les deux cas, ils s'efforcèrent d'atteindre leurs adhérents et le grand public au moyen de brochures, autocollants et films vidéo projetés en réunion. On chapitra dûment des militants bien choisis, pour qu'ils viennent faire leur numéro à la télévision. On s'adressait particulièrement aux indécis, ainsi qu'aux groupes tels que les personnes âgées, les handicapés et les personnes isolées, susceptibles de craindre d'être un jour privés d'un service téléphonique indispensable.
Tout cela eut peu d'impact, l'une des précautions du gouvernement ayant été de lancer une vaste campagne de publicité pour promouvoir les émissions d'actions. Même une communication d'un million de livres ne fait pas le poids face à des campagnes évaluées à des centaines de millions. Ces campagnes, rondement menées par des professionnels, avaient peut-être été conçues pour vendre des actions, mais elles vendaient en même temps le principe de la privatisation. Une partie de leur message visait à rassurer les usagers quant à l'avenir du service.
Quand la micropolitique a réponse à tout
Au niveau pratique, les mesures particulières démolissaient un par un tous les prétextes éventuels pour monter une opposition. Les habitants des campagnes étaient inquiets ? Eh bien, on ferait une clause pour imposer le maintien des cabines téléphoniques dans les zones rurales. Si les consommateurs s'inquiétaient d'une hausse éventuelle de leurs factures, alors on lierait les tarifs au taux d'inflation pour plusieurs années. Si une éventuelle prise de contrôle par l'étranger était une menace, pas de problème ! L'action préférentielle de l'Etat y ferait face. Le terrain sur lequel les syndicats auraient pu rassembler une opposition leur était enlevé, centimètre carré par centimètre carré.
Face à la hiérarchie
Une tactique plus prometteuse au départ pour les syndicats avait été de faire front commun avec la direction. Si la hiérarchie et les syndicats d'une entreprise s'opposaient à la privatisation, il devenait difficile de la mener à bien. Ainsi, on les vit s'associer avec Lord Kearton de la British National Oil Corporation, qui s'opposait à la vente de son holding de pétrole et de gaz, et avec Robert Atkinson des British Shipbuilders, qui ne voulait pas entendre parler de vendre les chantiers de la Marine. Il y eut quelques autres opposants dans le groupe des Présidents des Sociétés Nationalisées, mais le gouvernement leur coupa l'herbe sous le pied de deux manières. Tout d'abord, dès qu'un poste était vacant dans les conseils de direction, il y nommait des partisans de la privatisation. Ensuite, il constitua à son tour un front uni des dirigeants, en les associant aux enjeux de la privatisation.
Vanité de la grève
L'action revendicative classique dans les entreprises fut rarement utilisée. Il y avait eu des grèves symboliques dans l'industrie du gaz pour s'opposer à la vente des magasins de détail, dans les ferries de la Manche pour protester contre la vente de Sealink, et dans les usines des Armureries Royales. Un an avant la vente de British Telecom, il y eut des grèves contre Mercury, le concurrent en télécommunications d'affaires qui devait être autorisé après la vente. Elles furent interrompues par les jugements des tribunaux sans avoir jamais eu assez d'impact pour influencer la décision de privatiser.
Ce type de démarche était donc vain, et s'en est finalement tenu à quelques initiatives de petite envergure lancées par des activistes, en partie parce que les dirigeants syndicaux savaient ne pas pouvoir compter sur le soutien de la base pour des actions plus ambitieuses ou de plus longue haleine. C'était l'opposition de la direction qui avait empêché la vente des magasins de détail de gaz ; or ce fut cette même direction que l'on vit mener la vente de British Gas en 1986.
Faire directement des offres alléchantes court-circuite complètement les hiérarques syndicaux
Cette incapacité des manœuvres syndicales traditionnelles à influencer le cours des événements traduit d'une certaine manière la position inconfortable où la politique du gouvernement avait placé les dirigeants syndicaux. Les propositions détaillées de privatisation finalement présentées n'exprimaient pas du tout l'opinion selon laquelle les employés du secteur public étaient surpayés, privilégiés et trop puissants. Au contraire, elles cherchaient à garantir les intérêts de ces employés dans le nouvel état de choses. Elles eurent pour effet de détacher les intérêts des travailleurs syndiqués de ceux de leurs camarades dirigeants. A la suite de quoi ces derniers se mirent vraiment à sentir du mou dans les rangs, de sorte qu'ils ne pouvaient plus faire appel aux réflexes de "solidarité" qui les avaient si bien servis dans les confrontations directes. Pour la National Freight Corporation, par exemple, il était trop manifeste que l'intérêt de la base était de soutenir la privatisation et d'y être associée.
La politique des directions et du gouvernement a été d'obtenir aussi souvent que possible ce type de résultat. Non seulement les offres faites étaient assez alléchantes pour donner aux travailleurs l'envie d'en être, mais il y avait aussi des campagnes de formation et de promotion pour les pousser à participer. Lorsque les salariés eurent comparé ce qu'on leur offrait de ce côté-là et leur avenir probable dans le secteur d'Etat, ils choisirent massivement de dire "oui" au changement, méprisant l'hostilité des hiérarques syndicaux. On en apprend pas mal sur la popularité réelle des industries nationalisées quand on constate l'enthousiasme avec lequel, à plusieurs reprises, les salariés ont participé à la privatisation, et leur fierté manifeste d'avoir pris part à cette nouvelle aventure.
Résignation des syndicats
Entre-temps, les chefs syndicalistes, dont la première réaction avait été de voter motion sur motion au cours des conférences annuelles pour appeler à renationaliser sans indemnités, et de faire campagne au sein du parti travailliste pour qu'il s'engage à revenir sur tout ce qui avait été fait, ont fini par se résigner à considérer comme irréversible une bonne partie de ce qui s'était produit. Les nouveaux groupes d'intérêts, constitués aussi bien par les employés que par le grand public, étaient désormais trop puissants pour qu'on les attaque de front.
If you can't beat 'em, join 'em7
On peut voir un signe des temps dans la vitesse à laquelle certains syndicats, pourtant en principe si lents à changer de position dans d'autres domaines, ont relevé le défi en changeant d'attitude face à la privatisation. Des quatre syndicats impliqués dans la National Freight Corporation, trois ont fini par soutenir le consortium direction/ouvriers qui avait assuré le passage au privé. Le Syndicat National des Cheminots est devenu actionnaire des Gleneagles Hotels, l'une des entreprises qui gère par le biais de British Rail certains des hôtels anciennement possédés par l'Etat. D'autres syndicats n'ont pas manqué de noter la bonne image que l'attribution d'actions aux employés avait valu à British Aerospace, Amersham International et Cable and Wireless auprès de leurs propres adhérents. Cela n'a pas échappé au gouvernement non plus : la bonne réaction des militants syndicaux à l'occasion de ces premiers exemples de privatisation était un précédent utile, précédent dont il s'est servi par la suite pour obtenir le soutien massif du personnel à l'occasion des ventes de British Telecom et de British Gas.
Y a-t-il une vie après la privatisation ?
Il reste à savoir si les travailleurs, en tant qu'employés, tirent également parti de la privatisation. Qu'ils y gagnent en tant qu'actionnaires ne fait aucun doute. La stratégie micropolitique a consisté en partie à donner aux travailleurs un nouveau statut d'actionnaires-capitalistes afin qu'ils aient le sentiment d'être gagnants, quelles que soient les conséquences de ce nouvel état de fait pour leur première casquette.
En l'occurrence, les premiers résultats sont favorables, malgré les sinistres augures des dirigeants syndicaux, mais l'opération est trop récente pour permettre une évaluation définitive. En termes relatifs, les salaires n'ont pas baissé. En fait, à mesure que les entreprises privatisées tiraient parti de leur nouvelle liberté pour élargir leur marché et accroître leur rentabilité, les employés ont bénéficié d'augmentations de salaire en même temps que des plus-values sur leurs actions.
Les relations de travail ne se sont pas dégradées. Il est frappant de constater que la plupart des grands conflits du travail depuis l'avènement du gouvernement en 1979 se sont produits dans le secteur public. Les entreprises passées au privé n'ont connu aucun accroissement notable des conflits du travail. Il y en a eu dans des entreprises récemment privatisées, dont Jaguar et British Telecom. Ils tendaient à être brefs, et cherchaient à préserver la viabilité de l'entreprise. La règle générale est qu'il y a moins d'affrontements dans le secteur privé, et les nouvelles entreprises se sont conformées à cette règle.
Les dirigeants syndicaux s'alarmaient d'éventuelles réductions d'effectifs après transfert au secteur privé. Associated British Ports, par exemple, sous-traite à présent certains services qui étaient assurés par son propre personnel. Cable and Wireless a procédé à des licenciements, de même que British Aerospace. En revanche, Amersham International et Britoil ont embauché. La privatisation a des conséquences contrastées sur le niveau de l'emploi, la position compétitive étant le facteur le plus décisif. C'est à cette position que les pertes d'emploi chez British Aerospace et Cable and Wireless ont été attribuées, ce qui semble indiquer que le niveau de l'emploi dans les entreprises privatisées est désormais soumis aux disciplines concurrentielles, et qu'il s'y adapte en conséquence.
Des salaires plus conformes aux qualifications
Un effet possible du passage au privé est imputable à un phénomène caractéristique du secteur public, où le pouvoir syndical a souvent pour effet d'écraser les écarts de rémunération entre salariés qualifiés et non qualifiés. En d'autres termes, dans les entreprises publiques, les syndicats font monter le salaire des non-qualifiés — plus nombreux — aux dépens de ceux, moins nombreux, qui ont des qualifications ou des talents particuliers. On pouvait s'attendre à ce que le tir soit rectifié dans le secteur privé. Les entreprises doivent payer davantage les ouvriers qualifiés, sous peine de les voir partir chez des rivaux plus offrants. De ce fait, une fois passées au privé, les entreprises doivent offrir les avantages correspondants à ceux qui ont une compétence particulière. Et c'est exactement ce qui s'est passé8.
===Ayant fait du travailleur un capitaliste, la privatisation ménage aussi ses intérêts de salarié
Conclusion : à voir les avantages reçus par les travailleurs, il apparaît possible de mettre au point des politiques qui leur apporteront des profits immédiats en tant qu'actionnaires de l'entreprise, sans mettre en danger les avantages à long terme qu'ils perçoivent en tant qu'employés. En outre, la privatisation s'accompagne souvent de meilleures perspectives d'avancement. Tout cela étant avéré, démontré à profusion par les nombreux exemples de privatisations réussies jusqu'à présent, il n'est guère surprenant que le personnel des entreprises du secteur public ait perçu ce qu'il pouvait gagner à ce qu'on privatise, et qu'il ait le plus souvent coopéré dans ce sens. Là encore, par conséquent, les détails de la politique mise en œuvre ont atteint les résultats visés lors de leur mise au point.