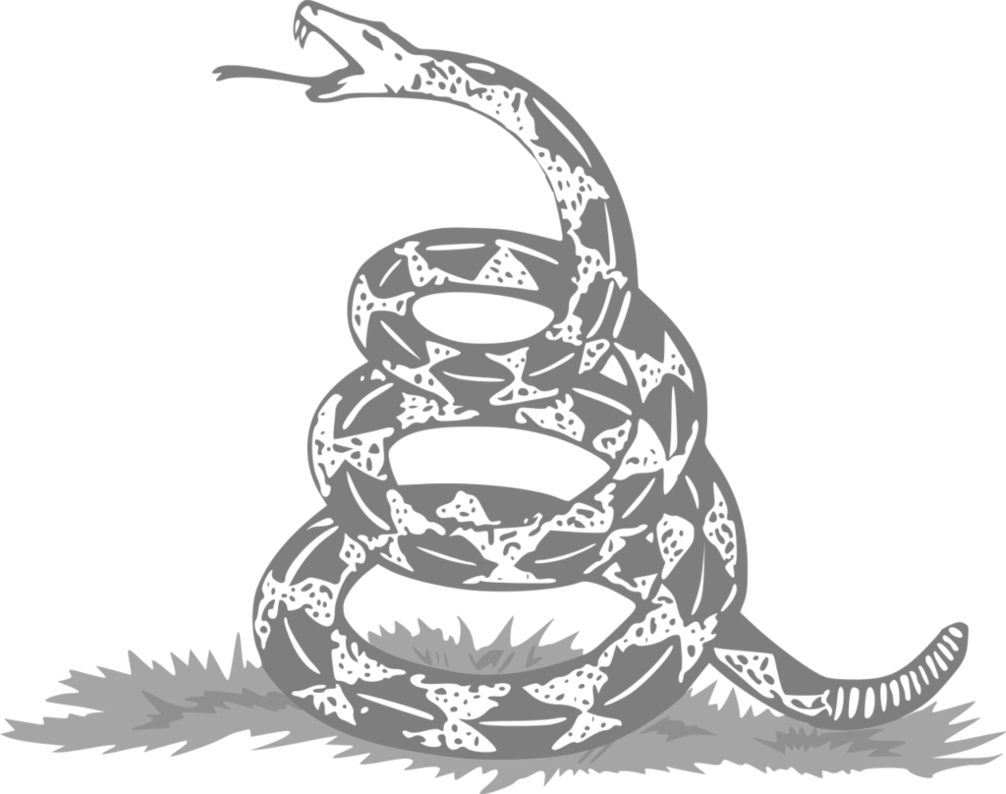Faut-il punir les criminels ?
Faut-il punir les criminels ?
par Christian Michel
Texte établi d’après la transcription d’une intervention en anglais au cours d’un congrès tenu à Katowice en novembre 1996, et reprise au congrès d’ISIL à Rome en octobre 1997[1]
Vers un système de justice libertarien
Le but de cette conférence est de voir avec vous si un système de justice libertarien est possible. Par « libertarien », j’entends un système de justice indépendant de l’État, qui ne se réfère pas à des lois promulguées par un État, qui ignore ses tribunaux et ses prisons. La plupart des libertariens sont des anarchistes. Ce sont cependant des anarchistes cohérents. Les autres anarchistes, les « syndicalistes » et les « gauchistes », n’ont jamais pu élaborer une théorie satisfaisante de la justice, c’est-à-dire qui réponde à la question « Comment donner à chacun son dû ? ». Une question plutôt centrale, il me semble, pour une vie en société. Les libertariens apportent une réponse à cette question, sous la forme d’une théorie des droits de propriété. Rendre à chacun son dû, c’est rendre à chacun ce qui lui appartient. Définir et appliquer le droit de propriété est la procédure pour savoir si quelqu’un a été privé de son dû et comment lui rendre justice. Les libertariens traitent cette question de la justice avec objectivité, et non pas avec l’arbitraire que pratiquent tous les appareils judiciaires, tant étatiques qu’anarchistes « gauchistes ».
Beaucoup de gens ne croient pas possible de se dispenser de l’État dans l’exercice de la justice. Même les libéraux bon teint, qui prescrivent un amaigrissement drastique du « plus froid des monstres froids », pensent que l’administration de la justice reste une de ses fonctions inaliénables (au même titre que la diplomatie et la défense nationale). Il semble donc que de l’extrême droite à l’extrême gauche du spectre politique, le consensus est que la justice ne peut pas être rendue autrement qu’elle ne l’est actuellement, c’est-à-dire par des tribunaux d’État, et que les coupables doivent subir une privation d’argent sous forme d’une amende payée à l’État, ou une privation de mouvements sous forme d’une peine de prison, ou les deux. Plusieurs juridictions ajoutent la peine de mort et quelques autres les châtiments corporels et les mutilations. La violence, pense-t-on, est la seule réponse possible à la violence.
Pourtant, il est clair que l’administration de châtiments « ne marche pas ».[1] D’abord, la violence prononcée contre l’auteur d’un crime n’annule pas la violence faite à la victime, elle s’ajoute simplement à la somme des violences perpétrées dans le monde. En plus, l’exemplarité des châtiments n’a jamais été prouvée. Tout au long de l’histoire, les tortures effroyables infligées en public aux criminels n’ont guère servi de dissuasion, ou nos ancêtres, qui ne manquaient pas d’imagination dans la cruauté, auraient vécu dans un monde sans criminalité. Enfin, ce cycle de violence ne semble au bénéfice de personne. Il ne ramène pas le délinquant dans le droit chemin ; on souligne au contraire que la prison est bien souvent l’école du crime.
Les peines de prison ne sont pas seulement inefficaces, elles sont absurdes. Elles font retomber le coût de punir les délinquants sur leurs victimes réelles ou potentielles. (Une discrimination qu’on ne note pas assez à l’égard des femmes est de leur faire supporter le coût d’entretenir des prisons, alors que 90% des détenus sont des hommes).
Une autre critique des libertariens est que le système de justice actuel est fondé sur un principe collectiviste qui place clairement la « société » au dessus des personnes.[2] La justice aujourd’hui n’est pas rendue à la victime ; la justice est une affaire entre le présumé coupable et la société. La victime est exclue de cette procédure. L’action judiciaire est initiée par un procureur (ou « ministère public »), qui n’agit pas au nom de ceux qui ont subi une agression, mais qui prétend représenter « la société ». Même si la victime retire sa plainte, la procédure ne s’éteint pas automatiquement.[3] Car le but de cette procédure est de punir un coupable et non pas d’obtenir qu’il répare les conséquences de ses actes. Le système ne s’intéresse qu’aux criminels, pas à leurs victimes.
En d’autres termes, la justice d’État a confisqué les droits de la victime. L’appareil judiciaire prétend que les crimes et délits ne sont pas tant commis contre des personnes que contre « la société ». Cependant cette notion même de crimes contre « la société » ouvre la porte aux plus inquiétantes manifestations de l’arbitraire. Un crime dans nos sociétés est ce que le législateur dit être un crime. Or, pour tel législateur, ouvrir sa boutique le dimanche est un délit, et pour tel autre, c’est le samedi. Des centaines de millions de gens vivent sous des régimes qui punissent du fouet les buveurs de vin, mais vous laissent fumer un joint, et à peu près autant de gens peuvent se retrouver en prison sous d’autres régimes parce qu’ils fument quelque chose de plus corsé qu’une Marlboro, mais leur ministre de la santé recommande qu’ils boivent un verre de vin rouge tous les jours. Avec cette logique que le crime peut être défini non par la victime, mais par le législateur, on ne peut rien objecter au législateur qui promulgue une loi contre les rouquins, ou contre ceux qui tournent le dos à une mosquée, ou ceux qui participent à des congrès comme celui d’aujourd’hui. Aussi longtemps que la justice sera rendue au nom de la société, nous resterons à la merci de ceux qui parlent au nom de la société. Selon le bon plaisir du gouvernement en place, tel individu sera déclaré un criminel et tel autre un homme de bien.
La loi du talion
Notre plus ancienne définition d’une procédure judiciaire vise pourtant précisément à nous protéger de l’arbitraire des gouvernants.[4] Le principe fondateur de la justice dans notre société judéo-chrétienne est : « Œil pour œil, dent pour dent ». Par rapport aux mœurs de l’époque, les hébreux voyaient un progrès dans cette identité du crime et du châtiment. Il existait enfin une loi pour limiter l’emportement des juges, qui se voyaient privés du droit de couper la tête à celui qui avait seulement volé un poulet.
Mais le principe « œil pour œil.. » nous enseigne aussi qu’il ne saurait y avoir de crime s’il n’y a pas de victime. Si aucune dent n’a été cassée, alors aucune peine ne peut être prononcée. Ce principe est fondamentalement libertarien. Ce que vous faites à vous-même, ou ce que des adultes consentants font entre eux, peut bien être moralement répréhensible, pourquoi est-ce que ce devrait être illégal ?[5] Un vice n’est pas un crime. Il existe une différence essentielle entre les deux. Par conséquent, si l’un ou l’autre d’entre vous veut fumer un joint ou employer un travailleur clandestin, vous pouvez invoquer Exode XXI et sa « loi du Talion ».
Le grand philosophe et économiste libertarien Murray Rothbard est un des rares auteurs modernes qui prône l’application littérale du principe biblique « œil pour œil... ». Dans un passage étonnant de son Éthique de la Liberté,[6] il nous parle de bourreaux frappant, poignardant ou brisant les membres d’individus reconnus coupables d’agression, exactement comme ces agresseurs l’ont fait subir à leur victime. Nous sommes supposés croire que ce traitement crée une identité du crime et du châtiment. C’est pourtant une chose que de casser le tibia d’un marin dans une querelle de bar, et une autre de casser le tibia de l’agresseur de ce même marin de sang froid dans une salle de tortures. La souffrance causée à une personne ne peut jamais être identique à la souffrance que les mêmes actions causeraient à d’autres personnes. Par exemple, si nous acceptions intégralement le principe « œil pour œil », que ferait-on des violeurs ?
C’est pourquoi dans toutes les sociétés le législateur a cherché une équivalence plutôt qu’une parfaite identité entre le crime et la peine. Le procureur ne va pas réclamer un œil pour un œil, mais une peine censée être équivalente à la perte d’un œil, sous la forme d’une amende ou d’une incarcération. Le problème qui surgit alors est l’arbitraire de cette équivalence. Quelle est la juste proportionnalité entre un blasphème et son châtiment : un froncement de sourcil, ou bien une fatwah entraînant la peine de mort ? La gravité d’un délit est une notion qui a varié selon les cultures et les époques. Un viol n’entraînait pas les mêmes sanctions il y a vingt ans, avant que les mouvements féministes ne rendent l’opinion consciente de ses conséquences dévastatrices. Quel que soit le crime, les législateurs et les juges ne sauraient trouver de peine qui lui corresponde objectivement.
Vers un autre paradigme de justice
Qu’avons-nous établi jusqu’ici ? Nous avons distingué deux caractéristiques d’un système étatique de justice. D’une part, la société exerce une violence contre les délinquants en leur appliquant des amendes ou des peines de prison, ou même la mort. Ces sanctions ne sont fondées sur aucune donnée objective ; le même délit peut entraîner une peine très différente dans des juridictions ou à des moments différents. D’autre part, la victime est exclue de la procédure pénale. C’est comme si la société nationalisait la souffrance et les dommages matériels subis par l’un de ses membres. Il y a là une manifestation de la mentalité collectiviste dans ses œuvres. C’est pourquoi il est temps de réfléchir à un autre paradigme de justice, une justice qui renverserait le processus en plaçant les victimes en son centre, et non pas la société, et par conséquent qui s’efforcerait de mettre un terme au cycle de la violence. Le but d’un tel processus judiciaire serait la restitution aux victimes de ce qui leur a été pris, ou la pleine compensation des pertes et des dommages qui leur ont été causés.
Nous allons donc nous éloigner des notions traditionnelles du droit pénal, qui est fondé sur la notion morale de culpabilité et de châtiment, pour considérer seulement les concepts du droit civil. Cette approche est bien dans la définition de la justice qui rend « à chacun le sien ». Ce que cette définition souligne est que la justice a quelque chose à voir avec le droit de propriété, et seulement avec le doit de propriété, et ses violations. D’où tenons-nous, je me demande, cette idée que la justice doit punir ? Réfléchissez à ceci : un délit a été commis. Si le retour au statu quo ante était possible et réalisé, la justice aurait été rendue et aucune punition ne serait justifiée. Si je vole le sac de ma voisine, puis je change d’avis et je remets ce sac en place sans qu’elle se soit aperçue de rien, elle n’a subi aucun préjudice, et même si elle est avertie après coup de mon geste, elle ne peut réclamer aucune réparation. Ou bien, si je peux rendre aveugle quelqu’un pendant son sommeil, puis changeant à nouveau d’avis, je lui rends la vue, si bien qu’à son réveil, il ignore qu’il a été aveuglé pendant quelques heures, qui donc peut demander justice ? Moralement, j’ai connu un accès de faiblesse et je devrais me livrer à un examen de conscience, mais en droit, ne suis-je pas totalement innocent ?
Dans ces deux exemples, le retour au statu quo ante a été possible, mais si ce ne pouvait pas être le cas, est-ce que la solution ne serait pas de s’en rapprocher le plus possible ? Si la vue ne peut lui être rendue, l’aveugle n’a-t-il pas droit au moins à une réparation de la part de celui qui l’a aveuglé, que cette réparation soit financière ou sous une autre forme ? Quel peut être le bénéfice pour quiconque de crever les yeux de l’agresseur ou de le maintenir derrière les barreaux ? Quelle est la logique du châtiment ? Il semble que le châtiment est une sorte de rituel. Il satisfait peut-être un besoin impulsif de vengeance, mais n’est-ce pas ce type de réaction primaire que la civilisation a précisément pour but de contrôler, voire d’éradiquer ?
Une procédure judiciaire basée sur la réparation est simple, au moins en théorie. Elle consiste à rendre à la victime ce qui lui appartient, c’est-à-dire ses biens, ou leur équivalent monétaire, plus des dommages pour le trouble de jouissance, les occasions manquées à cause de la privation de ses biens, le coût de récupérer ceux-ci, etc. La procédure judiciaire commence donc par une enquête :
· Une personne se plaint-elle d’une violation de son droit de propriété ? (Sans cette plainte d’une victime déclarée ou de ses ayants-droit, aucune procédure ne peut commencer).
· Cette violation du droit de propriété est-elle réelle ?
· Qui en est l’auteur ?
· Pouvons-nous rendre le bien à son légitime propriétaire ? Sinon, à quelle réparation le propriétaire lésé a-t-il droit ?
La procédure judiciaire doit se limiter à cette enquête et à cette réparation. Elle n’a rien à voir avec le châtiment. Il n’existe donc aucune raison pour une quelconque « législation ».
Mon intérêt bien compris veut que je sois le « gardien de mon frère »
Si nous sommes d’accord qu’il n’existe pas de crime s’il n’existe pas de victime, et que la seule raison d’être d’une procédure judiciaire est de forcer l’agresseur à rendre ce qui est dû à la victime, nous nous trouvons confrontés à un gros problème : la restitution est-elle toujours possible ?
Laissez-moi vous donner quelques exemples. Quand une vitre a été brisée, il semble facile pour un juge, assisté d’experts en bâtiment, d’évaluer le montant des dégâts. Il appartient alors au juge d’ordonner aux casseurs de payer le remplacement de la vitre, plus les dégâts annexes, un nouveau tapis, par exemple, si l’ancien a été détérioré par la pluie. Si une voiture a été volée, le voleur doit évidemment rendre la voiture au propriétaire et le compenser pour les dommages éventuellement causés au véhicule, l’essence consommée, le kilométrage effectué abusivement, la location d’un véhicule de remplacement pendant la durée du vol, plus les coûts encourus par la police dans sa recherche du voleur (il n’y a pas de raison que la police, privée ou pas, soit entièrement payée par les honnêtes gens).
Le problème de la restitution apparaît plus complexe, peut être même insoluble, dans les cas de crimes de sang. Que signifie « restitution » dans le cas d’un homicide, par exemple ? A qui cette restitution est-elle due ? Les héritiers y ont-ils droit ?[7] Peut-être, mais considérons un cas-limite, le meurtre sauvage d’un enfant. Il n’existe pas d’héritier dans ce cas pour réclamer quoi que ce soit. Les parents ? Mais on pourrait prétendre, même si c’est avec cynisme, que les parents, en termes monétaires, ont gagné à la mort de leur enfant, ils épargnent sur les jouets, l’alimentation, l’habillement, la scolarité…, autant d’économies qui amortiront vite le coût inattendu des funérailles. Il reste évidemment le chagrin, mais comment un juge évaluera-t-il le chagrin ? Et si les parents eux-mêmes sont les auteurs du crime (ces horreurs arrivent dans la vie n’est-ce pas ?), qui peut prétendre toucher une quelconque réparation ?
Considérons encore le cas d’un retraité, solitaire comme ils le sont si souvent de nos jours. Son corps poignardé est découvert par des voisins. Personne ne pleure sa mort. De lointains héritiers sont agréablement surpris de l’événement. La caisse de retraite verse une rente de moins. Qui se donnera la peine d’initier une procédure judiciaire ? Qui donc, en fait, peut prétendre à une quelconque réparation pour ce meurtre ? Le paradoxe apparent dans le cas d’agressions contre des personnes seules est que l’agresseur a intérêt à tuer systématiquement ses victimes, car si elles ne sont plus là pour se plaindre elles-mêmes de l’agression, il semble que personne ne sera intéressé à le faire. Sans un ministère public agissant « au nom de la société », on dirait que mon système judiciaire libertarien garantit l’impunité aux tueurs en série de petites vieilles sans famille.
Cette opinion fait fi des ressources du marché. Les hommes de l’État rendent la solidarité obligatoire entre les êtres humains, mais cette solidarité existe naturellement. Elle existe entre les membres d’une même famille, d’une même ethnie, d’une même religion… Elle se construit librement à travers ces entreprises que sont les compagnies d’assurances, les mutuelles, les syndicats, les associations caritatives… Les hommes de l’État ont confisqué cette solidarité naturelle entre les gens. Si nous privatisons l’administration de la justice, nous rendons aux gens la possibilité de constituer des réseaux d’entraide, qui existent dans tous les groupes humains, sauf dans les sociétés socialistes et démocrates sociales.
Nous pouvons donc en confiance fonder les relations sociales sur cette solidarité volontaire. Ses manifestations prendront toutes les formes que l’imagination de l’être humain peut inventer, aussi mon ambition se limite-t-elle ici à suggérer quelques scénarios parmi une infinité d’autres possibles. Commençons par le deuxième exemple que je vous proposais, celui du retraité sans aucun lien familial ni social. Une telle solitude est improbable dans une société libertarienne pour des raisons qui seraient hors sujet ici, mais supposons qu’il en soit ainsi. Même dans ces circonstances extrêmes, la poursuite par la plupart des gens de leur intérêt bien compris assurera la protection de ce solitaire misanthrope ou froidement abandonné.
Comment la poursuite par chacun de son intérêt personnel peut-elle assurer une protection policière et judiciaire au retraité solitaire ? J’émets l’hypothèse que les voisins de ce retraité pourraient bien prendre une assurance sur sa vie garantissant à leur association de quartier ou à une association caritative de leur choix le versement d’un capital en cas de mort violente de leur voisin. Le propriétaire de l’immeuble lui-même pourrait prendre une telle assurance. Pourquoi feraient-ils ce geste ? Parce que si le bruit courait qu’un individu sans assurance habitait le quartier, cet individu deviendrait la cible facile d’un criminel à qui serait garantie l’impunité. Voilà une situation dans laquelle le propriétaire et les voisins ne souhaitent pas se trouver. Il n’est pas facile de vendre ou louer un appartement s’il existe une victime toute désignée dans l’immeuble. Heureusement, les crimes sont rares dans la société, quoiqu’on dise, et encore plus rares dans une société libertarienne qui ne donne pas l’exemple de la violence institutionnalisée policière et militaire. C’est pourquoi, déjà aujourd’hui, les primes d’assurances contre le meurtre sont minimes. Elles sont à la portée de tous, y compris de propriétaires pingres, de voisins chargés de famille, et, bien sûr, de riches philanthropes. Ces derniers, au moins quelques uns d’entre eux, cessant d’être soumis aux confiscations du fisc, considéreront de leur devoir d’aider les plus pauvres dans la société. Il en va de leur réputation. J’imagine même que beaucoup d’institutions caritatives achèteront une prime sur la vie d’enfants et sur celles de sans-logis, d’abord parce qu’il leur appartient de le faire, et ensuite parce qu’elles toucheraient un joli capital si, par malheur, un de leurs protégés était assassiné.[8]
De son côté, la compagnie d’assurances exigera que la personne assurée soit sous la protection d’une société spécialisée (une agence de protection privée), à moins que cette compagnie n’offre le service elle-même. En effet, une personne protégée professionnellement risque moins une agression. Si les clients d’une de ces agences spécialisées étaient trop souvent victimes d’agression et si l’agence ne parvenait pas à en arrêter les auteurs, cette agence perdrait vite sa réputation et ses revenus. On peut donc imaginer le zèle (inconnu des polices d’État) que ces agences mettraient à prévenir les agressions et, éventuellement, à en retrouver les coupables.
Restitution à la victime
L’intérêt du coupable est d’effectuer la restitution à sa victime le plus vite possible et être débarrassé de cette contrainte. La victime ou ses ayants-droit n’ont pas d’objection à une prompte réparation. Les parties tomberont donc d’accord pour que les revenus du coupable, moins un minimum pour assurer sa subsistance, soient alloués à la victime ou à ses ayants-droit. Cette procédure est celle que nous connaissons aujourd’hui sous la forme de saisie sur salaire, par exemple. Si le coupable n’a pas d’emploi fixe ou refuse d’en prendre un pour échapper à son obligation de réparation, le juge exigera que le coupable soit placé dans un camp de travail.
La notion de travail forcé évoque les bagnes de Guyane ou de Nouvelle-Calédonie. Avec une différence cependant : on ne confiait pas aux forçats le moindre travail productif, quelque talent qu’ils aient pu avoir. Au contraire, le travail dans les bagnes n’avaient pas pour objet de créer de la richesse, il était conçu comme un châtiment, le plus absurde et pénible possible, et volontairement dénué de toute utilité pour être encore plus humiliant. Le travail forcé, dans une conception libertarienne de la justice, a un sens. Il vise une exécution complète et rapide de la réparation due à la victime. C’est pourquoi cette dernière, ou son représentant, le juge, choisira un camp de travail qui exploitera au mieux les capacités du coupable.
Dans le cas de dommages importants causés par le coupable, dans le cas extrême de meurtre, par exemple, les criminels ne pourront jamais restituer la valeur de ce qu’ils ont détruit, devraient-ils y passer toute leur vie et être les personnes les plus productives du monde. Pour être assurés d’une réparation rapide, les gens s’assureront, comme ils le font aujourd’hui. Les primes cependant seront moins chères qu’aujourd’hui, puisque si les victimes optent pour un dédommagement par la compagnie d’assurances au lieu d’attendre une restitution du coupable, ces victimes céderont à la compagnie d’assurances leurs droits à la restitution, et grâce à cette restitution qui les dédommagera au moins en partie, chaque sinistre ne sera plus une perte totale pour les compagnies d’assurances comme c’est le cas actuellement.
La relation dans tous les cas reste entre la victime et son agresseur, et cet aspect est important. Si la victime déclare à n’importe quel moment qu’elle n’a plus de grief contre l’agresseur, celui-ci est immédiatement libéré de toutes ses obligations. Qui d’autre que la victime peut prétendre en décider autrement ? Il ne saurait y avoir de condamnation légitime par « la société », c’est-à-dire par des gens qui n’ont pas subi l’agression. (Par conséquent, il ne saurait y avoir non plus de « revanche » que le criminel pourrait rechercher contre « la société »).
Justice privée
Arrivé à ce point, je crois avoir bien montré que personne ne se trouvera exclu d’une procédure de justice dans une société sans État, quelle que soit sa situation personnelle. Il y a bien d’autres acteurs que « l’État providence » qui ont intérêt à rendre la justice et qui le feront, même aux plus déshérités.[9]
Quand les gens au sein d’une société n’ont pas d’autres conflits que ceux qui portent sur les droits de propriété, sans les prétendus crimes et délits qu’inventent les hommes de l’État, les procédures judiciaires sont moins nombreuses que dans nos sociétés étatisées. (Nos tribunaux et nos prisons seraient-ils encombrés s’il n’existait pas de délits liés aux drogues et à la fiscalité ? Ces délits sans victime comptent pour la moitié des condamnations rendues par la justice en France et aux États-Unis). En outre, des juges rémunérés par les parties sont plus efficaces que des magistrats nommés par l’État. Pourquoi cette conviction ? Parce que toute procédure judiciaire est coûteuse et les requérants ne plaideront leur cas que devant des juges connus pour intégrité et leur équité. Les juges perdraient vite leur clientèle si leurs jugements étaient trop fréquemment contestés. Quand un juge ou une agence privée de justice rendra un verdict de réparation, ce sera après s’être assuré que la victime qui réclame cette réparation est vraiment la victime, que l’accusé est vraiment l’auteur de l’agression, que le montant de la réparation est équitable. Car la réputation des juges n’est pas seule en cause dans cette affaire, leur situation financière est également en jeu. La meilleure garantie des justiciables est que les juges soient tenus personnellement responsables de leurs erreurs judiciaires.
Cette responsabilité des juges envers à la fois la victime et le coupable présumé est la principale différence entre une justice libertarienne et une justice d’État. Contrairement au magistrat d’État, un juge dans une société libertarienne est responsable de ses actes. Il ne peut pas prétendre rendre un verdict et s’en laver les mains. S’il a déclaré une personne coupable et l’a condamnée à une réparation alors que cette personne était innocente, ce juge peut être tenu par un autre jugement à compenser l’innocent pour tous les dommages subis, par exemple pour la perte d’un emploi, de la réputation... Inversement, la victime (ou son assureur) qui n’aurait pas obtenu de réparation d’un accusé innocenté à tort peut se retourner contre le juge pour avoir été privée de son dû. La fonction d’un juge dans une société de liberté n’est pas de punir, mais de restaurer la paix entre les parties. Ce but ne peut pas être atteint si un jugement n’est pas équitable et si la partie lésée ne peut pas espérer une réparation à la suite d’une erreur judiciaire.
Parce qu’en définitive le plaignant devant un juge sera le plus souvent une compagnie d’assurance qui aura compensé la victime et aura reçu d’elle les droits à une réparation de l’accusé, les pauvres auront les mêmes chances que les riches dans une procédure judiciaire. On en a la démonstration aujourd’hui : la compagnie d’assurances d’un propriétaire de Rolls ne gagne pas systématiquement sur celle d’un propriétaire de 2CV, même quand elles concluent une transaction en dehors des tribunaux d’État.
Objections
Plusieurs objections à cette conception de la justice viennent aussitôt à l’esprit. La première est que ce système fondé sur la restitution place une valeur monétaire sur chaque crime et délit. Les marxistes ricaneraient en voyant là l’ultime étape dans la transformation de toutes les actions humaines en actions marchandes. Ce n’est qu’une vision cependant, et singulièrement réductrice, de notre conception de la justice. Exactement comme le mariage est plus qu’un contrat définissant les droits et les obligations des époux et la répartition de leurs biens, il y a plus dans une procédure judiciaire que l’application de textes et de principes. Aucune restitution sous quelque forme, monétaire ou autre, ne satisfera la soif de vengeance et ne compensera la souffrance des victimes. Il n’existe pas d’équivalent qu’un juge puisse déterminer pour les sentiments qui entourent un verdict, la culpabilité, la compassion, la haine, la peur… Mais, arrêtons-nous un moment, est-ce le rôle d’un système judiciaire d’attiser ces émotions-là ? Nous l’avons déjà dit, il ne saurait exister de châtiment qui corresponde objectivement au crime. Un châtiment est toujours arbitraire. Une justice qui s’attache à restituer plutôt qu’à punir a au moins le mérite de lier directement l’agresseur et sa victime, l’agression et la réparation de l’agression.
Si tous les verdicts comportent une part d’arbitraire, ne peut-on au moins soutenir que les coupables sont à égalité en servant leur peine ? Même cette satisfaction pour notre sentiment de la justice nous est refusée. L’incarcération n’affecte pas deux individus de la même façon, et même la peine de mort ne les trouve pas dans le même état de préparation psychologique et spirituel. L’apparente identité « Œil pour œil… » est trompeuse : l’œil vaut plus pour un peintre que pour un musicien. De la même façon, on peut bien soutenir que l’obligation de compenser leur victime n’aura pas le même effet pour deux agresseurs. Le millionnaire trouvera plus facile de payer la restitution d’un autoradio volé qu’un chapardeur de banlieue. Les millionnaires cependant ressentent rarement le besoin de voler des autoradios. Une des raisons est qu’ayant atteint une telle aisance financière, ils ont d’autres valeurs, et l’une d’entre elles est la considération dont ils jouissent dans leur entourage. La restitution d’un vol ne les ruinera pas, mais la condamnation aura nécessairement un impact sur leur honneur et sur la marche de leurs affaires. C’est l’atteinte à la réputation qui est la véritable sanction pour l’homme riche, alors qu’elle affecte le chapardeur bien moins que la contrainte financière.
Un crime ne prive-t-il pas le criminel de ses droits ?
Il me paraît singulièrement difficile de suivre Murray Rothbard quand il soutient à la fois le principe de restitution et celui de la déchéance des droits du criminel comme conséquence de son acte. Toute condamnation qui excéderait la réparation des dommages causés, y compris les frais de police et de justice, toujours à la charge de l’agresseur, verserait à mon sens dans l’arbitraire pur. Cet arbitraire devient manifeste quand nous considérons le cas du meurtre comme le fait Murray Rothbard. Il soutient, avec beaucoup d’autres, que le meurtrier, ayant pris la vie de sa victime, s’est lui même déchu du droit à sa propre vie.
Condamner à mort un meurtrier peut assouvir un besoin de vengeance, mais comment cette condamnation pourrait-elle bien s’inscrire dans un système judiciaire basé sur la restitution ? Si la vie pouvait m’être prise pour remplacer celle que j’ai ôtée à quelqu’un, la peine de mort aurait un sens. Aucun indice ne nous permet de croire cependant que la science est capable d’inventer une « machine à transférer la vie ». Alors en quoi le fait que j’ai tué quelqu’un donnerait-il à d’autres le droit de me tuer ? Supposons que j’ai volé le téléviseur de mon voisin Tartemolle. Je lui ai fait manquer ses feuilletons favoris. Si mon larcin est découvert, est-ce que le juge doit me condamner à rendre son téléviseur à Tartemolle, ou un autre téléviseur de même qualité, plus une réparation pour la privation des feuilletons qu’il a manqués, ou bien est-ce que le juge doit me priver de regarder la télévision pendant le temps équivalent à la durée de mon larcin ? Si voler un téléviseur ne me prive pas du droit d’en posséder un moi-même, pourquoi voler une vie me priverait-il du droit à ma propre vie [10] ?
Le principe de restitution est-il trop laxiste ?
On peut trouver quelque mérite à l’objection que la simple réparation du tort causé laisse l’agresseur s’en tirer à bon compte dans bien des cas. C’est pourquoi, dans une société de liberté, certains individus voudront marquer leur adhésion aux valeurs d’intégrité et de responsabilité en se soumettant volontairement à la possibilité de peines plus lourdes s’ils devaient manquer à leurs engagements. Par exemple, si un voleur est aussi un musulman convaincu, le juge lui ordonnera d’effectuer la restitution de son bien à la victime, puis livrera ce voleur à sa communauté pour qu’il soit puni selon les règles coraniques, un sort que le voleur aura accepté pour lui-même en embrassant l’islam
On pourrait bien voir prospérer dans une société de liberté ces communautés appliquant des règles plus pénalisantes que la simple restitution.[11] Non pas que les châtiments soient dissuasifs, mais l’adhésion à ces communautés manifestera la conviction de leurs membres de pouvoir rester fidèles à leurs valeurs en toutes circonstances. Cet engagement de leur part, pris au risque d’encourir de graves sanctions en cas de manquements, pourrait bien rendre les membres de ces communautés très populaires dans certaines professions. Le vieux principe du châtiment ne disparaîtra donc pas. Mais il sera librement accepté. C’est toute la différence.
Il faut en effet distinguer ici deux notions, le droit et la morale. Pour acquérir sa légitimité, le droit doit être objectif. Dans la mesure où la règle de droit peut nous être imposée par la force des armes s’il le faut, son application doit ne souffrir aucune contestation. Le respect du droit de propriété et le principe de restitution constituent ce minimum que nous pouvons légitimement exiger des autres. Le châtiment appartient à une autre sphère métaphysique. Aucune personne humaine n’a le droit de punir. Cependant, si pour des raisons qui ne ressortent pas du droit, mais de convictions religieuses ou morales, l’agresseur a accepté le risque d’être puni pour ses actions, cela ne concerne plus la victime. C’est une affaire entre l’agresseur, sa conscience et la relation qu’il entretient librement avec sa communauté.
Conclusion
Dans le temps limité de cette intervention, j’ai essayé de montrer qu’aucune mesure judiciaire ne saurait rétablir le statu quo ante. L’alternative qui s’en rapproche le plus est la réparation offerte à la victime. Cette réparation peut être évaluée en termes financiers, mais aussi prendre d’autres formes à la demande de la victime et après approbation du juge, par exemple un travail en faveur d’une association caritative.
Certaines communautés mettront comme condition à l’adhésion de leurs membres qu’ils s’abstiennent de comportements qui sont jugés nuisibles. Nous avons vu que le manquement à ces règles entraînera un châtiment, connu d’avance et expressément accepté par les membres de ces communautés.
Certaines compagnies d’assurances - mais peut être pas toutes - refuseront de même une clientèle dont elles jugent le comportement trop risqué ou bien leur imposeront des primes plus lourdes (par exemple, aux automobilistes qui ne bouclent pas leur ceinture). La société découvrira ainsi quels sont les comportements réellement dangereux et ceux qui sont interdits seulement parce qu’ils choquent la morale des politiciens ou de leur électorat.
Un système judiciaire fondé sur la réparation réduit le niveau global de violence dans le monde. La raison n’en est pas seulement que le système refuse de répondre à la violence par la violence, mais plutôt qu’il ne range pas parmi les délits des comportements que d’aucuns adoptent, qui sont peut-être moralement répréhensibles, mais qui ne portent pas préjudice à autrui : où est donc la victime de celui qui roule en moto sans casque, qui traverse une frontière sans s’annoncer, qui travaille sans permis, qui consomme des drogues… ?
Au cours de l’histoire, les hommes de l’État ont confisqué les droits de la victime. Ils vont même jusqu’à se prétendre les victimes de délits contre un prétendu « ordre public ». Le danger dont l’histoire révèle la manifestation constante est que la technique pour accéder au pouvoir et s’y maintenir est la fabrication de crimes dont le pouvoir peut ensuite dénoncer les auteurs. Lorsque les hommes de l’État ont la faculté de déclarer que « la société » est une victime, chacun de nous devient un criminel potentiel. Retirer l’administration de la justice aux hommes de l’État est essentiel à notre liberté.
NOTES
[1] Dans le cadre d’un contrat, la perspective de pénalités est un bon moyen de dissuasion envers ceux qui voudraient manquer à leurs obligations (des pénalités de retard pour livraison tardive, par exemple). Mais toutes nos actions ne s’inscrivent pas dans le cadre des relations rationnelles et pacifiques que génère le commerce.
[2] Quand la délinquance et la criminalité envahissent un quartier, tous les habitants en pâtissent même s’ils n’en sont pas directement victimes : ils se barricadent chez eux, ils ne sortent plus le soir, etc. Cela n’entraîne pas que la justice doive être rendue « au nom du quartier », mais seulement que les délinquants qui ont effrayé les habitants doivent les compenser pour le préjudice qu’ils ont ainsi subi.
[3] La raison invoquée pour poursuivre une procédure pénale contre un présumé coupable sans tenir compte du souhait de la victime est que cette dernière pourrait être l’objet de pressions la forçant à retirer sa plainte. Les criminels ne seraient ainsi jamais jugés. L’argument n’est pas convaincant. Les témoins aussi peuvent être menacés s’ils ne disent pas ce qu’on attend d’eux. C’est pourquoi il existe dans tous les pays des mesures pour les mettre à l’abri et ces mêmes mesures pourraient protéger les victimes. L’argument oublie aussi que les victimes peuvent céder leur droit à une restitution, et les acheteurs se chargeront d’extraire devant la justice le maximum de restitution de la part du criminel, sans se laisser aucunement intimider par quelques mafieux.
[4] Le code d’Hammourabi et certains recueils de lois égyptiens et chinois sont plus anciens, mais ils n’ont pas eu de postérité marquante dans notre tradition judiciaire.
[5] Si nous tombons d’accord qu’une loi morale ne saurait être la propriété de quiconque, et que le Droit est le droit de propriété, alors nous devons conclure qu’aucune restitution n’est due - en quoi consisterait-elle ? - lorsqu’une loi morale est violée, si la violation de cette loi morale n’est pas en même temps une violation du droit de propriété.
[6] Murray Rothbard, L’Ethique de la liberté, Les Belles Lettres, Paris, 1992
[7] Dans une société d’hommes libres, les héritiers ne sont pas nécessairement les enfants du défunt. La profonde injustice du Code Civil napoléonien est qu’il crée une obligation pour un propriétaire de léguer ses biens à ses enfants, à parts égales. Une personne qui est propriétaire d’un bien, par définition, doit pouvoir le donner à qui elle veut, à une association caritative, aux employés de son entreprise, à son petit ami, ou pourquoi pas, à ses enfants. Si cette personne pense pouvoir être la victime d’un meurtre, elle peut donc léguer par testament à qui elle veut la restitution que son meurtrier sera condamné à effectuer.
[8] Les compagnies d’assurance étudieraient de très près une police demandée par un souscripteur à son bénéfice sur la vie d’un enfant ou d’une personne isolée. On serait en présence d’un pari sur la vie d’un tiers, pari qui pourrait vite devenir une tentation pour le bénéficiaire en mal d’argent. Les assureurs en revanche n’auraient pas de réserve si la police était souscrite au bénéfice d’une institution comme un hôpital, une église, une école, un musée ou une association de quartier.
[9] Une police d’Etat n’est pas plus nécessaire à la protection des gens, même des plus pauvres, que ne l’est une justice d’Etat. Je ne peux pas développer ici le concept d’ « agence de protection ». On peut simplement remarquer, comme nous l’avons dit plus haut, que les compagnies d’assurances, parce qu’elles auront à rembourser les dommages causés par une agression contre un assuré, feront une condition de leurs contrats que l’assuré soit protégé par une telle entreprise, et peut-être les assurances les financeront-elles elles-mêmes. La seule fonction de ces entreprises de protection sera de protéger les gens, pas les gouvernants.
[10] Quelques rothbardiens suggèrent qu’ôter la vie à autrui n’entraîne pas nécessairement l’application de la peine de mort ; en réalité, le droit de l’agresseur à sa propre vie est transféré aux héritiers de sa victime. C’est à eux qu’il appartient de réclamer la mort du meurtrier, s’ils la souhaitent. Il y aurait là une sorte de restitution sous la forme : « Une vie pour une vie.. » Le test pour savoir si ce transfert du droit du meurtrier à sa propre vie est une restitution ou un châtiment peut prendre la forme du cas de figure suivant. Supposons que Nikita égorge mon père et est reconnue coupable de ce meurtre. Je suis le seul héritier de mon père. Selon les rothbardiens, le droit de Nikita à sa propre vie est transféré en ma faveur. Je peux donc faire d’elle ce qui me plaît, elle est mon esclave en droit, je peux la mettre à mort et vendre ses organes, etc. Une perspective alléchante, sans doute, mais il y a plus : Si nous admettons ce principe d’ « une vie pour une vie », je me trouve maintenant dans la situation de tuer qui je veux en totale impunité. En effet, je peux aborder mon vieil ennemi Sabot en plein jour et en public, et lui loger une balle entre les deux yeux. Je serais convaincu de meurtre, certes, mais quand les héritiers de Sabot viendront réclamer ma vie, je leur répondrai : « Vous pouvez avoir celle de Nikita, elle est à vous. J’ai pris une vie, je vous en rends une autre ». Prétendre que seule ma vie satisfera les ayants-droit de la victime n’est plus défendre le principe de restitution, mais celui de châtiment. De quelque façon que l’on argumente, tant qu’on ne pourra pas transférer la vie du meurtrier à celle de sa victime par quelque procédé merveilleux, la peine de mort sera toujours l’institutionnalisation de la vengeance.
[11] Je remercie Alain Laurent, qui est en désaccord avec moi sur le principe d’une justice fondée sur la restitution, mais qui m’a suggéré l’idée que le marché suscitera des procédures de justice moins « laxistes ».