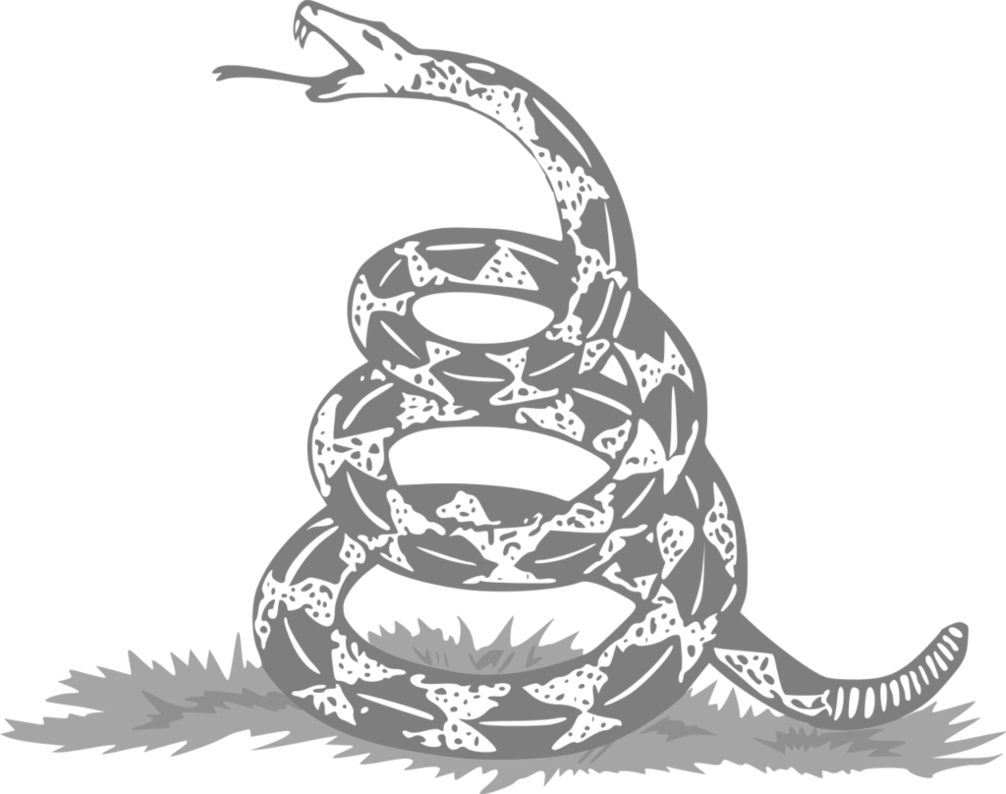Dignité humaine : le plus flou des concepts
par Olivier Cayla
Le Monde, 31 janvier 2003. Olivier Cayla est agrégé de droit public, directeur d’étude à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS).
Toute dispute consacrée au point de savoir s’il convient de légiférer sur les questions « de société » s’articule aujourd’hui autour d’un argument unique : la « dignité de la personne humaine » Depuis quelques années, la référence rituelle à ce concept éthico-juridique semble en effet suffire à résoudre tout problème de définition de nos valeurs sociales fondamentales. Imagine-t-on pourtant un concept plus flou? Dispose-t-on au moins des critères permettant d’identifier, parmi ses diverses interprétations possibles, celle qui apparaît à coup sûr comme étant « la meilleure »?
Par exemple, selon l’acception commune, le respect de la dignité commande de ne jamais instrumentaliser la personne humaine: aussi, l’un des cas les plus flagrants d’atteinte à cette dignité apparaît-il à beaucoup comme étant celui de la prostitution, que la loi pénale devrait par conséquent prohiber, même lorsqu’elle est librement consentie et pratiquée dans l’indépendance. Mais les avis diffèrent sur le point de savoir qui est le coupable de cette « chosification » de la personne.
Pour les uns, iI s’agit du client, qui exploite la détresse économique de la prostituée et l’asservit à la satisfaction unilatérale de son désir. Pour d’autres, c’est plutôt la prostituée elle-même que la loi doit condamner, puisque, par sa libre décision de se vendre, elle apparaît comme l’auteur de la dégradation de l’humanité dont elle est porteuse sans en être propriétaire. Bien entendu, le partisan de la liberté de se prostituer n’est pas en reste non plus dans la déférence envers la dignité, mais il interprète ce concept en sens inverse : dénier à la prostituée, majeure et consentante, toute capacité de jugement pour apprécier par elle-même ce qui est ou non à la hauteur de sa propre dignité revient à douter de sa maturité et de sa conscience, et donc à contester sa qualité de personne autonome, avec la dignité qui s’y attache.
Du même argument de la dignité découlent donc toutes les attitudes normatives possibles.
Songeons aussi à ce jeune tétraplégique, qui, au nom du droit à mourir dans la dignité, demande au président de la République la légalisation de l’euthanasie. Certains lui rétorquent que faire droit à sa demande de mort serait en réalité une forme de mépris pour son humanité indisponible, si bien que l’intervention compatissante d’une tierce personne destinée à la satisfaire ne saurait perdre son caractère criminel en dépit du consentement avéré de la victime.
Deux interprétations de la notion de dignité lui font donc dire la chose et son contraire. Avancer cet argument ne nous avance à rien pour savoir quoi décider.
Mais on objectera que certaines pratiques ne sauraient jamais être justifiées par l’argument de la dignité, lequel ne serait donc pas si réversible qu’on veut bien le dire ici. Le clonage reproductif, notamment, appelle la stigmatisation pénale la plus énergique, sous la forme d’un « crime contre la dignité humaine » imprescriptible.
Soit. Mais comment le clonage thérapeutique ne porterait-il pas a fortiori une même atteinte objective à la dignité humaine ? Cette dernière pratique ne revient-elle pas à instrumentaliser l’humain? Or, parmi les voix réclamant la criminalisation du reproductif, les plus ardentes sont celles qui prônent la légalisation du thérapeutique. Comment justifient-elles alors une position si paradoxale? Par le refus - loin d’être partagé par tout le monde - de voir dans l’embryon une « personne humaine », voire par l’affirmation peu limpide selon laquelle l’embryon de quelques jours dont les cellules souches pluripotentes peuvent se prêter à un usage thérapeutique devrait être considéré non pas comme un embryon, mais seulement comme un négligeable « pré- embryon ».
En tout cas, de l’avis des partisans comme des adversaires du thérapeutique, l’atteinte portée à la dignité humaine par le clonage reproductif est, quant à elle, évidente. Certains avertissent, notamment, qu’en l’état actuel des techniques les dangers sont considérables pour l’enfant né d’une opération dont on ne connaît pas encore toutes les implications pour sa santé. Certes, mais n’est-ce pas en fait le principe de précaution qu’on invoque alors, et non pas celui de la dignité?
Il est vrai qu’on fait aussi valoir que le clonage subvertit la règle naturelle de la reproduction humaine, qui est de ne donner naissance qu’à des individus génétiquement uniques. Pourtant, le phénomène de la gémellité monozygote, qui est une forme de clonage naturel, ne fait-il pas obstacle à cet argument? D’ailleurs, comme tout le monde le souligne, le fait qu’un jumeau monozygote soit « le même » génétique que son frère n’entraîne évidemment pas pour autant que son identité psychique et sociale, c’est-à-dire sa qualité de sujet, se confonde avec celle de son frère.
Certes, la demande de clonage reproductif peut émaner d’individus qui commettent une telle confusion, en prenant pour la réalité leur désir d’identité absolue avec leur clone, ce qui ne peut en effet qu’aliéner les êtres humains issus du clonage à leurs fantasmes délirants. Mais, dans ce cas, est-ce bien, là encore, le clonage en soi qu’on dénonce comme étant attentatoire à la dignité, ou bien plutôt les fantasmes qu’il suscite et que font prospérer des illuminés affligeants qui promettent grotesquement la vie éternelle ?
Ce concept de dignité humaine fournit-il donc l’argument le plus adéquat pour prohiber efficacement le clonage reproductif? Ne pourrait-on pas plutôt faire valoir que ce dernier subvertit les catégories les plus élémentaires de la parenté puisque, en rendant possibles les naissances, indéfiniment différables dans le temps et en nombre illimité, de jumeaux artificiels de chacun d’entre nous, il empêche de distinguer les générations ? De même, en permettant à toute femme de porter son propre clone formé à partir de l’un de ses ovocytes énucléé, il lui permet d’accoucher de sa soeur jumelle sans en être la « mère » à proprement parler, ce qui interdit toute traduction juridique compréhensible de l’identité personnelle.
Pourquoi ne pas se contenter d’arguer de ce que de telles configurations monstrueuses, inhérentes au principe même du clonage, sont en outre de nature à nuire gravement à la santé psychique des clones, ce qui peut s’établir sans nullement recourir au concept de dignité?
Mais la force d’un argument dépend peut-être moins de la clarté de son énoncé que de son aptitude à asseoir l’autorité de son énonciateur. De ce point de vue, cette invocation fétichiste du principe de dignité, quelles qu’en soient la teneur et l’orientation politique ou philosophique, est d’une admirable puissance de persuasion. L’emphase de la formule ne permet-elle pas, en effet, à celui qui s’en prévaut de se désigner comme sauveur de l’humanité? L’efficacité de cet artifice rhétorique plutôt simpliste est dès lors imparable : quiconque s’aventure à contester telle interprétation particulière du principe de dignité est censé contester, du même coup, l’idée même de dignité en général et se dévoiler ainsi comme un dangereux ennemi de l’humanité.
Au fond, le principe de « dignité de la personne humaine » présente toutes les caractéristiques de cette formule fixe mais vide, de ce « signifiant flottant », de cet « abracadabra », dont la profération liturgique accompagne l’édiction de toute loi, pour fonder symboliquement l’autorité de celle-ci grâce au ressort magique de sa forme sacrée, Il correspond alors sans doute à ce discours religieux déployé, chez Rousseau, par le « Législateur », qui, ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement », parvient néanmoins à se faire entendre du peuple « souverain » en recourant « à une autorité d’un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre ».