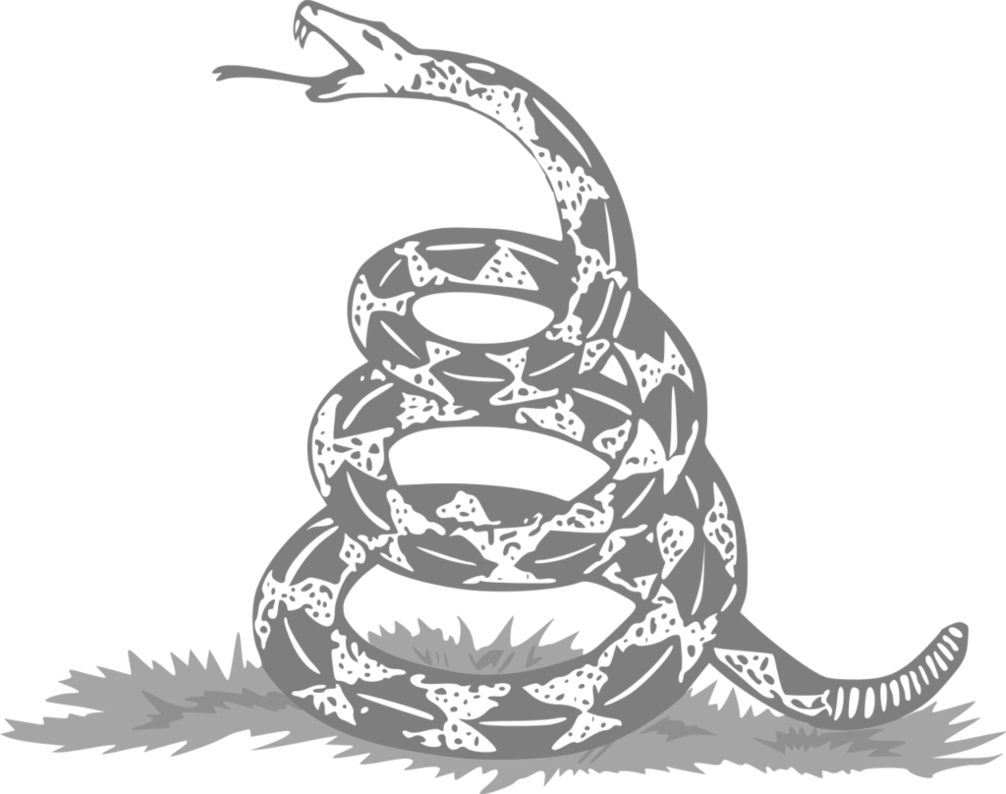Péché et structure de péché
par Christian Michel
Péché et structure de péché : quelques réflexions à propos de l'encyclique Sollicitudo Rei Socialis
Le Mal est dans le monde. Le monde est en désordre et ce désordre nous scandalise. Nous portons tous en nous la vision d'une société douce et harmonieuse et nous rencontrons l'incohérence. Mais ce désordre du monde s'exprime généralement en termes d'économie, de viol des droits de l'homme... Le Pape nous dit : « Non, c'est le péché. On n'a pas l'habitude d'appeler cela péché, mais le péché, c'est ça, c'est la destruction de l'harmonie du monde voulue par Dieu ».
Mais l'ordre du monde voulu par Dieu, nous ne pouvons pas le connaître. Nous pouvons appréhender le concept de perfection, mais nous ne savons pas la décrire, encore moins la réaliser. La première conséquence du péché originel est que nous ne pouvons pas comprendre par la seule puissance de notre esprit humain le plan de Dieu.
Parler de la politique, de l'économie, du développement des peuples, en termes de péché, comme le propose le Pape dans cette encyclique, m'amène à proposer quatre idées :
- 1re idée : S'il y a du péché dans le monde, il est en vous, il est en moi, et il est chez les hommes de pouvoir. Est-ce que tout pouvoir ne sera donc pas nécessairement un jour le pouvoir du péché, le pouvoir du mal?
- 2e idée : Il y du désordre dans le monde, il y a des souffrances, et pour certains de ces désordres, certaines de ces souffrances, nous n'y pouvons rien. Le péché, au contraire, serait de dire : « j'y peux quelque chose ».
- 3e idée : Il existe aussi du désordre et des souffrances que nous pouvons éviter en refusant les structures de péché. Et il y a même le bien que nous pouvons faire. Mais ce n'est pas forcément parce que nous voulons faire le bien que nous le réalisons.
- 4e idée : Le Pape oppose à la notion de structure de péché deux autres notions (c'est au nº 36), ce sont les notions d'interdépendance et de solidarité. Le Pape définit la structure de péché comme le refus de l'interdépendance et l'oubli de la solidarité. D'une part, je ne peux éviter d'aggraver le péché du monde qu'en acceptant l'interdépendance, d'autre part, je ne peux espérer améliorer le monde qu'en pratiquant moi-même la vertu de solidarité ou de charité. « Améliorer » n’est pas la même chose qu’« éviter d’aggraver ».
1.
Pour partir de ce problème du pouvoir, et c'est ma première réflexion à propos de cette encyclique, je dirai que tout pouvoir, même « démocratique », doit être constamment tenu pour suspect. Car si aucun homme n'est exempt du péché, celui que nous élisons n'est pas du fait de son élection miraculeusement lavé du péché. Les pauvres ne sont pas lavés du péché, les experts non plus. Or le mal que peut causer un simple citoyen est limité : un raciste peut insulter quelques hommes d'une autre race, un voleur va cambrioler quelques dizaines de personnes au cours de sa carrière, un assassin performant va commettre une demi douzaine de meurtres. Mais si le péché individuel se constitue en structure de péché, c'est-à-dire en pouvoir politique, cet assassin devient un général, et ce sont des millions d'hommes qu'il envoie à la mort ; ce voleur devient un ministre, et ce sont des millions de citoyens qu'il peut voler ; le raciste va construire légalement des camps.
Cependant si nous pouvons dire que toute structure de pouvoir est potentiellement une structure de péché, ce n'est pas parce que les hommes politiques sont des salauds. Beaucoup sont très honnêtes, ils veulent le bien de leurs administrés. Mais ils ne sont pas omniscients. Et en voulant instaurer par décret l'ordre du monde, comme ils se trompent nécessairement une fois ou l'autre parce que leur nature humaine est imparfaite, ils causent par l'effet multiplicateur du pouvoir qu'ils exercent un désordre encore plus grand. On le constate dans le domaine du développement, qui est celui de cette encyclique. Les mesures que prennent les hommes politiques pour combattre la famine, par exemple, ou lutter contre le chômage, ces mesures contribuent le plus souvent à aggraver la famine et créer du chômage.
Sans doute Dieu sait comment devrait être gouvernée la société juste, ordonnée conformément à Son plan. Mais notre raison humaine limitée est incapable de le savoir. Et nous ne devons donc pas essayer d'utiliser la loi positive, la contrainte, le pouvoir temporel, pour réaliser la société « plus juste ». Ce serait permettre à un homme ou groupe d'hommes, un parti, d'imposer sa propre vision du monde, c'est-à-dire son péché. Et c'est en outre une démission de notre responsabilité d'hommes que de penser que la société juste pourra nous être apportée d'en haut, sans que nous ayons nous-mêmes à nous convertir.
2.
J’illustrerai ma 2e idée par le sujet d'une dissertation qu'avait donnée un jour un professeur de français anticlérical et facétieux: « Vous commenterez, du point de vue du ver de terre, les alexandrins fameux d'Athalie,
- "Aux petits des oiseaux [Dieu] donne la pâture
- "Et Sa bonté s'étend à toute la nature. »
Nous ne pouvons pas espérer, nous les humains, depuis que nous avons été expulsés du paradis terrestre, empêcher totalement le désordre et la violence. Cette constatation ne justifie absolument pas le fatalisme. Mais il s'agit de déterminer quand nous pouvons agir sur le péché, et quand cette action est au-dessus de nos forces humaines, et vouloir agir serait même un péché, ce serait de l'orgueil. S'accuser, comme d'un péché, d'être responsable du sous-développement au Pérou ou au Bangladesh, est une forme subtile d'orgueil, l'orgueil de croire que nous avons ce pouvoir-là. Quelle prétention ! Et n'est-ce pas totalement démoralisant pour les peuples en voie de développement que de leur seriner qu'ils sont incapables de se prendre en main, que leur destin sera toujours décidé en Europe ou à Washington, qu'ils sont à jamais des mineurs incapables ?
Paradoxalement, ces prétendus défenseurs du Tiers Monde tiennent un discours de type colonialiste. Il y a 100 ans, les « civilisateurs » expliquaient aux nations colonisées qu'elles étaient incapables de se gouverner, que les Européens décideraient de leur avenir et que c'était pour leur bien. Aujourd'hui, on entend les faux amis du Tiers Monde tenir le même discours : les ex-nations colonisées seraient toujours incapables de se prendre en charge, ce seraient toujours les Occidentaux qui décideraient de leur avenir, mais cette fois-ci, ce serait pour leur malheur.
On a l'impression que ça rassure certains Européens, devant la montée de ces peuples qui ne partagent pas notre culture, qui sont profondément « autres », de se dire que nous les contrôlons encore. Des « méchants », certes qu'il faut dénoncer, mais au moins des méchants « de chez nous », tireraient les ficelles, manipuleraient la dette internationale et le cours des matières premières... Hélas, la réalité a plus d'imagination que n'importe quel comploteur. Elle déjoue tous les plans humains, même ceux de nous autres, Occidentaux hyper-développés. Nous sommes loin d'avoir ce pouvoir de manipuler que nous imaginent les tiers-mondistes (et si nous causons du mal, ce n'est pas celui dont ils nous accusent). Il faut rester humbles et, pour être efficaces, commençons par déterminer à quel niveau réel se situe notre responsabilité. Et commençons par nous poser la question : d'où viennent la violence et le désordre du monde ?
Car il y a d'abord le désordre qui n'est causé par aucun homme et dont aucun homme n'est coupable : l'ouragan, le tremblement de terre...
Il y a le désordre causé par l'homme et dont il est coupable, par exemple, si j'empoisonne les citernes d'eau de la Ville de Genève, je suis coupable d'une agression dont je dois répondre pénalement.
Et puis, il existe le désordre qui est bien causé par les hommes, mais dont ils ne sont pas coupables. Il découle du fait de vivre dans une société imparfaite, il n'est dû à aucun péché personnel, mais au péché du monde. Je gare ma voiture et juste derrière moi, quelqu'un a raté cette place, qui était peut-être encore plus en retard que moi pour un rendez-vous important. Je ne peux pas le savoir. Je suis source de dysharmonie sans le savoir, du simple fait d'agir dans le monde, et je ne peux pourtant pas renoncer à agir. Et même quand je sais que je dérange, je dois quand même agir. Si j'invente un produit révolutionnaire, qui va supplanter tous les autres produits dans la même application, je suis conscient que cette invention va provoquer des faillites et du chômage chez mes concurrents. Mais ne dois-je pas quand même inventer, car ne pas inventer causerait aussi un dommage à tous les autres gens qui attendent cette invention pour faciliter leur vie ? Ainsi chacune des actions d'un homme a des répercussions sur la vie d'autres hommes et les actions des autres hommes vont avoir des répercussions sur sa vie. Et ça, c'est le point central de l'encyclique, c'est ce que le Pape nomme l'interdépendance. Il développe cette notion d'interdépendance tout au long de l'encyclique, mais voici une citation, elle est au nº 38 :
- « Il s'agit avant tout du fait de l'interdépendance ressentie comme un système nécessaire de relations dans le monde contemporain, avec ses composantes économiques, culturelles, politiques et religieuses, et élevé au rang de catégorie morale. »
Cette interdépendance est « élevée au rang de catégorie morale », et pourtant le Pape sait bien que nous ne sommes pas des êtres parfaits, nos actions ne vont pas nécessairement être bonnes pour autrui, même si nous le voulions toujours. Mais il nous faut quand même accepter cette interdépendance, avec toutes ses conséquences heureuses et malheureuses. Conséquences heureuses : l'amitié, l'amour, le commerce, la culture... Conséquences malheureuses : le chagrin d'amour, l'incertitude économique...
Mais alors comment distinguer entre les conséquences légitimes de l'interdépendance et celles qui ne le sont pas. Car je suis dépendant de la Ville de Genève pour mon approvisionnement en eau, mais je ne vais pas accepter qu'elle soit empoisonnée. C'est pourquoi nous concevons la notion de Droit. Je sais que je n'ai pas le droit d'empoisonner l'eau de la Ville. Si le Pape s'exprimait en termes juridiques, il dirait que l'interdépendance des hommes est signifiée dans le Droit. Le Droit est identique pour tous les êtres humains. Le Droit est ce qui rend les hommes légitimement interdépendants. La structure de péché, au contraire, est ce qui limite l'interdépendance légitime des hommes. Il y a structure de péché chaque fois que les hommes parviennent à se faire accorder un privilège légal, qui fait que leur droit n’est plus identique à celui des autres humains, qui les placent au-dessus du « système nécessaire de relations économiques, culturelles, politiques, religieuses ».
Quelle est la différence entre le maître et l'esclave ? C'est qu'ils n'ont pas le même droit. Ce qui est permis au maître ne l'est pas à l'esclave. Si le maître flanque des coups à l'esclave, que ce soit mérité ou pas, l'esclave se couche. En revanche, si l'esclave bat le maître, avec ou sans raison, il terminera crucifié. La structure de péché est celle qui permet à des hommes, les maîtres, d'échapper à l'égalité devant le Droit, c'est-à-dire à l'interdépendance.
Et le Pape spécifie bien que cet isolationnisme (en langage économique : ce protectionnisme), ce privilège qui ferait que nous ne serions plus dépendants des autres hommes, est une atteinte à la morale. Pour prendre un exemple qui ne peut laisser indifférents vous qui, au BIT, travaillez sur les problèmes d'emploi et de chômage, lorsqu'une loi garantit un emploi à vie à certaines catégories de personnes, comme les fonctionnaires de l'État dans beaucoup de pays, ou confère à certaines autres personnes un monopole avec un statut vis-à-vis de l'emploi, qui est une préoccupation importante aujourd'hui, ces personnes sont protégées par une loi qui ne protège pas tout le monde. Il n'y a plus d'interdépendance. Les différentes décisions que vont prendre les consommateurs et les producteurs dans le domaine économique vont affecter tout le monde, sauf ces personnes que la loi privilégie.
Autre exemple. Les plus pauvres paysans du monde ne peuvent pas vendre leurs produits à nous, qui sommes les consommateurs les plus riches. Ce n'est pas que leurs produits soient de mauvaise qualité, ou trop chers, ou pas adaptés à notre goût. Ils ne peuvent pas vendre parce que la loi leur interdit de vendre (la loi du Marché Commun Agricole, ou du Japon, ou des États-Unis). Il faut bien voir cela. Si les Maliens (ou les Argentins) ne peuvent pas écouler leur viande parce que vous et moi sommes végétariens, ou que nous n'aimons pas la viande malienne, les éleveurs maliens vont rester pauvres. Cela est une conséquence de l'interdépendance des hommes qui veut que nous ne puissions prospérer sur cette Terre qu'en rendant service à quelqu'un. Mais dans la réalité, les éleveurs maliens restent pauvres, non pas parce que leurs produits ne sont pas acceptés, mais parce qu'une loi leur interdit de proposer ces produits.
Et c'est précisément cela la structure de péché. C'est une structure sociale à l'intérieur de laquelle personne ne peut agir pour le bien, même s'il le veut. Car les fonctionnaires du Marché Commun ne sont pas plus « moraux » pour entretenir par des barrières douanières la misère des Maliens ; les consommateurs européens ne sont pas plus « moraux » pour se voir interdire des importations moins chères et peut-être de meilleure qualité ; les agriculteurs européens ne sont pas plus « moraux » non plus pour profiter du produit de cette véritable agression contre les plus pauvres. Donc tout le monde se retrouve prisonnier d'une structure qui, en rompant l'interdépendance, interdit aux gens d'agir selon leurs valeurs.
Je cite souvent cet exemple parce que lorsqu'on évoque une « structure de péché », on voit se dresser l'Afrique du Sud, les dictatures socialistes, Pinochet... Mais nous avons à notre porte, avec le Marché Commun, des situations plus feutrées, mais peccamineuses quand même. Et l'on pourrait ajouter dans la même veine et dans les domaines qui sont les vôtres au BIT, les lois qui restreignent l'immigration, celles qui font obligation de prendre sa retraite à un âge donné, le salaire minimum fixé par la loi, etc.
3.
Et j'en viens à ma 3e idée : j'ai entendu mentionner récemment que l'homme le plus riche du monde était un Américain qui fournissait des frites à McDonald's. Il est donc fabuleusement riche, il gagne peut-être en 5 minutes ce qu'un paysan du Tiers Monde ne gagne pas en une vie. Mais où est la structure de péché ? Cet homme vend des frites. Ceux qui vont consommer chez McDonald's ne peuvent pas lui reprocher de s'enrichir puisque eux-mêmes de leur plein gré ont fait cette fortune. Et ceux qui ne mettent jamais les pieds dans un MacDo ne peuvent rien lui reprocher non plus : ce n'est pas de leur argent qu'il s'est enrichi.
Sans doute le Pape, dans une encyclique consacrée au développement, n'insiste-t-il pas assez sur un point qui est que la richesse est créée. Car il existe des gens aujourd'hui qui n'arrivent toujours pas à comprendre cela et qui s'imaginent que si quelqu'un s'enrichit quelque part, c'est que nécessairement quelqu'un d'autre ailleurs s'appauvrit. Comme si nous étions tous des voleurs ! Or, la richesse est comme le bonheur, la santé, le talent, de beaux enfants... Je peux en avoir sans en priver personne. Je peux être heureux sans pour cela causer le malheur d'autrui, et au contraire : le bonheur est souvent communicatif. Et de même, je peux m'enrichir sans appauvrir quiconque, et la richesse aussi est communicative.
Le péché par conséquent n'est pas dans le fait de s'enrichir dans le cadre de l'interdépendance, c'est-à-dire sur un marché libre, c'est-à-dire encore, conformément au Droit. Le péché peut consister éventuellement dans l'usage que nous faisons de nos richesses. Peut-être que cet Américain qui vend des frites ne trouve pas son épanouissement dans la possession de sa fortune. Cela est une affaire entre sa conscience et lui. Cette affaire ne nous regarde pas.
Cela ne nous regarde pas, et il existe une conception normative de la distribution des richesses que l'on peut éclairer en utilisant les notions de péché et de structure de péché. Si un homme a volé son voisin et que les gendarmes viennent récupérer son butin pour le rendre au légitime propriétaire, on ne dira pas que cet homme est bon et généreux de se séparer de ses biens. Il a volé, il doit restituer. Mais si cet homme a vendu des frites, ou des fils à couper le beurre, au point de s'enrichir fabuleusement, il n'a volé personne. Les gens ont acheté ses produits parce que, parmi tous les produits disponibles, ils étaient ceux qui leur convenaient le mieux. Mais alors si cet homme n'a pas volé, à qui est-il tenu de restituer de l'argent ? Quelle est sa faute, en quoi consiste son péché ? Pourquoi va-t-on vouloir par la contrainte, par l'impôt, faire payer un innocent ?
4.
C'est ici que l'on introduit la notion de solidarité, entendue comme « générosité », et c'est la 4e idée que j'énonçais tout à l'heure.
Le Pape écrit ceci à propos de la solidarité pour l'opposer à l'interdépendance:
- « Quand l'interdépendance est ainsi reconnue [comme système nécessaire de relations dans le monde contemporain], la réponse correspondante, comme attitude morale et sociale et comme vertu, est la solidarité ».
La solidarité entendue ici n'a pas le sens de dépendance automatique, comme on dit des pièces d'un système mécanique qu'elles sont « solidaires » ; la solidarité ici n'est pas la dépendance mutuelle que nous connaissons sur le marché capitaliste et généralement dans les relations de droit, ce n’est pas cette relation-là, puisque le Pape introduit cette notion de solidarité précisément en l'opposant à l'interdépendance. Il s'agit ici de la solidarité comprise comme « attitude morale », comme « vertu » ; c'est la solidarité que nous appelons aussi « générosité » ou « charité ».
Ainsi le Pape marque les deux étapes de la lutte contre le Mal. Si l'interdépendance - le respect du Droit, le marché libre - était universelle, nous aurions dissous les structures de péché et nous aurions réparé les torts que nous aurions nous-mêmes causés. Mais même dans cette situation rêvée, nous n'aurions pas encore réalisé une société harmonieuse. Il existerait encore le mal dont nous ne sommes pas coupables, donc le mal que le Droit ne peut pas nous obliger à réparer, et qui est le mal que nous évoquions tout à l'heure, que subissent les victimes des catastrophes naturelles, des aléas économiques... C'est la vertu de solidarité, la générosité, qui va nous appeler à soulager ces souffrances. Mais comme toute vertu, elle n'est pas imposable. Elle ne saurait être inscrite dans aucune législation.
Et j'en reviens à ce que je proposais en commençant cette intervention. Le Droit ne peut que nous éviter d'aggraver la violence et le Mal dans le monde, le Droit ne peut pas à lui tout seul accomplir le Bien. Si tous, sans exception, nous vivions scrupuleusement selon le Droit, et que nous nous limitions à cela, nous ne causerions aucun mal - mais aucun d'entre nous ne serait vertueux.
Par la loi, par l'exercice du pouvoir, on ne rend pas les gens vertueux, on ne fait éclore aucune solidarité, aucune générosité, puisque l'exercice même du pouvoir nie la solidarité et la générosité. Confier au pouvoir le soin de réaliser la « société solidaire et généreuse » qu'attendent ceux dont la sensibilité est « à gauche », c'est rééditer le péché des Pharisiens, de ceux qui ne croient qu'à la loi (et ne font pas confiance à la vertu, à l'amour).
Péché double : d'une part, l'homme de gouvernement qui oblige ses concitoyens à agir de telle ou telle façon, à aider le Tiers Monde, par exemple, comme il n'est pas omniscient, il ne peut absolument pas savoir si cette action qu'il commande va être pour le Bien. Il est peut-être en train de causer du mal à ceux qu'il entend aider, et pas seulement de causer lui-même du mal, mais de forcer ses concitoyens à en causer aussi, alors même qu'ils voudraient, eux, agir autrement, et que leur décision serait peut-être la bonne. C'est-à-dire que cet homme de gouvernement est en train de constituer une structure de péché. Et d'autre part, même si cet homme de gouvernement a pris la bonne décision — aider le Tiers Monde de la façon qu'il dit — puisqu'il contraint ses concitoyens à le faire, il leur retire la possibilité d'agir par vertu.
Dans ce domaine de l'aide au Tiers Monde comme dans tous les domaines, nous pouvons nous tromper, les ministres comme les autres. Mais si nous nous plaçons sur le terrain de l'éthique, erreur ou pas, pour qu'il y ait mérite, il faut que l'engagement soit le nôtre. Je dois prendre mes responsabilités moi-même, ou au sein d'associations auxquelles j'adhère de plein gré. Personne ne saurait moralement décider à ma place qui je dois aider, ni même si je dois aider.
Pour conclure d'une façon provocante, je reprendrai l'intervention de la personne tout à l'heure qui me disait : « Votre conception du Droit, c'est le Code de la Route ». Absolument. Le Code de la Route ne prescrit pas que je dois faire du bien aux autres. Il signale seulement comment éviter de leur faire du mal. Leur faire du bien, c'est le rôle de la générosité et de l'amour, il n'y a pas de code pour ça. Le Code est une liste d'obstacles : je dois m'arrêter au feu rouge sinon j'encours une punition, et c'est pourquoi les feux rouges nous irritent. Mais être généreux, aimer, ne peut jamais être une punition, ou alors ce n'est plus de l'amour; nous ne pouvons pas être irrités d'être généreux, ou on ne parle plus de générosité. Maintenant si l'on me dit : « Vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela, et on vous en empêchera, même par la force, parce qu'il faut aider les pauvres » ; si l’on décrète : « Vous avez l'ordre de verser aux pauvres tant de pour-cent de ce que vous gagnez », alors ceux qui prétendent parler au nom des pauvres font des pauvres un obstacle — ils ne soulignent pas une obligation morale faisant appel à notre conscience, ils créent une obligation légale, sanctionnée par la police armée. Si aider les pauvres passe par l'impôt et les gendarmes, c'est une punition, ce ne peut plus être de la solidarité, de la générosité ni de l'amour. Et je crois que la société où l'on présente les déshérités comme un obstacle, la solidarité avec les plus démunis comme une punition et une obligation policière, cette société est une société perverse, elle est une structure de péché.
C'est le danger que courent nos sociétés modernes si nous ne reconnaissons pas que les relations sociales ont une dimension morale, et ne constituent pas uniquement des enjeux politiques, des rapports de force, et c'est contre ce danger que le Pape nous met en garde.
(Transcription d’une intervention au cours d'une conférence organisée sous l’égide du Bureau International du Travail, Genève, 24 novembre 1988. Version texte reprise du site Liberalia.)