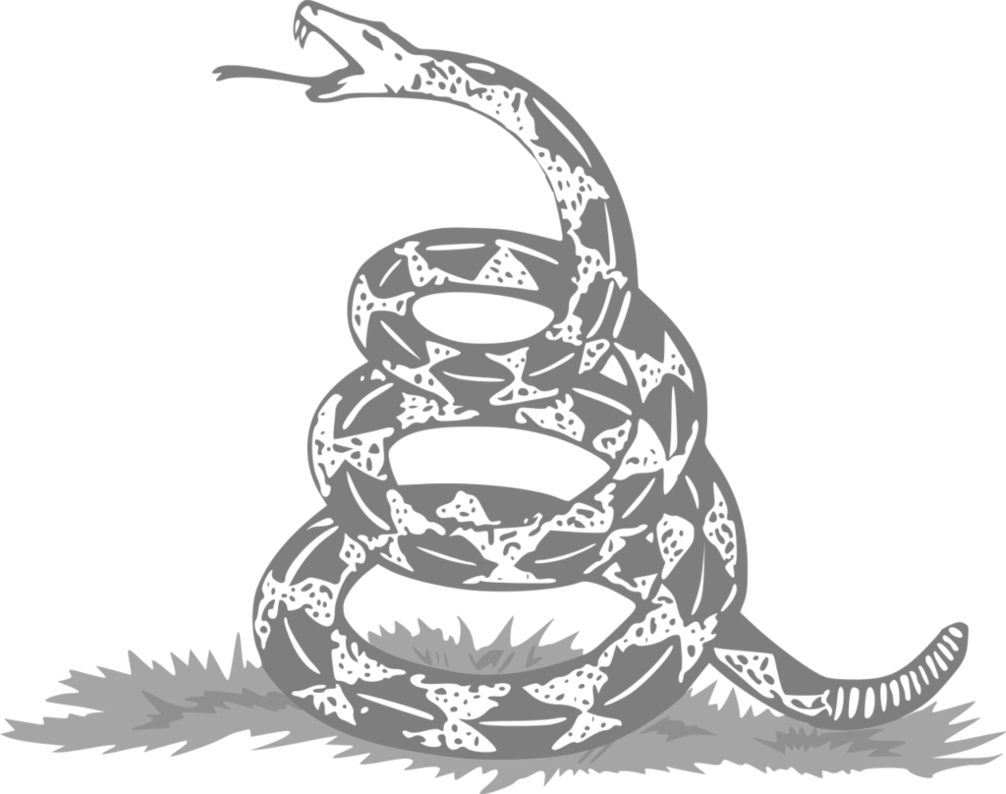Comment prouver que l’on doit rester wertfrei ?
Comment prouver que l’on doit rester wertfrei ?
- Des hommes sans valeurs sont des zombies ou des marionnettes — ou des Nazis
Les démocrates-sociaux — dont un grand nombre, pour ajouter à la confusion générale, se disent « libéraux » — affirment, au moins depuis le XVIIIe siècle2, qu’on ne pourrait pas définir objectivement le Bien ni le Juste, de sorte que la subjectivité serait inévitable en la matière : personnelle pour définir le Bien, et collective pour définir le Juste, puisqu’en politique, il faut bien imposer une norme générale tout en évitant la guerre civile.
J’entends pour ma part poser la question de la cohérence, notamment pratique, de ces subjectivisme et relativisme moraux, et à ce titre démontrer que leurs partisans les contredisent implicitement chaque fois qu’ils tentent de les justifier. En somme, que leur position n’est pas conforme aux exigences de la raison, même dans l’acception limitée que leur irrationalisme partiel admet de reconnaître comme valide.
La contradiction pratique comme moyen de preuve
La contradiction pratique, moyen classique de preuve ?
J’ai récemment découvert pourquoi depuis l’Antiquité les logiciens persistent à associer une certaine nationalité au fameux paradoxe du menteur : c’est donc bien que la contradiction pratique figure parmi les classiques de la philosophie. En revanche, il n’est pas certain qu’elle ait toujours été employée pour éclairer les esprits, comme ce sera le cas ici. Si l’on doit en juger par l’ampleur des découvertes que l’on peut faire en lisant Ayn Rand et Hans-Hermann Hoppe, on peut imaginer que son efficacité et son utilité comme moyen de preuve aient été sous-estimées. Et en explorant la contradiction pratique comme moyen de preuve, on redécouvrira au moins ce que savaient déjà les anciens Hébreux : que toute parole est une action, de même que tout acte implique en même temps des énoncés précis.
La contradiction pratique, donc, part du fait que quiconque agit déclare de ce fait implicitement certaines choses : par exemple, tout acte implique au moins qu’on s’attend à un certain effet, qu’il est bon qu’on agisse ainsi, qu’on en a le droit et même le devoir. Et ces énoncés, on peut les soumettre au test de la cohérence logique pour constater, ou non, qu’ils se contredisent. Si on prend la logique au sérieux, l’énoncé est faux ou l’acte de parler injustifié.
Très important pour la contradiction pratique comme moyen de preuve : parler est un mode de l’agir. Donc quiconque dit une chose en implique en même temps d’autres par cet acte de parler. Et si on dit quelque chose que cet acte de parler contredit implicitement, la réfutation est immédiate : toutes les fois que quelqu’un dit une chose, chose que ce même acte de parler contredit implicitement, nous pouvons et devons constater qu’il a réfuté cette chose ou parlé sans justification. Contradiction pratique ou « performative » — et irremplaçable moyen de preuve pour la logique.
Notamment, il y a des contradictions pratiques qui sont inéluctables : des choses qu’on ne peut pas affirmer sans contradiction. Exemple classique : on ne peut pas sans se contredire argumenter contre le principe de non-contradiction. Nous pouvons alors en déduire que la loi fondamentale de la cohérence logique — à savoir qu’une même chose ne peut pas à la fois être et ne pas être — doit être présupposée par toute argumentation. Or, pour reprendre une formulation de Rothbard, si l’on est obligé de se servir d’une proposition au cours de toute tentative pour la réfuter, alors cela érige cette proposition au rang d’axiome.
Qu’il existe des contradictions pratiques automatiques a donc pour conséquence que tout discours rationnel implique en même temps des vérités permanentes : on ne peut pas argumenter sans que l’acte d’argumenter les implique effectivement, et on est donc obligé de les tenir pour vraies comme condition même d’une argumentation rationnelle. Ce sont, pour reprendre les termes du spécialiste Hans-Hermann Hoppe, des énoncés vrais a priori , qui sont définitivement justifiés.
La contradiction pratique, instrument de recherche inattendu ?
Ce test de la contradiction pratique nous permet d’étendre le champ des présupposés logiquement nécessaires bien au-delà de ce à quoi on s’attend conventionnellement. Dans ses écrits, Hans-Hermann Hoppe nous a donné d’autres occasions d’apprécier les produits de la contradiction pratique comme moyen de preuve et notamment des présupposés logiquement nécessaires de l’argumentation rationnelle, par exemple :
Sur la connaissance des faits naturels
- « du monde extérieur, du monde physique, [on peut connaître avec certitude] les faits plutôt abstraits mais universels et «réels » qui sont déjà impliqués par notre connaissance certaine de l’acte d’agir et [des implications] de l’action : à savoir, que ce monde-là doit nécessairement être un monde d’objets singuliers dotés de qualités (de prédicats), d’unités dénombrables, de grandeurs physiques, et de déterminisme quantitatif (la régularité des causes). En l’absence d’objets ou de leurs attributs, il ne peut pas y avoir de propositions ; en l’absence d’objets dénombrables, il ne peut pas y avoir d’arithmétique ; et sans déterminisme quantitatif — le fait que des quantités définies de causes ne peuvent avoir que des effets définis (délimités) — il ne peut pas y avoir ni moyens ni projets (ni biens ni services), c’est-à-dire pas d’intervention active dans le courant des événements extérieurs, afin d’obtenir un résultat auquel on donne plus de valeur (un effet que l’on préfère).»3
Sur la connaissance de l’avenir
- « l’idée d’une incertitude (ou d’une ignorance) “parfaites” est soit ouvertement contradictoire dans la mesure où elle veut dire “tout est incertain de l’avenir sauf qu’il y aura de l’incertitude — et de cela nous sommes certains”, ou alors induit une contradiction implicite en ce que cela veut dire que “tout est certain mais le fait que tout est incertain est lui-même incertain” (du type : “je sais assurément que ceci ou cela est vrai, et [simultanément] je ne sais pas si ce même ceci ou cela [la même chose] est vrai ou faux”). Il n’y a qu’une position intermédiaire entre les deux extrêmes de la “connaissance parfaite” et de l’“ignorance parfaite” qui soit défendable au nom de la cohérence logique : l’incertitude existe, mais cela nous le savons avec certitude. En conséquence de quoi, la certitude existe tout autant, et la limite de la connaissance certaine et incertaine est elle-même certaine (fondée sur une connaissance qui l’est aussi). » 4
- « Le modèle des “anticipations rationnelles” de l’homme comme machine dotée d’une connaissance parfaite des distributions de fréquence relative de toutes les classes d’“actes” éventuels à venir, est condamné par des contradictions internes irrémédiables. L’hypothèse selon laquelle tous les acteurs posséderaient une information identique [implique] une contradiction performative : [énoncer ces mots-là est démenti] par le fait même de les prononcer. Car celui qui parle n’aurait aucun besoin de [le] dire si tous les autres [le] savaient aussi. En fait, si tout le monde savait exactement les mêmes choses que tout le monde, personne n’aurait besoin de communiquer du tout. Le fait que les gens, bel et bien, communiquent, prouve que leurs informations ne sont pas identiques. Les théoriciens des anticipations rationnelles eux-mêmes, en vertu du fait qu’ils présentent leurs idées au public qui lit, doivent naturellement supposer que le public ne sait pas encore ce qu’eux-mêmes savent déjà. »5
Sur les traits généraux de l’action humaine
- « [si quelqu’un] prétend savoir de science certaine que l’information à venir des gens, et par extension logique, leurs actions, ne peuvent pas être connues, c’est que lui-même sait bel et bien quelque chose [et qui n’est pas prêt de changer] de la connaissance et de l’action à venir. Il doit l’admettre dès le départ : il existe quelque chose [d’universel], qu’il peut nous dire, parce qu’il le sait, de la connaissance et de l’action en tant que tels. Ce qu’[on] doit présupposer n’est pas seulement que l’homme pourra changer dans sa conduite ultérieure, mais aussi que ces changements-là seront le fruit d’un processus d’apprentissage, c’est-à-dire qu’ils résulteront du fait que l’homme aura su distinguer entre le succès et l’échec, entre la confirmation et la réfutation, et tirer des conclusions de ces expériences catégoriquement distinctes ; que, par conséquent, tous les changements possibles dans la conduite de l’homme, si imprévisible que puisse être leur contenu particulier, sont soumis à des lois prévisibles : une logique uniforme et constante de l’action et de l’apprentissage humains ».6
Sur la connaissance des énoncés à venir
- « Je peux bel et bien prédire, et en fait prédire avec une certitude parfaite que, aussi longtemps que je parlerai seulement, quelle que soit ma langue, tout ce qu’aurai dit ou écrit aura une structure logique (propositionnelle) constante et invariable : par exemple, qu’il me faudra employer des propositions identifiantes, telles que des noms propres, et des propositions d’assertion pour affirmer ou nier quelque propriété particulière de l’objet identifié ou nommé »7
Voilà donc quelques illustrations des emplois de la contradiction pratique et de sa conséquence, les présupposés nécessaires de l’action et de l’argumentation, pour élucider certains domaines de la pensée. Nous allons pouvoir constater comment la Wertfreiheit se tire de ces tests-là.
Dans quelle mesure la Wertfreiheit passe le test de la cohérence pratique
Le savant peut-il demeurer wertfrei ?
Max Weber, démocrate-social qui se prenait pour un libéral, a systématisé parmi les savants, et notamment dans les sciences sociales, la distinction déjà avancée par David Hume entre les énoncés de fait, qui relèveraient de la science (ceci est vrai, ceci est faux), et les normes ou jugements de valeur (ceci est bien, ceci est mal), qui ne pourraient pas être établies par la connaissance rationnelle et seraient donc livrées à notre subjectivité. En conséquence, le discours rationnel devrait s’en tenir aux simples faits, et renoncer à tout jugement de valeur. Pour lui, une science sociale objective ne peut rien avoir à faire de l’éthique ni de quelque absolu que ce soit, mais doit être relativiste, hypothétique, « neutre par rapport aux valeurs ».
On ne saurait méconnaître l’intérêt pratique que présente cette prescription
Pour commencer, elle est plus prudente : les savants qui partagent l’option subjectiviste, notamment sous l’influence du positivisme qui ne reconnaît de preuve qu’expérimentale, sont aujourd’hui si nombreux qu’on ne saurait sans précaution leur révéler qu’on n’adhère pas nécessairement aux pétitions de principe qui prétendent a priori disqualifier la preuve philosophique8.
Un autre effet bienvenu de cette règle, dans ce même contexte contemporain où le raisonnement normatif n’est pas généralement reconnu comme valide, serait que, si par extraordinaire ses soi-disant adeptes la respectaient effectivement dans les domaines politique et moral, une telle ascèse de leur part épargnerait à ceux qui ont malgré tout appris à raisonner sur les normes l’impression que cette fameuse Wertfreiheit ne leur sert qu’à dispenser de toute rigueur intellectuelle les jugements de valeur qui surabondent dans leurs écrits. Car, comme disait Rothbard :
- « Les partisans de la Wertfreiheit, ayant rejeté la possibilité d’une théorie normative comme discipline particulière de la pensée, se sont mis à introduire en douce des jugements de valeur dans chacune des sciences de l’homme. La mode courante est de conserver une façade de Wertfreiheit, tout en adoptant sans l’avouer des jugements de valeur qui sont présentés, non comme des choix personnels du savant, mais comme un consensus sur les valeurs des autres. Mettre en avant ses propres valeurs est maintenant considéré comme partial et “non objectif” tandis qu’adopter sans examen les slogans d’autres personnes serait le summum de l’“objectivité”. L’objectivité scientifique ne consisterait donc plus à chercher la vérité, où que cela puisse mener, mais à se soumettre aux résultats de sondages d’opinion sur la subjectivité des autres, qui en savent moins que vous. »9
Il faut bien comprendre que les jugements de valeur ne deviennent pas justes ni légitimes, simplement parce qu’il se trouve exister beaucoup de gens qui y croient ; leur popularité n’en fait pas des évidences. L’économie politique est truffée d’exemples de jugements de valeur arbitraires, subrepticement glissés dans les travaux de gens qui ne songeraient jamais à étudier la philosophie morale ni à proposer un système cohérent de normes. La « vertu » égalitariste, comme nous l’avons indiqué, est simplement tenue pour allant de soi, sans aucune tentative de justification ; et on la fonde, non sur une expérience perçue de la réalité ni parce que la nier serait contradictoire — les vrais critères de l’évidence rationnelle — mais en insinuant que celui qui n’est pas d’accord est un minable et un salaud.
- « Même le plus anodin de ces jugements de valeur est complètement illégitime en économie politique. Et il l’est, que l’on croie à la Wertfreiheit ou à la possibilité d’une éthique rationnelle : en effet ces jugements de valeur ad hoc violent les normes des deux écoles. Ils ne sont ni wertfrei ni justifiés par aucune analyse systématique. »10
La Wertfreiheit comme instrument de recherche
Il est aussi certain qu’à juger trop rapidement, étant données les faiblesses de notre nature humaine, on risque de ne pas comprendre. A ce titre, la distinction des faits et des normes, et une discipline consistant à s’en tenir à des énoncés descriptifs, peuvent former un principe heuristique fécond, sans lequel bien des découvertes n’auraient pas été faites. Plus encore qu’un tel principe, les lois naturelles strictement déterministes relèvent de la seule méthode expérimentale alors que le raisonnement sur les normes, s’il est possible, ne saurait par construction dépendre de cette procédure, et cela justifie en soi le maintien d’une stricte distinction, du moins dans les sciences de la nature.
La Wertfreiheit ne se confond pas avec les normes de l’argumentation rationnelle
Cependant, que l’on distingue entre la science descriptive et la science normative ne prouve pas que la seconde soit impossible. Par ailleurs, on ne saurait réduire la Wertfreiheit à ces exigences de la logique que sont l’obligation de distinguer ce qui est de ce qui devrait être sous peine de méconnaître le réel, ou celle de ne pas laisser ses préférences influencer ses conclusions. Certes, nombreux sont ceux qui rejettent les enseignements de telle ou telle science sociale, non pas parce qu’ils ont pu prouver qu’elles seraient erronées, mais parce qu’elles leur déplaisent : mais il ne s’agit là que de respecter, ou non, les normes de l’argumentation rationnelle. Et la meilleure illustration du fait que la Wertfreiheit ne se réduit pas à cela est que ces exigences-là, dans la mesure où l’argumentation serait valide pour le raisonnement normatif, s’appliqueraient à ce dernier tout autant qu’à la science descriptive.
Pourra-t-on éviter d’admettre que le savant doit se conformer à certaines normes pour chercher la vérité ?
En outre, ce n’est pas seulement parce qu’elles sont universelles que ces exigences-là sont indépendantes de la Wertfreiheit : c’est aussi parce qu’elles sont rationnellement nécessaires pour rechercher la vérité. Aïe ! Il faudrait donc rechercher la vérité dans les sciences ? Et pour cela, il existerait des normes rationnelles, dont la science, qui plus est, aurait besoin ? Si on ne se retenait pas, on en conclurait non pas qu’il peut mais qu’il doit y avoir des normes objectives pour le savant.
Comment donc prouver que les jugements de valeur ne sont pas des énoncés de fait ?
Les ennuis s’accumulent lorsqu’on vous fait remarquer qu’il est toujours possible de traduire l’énoncé « ceci est bien, ceci est mal », par : « il est vrai que ceci est bien, ou que ceci est mal ». Même les impératifs, comme « il faut » ou « tu dois » faire ceci ou cela, peuvent être précédés de la même formule fatidique sans violer les règles ni de la langue ni de la logique formelle. Ah ! Comment maintenir malgré cela que les jugements de valeur et les impératifs ne sont pas, eux aussi, des énoncés de fait, même d’un type particulier ?
On se raccrochera heureusement à cette évidence nécessaire que les jugements de valeur dépendent des goûts et que les goûts sont bel et bien subjectifs. De gustibus non disputandum et on a donc prouvé, en dernière analyse et fondamentalement, que les jugements de valeur sont subjectifs. Ouf ! Mais voilà qu’un mauvais plaisantin vous fait remarquer qu’un goût est une donnée de fait. Et les données de fait, on les constate plutôt parce que ce sont des faits. Or, justement, les jugements de valeur ne font rien d’autre non plus que cela. Car ils ne se bornent pas à transcrire automatiquement les goûts : ils sont le produit d’une conscience conceptuelle qui tient seulement compte de leur existence ; mais on a déjà vu des gens agir contre certains de leurs goûts. Qu’un goût existe ou non n’est rien d’autre qu’un fait, que l’on peut prouver ou réfuter : si je sais que j’aime le chocolat, ce goût, aussi bien que la connaissance que j’en ai, sont des faits objectifs, même pas spécialement difficiles à prouver vrais ou faux, et qu’en outre dire « j’aime le chocolat » est un énoncé de fait qui, ne disant rien du bien ni du mal, et pas davantage de ce qu’il faut en faire, n’est même pas un jugement de valeur !
On voudrait bien aussi tenir pour assuré que le jugement de valeur ne peut, logiquement, être confronté à aucune réalité. Mais voilà qu’Ayn Rand arrive avec son obstination à penser, et vous fait remarquer que la conscience est identification : qu’une conscience avec rien dont il y ait à être conscient est une contradiction dans les termes. Appliqué aux affirmations, cela veut dire que pour qu’un énoncé ne soit pas une proposition authentique, il faut qu’il ne se rapporte à rien d’autre qu’à son propre contenu. Sinon, on peut la comparer à cette réalité autre, et de ce fait elle est nécessairement vraie ou fausse. Or, les jugements de valeur et les impératifs ne se rapportent pas à leur seul contenu.
On ne se sent vraiment pas soutenu lorsqu’on découvre que, bien au contraire, les jugements de valeur et les impératifs inspirent souvent des actes et que, pour ce qui est des actes, l’économiste au moins sait qu’ils débouchent nécessairement sur le succès ou sur l’échec. Serait-ce donc que les jugements de valeur sont plus ou moins adaptés au réel ? Ce serait ennuyeux, car la correspondance au réel est le critère de la vérité et qu’il faudrait en déduire qu’ils peuvent bel et bien être plus ou moins vrais ou faux. Ah ! comme il serait plus commode que l’action ne lie pas les jugements de valeur au réel.
Dans ces conditions, comment, et au nom de quoi affirmer qu’ils ne sauraient être ni vrais ni faux ? Et à moins que ce ne soit parce qu’on n’a pas compris ce qu’ils disaient qu’on les a identifiés comme tels, comment prétendre, comme le font tant de philosophes contemporains, qu’« ils ne décrivent rien, qu’ils ne sont que des expressions émotives, du bruit avec la bouche, comme un chien qui aboie », condition nécessaire pour qu’on ne puisse pas les soumettre au moins à un test de cohérence logique ?
Petite concession à la réalité
Face à un tel doute, on pourra proposer la Wertfreiheit, qui vaut ce qu’elle vaut mais qui a l’avantage provisoire de concéder, pour ce qu’il vaut, leur argument aux philosophes contemporains précités. Si l’on ne comprend pas plus un jugement de valeur ou un énoncé impératif qu’on ne comprend l’aboiement d’un chien, on ne le soumettra pas davantage à un test de sa cohérence logique. Si l’on est capable d’aller au-delà, alors il faudra bien admettre qu’il leur soit appliqué, quand bien même on risquerait d’y contracter — horresco referens — la certitude que certains d’entre eux au moins sont faux.
Premières applications du test de la contradiction pratique
Puisqu’une première application du test de la cohérence pratique exige un exemple marquant et qu’à tout seigneur, tout honneur, nous allons l’appliquer derechef à Max Weber et à sa prescription même. Voici comment cela marche : le sujet prône une norme et en même temps il disqualifie tout jugement normatif ; mais si le discours sur les valeurs ne peut pas être rationnel, que vaut l’aune de sa prescription à lui ? Poser la question, c’est y répondre. C’est cela, la contradiction pratique ; et à celle-là, Ayn Rand a même donné un nom poétique : c’est un vol de concepts, car il consiste à se servir d’une notion dont on a par ailleurs nié la validité philosophique, en rejetant ses fondements logiques et factuels.
De cette inconséquence fondamentale de la démarche wébérienne, on pourrait s’amuser à tirer directement, par les moyens de la simple déduction, l’infinité d’énoncés absurdes qu’en principe elle implique. Mais cela ne permettrait pas d’illustrer la contradiction pratique. Nous allons donc en donner un autre exemple pour montrer son intérêt : on voit des économistes tout ce qu’il y a de plus relativiste qui s’indignent de politiques dont les promoteurs ignorent les faits les mieux établis de la science économique. Mais qu’affirment-ils donc là ? Qu’il faudrait les connaître alors qu’ils prétendent qu’aucune norme ne saurait être justifiée ! Est-il donc si important que l’homme de l’État ruine son pays parce que ça lui plaît de le ruiner, ou parce que c’est d’ignorer la science économique qu’il a envie, sachant qu’il pourra forcer les autres à payer les effets de son incompétence ? Le fait est qu’à partir du moment où on s’est interdit par principe de dire ce qu’on doit ou ne doit pas faire, il est difficile de comprendre ce qu’on pourrait reprocher, et pourquoi, à l’analphabète économique au pouvoir, dans le triomphe de ses destructions.
C’est ce que Rothbard faisait déjà remarquer contre Mises dans L’Éthique de la liberté :
- « [...] Une dernière tentative de Mises pour fonder sa position est encore moins heureuse. Il rejette comme “verbiage inspiré par l’émotion” la thèse de l’intervention étatique au nom de l’égalitarisme ou d’autres considérations morales. Il insiste [...] sur l’idée que “celui qui n’approuve pas les conclusions de l’économie politique doit les réfuter au moyen du raisonnement discursif, et non en ayant recours à des normes prétendument éthiques et en fait arbitraires” ».11
- « A mon avis pourtant, cela ne tient pas debout. En effet, Mises doit admettre que personne ne peut évaluer aucune mesure politique à moins de poser un choix normatif ou jugement de valeur ultime. Cela étant admis et comme, en outre, Mises définit comme arbitraire tout jugement de valeur ou norme éthique ultime, comment alors peut-il dénoncer l’arbitraire de ces jugements particuliers ? Il est fort mal placé pour condamner ces choix comme “inspirés par l’émotion” alors que, pour l’utilitariste qu’il est, la raison ne peut déterminer les principes éthiques ultimes, ce qui implique qu’ils relèvent forcément d’émotions subjectives. Que Mises enjoigne à ses critiques de recourir au “raisonnement discursif” ne rime à rien, aussi longtemps que lui-même nie que cette méthode ait une quelconque pertinence pour l’établissement des valeurs normatives ultimes. Il devrait aussi condamner comme “arbitraire” et “émotive” la personne que ses principes normatifs ultimes conduisent à prendre parti en faveur du marché libre alors même que son choix éthique à elle tiendrait dûment compte des lois de la praxéologie. Enfin, nous avons vu plus haut que la majorité de la population poursuit souvent des objectifs différents qu’elle préfère, dans une certaine mesure du moins, à son propre bien-être matériel. »12
La Wertfreiheit rendrait complètement inutile toute science descriptive
Il est vrai que la contradiction pratique n’était pas vraiment nécessaire pour arriver à cette conclusion-là, car on aurait pu prouver d’emblée que la Wertfreiheit prise au sérieux rend toute connaissance factuelle complètement vaine : en effet, si les jugements de valeur ne peuvent vraiment pas être rationnels, alors qu’importe que les énoncés de fait supposés par celui qui agit soient justes ou erronés, ou même qu’il soit honnête ou malhonnête ? Car cela signifie que les actes qu’ils inspirent ne peuvent pas non plus être plus ou moins conformes à une réalité quelconque. Si les jugements de valeur sont irrationnels, cette irrationalité disqualifie l’ensemble de ces jugements de valeur ainsi que des actes qu’ils inspirent, quelles que soient les bribes de raisonnement rationnel employées à l’occasion. En d’autres termes, si le raisonnement normatif ne peut pas être rationnel, la science ne sert en fait à rien.
Mais c’est à la contradiction pratique que nous nous intéressions et en voici donc une autre, que nous présente encore Rothbard :
- « On voit souvent le savant proclamer qu’il n’est qu’un “technicien”, qu’il se borne à indiquer à ses clients — au public — comment atteindre leurs fins. Ce qu’il croit, c’est qu’en agissant ainsi il pourrait indiquer une norme sans vraiment s’impliquer dans un jugement de valeur personnel
- « Le fait est que le savant ne peut jamais échapper à la nécessité de porter des jugements de valeur qui lui soient propres. Un individu qui, en connaissance de cause, conseillerait une bande de délinquants sur la meilleure façon de forcer un coffre prendrait implicitement à son compte cet objectif : ouvrir le coffre. Il est un instrument du délit. Un économiste qui conseille le public sur la meilleure manière de tendre à l’égalité des revenus assume pour lui-même l’objectif égalitariste. L’économiste qui cherche à indiquer au Système de la Réserve Fédérale comment manipuler l’économie de la “meilleure” manière possible accepte par là l’existence du système et son objectif de “stabilisation”. Un sociologue qui conseille un “service public” dans l’affectation de son personnel pour le rendre plus efficace (ou moins inefficace) approuve par là l’existence et les objectifs du monopole d’État. Pour en être convaincus, demandons-nous donc quel devrait être le juste choix d’un économiste hostile à l’existence du Système de Réserve Fédérale ou celui du sociologue qui rêve de voir liquider le monopole en question. Ne trahirait-il pas ses principes s’il contribuait à l’efficacité de ce à quoi il s’oppose ? Son devoir n’est-il pas plutôt, soit de lui refuser ses conseils, soit peut-être d’essayer de nuire à son efficacité, dans l’esprit de cette fameuse remarque d’un industriel américain (sur la corruption des hommes de l’État) : “Dieu merci, nous n’avons pas autant d’État que nous payons pour avoir !” ? »13
Mais le plus beau est quand même que des adeptes de la Wertfreiheit puissent exiger du savant, conformément à la nature de son état mais contrairement à cette « neutralité » même, qu’il prenne les moyens de dire la vérité et notamment qu’il soit honnête et respecte les règles de la logique. Cette fois-ci, le refus de l’engagement normatif — si on le prenait au sérieux — ne rendrait pas seulement la science inutile : il la tuerait, purement et simplement. Nous allons voir cela plus avant.
Présupposés plus ou moins reconnus de la démarche scientifique
Les présupposés de fait de la science
Dans la science expérimentale, comme le disait Hoppe :
- « s’il essaie de produire un phénomène naturel, personne n’aime mieux se trouver des excuses automatiques pour échouer, plutôt que d’y parvenir effectivement. Car c’est lui seul qui devrait payer le prix de cette obstination.14 »
Par conséquent, je risque peu à citer d’emblée les conclusions de Paul Lorentzen quant aux présupposés logiquement nécessaires de l’expérience scientifique :
- « la géométrie, la chronométrie et l’hylométrie [la mécanique rationnelle] sont des théories a priori qui rendent “possible” la mesure empirique de l’espace, du temps et de la matière. Elles doivent être établies avant que la physique, dans le sens moderne d’une connaissance empirique, avec ses champs de forces hypothétiques, puisse commencer. C’est pourquoi je souhaite ranger ces disciplines sous le nom commun de “protophysique”. Les propositions vraies de la protophysique sont celles qui peuvent être fondées par la logique, l’arithmétique et l’analyse, les définitions et les normes idéales qui rendent la mesure possible.15 »
Les normes implicites et néanmoins nécessaires de la science
Cependant, Hoppe a bien raison de nous rappeler qu’en revanche,
- « dans le domaine des sciences morales, où l’on peut imposer aux autres les conséquences de ses décisions, la possibilité d’immuniser ses hypothèses contre toute réfutation offre des occasions bienvenues pour les gens au pouvoir »15b
Ce n’est donc pas sans risque de déplaire à beaucoup de penseurs contemporains que je vais rappeler les normes implicites de toute science.
Tout d’abord, comme nous venons de le voir, la recherche de la vérité. Et elle n’est pas seulement une nécessité inhérente à la science, directement déduite de sa définition comme connaissance correcte, c’est aussi, grâce à la notion de contradiction pratique, une norme humaine axiomatique : quiconque (et pas seulement un savant) affirme quelque chose, prétend implicitement avoir pris les moyens de dire la vérité. S’il ne le fait pas, que ce soit d’ignorance qu’il est coupable — n’ayant pas pris les moyens de connaître la vérité — ou de mensonge, c’est un nouvel exemple de contradiction pratique, qui le disqualifie16.
Prendre les moyens de dire la vérité implique aussi un autre choix : celui de reconnaître l’obligation de cohérence logique ; la règle de non-contradiction, sans laquelle non seulement aucun raisonnement mais encore — il faut le rappeler — aucune expérience n’est possible, et qui est elle aussi une règle morale axiomatique. La logique, comme on l’a vu, fait partie de ces présupposés nécessaires de l’argumentation, de ces vérités a priori, que personne ne pourrait tenter de réfuter sans les employer implicitement, c’est-à-dire sans les supposer vraies.
Cependant, on va voir que c’est le principe auquel les gens refusent le plus de se soumettre en matière politique. En fait, c’est même le tabou majeur de la démocratie sociale contemporaine, la marque d’infamie de l’« extrémiste », c’est-à-dire le motif principal de ses proscriptions. Qu’on ne soit donc pas surpris que j’ai enfoncé cette porte ouverte-là sur la fin, pour souligner son importance.
La norme politique vraie a priori
Implication inattendue de l’éthique scientifique
Jusqu’à présent, nous étions encore en terrain connu. Mais, voilà : il se trouve aussi que ces règles mêmes de l’argumentation rationnelle incluent l’essentiel d'une définition rationnelle et irréfutable de la justice. Et que parmi les présupposés logiquement nécessaires de toute discussion rationnelle figure une théorie politique déterminée.
En effet, l’obligation implicite de servir la vérité n’exige pas seulement de la connaître : dans la société des hommes, elle exige aussi de discuter ceux avec qui l’on discute. L’argument du gros bâton, qu’emploient aujourd’hui les hommes de l’État pour imposer — directement par la censure et indirectement par l’impôt-subvention — leurs vérités officielles, est depuis les Grecs identifié pour ce qu’il vaut. Cela veut dire que, parmi les moyens de connaître la vérité logiquement impliqués par toute argumentation figure le principe de non-agression : en somme, que le principe de non-agression ne pourra jamais être réfuté.
Le principe de non-agression est le même que celui de la propriété naturelle et s’énonce ainsi (c’est un rappel) :
« On a le droit de faire ce qu’on veut de ce qu’on n’a pas volé, c’est-à-dire pris à un autre contre son gré ».
Appliqué aux choses, le principe de la propriété naturelle est le droit du premier utilisateur : on peut faire ce qu’on veut de ce qui n’est à personne, mais rien de ce qui est à autrui — à moins qu’il n’y consente. Considéré du point de vue de la production, ce principe établit le droit du producteur : celui qui a produit la valeur a le droit de disposer de la production.
Appliqué au corps, c’est le principe de la propriété de soi : en tant que premier utilisateur — et pour cause — de son corps, on en est le propriétaire légitime et nous pouvons trouver là une autre version de la démonstration : quiconque entreprend de réfuter la propriété de soi agit lui-même sur son propre corps comme s’il en était propriétaire. Cet acte même affirme implicitement le contraire de ce qu’il prétend affirmer, contradiction pratique (et vol de concept) qui suffit à le réfuter.
On pourra donc établir à la suite de Hoppe que quiconque prend part à une argumentation rationnelle, en s’abstenant d’agresser et de menacer quiconque, traite son propre corps et celui d’autrui (mais comme on vient de le voir, pour qui respecte l’universalité du droit ce dernier point n’est même pas logiquement nécessaire) comme si chacun en était le propriétaire. Qu’il soit impossible d’argumenter rationnellement sans le faire établit le principe de la propriété naturelle comme vérité axiomatique ou a priori.
Parmi les présupposés logiques de tout discours rationnel figure donc bien le principe politique de non-agression, c’est-à-dire la définition traditionnelle et universelle de la justice : non seulement comme conséquence directe du fait que l’argument du gros bâton n’est pas recevable comme moyen de l’argumentation mais plus immédiatement et universellement encore, parce qu’ouvrir la bouche pour argumenter implique en soi l’équivalent de ce principe.
Par conséquent, Max Weber était encore plus dans l’erreur qu’on ne pouvait l’imaginer habituellement : la science ne peut se passer de valeurs non seulement pour exister, mais aussi pour avoir un sens. Et parmi ces normes mêmes figure un parti pris politique déterminé, unique et absolu, celui de la propriété naturelle.
Les implications rarement admises du principe de non-agression
C’est là que nous allons voir à quel point la règle de cohérence logique, elle aussi axiomatique, a de l’importance. Car ce que nous avons prouvé, c’est qu’aucune argumentation rationnelle ne peut jamais contredire la propriété naturelle : cela veut dire qu’aucune violation ce principe ne peut jamais être justifiée.
Hans-Hermann Hoppe, répondant aux critiques de cette démonstration qui est la sienne17, a démontré sa portée universelle :
- « Il faut considérer comme la défaite la plus absolue pour une proposition normative que l’on puisse démontrer que son contenu est logiquement incompatible avec l’affirmation de son auteur que sa validité pourrait être constatée au moyen d’une argumentation. Démontrer une telle incompatibilité équivaut à une démonstration d’impossibilité ; et une telle démonstration est absolue dans le domaine de la recherche intellectuelle.18 »
En somme, le principe de la propriété naturelle est un principe : si on l’a reconnu à une occasion, on ne peut pas le méconnaître à une autre sans contradiction.
Notamment, on ne peut pas prétendre limiter le domaine des choses qui peuvent faire l’objet de l’appropriation naturelle. Car prétendre empêcher un autre de disposer d’une ressource, c’est s’en dire soi-même propriétaire : celui qui proposerait une telle restriction aurait par là l’inconséquence d’étendre ses propres prétentions à l’appropriation au-delà des ressources qu’il considérait avoir justement appropriées.
En outre, pour justifier cette extension, il lui faudrait invoquer un principe d’acquisition de la propriété incompatible avec le principe d’appropriation des biens sans maître qu’il aurait déjà admis comme justifié.
On aurait pu imaginer qu’il existât un principe supérieur de justice, qui soit compatible avec la propriété naturelle tout en la limitant, comme elle-même par exemple justifie et borne à la fois la liberté des échanges19. Mais ce qu’on vient justement de prouver, c’est que la propriété naturelle est le seul principe de justice qui puisse jamais être justifié : elle est elle-même la justice, universellement applicable et exclusive de tout autre, et donc pas plus la « justice sociale » des socialistes que leurs « droits sociaux », qui nient et qui violent la justice, ne peuvent être rationnellement défendus.
Il faut rappeler notamment que la notion de « droits sociaux » — l’idée suivant laquelle on pourrait avoir des droits opposables à la propriété naturelle d’autrui — n’est pas seulement incompatible avec la propriété naturelle ; elle implique en fait un principe moral opposé : la propriété naturelle implique que c’est parce qu’on a produit que l’on a des droits. Or, la seule conséquence pratique des prétendus « droits à » serait que les hommes de l’État dépouillent les producteurs au profit (du moins ostensible) des pauvres : cela veut dire que c’est parce qu’on n’a pas produit qu’on aurait des droits.
Il est vrai que les socialistes continuent à défendre de telles normes, mais cela ne change rien à la démonstration. Que deux et deux font quatre n’empêche personne de dire que cela fait trois ou cinq, ni même d’essayer de faire de « deux et deux font cinq » le principe de l’arithmétique nationale. Cependant, deux et deux font toujours quatre. De manière strictement analogue, Hoppe prétend « seulement » que toute argumentation en faveur du socialisme est nécessairement absurde, et que comprendre cela est à la portée de tout homme compétent et honnête.
De même, que l’on puisse observer que la justice n’est pas respectée et que le socialisme règne malgré tout n’a absolument aucune prise sur le fait que la non-agression est la seule norme politique rationnellement défendable. Qu’est-ce que ça y change qu’il y ait des monopoles, de la censure et des impôts ? Nous avons une démonstration d’impossibilité, de nature logique, comme les démonstrations mathématiques : sa validité peut être établie indépendamment de toute expérience contingente. Elle a prétendu démontrer qu’il est impossible, par des propositions, de justifier des institutions socialistes sans tomber dans des contradictions, notamment pratiques.
Et tout comme la validité d’une démonstration mathématique n’est pas confinée à l’instant où on l’énonce, celle de la propriété naturelle n’est pas limitée aux situations où quelqu’un argumente. S’il est juste, l’argument démontre sa validité universelle, que l’on argumente ou qu’on n’argumente pas : justifier quoi que ce soit nécessite d’argumenter, et ce qu’on doit présupposer avant toute argumentation est justifié pour toujours, c’est-à-dire que le considérer comme vrai est une condition préalable nécessaire pour que tout argument le soit ; et que tout énoncé qui contredirait ces faits est à jamais réfuté comme impliquant une contradiction pratique.
Et elle n’est pas non plus affectée en quoi que ce soit par la question de savoir si les gens la trouvent ou non à leur goût, si elle a ou non leur faveur, s’ils la comprennent ou non, s’ils se mettent ou non d’accord à son sujet et pas davantage s’ils sont ou non en train d’argumenter maintenant. La philosophie politique est la philosophie politique, et la psychologie sociale la psychologie sociale. Comme la plus belle fille du monde, qui ne peut donner que ce qu’elle a, la philosophie politique ne peut pas offrir davantage qu’une preuve de sa définition de la justice, si absolue et définitive soit-elle. Elle n’est pas un antidote contre l’incapacité de penser, la malhonnêteté et la méchanceté : celles-ci pourront toujours continuer à exister et même à l’emporter sur la vérité et la justice.
Contradictions pratiques chez l’homme de l’État socialiste
Une fois qu’on a attiré l’attention sur l’incohérence qu’il y a à respecter un principe de justice — c’est-à-dire de propriété légitime — dans certains cas et non dans d’autres, on se rend compte que les exemples de cette inconséquence-là surabondent.
Par exemple, l’homme de l’État socialiste : quand il accepte de participer à une discussion rationnelle, il vous traite comme si vous étiez son égal et non son esclave, à lui et aux autres hommes de l’État. Il ne vous agresse pas, il ne vous menace pas ; en somme, il se conforme au principe de non-agression : à cette occasion, il vous reconnaît propriétaire de vous-même comme il ne peut pas ne pas le faire pour lui.
En revanche, une fois sorti de cette discussion, il ne se gênera pas, lui et ses complices de l’État, pour vous menacer de violence afin de vous voler. Or, tout en acceptant en votre présence de respecter les règles de la discussion civilisée, il ne pouvait pas méconnaître sa détermination et celle de ses complices à vous faire subir cette violence ultérieure : car c’est ce qu’implique son statut même d’homme de l’État socialiste.
En somme, l’homme de l’État socialiste est un hypocrite ou un incohérent qui souffre d’un dédoublement de la personnalité : honnête dans sa vie de tous les jours, criminel officiellement impuni en tant qu’homme de l’État.
On pourrait d’ailleurs beaucoup commenter cette schizophrénie sociale : nous reconnaissons tous une morale dans nos relations avec les autres, sous peine d’ailleurs de nous retrouver rapidement à l’hôpital ou en prison, or la plupart d’entre nous acceptent que les hommes de l’État agissent de la manière même que notre morale commune et leurs propres lois nous désignent sans conteste comme criminelle.
Cette incohérence ne peut demeurer que là où elle n’est pas trop fortement perçue, ne serait-ce que parce que la libre discussion les gêne de plus en plus. Si seuls les voleurs et les assassins ont intérêt à ce que la définition du vol et de l’assassinat passe pour une affaire de subjectivité, alors la réciproque est vraie : plus les hommes de l’État socialiste volent et tuent, et moins ils peuvent tolérer ceux qui, au nom de définitions objectives, les dénoncent comme autant de voleurs et d’assassins.
D’où la violence politique qui se développe, à l’encontre des règles théoriques de la démocratie sociale même, à l’encontre des « extrémistes », c’est-à-dire des opposants les moins incohérents ou les mieux inspirés. Anthony de Jasay avait prévu tout cela en 1985 dans L’État20 : la seule manière pour la démocratie sociale de surmonter ses inextricables contradictions c’est de se passer de démocratie.
Ainsi les sociaux-démocrates affichent-ils de plus en plus les mœurs des léninistes, et à mesure que le cannibalisme moral socialiste progresse dans notre pays, se développent de plus en plus la malhonnêteté intellectuelle, avec ses manipulations vicieuses, ses faux concepts, faux évêques, faux libéraux, faux démocrates, faux antiracistes, etc., etc.
Les adeptes de la Wertfreiheit dans leurs œuvres politiques
Impuissance du relativiste modéré face à la violence socialiste nationale
On pourra apprécier a contrario l’importance de la norme rationnelle de la propriété naturelle en observant les champions de la Wertfreiheit dans leurs œuvres politiques : l’exemple même de Max Weber sous la république de Weimar, suffit à montrer ce que vaut sa fameuse modération face à des subjectivismes plus dynamiques que le sien.
En 1919, un groupe d’étudiants de Munich, choqués par la violence dans le pays, avaient invité Max Weber. Ils voulaient qu’on les guide, que cet universitaire célèbre, ce grand savant, leur dise quel système politique soutenir, comment juger des valeurs, quel rôle joue la science dans la recherche des valeurs.
« Weber savait ce qu’ils avaient en tête », écrit Frederic Lilge21), « il savait aussi qu’une méfiance générale à l’égard de la pensée rationnelle étaitdéjà répandue, sentiment qui pouvait atteindre des proportions alarmantes, il décida donc d’imprimer dans l’esprit de son jeune public la nécessité d’un esprit sain et pondéré. »
Il ne fallait pas, dit Weber aux étudiants, se laisser prendre par des charlatans irrationalistes qui prétendent offrir des solutions aux problèmes du monde. Le fait, expliqua-t-il, est qu’il n’y a pas de solution. La certitude est inaccessible à l’homme, la connaissance est provisoire, les valeurs sont relatives, les universitaires ne sont que des spécialistes qui font des métiers techniques détachés de la vie réelle, la science n’a rien à dire de la politique et de la morale et (résume Lilge), c’était par conséquent une erreur de la part des étudiants de demander à leurs professeurs une direction et des décisions morales effectives. Tenter une telle réponse ne ferait pas que dépasser le cadre de leur travail de savants ; ce serait aussi une violation du libéralisme que Weber faisait de son mieux pour défendre.
Le libéralisme, à en croire Weber, signifiait la fin de toutes les illusions, y compris l’« illusion » du progrès humain — en même temps qu’une attitude d’endurance,
« endurance pour supporter la destruction de tous les absolus. Il n’y avait que les questions de moyens et non de fins qui tombaient dans le domaine de la science, et les fins devaient être choisies subjectivement, par référence aux sentiments.22 »
Les faux libéraux (et vrais démocrates-sociaux) à la Weber, confondant la conviction absolue avec le fanatisme, croyaient que la condition préalable de la liberté était le scepticisme. D’après eux, pour limiter la violence organisée et inspirer le respect pour la raison, il fallait dire aux bandes que la raison est impuissante et qu’on doit se laisser guider par ses sentiments. Pour ralentir la dérive vers l’État omnipotent, croyaient-ils, on était fondé à le justifier dans son principe, à condition d’ajouter qu’on ne devait surtout se conformer à aucun principe, ce qui aurait été « extrémiste ». Pour discréditer les totalitaires, pour faire taire leurs clameurs bruyantes comme quoi ils avaient, eux, la réponse à la crise de l’Allemagne, ces hommes pensaient qu’on doit dire à un pays au désespoir, sur un ton las et sourd, que les hommes de bon sens n’ont et n’auront jamais aucune idée de ce qu’il faut faire.
En somme, face à la violence socialiste montante, Max Weber, soi-disant « libéral » et vrai démocrate-social, n’avait rien d’autre à opposer que l’absurdité obstinée de son refus de penser les valeurs. La conséquence, on la connaît : l’arrivée au pouvoir du socialisme hitlérien, dont chacun sait qu’il fut beaucoup plus criminel que la démocratie sociale, démocratie sociale dont tous les irrationalistes à la Weber lui avaient préparé le terrain et ouvert la voie.
Interprétation démocrate-sociale du socialisme hitlérien
Peut-on dire que cette leçon-là ait au moins été comprise ? Eh bien, pas du tout : Hannah Arendt, pourtant une des plus soucieuses d’analyser les origines intellectuelles du socialisme national, jugeait après la guerre, en bonne démocrate-sociale, que si Hitler avait commis tous ces crimes ce n’était pas, ce qui est pourtant évident, parce qu’il était socialiste mais — tenez-vous bien — parce qu’il prenait la logique trop au sérieux. Les socialistes nationaux, et les masses qu’ils avaient séduites auraient été influencés par la « tyrannie de la logique », auraient abandonné la liberté de penser au profit de la « camisole de force de la logique ». Ils n’avaient, disait-elle, « pas admis que la cohérence complète n’existe nulle part dans le domaine de la réalité, laquelle foisonne au contraire de phénomènes sans raison apparente23 ».
On peut laisser à Leonard Peikoff, qui rend compte de ces interprétations, le soin de les commenter :
- « Comme la plupart des commentateurs mais de façon encore plus marquée, Hannah Arendt ne se démarque pas du courant intellectuel moderne, acceptant sans aucune critique toutes ses idées fondamentales, y compris la diffamation convenue de la logique. Cela explique pourquoi elle ne voit pas la conclusion que son propre livre rendait pourtant presque inéluctable : que l’essence des théories hitlériennes n’était pas la logique mais la déraison ; que ce qui est sans raison visible n’est pas la réalité mais le socialisme national ; et que la logique n’est pas la tyrannie, mais l’arme qui permet de la combattre.
- « C’est un péché que de se pencher sur l’agonie d’un continent de victimes pour se retrouver à proposer, en guise d’explication, l’équivalent intellectuel d’un remède de bazar, ou pire : se retrouver à recommander, pour tout antidote, un principe essentiel des assassins. C’est un péché et un avertissement. La bataille contre le socialisme national n’est pas encore gagnée.24 »
Pourquoi cet aveuglement ? Arendt était démocrate-sociale, avec pour conséquence qu’elle trouvait « normal » qu’on soit socialiste. Le sien était simplement plus brouillon, c’est-à-dire encore mâtiné d’idées libérales et d’idées démocrates, dont bien sûr un socialisme plus conséquent ne peut jamais s’accommoder. Outre cette « trop grande logique », la différence qui la frappait le plus entre son socialisme à elle et celui de Hitler était bien sûr le racisme du second, d’où l’idée qu’il en constituait l’essence alors que le racisme, bien entendu, ne peut pas être un principe de la politique, tout au plus un de ses critères de discrimination.
Libéralisme contre démocratie sociale
On a l’impression que les subjectivistes à la Max Weber, Hannah Arendt et autres démocrates sociaux qui se croient libéraux, s’efforcent avec zèle de se conformer à la définition de Léon Daudet, pour qui « le libéral est celui qui pense que son adversaire a raison ». Mais cette critique est partiellement mal dirigée. Même si une majorité des gens qui se disent « libéraux » correspondent probablement à cette définition-là, la recherche d’une norme politique rationnelle nous conduit à une conclusion opposée : le seul libéralisme qui soit pensé se définit par la norme absolue de la propriété naturelle, et c’est au contraire de la démocratie sociale que le n’importe quoi subjectiviste et relativiste25 sont caractéristiques, comme on peut le constater à lire les écrits politiques de Karl Popper ou John Rawls.
Notes
1 Leonard Peikoff, The Ominous Parallels, New York, The American Library, 1982, p. 96.
2 Mais ce subjectivisme-là est connu depuis les Sophistes, cf. Xavier Dor, Le Crime contre Dieu, Paris, Perrin et Perrin, 1998, p. 59.
3 « On Certainty and Uncertainty or: How Rational Can Our Expectations Be? », Review of Austrian Economics, Vol. 10, nº 1, automne 1996 (je cite à partir de ma traduction de ce texte, c’est pourquoi il n’y a pas de référence de pages).
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Italiques ajoutés ; belle définition de la théorie économique !
7 et de citer des textes qui ont aussi exploré les présupposés logiques de l’argumentation comme Paul Lorenzen, Normative Logic and Ethics, Mannheim: Bibliographisches Institut, 1969 et Wilhelm Kamlah & Paul Lorenzen, Logische Propedeutik, Mannheim, Bibliographisches Institut, 1968, ch. 1.
8 C’est comme si l’on voulait leur prouver l’existence de Dieu, et pour la même raison : la pétition de principe scientiste nie la preuve philosophique, refusant de considérer comme digne d’expertise savante tout objet qui, par hypothèse, ne serait pas strictement déterminé.
9 Note de Rothbard : « Quand ils [les savants appliqués] se souviennent des serments qu’ils ont faits de respecter l’objectivité, ce qu’ils font, c’est demander à autrui de porter leurs jugements à leur place », Anthony Standen, Science is A Sacred Cow, New York, Dutton, 1958, p. 165.
Murray N. Rothbard, The Mantle of Science [« Les Oripeaux de la Science », Economistes et charlatans, ch. 1 , §6 : « La science et les valeurs ou l’éthique arbitraire »]
10 Ibid.
11 Note de Rothbard : Ludwig von Mises, « Epistemological Relativism in the Sciences of Human Action », in Helmut Schoeck et James W. Wiggins, éd., Relativism and the Study of Man, Princeton, D. van Nostrand, 1961, p. 133.
12 Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty, Atlantic Highlands, Humanities Press, 1982, ch. 26, pp. 205-212 [L’éthique de la liberté, Paris, Les Belles Lettres, 1991, pp. 274-290].
13 Murray N. Rothbard, « La science et les valeurs ou l’éthique arbitraire », loc. cit.
14 Hans-Hermman Hoppe, « Austrian Rationalism in the Age of the Decline of Positivism », The Economics and Ethics of Private Property, ch. 11, Boston/Dordrecht/London, Kluwer, 1993, pp. 209-234. Le rationalisme autrichien à l’ère du déclin du positivisme
15 Paul Lorenzen, Methodisches Denken, Francfort sur le Main, Suhrkamp, 1968, p. 60.
15b « Austrian Rationalism in the Age of the Decline of Positivism », op. cit.
16 C’est d’ailleurs la solution du fameux paradoxe du menteur. Si vous dites : « je suis un menteur », votre message est en fait : « ne me prenez pas au sérieux ». Il n’est ni ambigu ni incertain et il se trouve d’ailleurs qu’il est vrai, puisqu’un menteur n’est pas celui qui dit toujours le contraire de la vérité, car dans ce cas il serait parfaitement fiable, mais celui à qui on ne peut pas faire confiance quand il parle.
17 « Reply to David Osterfeld, “Comment on Hoppe” », Austrian Economics Newsletter, Printemps 1988 ; première publication ibid. Reply to « Symposium on Hoppe’s Argumentation Ethic », Liberty, novembre 1988 ; première publication ibid. Reply to Loren Lomasky, « The Argument From Mere Argument », Liberty, septembre 1989 ; première publication ibid., novembre 1989. « Reply to D. Conway, »’A Theory of Socialism and Capitalism’", Austrian Economics Newsletter, Hiver/printemps 1990. Première publication ibid.
18 Réponse à « Symposium on Hoppe’s Argumentation Ethic », Liberty, novembre 1988 ; première publication ibid.
19 C’est en vain qu’on invoquera les nécessités bien connues des juristes telles que l’obligation de preuve portant sur toute possession, même acquise selon la justice naturelle, ou « que la justice soit forte », c’est-à-dire la nécessité pratique d’organiser la société politique de telle manière que la justice puisse effectivement régner (principe que les hommes de l’État dénaturent sous l’appellation d’« ordre public ».
En effet, ces exigences-là ne contredisent pas la propriété naturelle comme seul principe de justice justifié. Elles ne sont que des exigences de sa mise en œuvre, à laquelle elles sont subordonnées.
Le socialisme, pour sa part, la nie et a entrepris de la détruire.
20 Anthony de Jasay, The State [L’Etat, Paris, Les Belles Lettres, 1993].
21 Frederic Lilge, The Abuse of Learning, New York, MacMillan, 1948, p. 133.
22Ibid., pp. 137-138.
Au contraire, Hoppe a bien élucidé le rôle réel des intuitions en matière normative :
- « C’est la fonction même de la théorie normative que de fournir une justification rationnelle à nos intuitions morales, ou alors de démontrer que cette justification fait défaut et de nous conduire à reconsidérer et à corriger nos réactions intuitives. Cela ne signifie pas que les intuitions n’auraient aucun rôle à jouer dans l’élaboration de la théorie normative. En fait, il se peut parfaitement que des conclusions théoriques contre-intuitives soient l'indice d’une erreur de raisonnement. Mais si après un réexamen théorique, on ne trouve d’erreurs ni dans ses axiomes ni dans ses déductions, alors ce sont nos intuitions qui doivent céder, et non notre théorie. »
Hans-Hermann Hoppe, « From the Economics of Laissez-Faire to the Ethics of Libertarianism », The Economics and Ethics of Private Property, ch. 8 [« De la théorie économique du laissez-faire à la politique du libéralisme »].
23 The Origins of Totalitarianism, New ed., New York, Harcourt, Brace & World, 1966, pp. 351, 457, 470, 471, 473.
24 Leonard Peikoff, The Ominous Parallels, op. cit., pp. 256-257.
25 [N. D. E. : À quoi il faut ajouter sa conséquence dans le domaine législatif, le positivisme juridique par opposition au Droit naturel, arrivé juste au bon moment pour enlever toute entrave à l’État (national-)socialiste. cf. Friedrich Hayek, The Constitution of Liberty, 1960 [1978], p. 239.]
Texte repris de Liberalia et édité pour Liberpédia [N. D. E.]
Voir aussi
- François Guillaumat, « Du doute sur la Wertfreiheit à l’absolu du critère de justice », L’étude des structures industrielles peut-elle être scientifique ?, 1re partie, pp. 196-225.